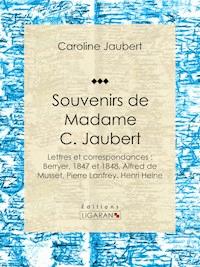
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Pour peindre Berryer, en retraçant sa longue et brillante carrière, il ne suffit pas de l'avoir beaucoup connu : il faudrait encore posséder une plume exercée, habile et éloquente. Je ne puis entreprendre pareille tâche ; mais dans un cadre limité, groupant mes souvenirs, je chercherai à faire connaître l'homme illustre par ce côté intime et vrai, toujours accueilli avec intérêt, quand, par son ressentiment, un nom éveille la curiosité..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335048018
©Ligaran 2015
UN SÉJOUR À AUGERVILLE EN 1840
Le fidèle Richomme. – M. le marquis de Talaru. – M. Roger l’académicien. – Comment Mlle Duchesnois corrigeait Racine. – Le secret de Mme Récamier. – Une marquise originale. – Le chevalier Artaud. – Mme Berryer. – Mme de Rupert. – Un oncle terrible. – Berryer père-noble et la comtesse Rossi. – Un couplet de Dupaty. – Eugène Delacroix. – Lettres de Berryer à la comtesse de T…. – Un mot regrettable de la princesse Belgiojoso. – Amédée Hennequin. – Le cas de Chopin et de Mme Sand. – Le chanteur Géraldy. – Le prince Belgiojoso. – Talent de lecteur de Berryer, – Un mariage sans dénouement.
Pour peindre Berryer, en retraçant sa longue et brillante carrière, il ne suffit pas de l’avoir beaucoup connu : il faudrait encore posséder une plume exercée, habile et éloquente. Je ne puis entreprendre une pareille tâche ; mais dans un cadre limité, groupant mes souvenirs, je chercherai à faire connaître l’homme illustre par ce côté intime et vrai, toujours accueilli avec intérêt, quand, par son retentissement, un nom éveille la curiosité.
Trois semaines passées au château d’Augerville, en 1840, seront propices à ce genre d’étude ; c’est là qu’il fallait voir le grand orateur, goûtant bourgeoisement les joies quotidiennes du propriétaire nouveau, et recevant ses visiteurs avec la distinction et l’aisance d’un seigneur châtelain par droit d’héritage. Ce mélange des temps passés et du présent, cette double face de l’esprit se dessinaient d’une façon tranchée chez Berryer. Ainsi les goûts les plus aristocratiques s’alliaient chez lui aux idées libérales. L’indépendance du caractère se prêtait à une soumission religieuse, absolue. Sa fierté plébéienne était au service de l’autorité monarchique. Le physique même rappelait cette nature complexe : d’une taille moyenne, les épaules larges et la poitrine bombée ; le col fort, comme il appartient à l’organe puissant de l’orateur ; cet ensemble au premier abord nuisait peut-être au caractère de distinction d’une très belle tête. Mais, si Berryer parlait, tout en lui s’ennoblissait. À la tribune, il semblait grandir. L’on demeurait frappé de la puissance que ce geste simple et sobre, cette physionomie fière et mobile, cette voix sonore et vibrante exerçaient autour de l’orateur.
Une fois admis comme hôte, on jouissait au château d’Augerville d’une entière liberté d’action, de parole et même d’omission. Ce dernier point peut être regardé comme la pierre de touche des maîtres de maison. Mme Berryer, dans son rôle un peu effacé, pleine d’indulgence, secondait son mari, ne s’imposant que par d’aimables attentions.
Lorsque des visiteurs attendus venaient à manquer de parole, ainsi qu’il arrive fréquemment quand une vingtaine de lieues vous séparent de Paris, on ne passait pas le temps à les regretter. On ne jouirait que mieux, savait-on, de la compagnie du châtelain. C’est alors qu’il exerçait cet art merveilleux d’éveiller l’intérêt, de piquer la curiosité, de paraître confiant, expansif, sans toutefois rien livrer de son for intérieur. Il généralisait, s’appuyant d’exemples ou de citations que sa riche mémoire lui fournissait. Il entraînait aux confidences sans jamais les faire regretter, par un souvenir inopportun. En gravissant le large escalier du château, qui conduit aux appartements particuliers, posant le regard sur la devise : « Faire sans dire », tracée sur les stores, la réflexion forçait à constater qu’appliquée à ce maître en l’art de la parole, elle était aussi juste que singulière.
Ce caractère secret, et point mystérieux, était une précieuse qualité chez un homme politique ; il possédait encore celle de conserver en toute situation une entière liberté d’esprit ; il n’aimait pas le danger, mais il l’acceptait.
Après avoir promis ma visite à la campagne, pour les premiers jours d’août, je la retardais volontairement. Ce ne fut donc qu’après avoir reçu la lettre suivante, que je me rendis à l’appel.
Chère, bien certainement vous n’avez ni arbres à planter dans Paris, ni chemins à tracer, ni fossés à creuser, ni portes à ouvrir, ni grains à battre, ni étables à clore, ni… Vous faites mieux, beaucoup mieux ; je n’en doute pas ; j’aime mieux vos affaires que les miennes, et d’abord parce qu’elles ne tiennent pas tous les moments captivés ; il y a des heures où votre bureau n’est qu’à deux pieds de vous, et où il ne vous faut que tendre la main pour obéir à cette résolution tombée soudainement dans vos rêveries : – Ah ! il faut que j’écrive à Berryer ! Comment donc n’ai-je pas un mot de vous depuis huit jours bien comptés ? et je vous attends, vous le savez. Tout est en fleur, l’air est parfumé. J’ai fait office de tapissier à faire crier miracle au tapissier de profession, et ces petites joies me plaisent. Me voilà donc impatient de vous voir ici. Jusque-là le piano est muet. Mais aussitôt que les grelots de votre postillon se feront entendre, Mme Berryer lancera les invitations qu’elle tient en réserve, au prince de Belgiojoso et à Just Géraldy. Près de vous, dilettante con amore, je puis m’écrier : – Vivent les gens pour qui tout est musique, mélodie, harmonie ; paroles, ton, couleurs, regards, mouvements, tout leur est chant, et ce chant éveille toutes les pensées. Je suis de ces musiciens-là, qui ne craignent ni brume, ni vent ; et dont la vie se cadence sur un mode toujours divers, mais dans une pensée soutenue à travers peines et joies, orages et clair soleil. Le vent qui souffle en mes voiles me pousse à cette heure vers le couchant, triste route, direction fâcheuse, qui soulèverait l’idée des cinquante ans qui approchent, si je ne me sentais en force de lutter contre et de revenir sur mes pas.
Arrivez donc, arrivez vite, vous qui rendez si belles les heures où l’on vous voit, et dont la pensée charme celles où l’on est loin de vous. Donnez vos ordres.
Je vous baise les mains.
BERRYER.
Le ton, certes, était engageant, pressant ; j’y cédai. Mon hésitation avait tenu à ce que je savais la comtesse de T… seule d’étrangère à Augerville en ce moment. Je ne la fuyais pas, il s’en faut. Dans le monde, nous nous recherchions. Je goûtais son esprit ; le mien ne l’ennuyait pas. Mais enfin si, dans les promenades et les longues soirées, j’allais involontairement jouer un rôle importun ? La comtesse tenait grande place dans l’existence de Berryer. Elle lui plaisait, j’en étais certaine. Sans cesse il allait chez elle. Par quels liens étaient-ils attachés l’un à l’autre ? Comment s’aimaient-ils ?
Dans le monde, s’il existe des liaisons qui échappent aux regards curieux ou malveillants. – chose difficile, – il y a, en revanche, grand nombre d’intimités dont les hommes pourraient avouer avoir eu l’honneur, sans le profit. La beauté, la grâce, l’esprit, le sexe même y jouent leur rôle. L’allure du début est vive, puis mille entraves surviennent, la raison se fait entendre ; peut-être l’expression d’un regret est-elle accordée : rien au-delà. Cependant, des deux côtés, on demeure en coquetterie ouverte ; des rapports dans les goûts font naître une certaine manière d’être animée, particulière et fort piquante.
Ainsi, notre monde civilisé crée entre hommes et femmes mille nuances dans les relations qui constituent, à vrai dire, le charme de la société. Ces nuances étaient mieux senties et mises en valeur, dans le genre de vie pratiqué aux derniers siècles. La première partie du nôtre avait encore conservé la trace de ces soirées régulières où l’on se réunissait pour deviser, sans autre souci que le plaisir de la conversation, auquel chacun contribuait de son mieux. Toutefois, la fréquence, la périodicité de ces réunions servaient et voilaient les inclinations naissantes au moment décisif : l’instant où le fruit se noue, dirait un jardinier.
Berryer, aimant uniquement la société des femmes, se plaisait fort dans un semblable milieu. Donnant de l’esprit, par sa manière d’écouter, à celles qui lui parlaient, il prouvait sans cesse qu’un habile causeur tire de son partner le même parti que le virtuose du plus médiocre instrument. Sensible à tous les charmes, il se trouvait singulièrement exposé à ces amours fractionnés qui le rendaient plein de séduction quand il était stimulé, quand il subissait l’entraînement causé par la présence de la personne aimée.
Sa femme parlait plaisamment de ces règnes éphémères et mettait une certaine vanité à prétendre n’être jamais prise pour dupe, à connaître, avec plus de précision que l’époux lui-même, ses bonnes fortunes et l’état de son cœur.
Je résolus, en arrivant à la campagne, d’avouer à Mme Berryer, en répondant à d’affectueux reproches, le motif de mon retard : l’appréhension de me trouver parfois de trop ; aussi, lorsqu’elle m’eut accompagnée dans mon appartement, accoutumé, la chambre du Prince, ainsi désignée parce que, du temps de la Fronde, le prince de Condé y avait pris abri une nuit, je m’excusai près d’elle en disant que l’idée de jouer le rôle importun de tiers m’était odieuse.
« Je vous ai vingt fois répété, s’écria d’un ton impatient la châtelaine, que le monde était dans l’erreur, à l’égard de rattachement qui existe entre Berryer et Mme de T…, C’est un pur platonisme, assaisonné de coquetterie. »
Et comme je prenais une physionomie dubitative, en ajoutant : « Mais elle est veuve maintenant ; ne faut-il pas tenir compte de cette liberté nouvelle ? »
Il me fut répliqué :
« Chère Elma, nous en parlerons dans quelques jours. Des visiteurs sont attendus, et d’ici-là, vous ne serez en tiers que si vous le voulez bien. Comme toujours, notre Richomme est à vos ordres. Il me remplacera quand vous le demanderez, très flatté de l’honneur que vous lui ferez. Quant à moi, mon amie, vous savez que ma paresse s’oppose aux promenades, ainsi que ma santé aux veillées du soir ; il faudra m’excuser.
L’intérieur de Berryer paraîtrait incomplet si l’on n’y retrouvait la figure de son fidèle Richomme, qui avait débuté dans la même étude d’avoué que lui, tous deux clercs et compagnons de plaisir. Celui qui avait illustré son nom vint en aide, plus tard, au camarade demeuré obscur et sans fortune.
Une déraison pleine de comique des lueurs de bon sens et de sensibilité, une gaieté inaltérable avec un grain de malice, tel était l’hôte admis au foyer de Berryer, sans que jamais il pût sentir que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit.
Le lendemain même de l’arrivée, nous suivions en promenade le cours de l’Essonne, jolie rivière qui traverse le parc d’Augerville dans toute sa longueur ; nous admirions les beaux peupliers dont ses eaux baignent les pieds, et que le propriétaire entourait amoureusement de ses bras pour constater leur développement, quand Richomme, pris d’un subit enthousiasma, s’écria :
« Que dira-t-on un jour, quand Berryer ne sera plus, et que je raconterai aux promeneurs que je suis venu là, à cette place même, avec le grand orateur ? On me questionnera ! Avait-il foi, croyait-il vraiment au retour de notre Henri ?…
– Assez, Richomme, assez !
– Assez, dis-tu ? Alors, je leur répondrai : – Notre chef politique ne traitait jamais de légitimisme en plein vent ! Une fois au grand air, il ne s’occupait plus que de ses peupliers, ou des femmes si elles étaient jolies !
– Archifou que tu es, interrompit le châtelain, qui ne pouvait ainsi que nous s’empêcher de rire, faut-il encore te rappeler que tu es mon aîné, ce que tu oublies sans cesse ?
– C’est vrai, pardonne-moi. Je me complais dans une petite débauche d’imagination ; ma vanité s’épanouit dans l’avenir.
– Et ton cœur, mauvais ami ?
– Ah ! mon cœur ? Il a son tour ; il ne peut fournir deux sentiments à la fois.
– Allons, allons, il faut que tu me prouves ton attachement au dîner ; nous demanderons du champagne, et tu boiras à ma longue vie.
– Bravo ! Je promets de boire ferme ! »
Berryer, pour son compte, ne se livrait jamais à ce genre d’excitation ; mais il souffrait avec une douce indulgence le plaisir très vif que trouvait parfois Rikomski dans une demi-ivresse.
Ce nom de Rikomski, avec lettres de noblesse polonaise, avait été octroyé par Mme Berryer, et avait survécu à la plaisanterie qui lui avait donné naissance. Le physique du personnage rendait comique toute prétention. Petit, trapu, chauve, nez vulgaire, bouche de satyre, teint vineux, petits yeux gris, fins et caressants, tel était le physique du personnage. J’ajouterais qu’il rappelait singulièrement. Étienne Béquet, des Débats, si je ne me souvenais, à propos de cette comparaison, de M. le vicomte de Chateaubriand, qui, dans un de ses ouvrages, parlant des ruines de Ninive, et cherchant à en donner une juste idée, nous invite à les comparer avec celles de Babylone !
En me rendant à Augerville, c’est à tort que j’avais redouté que le cercle ne fût restreint. À peine y étais-je qu’un groupe de légitimistes se présentait. Le plus important d’entre eux était le marquis de Talaru. Ancien ambassadeur, considérable par sa naissance et sa fortune, d’un très noble caractère, dans les conciliabules du parti ultra, il se plaçait toujours, ainsi que le duc de Fitz-James, le comte de la Ferronnays et le baron de Vitrolles, du côté de Berryer ; appuyant ses avis, et reconnaissant son autorité, sans cesse contestée par des hommes incapables, bouffis d’orgueil, qui voulaient, se haussant sur leurs généalogies, écarter ce simple avocat, qu’ils ne pouvaient admettre comme chef du parti royaliste. Quelle force leur apportait-il ? Rien, que son talent ! Ils abreuvaient de dégoûts l’illustre député. Sa femme, dans la répugnance que lui causaient ces réunions politiques, n’avait que trop raison. Elle s’irritait à l’idée que l’on discutait mesquinement, ce jour-là même, les moyens de conserver à son mari les droits à la députation, après l’avoir arraché au barreau, source honorable et certaine de fortune. Cette fierté était bien placée, et les vrais amis de Berryer souhaitaient de lui voir suivre la ligne de conduite que lui indiquait sa femme. Ce retour au Palais de Justice, elle l’obtint plusieurs fois, aussitôt les clients d’accourir. Tant de plaideurs réclamaient ce puissant talent ! Mais, comme l’amertume de l’absinthe, les amertumes de la politique sont, paraît-il, attractives et enivrantes ; on n’y saurait renoncer.
Ce fut la cloche du dîner qui mit fin au conciliabule légitimiste ; et la bonne grâce avec laquelle le maître de la maison fit les honneurs de sa table ne gardait aucune trace des ennuis de la séance.
Il était entendu que, de retour au salon, on ne s’occupait plus de la politique. Parmi les nouveaux venus, M. Roger, l’académicien, ne pouvait que gagner à cette règle. Il avait une façon nasale d’émettre ses arguments légitimistes un peu vieillots, qui agaçait singulièrement son ami Berryer, tandis que d’anciens succès littéraires à la Comédie-Française étaient une source intarissable de conversations intéressantes et d’anecdotes piquantes. C’était un homme bon et serviable. La maîtresse de la maison, cherchant à lui être agréable, fit tomber la conversation sur Mlle Rachel, dont on s’occupait alors beaucoup. On vantait l’intelligence supérieure avec laquelle ses rôles étaient conçus.
À l’encontre des enthousiastes, en tête desquels se plaçait le châtelain, notre académicien soutint aussitôt qu’un grand talent pouvait se rencontrer avec une intelligence très limitée. On se récria : il appuya son dire d’un exemple. Mlle Duchênois, la grande tragédienne qu’a quitté le théâtre en 1830, et n’est pas encore remplacée dans le rôle de Phèdre, était d’une laideur affligeante, avait un hoquet dramatique insupportable ; pas d’instruction, et une intelligence bornée. Elle dominait cependant, empoignait son public !
« Quel était donc son secret ? demanda Mme Berryer.
– La passion ! madame, la passion ! Elle la ressentait et la communiquait à son auditoire. Au sujet de ce rôle de Phèdre, j’ai eu avec elle des discussions incroyables ! Au moment où elle adresse à Hippolyte les vers suivants :
sans y manquer, elle estropiait sottement le second vers, déclamant ainsi :
Cela me rendait furieux. J’allai la trouver dans sa loge : « Vous voulez donc corriger Racine, criai-je ? Dites un fil, mademoiselle, un fil, vous entendez ? » Et je mettais le livre ouvert sous ses yeux. Elle répondait alors du plus grand sang-froid :
« Comment prétendez-vous qu’un fil me rassure ? Non, monsieur, à la bonne heure, un fils ! »
« En scène, le soir suivant elle refaisait la même faute, et le public, hélas ! ne s’en apercevait pas ! »
L’anecdote eut du succès. M. de Talaru parla ensuite de la tragédie échouée du vicomte de Chateaubriand, chute si plaisamment contée depuis, dans les Mémoires d’outre-tombe. On lisait alors des fragments de l’œuvre destinée à la race future, chez Mme Récamier, aux élus de l’Abbaye-aux-Bois. Ceux-ci en parlaient avec enthousiasme, ajoutant à la satisfaction avouée, celle secrètement ressentie d’exciter l’envie de ceux qui étaient demeurés à la porte du sanctuaire. Le marquis de Talaru s’enquérait avec curiosité du jugement qui serait porté plus tard sur cette publication.
Berryer exprima l’opinion que l’exactitude y ferait défaut. Allant du connu à l’inconnu, il redoutait la prédominance, dans le récit des faits, de l’imagination sur la réalité, et à l’appui, il cita ceci :
« En 1833, lorsque toutes les passions étaient éveillées par l’arrestation et l’emprisonnement de Mme la duchesse de Berry, la naissance de l’enfant, toutes les circonstances politiques et romanesques résultant, de cette situation, le vicomte de Chateaubriand fut désigné, concurremment avec moi, comme défenseur de la princesse. Ma plaidoirie eut un tel succès, que M. le vicomte refusa net de prendre la parole, disant, avec une vive émotion, qu’il ne voyait pas un mot à y ajouter. Mais dans ses Mémoires, je sais pertinemment qu’il raconte, au contraire, qu’après avoir entendu son plaidoyer à lui, le jury vota sans hésiter. Or, j’ai précisément une lettre, continua Berryer riant, qui rétablit le fait dans sa véracité, et je pourrai bien lui jouer le tour de la publier quelque part.
– Faites-le, répliqua avec vivacité la jolie veuve, et puisque nous nous permettons de pénétrer dans le sanctuaire de l’Abbaye-aux-Bois, parlons un peu de Mme Récamier. Donnez-moi la clef du charme inextinguible qu’elle exerce sur ses fidèles. Je me sers de cette qualification, parce que son culte ressemble à une religion. On y rencontre une sorte de fanatisme et beaucoup d’intolérance. Fait-elle des miracles ? A-t-elle prodigieusement d’esprit ? Cette beauté de la dernière heure a cessé d’être incomparable ; en grâce, d’où vient cette influence ?
– Faut-il vous révéler son secret ? » demanda d’un ton sérieux Berryer.
Un oui unanime éclata.
« Eh bien ! elle sait écouter.
– Il paraît, repris-je, que le moyen n’est pas irrésistible. J’ai remarqué, à votre honneur, que vous n’avez jamais figuré parmi les englués de l’Abbaye.
– Non ; et c’est pour cela que j’ai pu distinguer le procédé. Que de nuances, de degrés dans la pratique ! Quelle habileté ! C’est une merveille à étudier que cet art de plaire. La femme s’efface, et l’on sent toujours sa présence.
– Que de questions, s’écria la comtesse, on voudrait adresser à qui a connu Mme Récamier dans sa fleur de beauté ; mieux que cela, sur ce passé, il faudrait diriger une enquête, connaître par quelle sorcellerie elle a pu enguirlander les prétendants avec des refus. Ne laissera-t-elle donc pas quelque ouvrage instructif à ses héritières ?
– L’ouvrage serait puéril. Il me semble, mesdames, que vous n’avez rien à apprendre de son expérience, répliqua Berryer.
– Ce que je sais, moi, fit Rikomski, affectant une voix timide, en sortant d’un angle obscur du salon, c’est que je n’ai jamais voulu mettre les pieds à l’Abbaye-aux-Bois. Fi donc ! moi, homme, figurer dans cette réunion de refusés ! »
Cette bouffonnerie parut goûtée par le marquis de Talaru, qui, gaiement, déclara qu’il se ralliait tout à fait au sentiment de M. de Richomme. Puis se levant, il baisa la main à la maîtresse de la maison, nous souhaita un aimable bonsoir, et se hâta, voulant le soir même coucher chez lui au château de Chamarande.
Après avoir mis son hôte en voiture, le châtelain rentra au salon, où il me trouva racontant comment le hasard m’avait favorisé autrefois d’une rencontre avec la première femme de M. de Talaru. Lorsqu’elle avait convolé en secondes noces avec lui, elle était veuve de M. de Clermont-Tonnerre, charmante, quoique plus âgée que le nouvel époux. C’était une créature originale, singulière par ses habitudes et les allures d’ancien régime qu’elle conserva quand même.
Un jour d’été à la campagne, dans une matinale promenade à cheval, j’aperçois un lourd carrosse traîné par de vieux chevaux, conduits par un cocher dont le tricorne couvre des cheveux blancs simulant la poudré. L’équipage venait à nous dans une allée étroite, mon écuyer m’engage à me ranger de côté. Au même instant, reconnaissant un de ses voisins dans le cavalier qui m’accompagne, la marquise de Talaru, car c’était elle, abaisse une glace et me laisse voir une sorte de petite fée mignonne, taille de guêpe, demi-paniers, robe de soie en pékin rayé bleu et saumon, dont le corsage, ouvert très bas, laissait voir des appas respectés par le temps. Un rang de perles énormes étranglait le col, tandis que les cheveux dressés et poudrés à frimas, ornés de barbes en dentelles retroussées, découvraient un petit visage où le rouge s’étalait fièrement, ne cédant le pas qu’à l’éclat du vermillon des lèvres. Tout cela, cependant, formait un ensemble qui permettait, à distance, d’imaginer le piquant attrait qu’avait eu au temps jadis cette physionomie de blonde.
« Cher ami, cria-t-elle par la portière à mon cavalier, quelle est cette belle enfant ?
– C’est, madame la marquise, la jeune mariée dont je vous ai parlé.
– Ah ! ma reine, je vous soupirais, reprit-elle ; que votre mari vous amène bien vite, et dites-lui surtout que je vous trouve jolie comme un cœur. »
Puis, du bout des doigts, me jetant un baiser, elle permit à ma jument impatiente de reprendre sa course. J’étais charmée d’avoir vu s’animer et parler ce véritable portrait d’ancêtre, sans prétendre cultiver davantage un voisinage qui n’attrayait guère mes quinze ans.
« Eh bien ! reprit à son tour le châtelain, j’ai eu dans le temps de plaisantes séances avec cette même personne.
« Pendant les fréquentes absences de M. de Talaru, retenu à l’étranger, soit par des fonctions éminentes, ou des goûts de voyage, la marquise, toutes les fois qu’elle se trouvait empêchée, me mandait en consultation.
« Un jour, rentrant chez moi, vers cinq heures, je trouve d’elle trois billets successifs qui réclamaient ma présence. Inquiet, je me hâte d’accourir. En me voyant, l’intendant s’écrie :
« Oh ! monsieur, Mme la marquise vous attend avec tant d’impatience qu’elle en est malade.
– Il n’est pas arrivé malheur, j’espère ?
– Pas que je sache, monsieur. »
« Et il m’introduit dans une pièce immense en fermant la porte sur moi. Je cherche à me diriger dans une demi-clarté, quand d’un angle de la chambre part un éclat de voix :
« Enfin, c’est vous, cher ! Attendre ainsi, c’est à mourir ! »
« Je ne distinguais d’abord qu’une sorte de chapeau-toque, sur lequel se mêlaient aux plumes des fleurs artificielles ; puis, dessous, cette petite figure peinte que vous savez ; elle paraissait assise très bas, et devenue comme le centre d’un flot de mousseline blanche. Je cherchais en vain à me rendre compte de ce qui était mouvant sous mes yeux. Je suppose que ma physionomie exprimait l’étonnement, car tout d’abord la dame me dit :
« Ne faites pas attention, cher ! c’est pour calmer mes nerfs, l’attente me rend si malade.
– Qu’est-il donc arrivé, madame, que voulez-vous de moi ?
– Ne le devinez-vous pas ? N’avez-vous donc pas lu au Moniteur, ce matin, les nouvelles nominations dans la diplomatie ? Deux paltoquets, cher ami : l’un, premier secrétaire d’ambassade, l’autre, ministre au Pérou ? Des gens sans aveu, d’une roture évidente, ne pouvant fournir que des noms de calendrier. Ce gouvernement prétend nous avilir. J’écrirai à M. le marquis de donner sa démission comme ambassadeur, et nous la motiverons. J’écrirai au roi, et vous lui porterez la lettre, cher. Oui, vous la porterez !
La marquise, en ce moment, se livrant à des gestes désordonnés, un bruit de clapotement me révéla le secret que j’avais vainement cherché à pénétrer jusque-là : la marquise prenait un bain de siège. Elle agita une sonnette, une antique Mariette parut.
« Vite de l’eau chaude ! demanda-t-elle, le bain se refroidit. »
Puis, la colère de cette singulière personne s’exhala de nouveau en propositions folles. L’effet du bain me paraissait peu calmant. J’imaginai de renchérir sur son excentricité, l’engageant à demander une audience à Sa Majesté et à lui soumettre le plan d’une école diplomatique, pépinière où toujours on prendrait au choix les plus anciens… de race.
« C’est divin ! Vous êtes adorable ! Oui, agissons et laissons les deux susnommés dans leur crasse de naissance ! »
Accompagnant cette conclusion d’un violent geste de dédain, je fus vertement éclaboussé. Mettant à profit l’incident, je m’esquivai, sûr, du moins, de ne pas être suivi.
– Très bien ! fit Mme de T…, vous aviez réussi à vous mettre à la hauteur de votre marquise. Quel contraste entre les époux ! Le mari me paraît être la raison et la convenance même.
– Dites aussi la douceur et la bonté, ajouta Berryer. Il fait le plus noble emploi de sa fortune. Pour Paris, il a adopté un mode particulier de charité : il paye des loyers aux indigents. Sous cette forme unique, il dépense 40 000 francs tous les ans.
– Eh bien ! moi, remarqua Rikomski, fatigué d’un long silence, j’aurais un autre système de charité. Des malheureux, je ferais des heureux. Je leur donnerais un litre de vin par jour, mais rigoureusement ; pas une goutte de plus, par exemple ! »
Ce plan ingénieux fut déclaré absurde avec unanimité. Chacun se récriait en allumant les bougeoirs et se disant bonsoir.
« Absurde ! absurde ! répétait Rikomski. Ces gens-là noieraient leur chagrin. Je suis certain que monseigneur d’Orléans m’approuverait… »
Ici la voix se perdit dans l’éloignement.
Le jour suivant, une promenade en bateau fut décidée, sous l’inspiration de Mme de T…, qui avait vraiment les goûts d’une ondine. Au moment de s’embarquer, comme on perdait le temps en politesse, à qui passerait en premier, la comtesse s’élança dans la barque, s’assit au gouvernail, criant :
« Qui m’aime me suive ! »
Le chevalier Artaud, d’une galanterie surannée, mais spirituelle, l’excellent académicien Roger, Rikomski et deux jeunes propriétaires du voisinage se précipitèrent à sa suite. On me tendait la main, j’entrai à mon tour dans le bateau. Sur la berge, Berryer parut hésiter, puis renoncer résolument.
« Nous serions trop de monde, dit-il.
– Comme vous voudrez, fit Mme de T…, avec un petit rire moqueur ; on se noiera sans vous. »
Il me parut que notre châtelain avait un air abandonné. Avant que les rames ne fussent en mouvement, je me levai et sautai à terre.
« Moi aussi, dis-je, je préfère marcher. Nous serons deux pour, du rivage, admirer l’embarcation. »
Nous suivions d’un pas lent et distrait le courant de la rivière, quand des cris d’effroi nous arrachèrent à la rêverie. Nous voyons de loin les hommes s’agitant en tous sens ; mais la comtesse n’est plus dans le bateau ! Pâle d’émotion, Berryer s’élance ; mais déjà le visage riant de l’ondine se montre à fleur d’eau, nageant élégamment et gagnant la rive, sans paraître embarrassée du poids de ses vêtements.
« Le capitaine est sauvé ! » cria-t-elle à l’équipage troublé.
Elle n’osa avouer tout de suite que la chute était une expérience. Habile nageuse, elle s’était laissée choir en se penchant, voulant savoir comment, tout habillée, on pouvait se tirer d’un naufrage. En partant, son intention était de prévenir ceux qui voguaient avec elle. Une malice féminine la fit changer d’avis lorsque Berryer refusa la promenade. L’effrayer était tirer une petite vengeance de son abandon, vengeance dont le grave auteur de l’Histoire des Papes, le chevalier Artaud, devint la véritable victime. Dans le saisissement que lui causa cette chute, il avait lâché son lorgnon qui, tombé dans la rivière, suivit le fil de l’eau sans se laisser repêcher. Myope au superlatif, en prenant pied à terre, il ne pouvait plus se diriger. Je lui tendis une main secourable, tandis que la naïade s’appuyait sur le bras du châtelain.
De retour au château, tout le monde à la fois se plaisait à raconter l’aventure à Mme Berryer. Pour combattre les effets du refroidissement chez la baigneuse et de l’émotion chez les rameurs, Rikomski réclamait du vin chaud.
Mme Berryer s’occupait avec bonté de mettre la comtesse à l’abri d’un rhume, et de remplacer le lorgnon du chevalier Artaud. Elle ne put se procurer que des lunettes. Or, notre chevalier parfumé, avec des habitudes de coquetterie ayant quarante ans de pratique, ne consentit pas même à les essayer.
Mme de T…, cause de ce désagréable incident, expédia à l’instant même un domestique à Paris, et le lendemain matin, en se mettant à table. M. Artaud, sous sa serviette, trouva un charmant lorgnon. On peut imaginer tout ce que, sur ce thème, suggéra une galanterie cultivée en cour de Rome, où, longtemps, M. le chevalier avait fait partie du corps diplomatique.
La comtesse avait décidé cette même matinée de demander au maître de céans de faire avec elle une promenade en tilbury, sentant qu’il fallait racheter par quelque bonne grâce sa fantaisie aquatique de la veille. Pendant qu’elle disposait sa toilette, on entendit une voix retentissante appelant Pinson, le garde-chasse. Alors il s’établissait, entre maître et serviteur, de longs dialogues au sujet des eaux et des bois, toujours pleins d’intérêt.
Cette campagne d’Augerville plaît et attache. Une ceinture d’anciens fossés, avivés par une eau courante, entoure le château, laissant sur une des façades l’espace d’un parterre. Le parc semble un fragment soustrait à la forêt de Fontainebleau. De beaux rochers, non artificiels, sont réunis par de légers ponts en bois, et varient le paysage. Là-haut, de grands pins d’Italie vous offrent leur ombrage. Dans le bas, de jolies allées coupées dans les taillis sont favorables aux courses à cheval et aux voitures légères.
Berryer aimait beaucoup cette dernière façon de parcourir sa propriété. Je l’ai vu parfois s’arrêter, me confier les rênes, descendre, se coucher par terre, pour découvrir si un semis de chênes commençait à montrer ses pointes vertes. C’était plaisir de le voir ainsi ; tout cela se faisait con amore, avec l’allure d’un homme qui n’a d’autre souci que l’heure présente. Il taillait belle part aux affaires, sans empiéter sur les plaisirs. Que d’habileté dans cette distribution ! Rien ne demeurait en souffrance, tout était prévu ou conjuré. Les procès et les clients, la politique et la Chambre, rien ne devenait entrave. L’amour même, qui, dans sa vie, jouait un rôle important, se conciliait, par une volonté dominatrice, avec ses plaisirs d’amitié. Il se dédoublait, se multipliait, et par un charme réel, une fois présent, il était tout à vous. Quel attrait piquant dans ce laisser-aller apparent ! Ce gaspillage du temps devenait un véritable luxe, une prodigalité.
Qui jamais l’a entendu s’enquérir de l’heure ? Désobligeante question ! Toutefois il était d’une scrupuleuse exactitude, base indispensable des rapports de société. Jamais lettre ou billet ne demeurèrent sans réponse, et la correspondance prenait immédiatement un tour personnel, flatteur pour l’absent. J’insiste sur ces traits de caractère qui expliquent la solidité des relations d’amitié ; on ne pouvait y renoncer.
En ma présence, un jour, un homme aimable et spirituel, ennuyé de voir toutes les femmes engouées de l’orateur, soutint, contre de belles adversaires, qu’il refusait, en amour, la perfection qu’il accordait à Berryer dans les sentiments de mezzo caractère.
« Connaît-il cette passion, ce feu dévorant, concentré, qui est avant tout exclusif ? Non ! son cœur s’évapore entre les mille et une ! »
L’auditoire féminin se récriait, s’exclamait.
« Eh bien ! demandait-il, quelle femme pourrait montrer de lui des lettres comparables à celles de Mirabeau à Sophie ? »
Naturellement, sur ce point délicat, personne ne prenait la parole ni ne cherchait au fond de sa poche. Regardant ce silence comme gain de cause, il poursuivit :
« Croyez bien que, si Berryer ne dépensait en monnaie sa pièce d’or, peu de femmes, parmi les plus sages même, pourraient se vanter d’avoir résisté à cette éloquence passionnée, pénétrante. Pouvoir éveiller, agiter les passions, quel don divin ! Mirabeau est bien la preuve de ce que j’avance. Pourtant il était puissamment laid ! Jugez, avec tout l’agrément de figure de votre idole, jugez de ce qui adviendrait ! »
Il y avait quelque justesse apparente dans ce dire ; mais quelle large part d’inconnu existe encore dans le cœur et la vie même de ceux qu’on croit le mieux savoir !
Après avoir vu le tilbury emporter la jeune veuve et le châtelain, je me rendis au petit salon, où j’étais à peu près, sûre de trouver la maîtresse de la maison mollement plongée dans une bergère. Là, règne un jour mystérieux, qui tamisé par des tentures cramoisies, répand sa teinte animée sur un beau marbre de Canova, placé au milieu du salon. Cette Vénus a été léguée, en 1838, par le duc de Fitz-James à son ami Berryer. Tout dans cette retraite favorise l’épanchement, amène les confidences.
« Eh bien ! demanda Mme Berryer en m’apercevant, votre opinion est-elle arrêtée ? Est-ce l’amour ou l’amitié que vous venez de mettre en voiture ?
– Moquez-vous de moi, ma chère, répliquai-je. À cet égard, je ne sais que penser. Vu à la loupe, je crois à l’amitié ; mais, à distance, une sorte de mirage me fait supposer un amour réciproque consenti.
– Il n’en est rien, Elma ! fut-il dit d’un ton d’autorité. Faut-il donc vous répéter que mon époux ne peut rien me cacher ? »
Ce ton affirmatif me fit rire.
« Je ne saurais croire, madame, que cet homme, d’un tact délicat, vous fasse d’aussi étranges confidences.
– Je ne les lui demande pas : mais j’ai plus d’un moyen de me tenir au courant de sa vie. Dans le sommeil, s’il paraît un peu agité, je lui prends la main et l’interroge ; il répond à mes questions.
– Le soupçonne-t-il, le sait-il ? m’écriai-je, au comble de l’étonnement.
– Oui, il le sait. Que lui importe ? Il sait aussi que je suis sa meilleure amie, incapable d’abuser. Mariés tous deux à l’âge de dix-neuf ans, un attachement solide, dont la confiance forme la base, succéda entre nous à l’amour. Remarquez que je dis confiance et non confidence. Il y a des sujets qui vivent à l’état de sous-entendus ; nous ne les abordons guère. Quant aux lettres qui tombent sous ma main, je les lis sans scrupule. Ainsi, hier, il en est arrivé une dont le timbre seul indiquait le contenu. C’était un rendez-vous, et je m’ingéniais à deviner comment on s’y prendrait pour vous quitter, mesdames. Ce matin, au réveil, mon époux m’a annoncé qu’une affaire au Palais l’obligeait à passer vingt-quatre heures à Paris. Cela me contrarie fort, a-t-il ajouté d’un ton sincère. Vous avez, mes aimables amies, tout l’honneur du regret. C’est Mme de Rupert qui sera de passage dans la capitale.
– Comment ; son enthousiasme pour cette personne dure encore ?
– Hélas, oui. C’est devenu, ma chère, une passion à grand orchestre. Nous avons des jalousies, des exaltations mystiques ; la religion y a un rôle, le remords met des entraves, puis une phase contraire y succède ; l’on prie ensemble, c’est-à-dire à la même heure, à deux cents lieues de distance. Ma chère, en tout il y a de la mode j’ai connu un temps, continua avec bonhomie Mme Berryer, où les femmes adressaient ce genre de dévotion aux étoiles et à la lune ; il paraît qu’on a changé tout cela. »
Ici un court silence donné aux souvenirs, puis, retournant à Mme de Rupert :
« Que je voudrais, Elma, vous faire lire une de ces lettres si incandescentes !
– J’avoue, madame, que si cela se pouvait faire honnêtement, je m’en amuserais.
– On trouve beaucoup d’esprit à cette femme… de l’imagination, d’accord ; mais elle est envahissante, fatigante… et, convenons-en, mon amie, elle n’est ni belle, ni jolie.
– Puisque telle est votre opinion, je ne vous contrarierai pas sur ce point ; et je veux à ce sujet vous, conter une histoire, où j’ai joué un rôle très embarrassant.
« L’hiver dernier, à l’un des raouts de l’ambassade anglaise, j’aperçois M. Berryer circulant dans la foule et pilotant sa conquête. Il m’aborde, fait une présentation en règle ; nous échangeons quelques mots gracieux sur le désir de nous connaître ; puis tous deux se tournent vers le comte de la Ferronnays, l’arrêtant au passage. Au même instant, mon oncle le général, que vous connaissez bien, fond sur moi comme un cyclone, et, de cette voix qui fait merveille un jour de bataille, me crie : « Elma ! quel est donc ce grand garçon habillé en femme que promène notre député ?
– Pardon de vous interrompre, dit gaiement la châtelaine, mais c’est excellent, c’est tout à fait cela !
– Patience, écoutez ce qui suit ; j’arrive au lamentable. Pour arrêter le flux d’appréciations de mon oncle, j’avance précipitamment le pied, le posant en façon de pédale sur celui du général. Au même instant, je saisis le regard brillant du député, attaché sur mon avertissement. Je n’ose plus retirer le pied révélateur, et je demeure jambe tendue, fort gênée de mon rôle amical, d’autant que cette physionomie expressive que nous connaissons ne disait que trop clairement qu’il avait tout entendu. Résultat : embarras réciproque toutes les fois que le nom de Mme de Rupert se présente dans la conversation.
– Pour ma part, chère amie, reprit Mme Berryer, je suis charmée de votre bonté maladroite. C’est une leçon. Il ne faut pas prétendre ériger une femme pyramidale en beauté, et de l’absence déplorable de formes, constituer une élégance. »
Il faut se souvenir que celle qui parlait ainsi, avec des traits charmants et un teint éclatant, de taille moyenne, avait toujours été un peu grasse. « C’est un paquet de roses, » disait d’elle une envieuse.
Le soir de ce même jour, personne ne soufflait mot encore d’un départ. La musique vint remplir la plus grande partie de cette soirée. Notre châtelain adorait placer une partition de Rossini sur le pupitre, s’asseoir près du piano, et, guidé par les paroles, battant du pied la mesure, chanter de mémoire tour à tour toutes les parties, sans connaître une seule note des clefs de sol ou le fa. Musicienne, la comtesse se prêtait volontiers, comme moi, au rôle d’accompagnateur. Les souvenirs du Théâtre-Italien venaient colorer, accentuer la partie vocale. C’était tour à tour Lablache et Rubini, puis la Sontag, la Pisaroni, ou la diva Pasta que, par une sorte d’imitation, tenant à la vivacité du souvenir, le geste, la physionomie et la voix du chanteur nous indiquaient.
Les heures pour Berryer s’écoulaient ainsi délicieusement. Souvent quelque anecdote surgissait, qui, comme un point d’orgue, suspendait l’exercice vocal. Cette fois, ce fut en feuilletant l’opéra du Barbier, que tout à coup son séjour à Bade en 1836 et sa rencontre avec la charmante Sontag, devenue comtesse Rossi, lui revinrent en esprit.
Sur un théâtre de société, on voulait représenter une pièce de Scribe, les Premières Amours. Or, la Sontag ne consentit à remplir le rôle de jeune première que si, à son tour, le grand orateur se laissait enrôler, en acceptant celui de père noble. Le traité fut conclu, et, lors de l’exécution presque impromptue de l’œuvre, le seul reproche qui se pût adresser à Berryer, qui avait joué, assurait-on, avec un naturel exquis, était d’avoir donné à son rôle certain caractère qui troublait le spectateur. On arrivait à confondre parfois le père et l’amoureux, tandis que, précisément, le jeune premier, lui, remplissait son rôle d’une façon toute paternelle.
Il y a dans la pièce une situation où, pour conquérir son consentement au mariage, la jeune fille demande à son père ce qu’elle pourrait faire pour lui plaire. Une délicieuse surprise avait été préparée au public. D’accord avec l’orchestre, Berryer tira de sa poche une feuille de musique, qui n’était autre que la cavatine du Barbier de Séville. En reconnaissant la ritournelle, les spectateurs éclatent en transports. La cantatrice, après une courte hésitation que le père sut faire cesser, entama une fois encore cet air d’una voce poco fa, qui lui avait valu tant de succès scéniques.
« Oh ! que j’aurais aimé être là ! s’écria Mme de T…, jouir de ces accents, et surtout… voir jouer ce père qui n’en était plus un ! Comme vous aimez le théâtre, monsieur ! Je l’ai constaté il y a longtemps. N’étais-je pas en votre compagnie dans une avant-scène des Italiens, lorsqu’un soir, l’illusion fut pour vous si complète, que, debout et vous adressant à la Pasta, vous vous êtes écrié : « Ah ! cara ! ! ! » Oui, monsieur, et toute la salle vous a entendu.
– Quelle exagération ! reprit en riant Berryer.
– Est-ce surprenant, avec cette voix qui sonne comme une cloche ? Comment pouvait-on ne pas vous reconnaître ? Tout le monde se retournait, et je me cachais. Ce public croyait peut-être que vous commenciez un discours. Voyons, dites la vérité. Je suis certaine que vous avez eu des velléités prononcées d’aborder le théâtre !
– Pourquoi le nierais-je, madame ?
– Oh ! je suis là pour l’attester, s’écria Rikomski.
– On ne te consulte pas, mon bon ami.
– Non ; mais j’atteste et je circonstancie. C’était sous le règne de la belle-Émilie Contat, – alors un magnifique soleil couchant, – un peu forte par exemple. »
Ici le geste descriptif achevait la phrase.
« Richomme, tu es un être insupportable ; un bavard, qui ne sait ce qu’il dit. »
À cette attaque, Rikomski réplique avec bonne humeur :
« J’ai encore de la mémoire, et j’aime à la produire je n’ai plus que cela !
– Allons, allons, séparons-nous, fit Berryer, je dois me lever tôt. Je pars avec MM. Artaud et Roger qui, prudemment, se sont retirés il y a une heure déjà. – Mesdames, avez-vous des ordres à me donner pour Paris ? »
Sans répondre, la comtesse prit un air boudeur.
« Revenez vite, dis-je, souriant au souvenir du commentaire que j’avais recueilli, dans la journée, de ce voyage subit.
– Je ne serai que vingt-quatre heures, » acheva le châtelain en baisant la main de la jolie veuve.
Gagnant nos appartements, Mme de T… me demanda si j’avais sommeil, se déclarant pour sa part terriblement éveillée.
« Entrons chez moi et causons, dis-je.
– Vous êtes aimable et j’accepte, » fut sa réponse.
Puis, par la pensée continuant la soirée, la comtesse me demanda comment je m’expliquais le vif attrait qui poussait l’un vers l’autre Rossini et Berryer.
« Rien n’est plaisant comme l’épanouissement de ces deux visages lorsqu’ils se rencontrent.
– Ma chère, pour qui les connaît bien, répondis-je, cela s’explique par des affinités d’esprit et des aptitudes semblables.
– En fait d’affinités, reprit la veuve, je les soupçonne fort, l’un comme l’autre, de ne pas cultiver la désespérance ; ils n’acceptent d’ennuis que l’inévitable ; de l’amour que les plaisirs. Enfin, tous les deux prennent la vie du bon côté. Mais vous m’accorderez que ces analogies, dans les esprits et les goûts, ne modifient pas la diversité de nature de ces deux hommes éminents. L’orateur demeure indifférent, répulsif même aux intérêts d’argent, généreux au-delà de sa fortune ; tandis que le musicien devient de plus en plus parcimonieux, avaricieux, oubliant complètement les chiffres de ses recettes. J’opposerai encore la sensualité gastronomique de ce dernier à la sobriété du premier, dont les recherches de table sont toutes en l’honneur de ses hôtes. Voilà de terribles différences !
– Ma chère belle, ne savez-vous pas comment notre Berryer se plaît à ignorer ce qui pourrait amoindrir l’estime où il tient les gens qu’il aime ? Ces deux illustres ont reçu en naissant le même don ; ils ont le pouvoir d’émouvoir et de passionner les humains. Ils parlent une langue différente, mais tous deux sont des charmeurs. Lorsqu’ils se rencontrent, Rossini entend la façon chaude et intelligente dont son génie est compris, et il se sent tout à fait heureux. Notre ami, de son côté, n’éprouve-t-il pas alors cette jouissance intime que l’on goûte dans l’exercice de ses facultés ? Ce n’est pas avec tout le monde que l’on peut être éloquent !
– Accordé ! je jugeais superficiellement. ».
Je continuai à parler, oubliant l’heure, avancée de la nuit, tout en insistant près de la comtesse sur les effets prodigieux de l’art oratoire. « N’est-il pas vraiment magique, disais-je, de réussir par un acte de la volonté à transmettre à qui vous écoute toutes vos impressions, à faire rire ou pleurer, jouir ou souffrir, haïr ou aimer ?
– Je ne conteste pas ; seulement expliquez-moi alors comment une femme peut résister à l’amour qu’elle inspire, s’il est dépeint éloquemment ?
– Chère comtesse, fis-je en riant, tout en arrangeant mes cheveux pour la nuit, c’est là précisément ce que je désirais vous demander. »
Rougissant légèrement, sa réponse fut :
« Je vous deviné. Aussi bien je suis aise de saisir cette occasion d’éclairer des doutes que je lis parfois dans vos yeux. Venez avec moi, je vous confierai la lettre même reçue au moment de venir ici. »
Toutes deux, marchant sur la pointe des pieds, nous gagnâmes l’appartement de la comtesse ; là, dénouant un ruban qui réunissait quelques feuillets, consultant les datés, elle me remit une lettre du 1er août.
« Emportez-la avec vous, dit-elle ; je ne saurais en ma présence voir lire de telles douceurs ; mais vous me la rendrez, » fit-elle, me menaçant du doigt, et laissant échapper une partie de ses papiers.
Je me précipitai pour les ramasser.
L’aimable Lucy dit en riant :
« Vous les tenez ? eh bien ! emportez ces lettres, elles marquent diverses époques ; et maintenant, bonsoir, Elma ! Je suppose que nous venons de souffler sur le flambeau de la cérémonie. »
Ma réponse fut un baiser. Je m’enfuis, ayant hâte de m’enfoncer dans ma lecture ; en gourmet, je réservai pour la dernière la lettre la plus récente, et je pris celle datée de 1837, adressée à Mme de T… en Angleterre, où elle assistait au couronnement de la reine Victoria.
Jeudi matin 1837.
Ne croyez pas que j’en aie parlé seulement pour me mêler à la conversation où pour mettre en scène un acteur de plus, dans cette journée des brancards, où tout le monde partait pour Boulogne. Ce n’était pas même un simple désir, mais bien un projet très arrêté et qui s’exécutera ; aussi je vous demande de n’oublier pas de me dire de Londres, quand vous serez à Brighton, et combien de jours vous y comptez demeurer. Ce n’est pas que je me plonge en des rêveries sur votre façon si gentille de m’appeler ou sur le charmant cantilène de Mme de X…, qui met, dites-vous, traîtresse, grand prix à ma venue. Hélas ! hélas ! je commence à ne plus voir les choses de la vie que ce qu’elles sont, et, sceptique consciencieux, je ne marche plus ferme et confiant dans ces belles espérances que j’ai vu quelquefois faire de l’avenir ; pourtant vous avez toujours grande raison de dire : Il fera ce que je veux ; pourtant je ne cesse de murmurer contre ma sottise, et l’en fin c’est égal a toujours le même accent et porte en lui le même remords.
Y a-t-il rien, en effet, de plus ridicule que d’être aux yeux du monde comme si… et de n’être pas en effet comme ça.
Mais n’est-ce pas que la marquise est bien charmante à écouter tout un jour, et délicieuse à voir cheminer nonchalamment au bord des grandes lames noires de la mer et sur les difficiles galets ? Et puis vous me promettez bien un peu de soleil à Brighton ?
Bah ! ne vous ai-je donc jamais parlé de mes courses sur les rives de l’Océan, de la marée d’équinoxe à Saint-Malo, où j’ai manqué périr ? j’avais vingt-trois ans ; d’une cloche qui sonna au milieu de la nuit avec un interminable vacarme et mit sur pied toute une maison, à mon grand embarras ! Et entre Boulogne et Calais, en un lieu qu’on appelle Ouessant… Mais je vous ai dit tout cela.
En somme, l’Océan est grand, et son bruit et sa mauvaise odeur me plaisent aux jours sérieux, aux jours de pensées jetées au-delà de l’horizon du monde ; mais les idées de vie, de joie, d’amour, oh ! c’est l’onduleuse et caressante Méditerranée qui les colore et les rajeunit.
Allez donc vous promener au cap Griné, que je n’ai pas vu depuis vingt ans, asseyez-vous un moment au haut de cette falaise, et vous me direz s’il ne vous vient pas envie de bondir ; j’ai vu de ces mouvements-là en ce lieu.
Enfin, notre Chambre est fermée ou plutôt vidée ; mais, à mon grand ennui, je suis pris pour quatre jours par un long et fastidieux procès. J’ai vu X…, qui attaque et tue le ministère aujourd’hui même.
Dites-moi de Londres qui va à Brighton. À Brighton ! là le revoir, là mon dépit, là comme ici ma tendresse et ma joie quand même… L’heure de l’audience sonne, dites donc à la marquise quelque JUDICIEUSE et agréable parole, selon ma pensée.
BERRYER.
Après cette lecture ma curiosité cherchait à éclaircir si le ton de la correspondance entre Berryer et la comtesse, devenue veuve, était demeuré le même. Le court billet suivant me tomba sous la main, daté de 1838.
Chère, ah bah ! il faut appeler les choses par leur nom ; vous, la plus aimable de toutes, dites-moi si vous voulez de moi et à quelle heure, je serai exact. En tous cas, redites-moi en quel lieu se donne le concert, je me le suis fait dire cinq ou six fois, et je l’ai six fois oublié ; mais aussi pourquoi ne parlons-nous que de choses aussi indifférentes ?
« Shake hands. »
Dans ce billet s’en était-glissé un autre plié en pointe.
Chère, puisque hier au soir vous étiez moins souffrante, et ne manquiez que de la force de laisser tresser vos cheveux, vous pourrez sortir aujourd’hui. Je croyais n’être libre qu’à quatre heures, mais je le serai beaucoup plus tôt. Ne voulez-vous pas que nous visitions le musée Isabey, au grand jour ? Et ne pourrions-nous pas nous donner l’amusement de voir quelques autres raretés ? Dès une heure je serai à vos ordres ; si donc vous pouvez sortir plus tôt, faites-le dire, commandez et il vous sera obéi.
Je suis peut-être un grand sot, je ne vous ai pas dit mot, avant-hier, de la charmante lanterne. C’est tout ce que je désirais avoir, c’est un de ces petits bonheurs que je goûte encore avec joie d’enfant. Comment ne vous en ai-je pas dit merci ? Il faut qu’en vous voyant, j’aie pensé à tout autre chose qu’à la joie du cadeau. Serait-il donc vrai, qu’il n’est pas vrai, que ce me soit égal ? Ah ! povero !
À bientôt, je vous baise les mains.
Enfin la lettre la plus récente.
Août, Augerville.
Chère ! (car sans illusion, je supprime le possessif), tout ici est en fleur et l’air est parfumé ! ne nous viendrez-vous pas ? Ils sont si bons les jours où je vous regarde marcher dans votre liberté ! Rien n’est plus charmant à contempler, et plus riant à aimer. Si vous ne venez de suite, aumônez-moi d’un petit mot bien amical. Vous êtes du petit nombre de personnes dont mes pensées les plus chères peuplent ma solitude, et que je fais converser avec moi, en regardant couler l’eau, ou écoutant bruire le vent dans les arbres. Envoyez-moi quelques bonnes paroles à mêler à celles que je vous prête ; faites-moi voir que mes rêves ne sont pas mensonges, ni vos promesses non plus.
Adieu, vous que j’aime à part, et à travers tous les goûts, toutes les passions, toutes les joies, tous les entraînements de ma vie. Objet de regret, de dépit, de contentement, admiration et charme. Je vous envie à tous, et ne suis point jaloux. J’ai bonheur à ce qu’on vous aime et vous comprenne, et voudrais cependant qu’il n’y eût que moi qui vous fus bien « Your for ever ».
BERRYER.
De quel nom baptiser cette singulière intimité ? me demandais-je en repliant les lettres ; une flirtation ? Non, c’est un sentiment, une espérance, élevée à sa plus haute puissance… ; et, sans avoir trouvé à la chose un baptême qui me satisfit, je m’endormis.
Le lendemain, Berryer partit ; nous trouvâmes à propos, Lucy et moi, de consacrer la journée à la châtelaine, nous réservant la soirée. La poste apporta l’annonce positivé de la venue du prince de Belgiojoso et du virtuose Géraldy. Engagées d’avance, la comtesse et moi, à assister à la comédie qui se jouerait prochainement au château de P… par une excellente troupe d’amateurs, nous prétendions ne pas renoncer à ce divertissement. Or, il était dans les habitudes du château de ne préciser ni les arrivées ni les départs. Cependant j’insistai en demandant si les musiciens indiquaient un jour précis.
« Géraldy s’annonce pour la fin de la semaine, se déclarant certain d’entraîner le prince. Je pense, ajouta Mme Berryer, qu’ils nous donneront le samedi et le dimanche.
– Quelle bonne fortune musicale ! m’écriai-je : ténor et basse !
– Qu’est-ce donc qui a pu entraîner votre basso-cantante au mariage ? demanda Lucy.
– Il ne saurait l’expliquer lui-même, fis-je, me tournant en riant vers la maîtresse de céans, car il aimait ailleurs. Ne le savez-vous pas, madame ? Il a la passion loquace, se confie à tout le monde ; il ne la tairait donc qu’à vous seule ?
– Allons, ma chère Elma, vous vous plaisez à taxer de folie mon pauvre Géraldy. Bien reçu à Augerville, enthousiaste dans l’expression, il aura rendu ses sentiments de façon à induire en erreur ceux qui ne savent pas que je suis une vieille femme, et que Mme Géraldy est jeune et jolie.
– Est-ce l’acte de naissance qui règle les sentiments ? demanda la comtesse.
– Du moins, répartit Mme Berryer, il n’y a aucune tricherie de ma part. Dieu sait, mesdames, que je ne me suis jamais rajeunie d’un jour… que dis-je ? d’une heure !
– Oh ! m’écriai-je, ce serait plutôt le contraire ! Pardonnez-le-moi, mon excellente amie, il me semble parfois que c’est une petite taquinerie conjugale que vous exercez, ayant précisément le même âge que votre mari. »
Elle sourit, sans me contredire. Assez franche, elle ne s’épargnait guère. Cependant, subissant une sorte de routine, elle ne s’étonnait pas de plaire encore. Ses toilettes de couleurs sombres étaient sans prétentions à la jeunesse, mais l’élégance des détails y donnait de l’intérêt ; l’éclat du teint, le brillant des yeux bleus, aux larges prunelles, rendaient le visage agréable à regarder.
Notre causerie fut interrompue par un bruit de carambolages incessants venant de la salle de billard. Ouvrant la porte, nous trouvâmes Rikomski, qui, seul et en manches de chemise, se démenait comme un beau diable pour perfectionner son jeu, prétendait-il.
Sa perruque était posée sur un affreux buste en plâtre de Louis XVIII. Il l’apostrophait violemment, lui reprochant la charte de 1815, ses billes manquées et les malheurs de Charles X. Passant ensuite brusquement à notre Henri, nom qu’il prononçait toujours emphatiquement, – il chanta en larmoyant : – Quand le bien-aimé reviendra ! – puis finit par se coucher sur une des banquettes placées autour du billard, en s’écriant : « Mon Dieu, mon Dieu, si Berryer m’entendait ! » Un fou rire termina la scène.
Pour le ramener au sérieux, on lui annonça qu’il allait avoir l’honneur de nous servir de nautonier. Ce plaisir le laissait très froid. Habile rameur, par paresse, il dissimulait volontiers ce talent. Parmi les folies qu’il débita en naviguant, il donna un libre cours à son hostilité contre les promenades en bateau. « Je prétends, nous dit-il d’un ton de confidence, donner à ce sujet un avis indirect au seigneur d’Augerville Mais, diable ! il y faut des détours, pour donner des conseils : avec nos grands hommes comme avec nos rois ! Je le ferai en chantant, comme à l’Opéra-Comique.
– Oh ! je vous vois venir, Rikomski, interrompit Mme Berryer ; vous brûlez d’envie de nous faire connaître quelques petits vers nouveaux ; vous avez toujours mis beaucoup d’amour-propre à votre talent pour le couplet. Chantez donc, mon cher. »
Sans se faire prier davantage, abandonnant la rame, gesticulant, il entonna d’un air héroïque :
« Que signifie ce galimatias, s’écria la châtelaine, où avez-vous donc pris cela ?
– Moi, madame, je trouve cela grandiose. Remarquez que c’est l’orateur qui parle ! À mon tour maintenant, la leçon indirecte. Et prenant une voix flûtée : Attention, mesdames !
« Remarquez ce vers, répétait-il : « Un rien peut le faire périr… »
Et nous applaudissions.
« Je voudrais, reprit-il, faire passer le goût des promenades aquatiques, amener le seigneur de ces lieux à mettre du vin dans son eau…
– Voyons, galant batelier, rentrons, dit d’un ton moqueur la châtelaine, et je conviendrai qu’en fait de chansons, vous en avez fait de meilleures que celle-là.
– Je ne dis pas non, madame, je ne dis pas non. »
Et, comme nous abordions, il sauta vivement à terre, d’où il cria :
« Le couplet que je viens d’avoir l’honneur de vous chanter, est de la façon de M. Dupaty, membre de l’Académie française. » Puis il se sauva, triomphant du succès de sa mystification.
Le soir venu, nous pûmes enfin causer avec abandon, Lucy et moi.
« Voilà, dis-je, en lui restituant ses lettres, qui de votre part, prouve un puissant charme de captation, et, chez l’homme, des nuances vraiment délicates dans ses sentiments. J’y constate aussi ce discernement que La Bruyère déclare ce qu’il y a de plus précieux, après les perles et les diamants. Toutefois, le jeu demeure dangereux.
– J’en conviens : mais la raison me crie sans cesse que nos rapports d’affection ne doivent pas se transformer. – Je me ris des fausses suppositions, et quant à ma victime, faut-il la plaindre ? N’a-t-elle pas l’air heureux en ma compagnie ?
– Voulez-vous, dis-je, chère Lucy, connaître un des grands charmes de vos relations ? Il naît précisément de ce que l’homme fait retrouve près de vous des impressions de sa jeunesse ; il désire, sollicite, espère et désespère, et puis… et puis… faut-il tout expliquer ?
– Je vous en prie, pas de réserve.
– Bénissez, ma chère, les nombreuses distractions qui sauvent la position. Voyez, comme s’il n’était pas déjà favorisé par d’aimables compatriotes, la Russie, dit-on… car vous n’ignorez pas ce que tout le monde sait ? un de ses colosses de neige brûle pour lui d’une flamme diplomatique !
– Oh ! pas autant que cela, j’espère, interrompit la comtesse en me fermant la bouche avec la main.
– Quoi ! seriez-vous jalouse ?
– Non certes ; mais cela ne me plaît guère. Je préférerais ne pas y croire.
– Lucy, Lucy ! C’est là cependant ce qui préserve votre idéal.
– Que vous avouerai-je ? vorrei e non vorrei ! »
Ainsi se montrait le bout de l’oreille féminine.
En nous rejoignant le lendemain, Lucy déclara avoir peu dormi.
« J’ai médité, dit-elle ; avec profit ! j’espère. Décidément, cher Mentor, je trouve vos raisonnements topiques.
– Je devrai donc, imitant Rikomski, m’écrier : Ciel ! si Berryer m’entendait ! »
Mais il n’avait rien entendu, et, comme c’était annoncé, il revint dans la journée, joyeux de nous retrouver. En quittant Paris, avait-il été attristé ? Je l’espère pour lui.
Il aurait ainsi goûté le même jour les deux bonheurs que peut donner l’amour : larmes et sourires ! – la tristesse de l’adieu et la joie du retour.
« Réparons le temps perdu ! s’écria le voyageur d’une voix animée. Nous pouvons, avant le dîner, faire une belle promenade. »
Et nous nous mîmes en marche. Rien ne languissait. Comme nous approchions du château au retour, Berryer, s’emparant du bras de la jolie comtesse, lui adressa d’une voix émue ces deux vers de Musset :
– Sans hésiter, je vous dirais : « Monsieur, vous êtes un infidèle ! » puisque jamais on ne vous a connu le cœur inoccupé !
– Voilà qui s’appelle taper sur les doigts, fit Berryer regardant Lucy tendrement. Puis se tournant vers moi :
– Me traiteriez-vous aussi durement, chère, si j’introduisais en variante : a blonde aux yeux noirs ? »
– Oh ! moi, je répliquerais : « Ce qui vous charme particulièrement dans cette délicieuse déclaration de Musset est l’élasticité de la dédicace. Voyez toutes les variantes auxquelles se prête le thème : – Rousse aux yeux verts, blonde aux yeux bleus, brune aux yeux noirs…
– Assez, assez ! cria Berryer.
– Et, continuai-je, cela ne vous coûte que la peine d’en varier l’accent. Asseyons-nous, un moment sur ce banc avant de rentrer, et veuillez, monsieur, nous dire la pièce de vers en son entier. Entre la brune et la blonde, la situation devient critique et digne de votre talent. »
Il faut en convenir, ce fut dit, détaillé, révélé, avec un art incomparable. L’émotion, l’organe, tout y concourait. Quels regrets que le poète ne fût pas là pour jouir de cette diction merveilleuse !





























