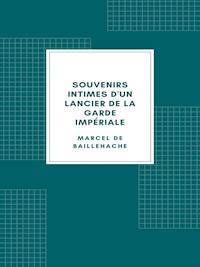
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Je suis né le 7 février 1846, à Rouen, où mon père occupait les fonctions d’avocat général près la cour royale. Mes souvenirs touchant la révolution de 1848 sont naturellement assez vagues. Mon père, comme beaucoup de magistrats du parquet, avait été destitué au lendemain de la chute du roi. Il songea, en présence de l’agitation qui régnait à Rouen, à nous envoyer, ma mère et moi, auprès de mes grands parents à Dieppe. Nous partîmes donc en voiture.
Les troupes du général de Castellane, qui commandait à Rouen, couronnaient les hauteurs qui bordent la route, tant pour protéger, disait-on, les princesses d’Orléans fuyant la capitale que pour arrêter les bandes d’émeutiers arrivant de Maromme et de Malaunay pour incendier le pont du chemin de fer et piller la ville.
Alexandre Louis Marcel de Baillehache né le 7 février 1846 à Rouen, mort le 16 décembre 1906 à Paris, est un officier français, auteur de plusieurs livres sur la vie militaire.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
LANCIER DE LA GARDE IMPÉRIALE
Souvenirs intimes d'un lancier de la Garde impériale
Marcel de Baillehache
© 2020 Librorium Editions
First Published in 1894
AVANT-PROPOS
Je présente au lecteur mes souvenirs sous le second Empire, pendant la Guerre de 1870 et pendant la Commune.
J’ai pensé que ce modeste livre pourrait offrir quelque intérêt, c’est pourquoi je me suis décidé à le faire paraître.
Bien loin de moi la pensée de vouloir donner à ces souvenirs intimes l’importance d’une page d’histoire, je dirai simplement comme le bon La Fontaine :
« J’étais là quand telle chose advint. »
M. DE B.
CHAPITRE PREMIER
La révolution de 1848 et la garde nationale de Dieppe. — Une revue du Prince-Président. — Effet produit en Alsace par le coup d’État de 1851. — Coup d’œil sur ce pays. — Voyage en Allemagne. — Nous apprenons à Bade la victoire de l’Aima. — Naissance du prince Impérial (mars 1856). —. Retour à Colmar d’un régiment de Crimée. — Deuxième voyage en Allemagne. — La langue française en Alsace. — Monseigneur Roess evêque de Strasbourg. — Passage à Colmar des prisonniers autrichiens en août 1859. — Voyage d’Italie. — Les champs de bataille de Solférino et de Magenta.
Je suis né le 7 février 1846, à Rouen, où mon père occupait les fonctions d’avocat général près la cour royale. Mes souvenirs touchant la révolution de 1848 sont naturellement assez vagues. Mon père, comme beaucoup de magistrats du parquet, avait été destitué au lendemain de la chute du roi. Il songea, en présence de l’agitation qui régnait à Rouen, à nous envoyer, ma mère et moi, auprès de mes grands parents à Dieppe. Nous partîmes donc en voiture.
Les troupes du général de Castellane, qui commandait à Rouen, couronnaient les hauteurs qui bordent la route, tant pour protéger, disait-on, les princesses d’Orléans fuyant la capitale que pour arrêter les bandes d’émeutiers arrivant de Maromme et de Malaunay pour incendier le pont du chemin de fer et piller la ville.
Mon père vint peu de jours après nous rejoindre à Dieppe et, dès son arrivée, se fit inscrire sur les contrôles de la garde nationale.
Le gouvernement provisoire qui trônait à Paris ne tarda pas à voir qu’il ne suffisait pas, pour être heureux, de faire une révolution et de renverser un prétendu tyran, mais qu’il fallait compter avec les revendications des socialistes et avec les partisans de ce qu’on appelait alors la république rouge.
Trois mois après le départ de Louis-Philippe, la terrible insurrection de Juin éclatait à Paris.
Mon père, qui a toujours été un homme d’ordre, fut d’avis, dès qu’on apprit les événements de Paris, qu’il n’y avait pas un instant à perdre pour aller porter secours à la capitale et aider à la répression d’une émeute qui menaçait l’ordre social. Il fit de son autorité privée battre le rappel, parvint à décider une partie de la garde nationale, et partit à sa tête pour aller combattre l’insurrection.
Je me rappelle le retour à Dieppe de ce détachement après les journées de Juin. On jetait des fleurs aux défenseurs de l’ordre, et chaque garde avait un bouquet planté dans le canon de son fusil. Ils se rendirent sur la plage, où une estrade ornée de drapeaux avait reçu la municipalité qui s’était montrée assez hostile au départ de ces braves gens.
Fidèle image des fluctuations politiques ! Le maire, socialiste ardent huit jours avant, leur fit un beau discours dans lequel il prodiguait les plus chaleureux éloges à des citoyens qui avaient su quitter leurs foyers et tout ce qu’ils avaient de plus cher pour aller terrasser l’hydre de l’anarchie, etc.
Il remit ensuite à chaque garde une médaille commémorative où était gravé le nom du garde et sur le revers : A ses concitoyens partis à Paris défendre l’ordre et les lois, la ville de Dieppe reconnaissante, juin 1848.
Quelque temps avant le coup d’État de 1851, le gouvernement du prince-président sentit le besoin d’avoir des fonctionnaires énergiques. Mon père, qui, j’ose le dire, appartenait à cette catégorie, fut replacé dans la magistrature et nommé avocat général à Colmar.
En traversant Paris j’eus occasion, pendant le court séjour que nous y fîmes, d’assister, au Champ-de-Mars, à une grande revue passée parle prince-président. Le Champ-de-Mars à cette époque était entouré de talus qui permettaient de bien voir les solennités de tout genre. Le prince, à cheval et entouré d’un nombreux et brillant état-major, arriva par l’avenue de La Motte-Piquet. Il portait l’uniforme de général de la-garde nationale : pantalon bleu à bandes d’argent, épaulettes et broderies également en argent, et son chapeau était surmonté d’une aigrette blanche, semblable à celle des colonels et sortant de plumes tricolores retombantes. Il était très acclamé, et il est bon de rappeler qu’on était en juin 1851, par conséquent, six mois avant le coup d’État.
Quelques jours après cette revue nous arrivions à Colmar. La maison que nous y habitâmes pendant quatorze ans avait été jadis la poste royale et le roi Louis XV y avait déjeuné dans un voyage en Alsace.
Sur le cintre de pierre de l’ancienne porte cochère était sculpté l’écusson de France et au-dessous ces mots :
La Poste sauvegarde du Roy, 1750.
Les événements politiques de 1851 n’eurent pas en Alsace de contre-coup sérieux. Tout ce que je me rappelle, c’est qu’en me promenant le soir avec mon père sur les anciens remparts de la ville, quelques jours avant le 2 décembre, il me fit remarquer des feux qui s’allumaient sur les montagnes et qui devaient être, disait-on, des signaux qu’échangeaient entre eux les insurgés.
A cela se borna à peu près l’agitation dans le Haut-Rhin, si toutefois ces feux avaient la signification qu’on leur attribuait.
Le coup d’État du 2 décembre ! A-t-il été assez reproché plus tard à son auteur, même par ceux qui, le lendemain, lui donnèrent leurs voix avec bonheur !
Nous nous apercevons que nous n’avons pas encore parlé de cette belle Alsace doublement chère à nos cœurs depuis qu’elle est devenue la proie du vainqueur.
Quelle superbe province et combien la séparation en semble plus cruelle à ceux qui, comme nous, y ont passé les belles années de la jeunesse.
Lorsque, dans nos excursions, nous étions transportés sur les sommets des Vosges, couronnées de distance en distance par les ruines des vieux burgs du moyen âge, quel panorama admirable il nous était donné de contempler ! Une plaine d’une fertilité incomparable, parsemée de bois, de vignes et de coquets villages, et, à l’horizon, la longue ligne argentée du vieux Rhin (der Vater Rhein) coulant au pied des montagnes de la Forêt-Noire.
Par les temps clairs, la vue s’étendait jusqu’aux glaciers de l’Oberland et on apercevait au nord la flèche de la cathédrale de Strasbourg élevant hardiment vers le ciel sa délicate dentelle de pierre. Quel beau spectacle ! Comme il élevait l’âme et on comprenait que cette terre, vraiment bénie de Dieu, avait dû depuis des siècles exciter successivement les convoitises du Franc et du Germain.
Pendant les vacances de 1854 mes parents m’emmenèrent avec eux en Allemagne. Indépendamment de ce que les voyages forment, dit-on, la jeunesse, mon père voulait me perfectionner dans la langue allemande que je commençais à parler. Dire qu’il a fallu la guerre de 1870 pour faire comprendre la nécessité d’apprendre aux enfants la dure langue de nos voisins !
Nous visitâmes Berlin, Leipsick et Dresde, et nous rentrâmes en France par Bade. A Berlin nous logeâmes sur le fameux boulevard Unter den Linden, à deux pas de la statue du grand Frederich et du palais du roi. La garde montante se rendant au château, précédée de son excellente musique, attirait toute mon attention : « Comme ils sont bien habillés, disais-je, et comme ils font bien l’exercice. » Nous visitâmes le Thiergarten et le château de Charlottenbourg où se trouve, dans le parc, le tombeau de la reine Louise, la mère de l’empereur Guillaume 1er, cette belle reine de Prusse qui fuyait à cheval à Iéna devant les hussards de Napoléon et qui plus tard, à Tilsitt, malgré toute la puissance de séduction dont la nature et l’éducation l’avaient douée, ne put rien changer aux résolutions du vainqueur.
Nous vîmes aussi Potsdam et Sans-Souci, si pleins des souvenirs du grand Frederich.
A Dresde le pont sur l’Elbe, long de plus de 200 mètres et aboutissant à la place de la cathédrale, faisait penser à la bataille livrée le 26 août 1813.
Ce fameux pont, Napoléon le traversait ce jour-là au galop à dix heures du matin, suivi des cuirassiers de Latour-Maubourg.
La mémorable bataille de Dresde commençait, et la Fortune allait accorder un dernier sourire au favori qui avait si longtemps abusé d’elle.
En visitant le palais du roi de Saxe, on pensait à l’affluence de têtes couronnées qui s’y étaient trouvées réunies en mai 1812 lorsque, avant de pénétrer en Russie, Napoléon y avait tenu un salon de rois. Combien la vue de ces appartements nous intéressait et qu’on était fier d’être Français en voyageant à l’étranger à cette époque !
En visitant le champ de bataille de Dresde, nous vîmes le monument élevé sur l’emplacement où Moreau, traître à son pays, fut atteint mortellement par un boulet parti d’une des batteries de la Garde, que l’Empereur avait fait pointer sur le groupe doré que formait l’état-major d’Alexandre. Ce monument entouré de quatre peupliers est très simple. Il consiste en un bloc de granit surmonté d’un casque et d’un glaive romain avec une inscription commémorative.
Notre dernière étape vivant de rentrer en France était Bade. Bade si abandonné depuis 1871 !
C’était alors le rendez-vous de toutes les élégances de Paris et de l’Europe. On y coudoyait à chaque pas des Altesses, quand ce n’étaient pas des têtes couronnées.
Ajoutez à cela un site enchanteur, des promenades ravissantes : le vieux château, l’allée de Lichtenthal et son couvent, Eberstein et la Favorite.
De plus, le salon de conversation, la salle des jeux, le théâtre du casino où l’on entendait les meilleurs chanteurs de Paris, où l’on jouait les plus jolies pièces du répertoire ; et enfin l’excellente musique autrichienne venant de Rastadt se faire entendre deux fois par semaine au kiosque.
Arrivés à Bade en septembre, nous y apprenions parle télégraphe la victoire de l’Alma remportée le 20 de ce mois sur les Russes par le maréchal de Saint-Arnaud.
Je vois encore la joie de mon père et Ja façon enthousiaste dont il s’entretenait de cet événement avec ses voisins de table d’hôte, lorsque par hasard ils parlaient français.
Il appartenait à cette génération qui, bien que née au bruit du canon de Wagram, avait assisté aux désastres qui marquèrent la chute du premier Empire. Mon père se rappelait qu’en 1815, au château de Chevilly, près Paris, appartenant à un de ses oncles, il avait été obligé de porter des fruits aux Cosaques du grand-duc Constantin qui s’y trouvait logé. Il avait conservé très vive la haine de l’étranger et l’extrême désir de voir laver l’affront infligé à la France par les deux invasions.
Cette première victoire du second Empire annoncée si brillamment par le rapport de Saint-Arnaud à l’Empereur et qui commentait ainsi : « Sire, le canon de Votre Majesté a parlé. L’armée russe, forte de plus de 40 000 hommes, occupait les hauteurs de l’Alma, etc. » lui causa un bonheur difficile à exprimer.
Il fut admirable ce jour-là, ce brave Saint-Arnaud que les conseillers municipaux de Paris ont voulu flétrir en débaptisant la rue qui portait son nom. Qu’ils sachent donc, s’ils l’ignorent, que ce maréchal de France, souffrant déjà du mal qui devait l’entraîner au tombeau quelques jours après son triomphe, se faisait, le jour de l’Alma, soutenir à cheval par deux cavaliers lorsqu’il craignait de faiblir au plus fort de la bataille.
Au lendemain du règne de la paix à tout prix que Louis-Philippe avait imposé au pays et surtout après les journées de Juin qui avaient menacé la société dans ses principes fondamentaux, la France reprenait possession d’elle-même. Elle se sentait protégée à l’intérieur par un gouvernement autoritaire et respectée au dehors après ce premier triomphe de son drapeau.
Le 16 mars 1856 tout le monde avait l’oreille tendue lorsque le premier coup de canon annonça la délivrance de l’Impératrice. Serait-ce un garçon ? Serait-ce une fille ? 21 coups de canon devaient annoncer la naissance d’une princesse et 101 celle d’un prince.
Au 21e coup l’anxiété était grande mais au 22e la joie la plus vive se manifesta. Dieu protégeait encore la France et l’heure des grandes catastrophes n’avait pas encore sonné.
Avec quel empressement on sortait de sa gaine le drapeau surmonté de l’aigle impériale pour l’accrocher à la fenêtre, et comme je courais avec le domestique acheter des lampions pour l’illumination du soir. Ce vieux lampion d’autrefois !
Il consistait en une petite soucoupe en terre contenant de la graisse et une mèche. Il fallait un temps infini pour l’allumer, il s’éteignait facilement et sentait bien mauvais.
La guerre de Crimée venait de finir.
Sébastopol était enfin tombé après un long et mémorable siège de deux ans.
Nos troupes revenaient couvertes de gloire et faisaient, à Paris, une rentrée triomphale.
L’armée, que l’Empereur était allé recevoir à la place de la Bastille, entra dans l’intérieur de la ville sous des arcs de triomphe, aux acclamations d’une foule ivre de joie et d’orgueil.
Napoléon III s’était placé pour le défilé devant le ministère de la justice, place Vendôme, ayant en face de lui au pied de la colonne d’Austerlitz les vétérans du premier Empire, dont la plupart avaient revêtu leurs anciens uniformes. Lorsque l’armée d’Orient passa devant ces vieux débris, ils attestèrent par leurs acclamations que leurs petits-fils n’avaient pas dégénéré.
A Colmar, où vint tenir garnison le 97e de ligne, les choses se passèrent plus simplement, mais n’en restèrent pas moins gravées dans mon souvenir.
J’étais allé avec mes parents chez des amis dont la maison se trouvait sur le passage de nos vaillants soldats.
Que c’était beau et à la fois triste de voir revenir ce régiment réduit à un bataillon ! Les hommes portaient sur leurs figures hâlées l’empreinte des souffrances éprouvées, mais leur œil était fier et leur allure bien martiale. Leurs longues capotes effiloquées faisaient penser aux vers de Béranger :
De quel éclat brillaient dans la bataille Ces habits bleus par la victoire usés !
Le drapeau à la soie déchirée et noire de poudre disparaissait sous les couronnes de fleurs, tous les hommes avaient des bouquets à leurs fusils, et la musique, composée à peine d’une quinzaine d’exécutants, jouait tant bien que mal un pas redoublé.
Je le répète, c’était beau et en même temps triste. Je leur jetai les fleurs que j’avais apportées et nous rentrâmes chez nous tout émus.
En 1857 mon père fut fait chevalier de la Légion d’honneur, et j’assistai avec mon frère à la remise de la croix qui lui fut faite, selon l’usage, par le premier président, toutes chambres assemblées.
Mon père était déjà ancien de service lorsqu’il fut décoré, car il était entré en 1832 dans la magistrature. Je ne l’avais cependant jamais entendu se plaindre de n’avoir pas encore reçu cette distinction qu’on accorde si facilement de nos jours, sous prétexte de services exceptionnels.
En septembre 1857 j’accompagnai mon père dans un second voyage en Allemagne. Nous gagnâmes Münich par Bâle, Schaffausen et le lac de Constance. Nous avions descendu, en bateau à vapeur, le Rhin jusqu’à cette dernière ville. Avant d’arriver à Ermatigen, on aperçoit à flanc de coteau et au milieu de beaux arbres le château d’Arenenberg, l’ancienne habitation de la reine Hortense et de l’Empereur lorsqu’il n’était encore que le prince Louis. En contemplant cette habitation d’une physionomie toute mélancolique, les vers que Mlle Delphine Gay adressait en 1828 à la reine exilée revenaient en mémoire :
Elle ne vient sur ces bords Réclamer un riche partage, Des souvenirs sont ses trésors Et la gloire son héritage.
Ce n’est pas sans une certaine émotion que nous vîmes disparaître, en doublant une petite presqu’île, les arbres du parc et le château d’Arenenberg.
Après avoir traversé le lac de Constance, nous arrivions à Lindau et nous couchions le soir même à Münich.
Les Bavarois sont très fiers de leur capitale qu’ils appellent pompeusement l’Athènes de l’Allemagne. Le style de beaucoup de ses monuments semble devoir expliquer cette dénomination, mais ce qui manquera toujours à Münich c’est le soleil et le ciel de la Grèce.
En dehors de la ville s’élève la statue colossale de la Bavaria, plus curieuse que vraiment belle.
Le matin du jour où nous allâmes la visiter, nous avions assisté au camp aune messe en plein air. Le coup d’œil était magnifique, l’uniforme bleu de ciel des soldats bavarois tranchant sur l’herbe verte. Le roi Maximilien II, entouré d’un nombreux état-major, assistait à la cérémonie. Le temps était superbe et lorsque, au moment de l’élévation, le canon tonna, que les tambours battirent et que la troupe mit le genou à terre. Nous nous sentîmes remués jusqu’au fond du cœur.
Hélas ! la France, reniant son passé, a supprimé tout cela, et ses soldats ne franchissent plus le seuil de l’église. C’est bien triste et peu digne de notre pays.
(En janvier 1883, étant capitaine au 11e chasseurs à cheval, j’ai été le dernier qui ait eu l’honneur de commander un escadron dans l’église de Saint-Germain-en-Laye pour les prières publiques, supprimées, du reste, peu après.)
A Münich, le château du roi et surtout la vieille résidence méritent d’être visités. N’oublions pas au château royal la salle dite des beautés, dans laquelle on a placé, par ordre du roi Louis, l’ancien protecteur de Lola Montes, qu’il fit comtesse de Lansfeld, une trentaine de portraits des plus charmantes femmes de tous les pays. Comme dans la chanson de Marlborough, il y en a des brunes, des blondes et des châtaines aussi. On sait que le roi Louis était grand admirateur du beau sexe.
Nuremberg, vieille ville moyen âge, nous intéressa beaucoup. Nous y vîmes arriver à huit heures du soir le roi Maximilien II. Sur le parcours de Sa Majesté les maisons, avec leurs vieux pignons, étaient illuminées. La voiture royale, escortée de chevau-légers portant des torches et traversant au trot ces antiques rues, présentait un spectacle d’un autre âge et vraiment féerique.
De Nuremberg, nous nous rendîmes à Wurtzbourg et à Francfort en passant par Hanau.
Hanau ! Ce fut la dernière victoire de l’Empereur au delà du Rhin. Les dispositions prises à cette bataille par le général bavarois de Wrede arrachèrent cette exclamation à Napoléon : « Ce pauvre de Wrede, j’ai pu le faire comte, mais je n’ai pu le faire général ! » et il passa sur le ventre des Austro-Bavarois en leur tuant dix mille hommes (30 octobre 1813).
A Stuttgart, le palais du roi nous parut très beau et nous y visitâmes les appartements que l’on préparait pour l’entrevue de Napoléon III et d’Alexandre II.
L’entrevue de Stuttgart ! Ce fut l’apogée du second Empire. Il y avait quarante-neuf ans que Napoléon Ier et Alexandre Ier s’étaient rencontrés à Erfurt. Comme à cette époque les deux souverains pouvaient se partager l’Europe. La suite des événements a prouvé qu’ils ne l’ont pas voulu.
En 1857, j’étais entré au lycée impérial. Ancien couvent de jésuites, c’était un superbe établissement sain et bien situé en face des Vosges.
A propos d’enseignement et d’Alsace, je veux dire un mot du peu de progrès que la langue française avait faits dans cette province depuis la conquête. La langue est en effet le signe de la race et tous les efforts des gouvernements qui se sont succédé en France depuis 1648 auraient dû tendre à extirper par tous les moyens possibles cette langue allemande mal prononcée, il est vrai, en Alsace, ce qui lui donne l’aspect d’un patois ! Cependant, en captivité en 1870, tous les soldats Alsaciens servaient d’interprètes à leurs camarades de l’intérieur.
Nous sommes arrivés à Colmar en 1851, deux cent trois ans après l’annexion. Eh bien ! il était souvent difficile de se faire comprendre même dans les magasins importants. Quant aux gens du peuple, ils ne parlaient pas un mot de français.
Les affiches de la préfecture ou de la mairie étaient rédigées dans les deux langues. L’ignorance de la langue française n’empêchait pas de faire partie du jury et la nécessité d’avoir un interprète prolongeait énormément les débats. Dans la montagne, tous les poteaux indicateurs étaient en allemand.
Les curés prêchaient en allemand dans les villages. Dans les villes le français leur était imposé, mais l’accent de ces dignes prêtres était si déplorable qu’un sermon devenait incompréhensible pour la grande majorité des assistants.
Mgr André Rœss, mort en 1888 à quatre-vingt-quinze ans, était évêque de Strasbourg. Il vint à Colmar pour la confirmation que j’eus l’honneur de recevoir de sa-main. A cette cérémonie l’évêque nous fit un long sermon en allemand, donnant ainsi ex cathedra un exemple regrettable à un clergé trop enclin à le suivre.
Ce prélat ne parlait presque jamais français et de plus il était très hostile à la propagation de notre langue dans son diocèse. J’en veux pour preuve la conversation qu’il eut avec mon père qui faisait partie de ce qu’on appelait la délégation cantonale chargée d’inspecter les écoles :
— Monseigneur, dit un jour mon père à l’évêque de Strasbourg, je suis désolé de constater le peu de progrès que le français a fait dans nos écoles.
— Ah ! voyez-fous, mossié l’avocat chénéral, dit l’évêque avec son accent alsacien, le français il est la langue de Voltaire.
— C’est possible, lui répondit mon père, mais c’est aussi la langue de Bossuet.
— Oui, répliqua monseigneur de Strasbourg, mais si y savent le français, y liront Voltaire et Il n’y liront pas Bossuet.
Mon pauvre père se retira sans rien ajouter, car il aurait perdu son temps à lutter contre le germanisme et l’entêtement de Sa Grandeur.
Mgr Rœss, après 1870, siégea au Reichstag fort loin du banc des protestataires justement indignés de la violence faite à leur pays.
L’évêque avait une maison de campagne à Sigolsheim, près Colmar. J’allais quelquefois lui faire visite avec mes parents. Dans cette propriété il cultivait la vigne et le calembour. Comme on vantait la bonté de son vin : « Oui, disait-il, il est assez bon pour du vin mexicain, car c’est du Juarez (du jus à Rœss). »
Il n’en commettait pas seulement en Alsace. Étant un jour reçu aux Tuileries après la messe, l’impératrice Eugénie vint à lui dire qu’il devrait faire des quêtes pour élever une seconde tour à sa cathédrale : « Matâme, lui répondit-il, les et êques y sont pas tes faiseurs de tours. »
J’en passe et des meilleurs.
Mon père adressait, lorsqu’il faisait l’intérim du procureur général, des rapports au maréchal Canrobert, commandant alors à Nancy, dans lesquels il signalait ce fâcheux état de choses. Ces rapports n’étaient certainement pas lus. On fermait les yeux systématiquement aussi bien à Nancy qu’à Paris, et cela depuis Louis XIV.
Nous assistons depuis plus de vingt ans à une tout autre manière de procéder et, à part les vexations inutiles dont ils accablent le pays conquis, on ne peut s’empêcher de trouver que les Allemands sont dans le vrai.
Je ne vois pas bien l’évêque actuel de Strasbourg venant faire un sermon en français dans la cathédrale de Colmar. Il y a gros à parier qu’il n’en ferait pas un second. Nous étions plus indulgents pour Mgr André Rœss.
Il faut dire que depuis la conquête, les enfants alsaciens, pour faire enrager les vainqueurs, peut-être par esprit de contradiction, leur chantent sous le nez des refrains français qu’ils ont probablement appris avec beaucoup de peine.
Espérons que cette belle province d’Alsace nous reviendra un jour et mon vœu le plus cher est de voir avant de mourir le drapeau tricolore déployer de nouveau ses nobles plis sur les hauts sommets de ses montagnes !
Le 15 janvier 1858, nous apprîmes à Colmar l’attentat Orsini. Un peloton du régiment dans lequel je devais m’engager six ans plus tard, les lanciers de la garde, escortait le soir du 14 la voiture où se trouvaient l’Empereur et l’Impératrice se rendant à l’Opéra. Plusieurs cavaliers furent atteints par les bombes des régicides et elles frappèrent également bon nombre de personnes qui se pressaient aux abords du théâtre pour saluer les souverains.
Ces derniers furent miraculeusement préservés. Cet attentat, qui rappelait par son horreur celui de la rue Saint-Nicaise et la machine de Fieschi, souleva en France et en Europe une indignation bien naturelle.
J’assistais dans l’église au Te Deum qui fut chanté à cette occasion et mon émotion fut vive lorsqu’on entonna le Domine salvum fac imperatorem.
On ne peut nier que l’action criminelle d’Orsini et de ses complices n’ait eu sur les événements de 1859 une influence réelle, mais l’attitude et l’agression de l’Autriche achevèrent de décider Napoléon III à voler au secours de son allié le roi de Sardaigne.
Je me souviens de l’enthousiasme qui accueillit la belle proclamation datée de Gênes que l’Empereur adressait à l’armée d’Italie :
« Je n’ai pas besoin de stimuler votre ardeur, disait-il à ses soldats, chaque étape vous rappellera une victoire.
« Dans la voie Sacrée de l’ancienne Rome les inscriptions se pressaient sur le marbre pour rappeler au peuple ses hauts faits ; de même aujourd’hui, en passant par Mondovi, Marengo, Lodi, Castiglione, Arcole, Rivoli, vous marcherez dans une autre voie sacrée au milieu de ces glorieux souvenirs... »
Depuis Napoléon Ier, les soldats français n’avaient pas entendu un plus noble langage.
Comme l’avait prédit la proclamation de l’Empereur, chaque étape de cette courte et brillante campagne fut marquée par un succès de nos armes : Montebello le 20 mai, Palestro le 31 mai, Magenta le 4 juin, Melegnano le 10 juin et enfin Solférino le 24 juin, suivie peu de jours après de la paix de Villafranca.
Toutes ces victoires remportées en si peu de temps étaient accueillies dans toute la France par les plus vives démonstrations de patriotisme et elles soulevaient le même enthousiasme dans le plus modeste hameau et au sein de la capitale.
Comme on était heureux, comme on était fier ! Au lycée, pendant les classes, notre esprit était bien loin du De viris ou du Conciones ; les Racines grecques même manquaient de charme. Soudain le canon retentissait, les cloches se mettaient à sonner et, lorsque nous sortions du lycée, nous apercevions des drapeaux à toutes les fenêtres. Alors nous courions à la préfecture où la foule se bousculait pour lire les dépêches. C’était encore une victoire ! et les cris de : « Vive l’Empereur ! » se confondaient avec ceux de : « Vive la France ! vive l’Italie ! vive l’armée ! »
Pour nous lycéens, nous avions, à chaque bataille, gagné un ou deux jours de congé. Les Te Deum succédaient aux Te Deum et les illuminations aux feux d’artifice.
Je sais qu’on est toujours tenté de trouver mieux ce qui se faisait autrefois, mais véritablement il y avait plus d’enthousiasme dans les manifestations populaires sous l’Empire qu’aux fêtes actuelles. Ceci s’explique facilement parce que l’opposition n’existait pas plus à la Chambre que dans le pays. On peut le dire hautement, jamais gouvernement ne fut moins discuté que le second Empire, on l’acclamait sincèrement le jour du 15 août, et la cantate, dont je me rappelle le refrain et que nous apprenions à chanter au lycée à cette occasion, était bien alors l’expression du sentiment public.
Voici le refrain de cette cantate dont Gounod avait fait la musique :
Vive l’Empereur ! (bis) C’est l’élu de la France, Il fut son sauveur, Il est son espérance. Le cri de France (bis) Est vive l’Empereur ! Vive, vive l’Empereur !
A la fin d’août 1859, des détachements du 6e d’artillerie-pontonniers, revenant d’Italie, passèrent à Colmar. Ils retournaient tenir, garnison à Strasbourg. Je courus au petit terrain devant le quartier de cavalerie, où leurs équipages de pont étaient parqués et leurs chevaux à la corde. Il m’était donné d’examiner de près, pour la première fois, des hommes et des chevaux venant de faire campagne. Eh bien ! mon impression fut celle-ci : « Mon Dieu, si les vainqueurs sont dans cet état, comment sont donc les vaincus ! » Des chevaux tellement maigres que les os perçaient la peau, des hommes épuisés, hâlés, les vêtements sales et raccommodés tant bien que mal. Les armes seules brillaient, faisant contraste par leur propreté avec le reste de l’équipement.
Après les pontonniers, ce fut le tour des prisonniers autrichiens qui regagnaient leur pays par le grand-duché de Bade et la Bavière. Plusieurs convois de ces malheureux passèrent à la gare de Colmar et parmi eux de nombreux blessés.
Toute la société de la ville s’était portée sur leur passage et munie de tabac, d’argent et de friandises avait envahi le quai du chemin de fer. La corporation des vignerons avait apporté des hottes de vin blanc. Chaque convoi de prisonniers était de mille à quinze cents hommes. La plupart de ces Autrichiens étaient très jeunes et beaucoup portaient, avec une certaine élégance, la tunique blanche, la culotte collante bleu de ciel, et la petite bottine hongroise. J’adressai la parole en allemand à plusieurs d’entre eux. Ils paraissaient enchantés de la façon dont ils avaient été traités en France, et surtout de la fin des hostilités qui leur permettait de retourner dans leur pays. Je ne me doutais pas alors que douze ans plus tard je passerais par les mêmes émotions ; c’est-à-dire bonheur de fouler de nouveau le sol de la patrie, après avoir ressenti en Allemagne toute l’amertume de la captivité.
Un de nos cousins, alors capitaine au 7e chasseurs à pied en garnison à Strasbourg, me racontait qu’il fut désigné avec sa compagnie pour conduire à Kehl le dernier convoi de prisonniers, pour les remettre entre les mains des autorités allemandes.
Kehl et son pont de bateaux sur le Rhin ! Que de fois je l’ai traversé lorsque nous revenions de nos voyages d’Allemagne. Le chemin de fer s’arrêtait à Kehl, et on prenait une diligence qui vous conduisait à Strasbourg. Le Rhin était majestueux à cet endroit et roulait lentement ses eaux vertes. Quel beau fleuve ! Il m’a toujours plus impressionné que les autres fleuves de France. La voiture s’engageait lentement sur le pont de bateaux qui remuait, et l’on se penchait aux portières pour apercevoir la flèche de la cathédrale se détachant à l’horizon. Tout à coup la vue s’arrêtait sur deux soldats en faction au milieu du pont et se touchant presque. Cependant ces deux hommes ne se parlaient ni ne quittaient le poteau près duquel chacun avait été placé ; ils se contentaient de se regarder fièrement. Le premier poteau, rayé de rouge et de jaune, supportait les armes de Bade, et son factionnaire, coiffé du casque à pointe, indiquait qu’à cet endroit du vieux fleuve finissait l’Allemagne. L’autre poteau était gardé par le second soldat. En apercevant, surtout après un long voyage, son pantalon rouge, sa capote grise et son shako à la visière crânement relevée, vous étiez ému, et le battement plus vif de votre cœur vous avertissait qu’à ce moment vous entriez en France.
Quand nous sera-t-il donné de le revoir, ce brave petit pioupiou montant la garde au milieu du pont du Rhin !
Mais je vois que je m’écarte un peu des chasseurs du 7e bataillon, venus pour conduire à Kehl les prisonniers autrichiens.





























