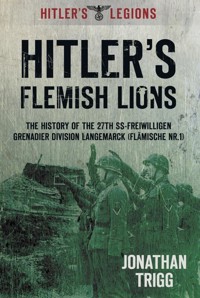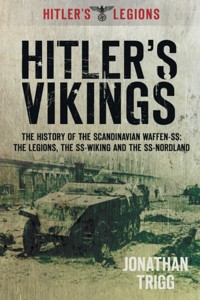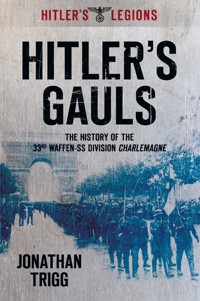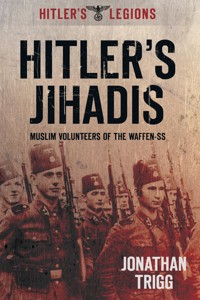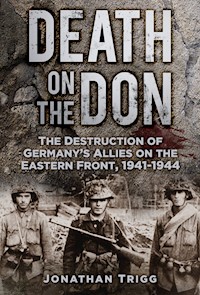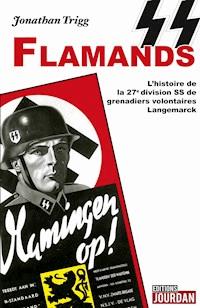
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jourdan
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
L’histoire de la 27ème Division SS de grenadiers volontaires « Langemarck »
Pendant la guerre 1940-1945, 23.000 Flamands s’engagèrent dans la SS. 11.000 Wallons choisirent également de porter l’uniforme noir des troupes d’Himmler. Cette différence s’explique par la volonté des dirigeants des formations nationalistes flamandes de l’époque, VNV, Dinaso et De Vlag, de persuader un maximum de jeunes gens de s’enrôler aux côtés des Allemands, dans l’espoir que les occupants reconnaissants accorderaient à la Flandre une autonomie plus grande, voire l’indépendance. Le communautaire, qui s’exprimait déjà en 1917, quand le Raad van Vlaaderen proclama l’indépendance unilatérale de la Flandre, n’est jamais absent des grands événements en Belgique. Les partis nationalistes en furent pour leurs frais : les Allemands considéraient les territoires occupés comme des vaches à lait, et rien d’autre. Parmi ces 23.000 hommes, la majorité fut contrainte de s’enrôler après le Débarquement du 6 juin 1944, après la fuite précipitée en Allemagne de tous ceux qui avaient collaboré de façon trop ostentatoire avec les nazis, et principalement les membres des nombreuses formations paramilitaires qui fleurirent dans le pays. Pendant les années qui précédèrent, le noyau des volontaires flamands qui combattirent en même temps dans diverses unités de la Wehrmacht et de la SS ne dépassa pas les 6.000 hommes. C’est l’histoire de ceux-ci, de la Légion SS Flandre jusqu’à la 27ème Division SS de grenadiers volontaires « Langemarck » que l’auteur raconte. Jonhattan Tripp, ancien militaire et spécialiste des formations de volontaires pendant la dernière guerre, constate que les Flamands combattirent courageusement, gagnant une réputation méritée de bravoure et de solidité au combat. 5000 devaient mourir au front. Il conclut qu’il fut dommage que tant de qualités aient été mises au service d’une si triste cause. L’histoire de ces jeunes hommes partis parfois combattre au nom d’une croisade antibolchevique, mais le plus souvent au nom du nationalisme flamand, continue de nos jours à empoisonner la vie politique blege. Les héritiers du VNV, Dinaso et autres De Vlag, ont largement contribué à l’émergence des modernes partis nationalistes flamands.
Le destin des flamands enrôlés dans les forces SS.
EXTRAIT :
La chaleur était accablante. Le jeune volontaire brugeois essuya la sueur dégoulinant de son front, mais ses yeux étaient encore brûlés par le sel de la transpiration qui coulait sur son visage tanné par le soleil.
Il risqua un rapide coup d’oeil sur son voisin de droite et éprouva une sorte de réconfort en constatant qu’il transpirait, lui aussi, abondamment, et qu’il paraissait diablement nerveux.
Son camarade le regarda à son tour, et ils grimacèrent de concert, la seule chose qu’ils puissent faire pour éviter d’éclater de rire.
Ils avaient pris position dès l’aube, et n’avaient pas encore eu l’occasion de se battre. Il y avait bien eu un échange de projectiles de part et d’autre, et la mort et les blessures frappant les hommes au hasard.
En ce torride mois de juillet, le soleil tapait de plus en plus fort, et personne n’avait encore eu la possibilité de boire ou de rechercher un coin d’ombre. Derrière eux, les jeunes volontaires entendaient les cris et les râles de leurs camarades blessés, et suivaient par la pensée les courses précipitées des brancardiers qui ramenaient vers l’arrière les morts et les blessés.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Mémorial de Courtrai en 1941, le jour de la commémoration de la Bataille des Éperons d’or en 1302.
Gustave « Staf » De Clercq, le charismatique chef du nationaliste Vlaamsch Nationaal Verbond.
Je souhaite ici exprimer ma gratitude à une série de personnes sans l’aide desquelles ce livre n’aurait jamais été écrit.
En premier lieu aux vétérans flamands, ceux de la Légion Flandre et ceux de la Langemarck.
Leur nombre diminue avec le temps qui passe inexorablement, et il y a quelques années déjà que Remy Schrijnen et Georg D’Haese ont disparu. Mais, comme d’habitude, sans l’aide et la patience de vétérans qui ont répondu à des questions sans fin, et ennuyeuses à mourir, sur d’obscurs détails d’événements qui se sont passés il y a plus de soixante ans, cet ouvrage aurait été impossible à écrire.
Merci à nouveau à Madame Notzke, du service des Archives de l’Allemagne fédérale. Je pense qu’elle a dû se résigner à répondre à mes multiples correspondances depuis le début de cette série d’ouvrages consacrés aux Légions d’Hitler, à moins qu’elle ne se décide de se trouver un autre travail !
Merci à mes éditeurs : à Jamie pour m’avoir conseillé d’entreprendre ce long voyage dans le temps, et à Shaun pour ses encouragements répétés.
Mes remerciements réitérés à mon plus vieil et meilleur ami Tim : ton aide est devenue une sorte d’habitude.
Comme tout auteur d’ouvrages consacrés à l’histoire militaire vous le confirmera, un des défis majeurs est de trouver des photographies, à la fois intéressantes et se rapportant au texte, et peut-être avoir la chance de tomber sur le « Saint Graal », des documents qui n’ont jamais été publiés. Cette tâche m’a été grandement facilitée, avec l’aide de vraies stars de ce domaine, dans le monde entier. Alors, merci à Kris Simoens, René Chavez, Michel Breiz, Sébastien J. Bianchi et James Mac Leod, et mes remerciements particuliers à Luc De Bast pour m’avoir autorisé l’accès à son étonnante collection privée.
Merci à tous ceux qui ont acheté et lu mon précédent ouvrage, les Gaulois d’Hitler. Si personne ne l’avait fait, ce livre n’aurait jamais vu le jour.
Et enfin, je tiens à exprimer ma gratitude à ma merveilleuse épouse, qui m’a soutenu pendant la rédaction de cet ouvrage, et à mes enfants, Maddy et Jack, qui au moins essayèrent d’arrêter de bailler pendant que leur père leur expliquait ce qu’il était en train de faire.
INTRODUCTION
La chaleur était accablante. Le jeune volontaire brugeois essuya la sueur dégoulinant de son front, mais ses yeux étaient encore brûlés par le sel de la transpiration qui coulait sur son visage tanné par le soleil.
Il risqua un rapide coup d’œil sur son voisin de droite et éprouva une sorte de réconfort en constatant qu’il transpirait, lui aussi, abondamment, et qu’il paraissait diablement nerveux.
Son camarade le regarda à son tour, et ils grimacèrent de concert, la seule chose qu’ils puissent faire pour éviter d’éclater de rire.
Ils avaient pris position dès l’aube, et n’avaient pas encore eu l’occasion de se battre. Il y avait bien eu un échange de projectiles de part et d’autre, et la mort et les blessures frappant les hommes au hasard.
En ce torride mois de juillet, le soleil tapait de plus en plus fort, et personne n’avait encore eu la possibilité de boire ou de rechercher un coin d’ombre. Derrière eux, les jeunes volontaires entendaient les cris et les râles de leurs camarades blessés, et suivaient par la pensée les courses précipitées des brancardiers qui ramenaient vers l’arrière les morts et les blessés.
Mais cela devint brusquement le cadet de leurs soucis ; toute leur attention était désormais attirée par les lignes ennemies qui commençaient à se déployer. Tout au long du front, les troupes se préparaient en vue de ce que chacun pressentait comme la charge décisive.
Les Flamands ajustèrent leurs casques et empoignèrent leurs armes. La bataille allait commencer et, Dieu, qu’ils étaient nombreux ! Les Flamands savaient qu’ils devaient tenir bon. Tenir, c’était leur seule chance de survie. Rompre le combat, c’était l’assurance de se voir tailler en pièces.
La même pensée envahit de nombreuses têtes flamandes : « Ils sont si nombreux, équipés de ce qu’il y a de meilleur. Comment pourrons-nous tenir bon ? » Une question à laquelle ils allaient bientôt connaître la réponse. La ligne ennemie s’ébranla, puis s’arrêta pour permettre aux fantassins d’aligner les rangs d’un pas saccadé. Puis, la course reprit et l’allure augmenta, accompagnée par de rauques hurlements et des cris d’encouragement.
De leur côté, les Flamands restaient silencieux. Seule la discipline maintenait leur cohésion, elle et la proximité de leurs camarades.
Car fuir est facile, si l’on est seul. Mais quand on est entouré par des gens habitant à deux pas de chez vous, c’est la chose la plus difficile à faire. Si l’un d’entre eux venait à déposer les armes, chacun le saurait et le déshonneur serait insupportable. Et ainsi, soudés par la peur de cette disgrâce autant que par une discipline de fer, les jeunes combattants de la petite Flandre tenaient le coup et attendaient l’ennemi de pied ferme, la gorge sèche et la vessie soudain prête à éclater.
L’ennemi chargeait maintenant à pleine vitesse. Les cris de bataille et le martèlement des pieds sur le sol frappèrent les lignes flamandes de plein fouet, et qui furent agitées d’une sorte de frisson.
Les attaquants le remarquèrent et hurlèrent de joie. L’ennemi allait rompre et ils allaient être massacrés. Mais le dispositif flamand tint bon, et parut même se renforcer, ce que l’assaillant nota avec une brusque inquiétude.
La cavalerie française ne réalisa que trop tard que les Flamands les attendaient de pied ferme. Ceux des chevaliers qui tentèrent de faire demi-tour ne réussirent qu’à briser l’élan de la charge. La grande majorité vint se briser sur le mur flamand de piques et de fers de lance. Les fantassins du Nord se jetèrent alors dans la mêlée avec leur « goedendag », dans un enchevêtrement d’hommes et de chevaux, anéantissant la fine fleur de la chevalerie française.
L’issue de cette bataille constitua un désastre militaire pour la France. Cette cavalerie, reconnue comme l’élite du monde militaire, et qui avait dominé les champs de bataille européens pendant des siècles, fut défaite à Courtrai l’après-midi du 11 juillet 1302, dans une fin sanglante et sans gloire.
Courtrai fut une bataille pivot dans l’histoire du Moyen Âge en Europe, qui annonçait les futures victoires des Écossais à Bannockburn en 1314 et des Suisses contre les Autrichiens à Morgarten en 1315. Ce n’est pas une coïncidence si ces trois batailles furent gagnées par des peuples, précédemment soumis, sur leurs anciens maîtres, et si l’on y enregistra la victoire de la piétaille sur des armées de chevaliers en armures, chevauchant leurs puissants destriers.
Ce livre, le second de la série « Les Légions d’Hitler », raconte les hommes de Flandre qui combattirent par milliers aux côtés des Allemands, d’abord dans la Légion SS Flandre, ensuite dans la brigade SS Langemarck, et finalement dans la 27e Division SS de Grenadiers volontaires « Langemarck » (la n° 1 flamande).
Bien que ne constituant pas une nation souveraine, et avec une population inférieure à celle de Birmingham, au Royaume-Uni, la Flandre fournit au Troisième Reich plus de volontaires que la Grande-Bretagne, la France, la Suède, la Norvège et le Danemark réunis.
Dans le même temps que leurs voisins immédiats, et cousins de race, les Hollandais, les Flamands envoyèrent plus de volontaires, proportionnellement à leur population, que n’importe quel pays d’Europe occidentale.
Et non seulement ils fournirent un grand nombre de combattants, mais ceux-ci se couvrirent de gloire dans les sanglantes batailles du front de l’Est dès le début des hostilités contre l’Union soviétique.
Sur les 38 divisions SS créées jusqu’à la fin du conflit, à peu près la moitié étaient composées soit d’étrangers, soit de « Volksdeutsche » (des citoyens d’origine allemande nés hors des frontières de l’Allemagne avant le début de la guerre).
Mais beaucoup de ces formations contribuèrent médiocrement, sinon pas, à l’effort de guerre nazi.
Ce qui ne fut pas le cas des Flamands. Du terrible siège de Leningrad en 1941, à la boucherie de la Poche de Volkhov en 1942, de la défense désespérée de l’Ukraine en 1943-44 à la fameuse bataille des Européens SS à Narva en Estonie en 1944, et finalement à l’enfer neigeux de Poméranie sur l’Oder en 1945, les Flamands firent preuve de leur valeur au combat.
Mais qui sont exactement les Flamands ? La Flandre constitue la moitié nord de la Belgique, à quelques heures de navigation des côtes anglaises. Les Flamands sont officiellement des Belges, mais pourquoi ne combattirent-ils pas avec cette icône du mouvement légionnaire étranger pendant la Seconde Guerre mondiale, Léon Degrelle et ses rexistes ? Après tout, il était Belge. Y avait-il de telles différences entre Degrelle et ses hommes d’une part et les Flamands d’autre part, de sorte qu’il était impossible qu’ils servent ensemble ?
Degrelle et ses volontaires débutèrent comme volontaires dans la Heer, l’armée de terre allemande, et non comme Waffen SS, tandis que les Flamands furent eux incorporés, dès le début, dans la Waffen SS.
Quelle était la différence ? La réponse est complexe, et plus encore que n’importe quelle autre réponse dans l’histoire des volontaires étrangers de la Seconde Guerre mondiale ; cette complexité est le fruit de l’histoire et de traditions.
Toute tentative d’explication des nombreuses motivations des volontaires d’Hitler doit commencer par l’évocation du climat d’antibolchevisme particulièrement virulent de l’époque. À cette période de l’histoire, beaucoup craignaient que la civilisation d’Europe occidentale ne soit menacée par les hordes barbares de l’Est. (Il va sans dire que les volontaires en provenance d’Union soviétique partageaient ces sentiments d’anticommunisme, mais sans éprouver les mêmes préjugés envers les populations de l’Est.)
Mais une partie de ce qui rend l’engagement des Flamands si intéressant est que, contrairement aux motivations de l’engagement de leurs camarades dans d’autres formations de volontaires, l’anticommunisme n’était pas la principale raison de leur participation à la guerre. Le principal motif était plutôt le nationalisme du peuple flamand, une très vieille revendication qui n’avait encore débouché sur aucun résultat.
L’histoire de la Waffen SS flamande doit être considérée comme un des chapitres de l’Histoire d’une lutte commencée il y a plusieurs siècles, et qui continue encore de nos jours avec les gesticulations politiques du parti d’extrême droite flamand, le Vlaams Blok et son successeur, le Vlaams Belang.
Si l’on veut comprendre les volontaires SS de la Langemarck, il faut comprendre qui sont les Flamands. Leur identité comprend les tumultueux événements du Champ des Éperons d’Or, au moment de la Bataille de Courtrai pendant cet été torride de 1302.
Staf De Clercq (au centre, bras tendu) s’adresse à des militants sur la Grand Place de Bruxelles.
L’HISTOIRE DE DEUX PEUPLES : LES FLAMANDS ET LES WALLONS
La Belgique est un petit pays qui compte 10 millions d’habitants. Sa frontière nord-est celle qui la sépare des Pays-Bas. Pour le reste, elle est entourée de deux géants : l’Allemagne à l’Est et la France à l’Ouest et au Sud.
La moitié sud du pays est la Wallonie, avec les villes de Liège, Charleroi et Namur. Elle représente un peu moins de 40 % de la population. Les Wallons sont les héritiers des Gaulois par la langue, la culture et l’allure. Ses habitants parlent le français et se situent dans la mouvance culturelle de la France.
La moitié nord du pays, comprenant les Provinces de Flandre occidentale et orientale, d’Anvers, du Limbourg et le Brabant flamand, constitue le territoire de la Flandre. Les Flamands sont majoritaires dans le pays et représentent 60 % de la population. Ils parlent leur propre langue, proche du néerlandais et de l’allemand. Le paysage, comme beaucoup de ceux du plat pays, est encore assez rural, avec des campagnes fertiles et monotones. Les villes y sont prospères et bien entretenues, et quelques centres historiques comme Bruges, Gand et Anvers dominent le paysage géographique, politique et culturel. La différence de race entre ces deux populations, la flamande et la wallonne, est l’élément dominant de toute l’histoire du pays, et le facteur le plus important si l’on veut comprendre l’histoire des hommes qui combattirent dans la Langemarck.
ROME ET LES BELGES
La Belgique d’aujourd’hui doit son nom à celui d’une tribu celtique, les Belges. En même temps que toute l’Europe celtique (à l’exception de l’Écosse et de l’Irlande), les Belges furent vaincus par les légions romaines.
Pendant plus de quatre siècles de pax romana, les Celtes se romanisèrent et leurs terres fertiles s’intégrèrent à l’Empire. Mais finalement, tout au début du IVe siècle, le territoire de la Rome impériale fut menacé par la marée de tribus germaniques s’approchant inexorablement de la frontière constituée par le Rhin.
LES GERMAINS ARRIVENT
Bien qu’en ce temps-là il était admis que l’Empire faisait face à une série d’invasions, nous savons aujourd’hui que ces événements constituaient le résultat de migrations importantes commencées à l’Est, à des milliers de kilomètres de là. Des peuples nomades comme les Scythes, et surtout les Huns, se mirent en route vers l’Ouest, à la recherche de nouveaux pâturages et de territoires de chasse. Ils déplacèrent les tribus rencontrées, qui, à leur tour, chassèrent les autres, et ainsi de suite.
Le résultat fut un tsunami qui vint submerger l’Empire romain d’Occident à un moment où celui-ci se trouvait dans un grand état de faiblesse, le plus important depuis des siècles.
Pour la Gaule romaine, cela signifia une foule de féroces Teutons arrivant par vagues successives sur leur territoire pendant plus d’un siècle. Certains de ces barbares traversèrent le pays vers d’autres provinces : Visigoths et Ostrogoths en Espagne, les Vandales en Afrique du Nord et les Lombards dans le nord de l’Italie.
Certains s’établirent dans des territoires auxquels ils donnèrent leur nom, comme les Burgondes. D’autres asservirent les peuplades qui y avaient toujours vécu.
Une de ces tribus était celle des Francs. Comme dans beaucoup de peuplades teutonnes, leurs guerriers étaient grands, avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Ils s’installèrent en Gaule, soumirent le pays, construisirent des maisons et se mirent à cultiver et à commercer.
Ils s’installèrent massivement dans quelques endroits, mais la plupart d’entre eux étaient disséminés sur le territoire où ils étaient largement inférieurs en nombre aux Gallo-Romains. Ils se marièrent entre eux, assimilant la langue et le mode de vie de leurs hôtes.
Ainsi, une France commença à définir son identité propre, pas teutonne, mais gauloise. Ce qui signifie que la frontière raciale entre les envahisseurs germaniques et le monde gallo-romain ne se situe pas en France, mais en Belgique, et plus précisément au milieu du pays.
LA FLANDRE GERMANIQUE
La Flandre fut l’extrême limite du mouvement migratoire des Teutons en Europe occidentale. Cette situation peut se comparer aux plaques tectoniques de la croûte terrestre et aux pressions et cataclysmes résultant de leurs chocs. C’est le destin de la Flandre d’appartenir à une « plaque raciale » qui sépare les peuples germaniques du Nord et du Centre de l’Europe de leurs voisins latins et celtes du Sud et de l’Ouest.
Cette ligne de démarcation commence dans le Haut Adige (l’ancien Tyrol du Sud de l’Empire Austro-hongrois), italien de nom et germain de sang. Elle s’infléchit vers le Nord-Ouest, traverse la mosaïque suisse, passe par les régions longtemps controversées d’Alsace-Lorraine, puis le Luxembourg, la Hollande et enfin la Flandre.
Les Néerlandais arrachèrent leur indépendance à l’Espagne impériale en 1581.
L’histoire de la Flandre n’est pas celle d’une nation indépendante, mais celle d’un conflit larvé avec leurs voisins du Sud, et des désastres causés par les guerres entre la France et l’Allemagne.
LA FLANDRE MÉDIÉVALE
La Flandre connut son apogée pendant l’époque médiévale. Toute la population flamande qui englobe aujourd’hui la Flandre moderne, le Nord de la France et le sud des Pays-Bas, tomba sous le contrôle de l’ancien Comté de Flandre et de son voisin le Duché de Brabant. Ces deux petits, mais influents territoires, étaient au cœur de la civilisation occidentale et furent courtisés ou combattus par une succession de monarques de toute l’Europe, en raison de leur puissance, leur richesse et leur situation géographique. Les Flamands et leurs cousins hollandais étaient à l’avant-garde du commerce européen et des industries bourguignonnes, en particulier le tissage, la confection et le travail des métaux.
Pour les rois d’Angleterre, la Flandre représentait un tremplin vers l’Europe, et un débouché pour la majeure partie de la production de l’« or blanc » du pays : la laine de mouton. En effet, les grands troupeaux de moutons qui couvraient l’Angleterre et le Pays de Galles fournissaient des montagnes de laine aux ateliers flamands, qui transformaient les toisons de haute qualité en vêtements pour toute l’Europe et même au-delà de ses frontières. Le poids de ces échanges commerciaux était si considérable, surtout pour l’Angleterre, que le Lord Chancelier du Royaume-Uni prend place à la Chambre des Lords, encore de nos jours, sur un vieux morceau de sac de laine.
COURTRAI : LE BANNOCKBURN FLAMAND
La puissance commerciale de l’Angleterre était placée sous la protection de ses rois. Les Flamands ne disposaient pas d’une protection équivalente pour la défense de ses intérêts. Ils se réunirent donc dans des guildes puissantes, aux structures complexes et aux codes très stricts, en vue de régler les affaires et de promouvoir leur puissance financière et leur influence. Avec le temps, les guildes en vinrent à dominer les grands centres du pays, comme Anvers, Bruges et Gand, ainsi que les campagnes environnantes. Ce type d’organisation était en marge du modèle féodal de la société européenne d’alors, et ne se reposait pas sur les campagnes pour l’affirmation de sa puissance. De plus, les guildes étaient contrôlées par des marchands et des artisans, plutôt que par de grands propriétaires féodaux.
Ceci constituait bien sûr une sorte d’anathème pour la France féodale, qui couvait la Flandre de regards envieux. En 1300, le roi Philippe le Bel tenta d’annexer le Comté en emprisonnant le Comte de Flandre, Guy de Dampierre, et son homme lige, Philippe de Chatillon. Le mécontentement déferla sur tout le pays, conduisant, en 1302, au massacre du Vendredi Saint de tous les ressortissants français de Bruges. Ce furent les célèbres Matines Brugeoises. La réaction française fut l’envoi d’une puissante armée placée sous les ordres du Comte Robert II d’Artois, pour punir le soulèvement.
Après s’être rassemblée à Arras, dans le Nord de la France, l’armée française prit la direction de Courtrai, la porte d’entrée des Flandres. L’armée de Robert d’Artois était impressionnante. Elle comptait à peu près 8 000 hommes, dont 1 000 arbalétriers, 1 000 piqueurs et 3 500 fantassins. Mais au centre de ce dispositif se déployaient 2 500 cavaliers en armures. C’est cette force qui rendait l’armée française vraiment dangereuse.
L’art de la guerre en Europe était encore dominé par des cavaliers recouverts d’une armure et maniant l’épée et la lance, protégés de surcroît par un bouclier. La méthodologie militaire de l’époque considérait que, sur un champ de bataille, un seul de ces cavaliers valait 10 fantassins. On peut donc considérer que l’armée française comptait 30 000 hommes en termes d’équivalent combattants.
Les Flamands leur opposaient 9 000 hommes, rien que des fantassins, principalement des membres des milices des guildes. Willem van Gulick, le petit-fils du Comte Guy de Dampierre et Pieter De Coninck commandaient 2 500 soldats des zones côtières, et 2 500 autres venaient de la partie est de la Flandre, dont les 700 hommes de Jan Borluut de Gand et encore 500 autres venus d’Ypres. En réserve se trouvaient les 500 hommes de Jean de Renaix. Tous ces soldats étaient bien équipés : piques, armures de fantassins et boucliers. Mais ils étaient considérés comme de peu de poids par l’armée capétienne.
Les forces flamandes se mirent en marche vers Courtrai pour s’y emparer du château, mais par un caprice du destin, les deux armées ennemies arrivèrent simultanément sur les lieux. Ils passèrent les journées des 9 et 10 juillet à manœuvrer pour s’assurer un avantage géographique, mais finalement, les deux belligérants se retrouvèrent face à face le 11 dans une vaste plaine à l’est de la ville.
Le dispositif français était composé de dix divisions et on envoya d’abord les arbalétriers, couverts par de l’infanterie, attaquer les rangs flamands pour y causer d’importants dégâts, en espérant ainsi rompre leur formation, composée de blocs d’hommes répartis sur huit lignes successives. Les Flamands n’avaient d’autre issue que celle de résister, compter leurs pertes et attendre l’inévitable charge de cavalerie.
L’attaque de celle-ci était essentielle pour l’issue de la bataille : il s’agissait de la synchroniser pour, soit profiter de l’effondrement des premières lignes flamandes, soit les enfoncer. Si l’on s’en tient strictement à l’art de la guerre, les Français avaient l’avantage, et tout ce qu’ils avaient à faire était de patienter en maintenant discipline et cohésion. Ils ne firent rien de cela. Avec la morgue aristocratique des élites d’alors, ils chargèrent avant que leurs arbalétriers aient eu le temps d’infliger suffisamment de dégâts dans les rangs ennemis. Ils étaient persuadés de voir les Flamands faire demi-tour et s’enfuir, ce que ces derniers refusèrent obstinément de faire. Le résultat fut une défaite catastrophique pour les Français, une sorte d’avant-goût de ce qui allait se passer le siècle suivant à Crécy, Poitiers et Azincourt. La noblesse française fut mise à bas de ses superbes chevaux par une piétaille socialement inférieure, et taillée en pièces dans la boue. La majeure partie de l’armée française fut annihilée, et parmi les victimes un millier de leurs chevaliers, au nombre desquels soixante barons et autres seigneurs. Parmi les morts, on retrouva Robert d’Artois, commandant l’armée, le connétable de France, deux maréchaux, les Comtes d’Aumale, Dammartin, Eu et Ostrevent, le duc de Brabant, le gouverneur des Flandres imposé par Philippe le Bel, Jacques de Chatillon, et même le principal conseiller de Philippe le Bel, Pierre de Flotte. On ne dénombra qu’une centaine de victimes dans les rangs flamands. Les vainqueurs récoltèrent les éperons d’or des chevaliers défunts et en suspendirent 500 paires dans l’Église Notre-Dame de Courtrai. La bataille s’appelle, depuis lors, la Bataille des Éperons d’Or.
Les échos de la bataille retentirent dans toute l’Europe, qui fut choquée au point que l’on réveilla le Pape au milieu de la nuit pour lui apprendre la nouvelle. La nouvelle emplit Philippe le Bel de rage, lequel envisagea d’envoyer une armée plus importante pour écraser l’insurrection. À long terme, la Bataille des Éperons d’Or fut un précédent qui annonçait la fin de la suprématie du chevalier en armure, et celle du système féodal qu’il représentait.
Pour les Flamands, cette victoire emblématique, remportée contre toute attente, allait constituer le premier élément d’une identité nationale. Le 11 juillet est devenu le jour de la Fête nationale en Flandre et le bouclier de Pieter De Coninck, le lion noir sur fond jaune, un symbole national, reproduit sur les drapeaux de Flandre.
LES COUSINS DE HOLLANDE
La population flamande est estimée à 6 millions d’habitants, dont une centaine de milliers dans le sud de la Hollande, et un millier de descendants flamands dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, appelés la Flandre française.
La population des Pays-Bas est linguistiquement et culturellement proche de celle de la Flandre. Mais, chose importante, les Hollandais sont farouchement attachés à leur foi protestante. Les Flamands sont tout aussi fidèles à leur catholicisme romain. Et quand le Congrès de Vienne de 1815 créa le Royaume des Pays-Bas, rattachant les provinces flamandes et wallonnes à la Hollande, ce fut le début d’une longue série d’affrontements. Les catholiques furent traités comme des citoyens de seconde zone, jusqu’à ce que Flamands et Wallons mettent de côté leur traditionnelle inimitié pour se révolter contre les Hollandais et gagnent leur indépendance. Mais ce n’était pas le résultat espéré par les Flamands. Sous l’influence du Premier ministre anglais Lord Palmerston, les puissances européennes organisèrent une conférence, qui déboucha sur la reconnaissance du Royaume de Belgique en décembre 1830.
Cette décision plaça le jeune État dans une configuration de conflits mutuellement destructeurs entre ses composantes « tribales ». Elle portait en elle les ferments du nationalisme flamand, un facteur important dans l’émergence de la Langemarck et des unités Waffen SS. Composantes qui joueront également un rôle important dans l’histoire de Degrelle et de ses volontaires wallons.
Dans le nouvel État, la composante francophone allait rapidement dominer le gouvernement, le commerce et la culture. On disait alors en se gaussant que les Wallons avaient la culture, les Flamands l’agriculture. Ce sentiment de supériorité des francophones se manifesta par le dédain, ouvertement affiché, à l’égard de leurs compatriotes néerlandophones et à leur mode de vie. Le français était la langue officielle et le flamand, marginalisé. L’entrée et la carrière dans l’administration, les forces armées et la plupart des professions étaient conditionnées à la connaissance du français, plaçant les Flamands dans une situation désavantageuse. Et de fait, ce ne fut pas avant 1930 que l’Université de Gand devint la première université belge où les cours seraient donnés en flamand. Le résultat fut que la Wallonie décolla économiquement au point de devenir la première région d’Europe continentale à s’industrialiser.
Même la nouvelle monarchie, les Saxe-Cobourg, se francisèrent rapidement et ignorèrent leurs sujets flamands. Ces tensions dans la vie au cœur même de la Belgique allaient conduire à l’inévitable essor du nationalisme flamand.
Raymond Tollenaere, le chef de la paramilitaire Brigade Noire de la VNV avant la guerre, avant qu’il ne devienne un des premiers volontaires de la Légion SS Flandre.
LA MONTÉE DU NATIONALISME ET DE L’EXTRÊME DROITE
Comme beaucoup l’ont relevé dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, une des raisons de l’essor du nationalisme flamand peut se retrouver dans la boue et l’horreur des tranchées de la « der des der ».
Quand les troupes de Guillaume II envahirent la Belgique, en route vers Paris, dans un ruineux effort pour se conformer à la stratégie du Plan Von Schlieffen, l’état d’esprit qui submergea le pays fut de se regrouper derrière les couleurs nationales pour défendre la patrie contre l’envahisseur allemand. Par milliers, les Flamands qui se battirent furent si déçus par ce qu’ils vécurent dans l’armée belge que, quand la guerre se termina, les survivants allaient devenir le fer de lance d’un bruyant nouveau mouvement politique qui préparait le terrain à l’éclosion de la naissance de la Langemarck.
La plus grande partie de la Flandre et de la Belgique fut occupée et administrée par les Allemands à la façon d’un pays conquis. Seule une petite partie du territoire de la Flandre de l’Ouest, proche de la côte et s’étendant autour de la ville d’Ypres, demeura inoccupée. Le reste de la Belgique fut gouverné par le général allemand von Bissing, et après sa mort en 1917, par son successeur le général von Falkenhausen. Hasard de l’Histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la Belgique fut à nouveau occupée, elle le serait sous la férule d’un autre von Falkenhausen, le fils de celui de la Première Guerre.
Ce qui restait du territoire flamand devint le théâtre de la lutte titanesque menée par les grandes puissances de l’époque. « Flanders field » est devenu familier à tous les lecteurs anglo-saxons, les champs sanglants où s’affrontaient Britanniques et Allemands. Des noms comme Ypres, Menin et Passendaele seront liés, dans l’inconscient collectif, à la boue et au sang des tranchées. Les jeunes paysans et citadins, volontaires ou conscrits, vont se retrouver dans un environnement où ils sont considérés à peine mieux que de la chair à canon.
L’infanterie était flamande en grande partie et commandée par des Wallons francophones qui constituaient la majorité des officiers et des sous-officiers, lesquels ne faisaient guère d’efforts pour cacher leur dédain pour les soldats flamands. Le résultat était facilement prévisible. Des masses de soldats flamands déroutés étaient conduits au combat par des gradés qui ne se donnaient même pas la peine de leur expliquer ce qu’ils étaient supposés faire. Ils étaient fauchés lors des attaques, et à chacune d’entre elles, le ressentiment de la troupe grandissait.
LE CONSEIL DE FLANDRE
Sous le gouvernorat von Bissing, la Flandre occupée fut encouragée à s’émanciper politiquement. En 1917, environ 200 activistes nationalistes se réunirent sous l’appellation grandiloquente de « Conseil de Flandre ». Leur première intention était de donner à la Flandre une nouvelle autonomie politique, qui devint, avec le temps, le gouvernement provisoire d’une nouvelle entité indépendante. Le couronnement de ce mouvement fut la Déclaration d’indépendance de la Flandre, prise par le Conseil en décembre 1917. Ceci fut jugé, par l’occupant, comme un pas de trop ; une même réaction serait constatée par tous les mouvements nationalistes qui s’allièrent aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Von Falkenhausen, le successeur de von Bissing, réfréna les ardeurs du Conseil, puis le suspendit.
L’idéologie allemande durant les deux conflits peut avoir différé sur bien des aspects, mais reste constante dans son refus d’envisager une situation où ils ne restaient pas totalement les maîtres du jeu. Pendant la Première Guerre, elle affecta grandement la capacité des puissances centrales à combattre les Alliés. Dans la seconde, elle fut un facteur décisif dans l’issue du conflit. Les Alliés triomphèrent en partie grâce au refus nazi de considérer leurs satellites et alliés potentiels autrement que comme des peuples à exploiter. Le besoin de dominer à tout prix fut le talon d’Achille allemand pendant les deux guerres.
LE « FRONTBEWEGING » OU LA NAISSANCE DU NATIONALISME FLAMAND MODERNE
Comme chez beaucoup d’hommes jetés dans la boucherie du front de l’Ouest, une sensibilisation politique commença à naître chez certains soldats flamands, phénomène jusque-là inconnu.
De nombreux jeunes gens dépourvus d’opinion politique avant le conflit se mirent à penser aux politiciens et au système politique qui les avaient conduits dans un monde qui acceptait la mort de milliaers de braves pour le gain de quelques arpents de boue. Compte tenu des circonstances, il était quasi inévitable que le réveil politique flamand soit de caractère nationaliste, visant l’autonomie ou l’indépendance immédiate.
Les soldats baptisèrent leur mouvement le « Frontbeweging », le Mouvement du Front. Ils se réunissaient pour rédiger des journaux de tranchée et des feuillets d’information où l’on discutait de politique et où l’on évoquait les changements souhaités quand le conflit serait terminé. Le « Frontbeweging » se transforma rapidement en « Vlaamse Front », le Front flamand, une dénomination abandonnée très rapidement, pour finalement devenir le « Frontpartij » (Parti du Front). Ce sont les hommes et les principes de ce parti qui constituèrent les points de repère du nationalisme flamand pour le restant du siècle.
LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Dès la fin du conflit, révolutions et guerres civiles éclatèrent un peu partout en Europe, et principalement en Allemagne.
La France s’englua dans une instabilité politique chronique et des violences urbaines sporadiques. Le Luxembourg, la Belgique et la Hollande demeurèrent relativement calmes. La Hollande était restée neutre pendant le conflit, et la retombée la plus importante à laquelle ils durent faire face fut, sans doute, d’avoir donné l’hospitalité à l’empereur Guillaume II après son abdication.
Les Belges durent négocier d’importants changements de leur statut d’avant-guerre. En premier lieu, de larges portions du territoire avaient servi de champs de bataille et étaient dévastées. Bien que n’ayant pas souffert des pertes en vies humaines considérables qui caractérisèrent l’effort de guerre français, allemand, britannique et russe, les Belges déplorèrent 58 000 tués et blessés, plus quelques milliers de disparus. Ensuite, le nationalisme était sorti de la boîte de Pandore.
Les membres du collaborationniste Conseil de Flandre furent arrêtés, jugés et condamnés, aux acclamations bruyantes de la population wallonne : 112 membres écopèrent de longues peines de prison, et 45 meneurs furent condamnés à mort. En Flandre, ces procès ne conduisirent qu’à provoquer troubles et ressentiment, tant et si bien que le gouvernement fut contraint de commuer les sentences capitales en vue de désamorcer les tensions.
Cependant, en dépit du spectre de la collaboration planant sur le nationalisme flamand, le Frontpartij recueillit 57 422 voix lors des élections de 1919, envoyant 3 députés siéger à la Chambre des Représentants, qui en comptait 202.
En 1929, le parti tripla le nombre de ses représentants en enregistrant 132 962 suffrages. Bien que ce fut une force avec laquelle il faudrait désormais compter, il faut rappeler que le parti socialiste, le plus important à l’époque, totalisait 70 sièges. Cette importante progression incita un gouvernement embarrassé à faire des concessions et à voter une loi d’amnistie qui libérait tous les membres du Conseil de Flandre encore en prison.
Cette époque de croissance du nationalisme flamand vit entrer en campagne le chef du Conseil de Flandre, August Borms. Lors d’une élection partielle à Anvers en 1928, Borms fut élu à la Chambre avec un nombre record de plus de 40 000 voix, et cela alors qu’il purgeait encore sa peine en prison.
NATIONALISME ET EXTRÊME DROITE
Le nationalisme a une tendance naturelle à virer à droite sur l’éventail politique, et au plus le nationalisme est radical, au plus il se situe à droite. Ceci ne constitue pas une vérité absolue : l’IRA, tant officielle que provisoire, a longtemps mêlé ses visées nationalistes à une éthique socialiste. Mais plus souvent qu’à son tour, le domaine des activités nationalistes est celui de l’apologie de l’ordre, des valeurs familiales traditionnelles, d’une structure quasi militaire et des grands rassemblements de foules. Aucune réunion nationaliste de par le monde ne peut se concevoir sans sa mer de drapeaux et ses dévots à la cause, défilant en tenue paramilitaire ou dans de vieux uniformes. Cette dévotion à l’ordre et à la discipline ne semble cependant pas s’appliquer à leurs propres rangs, et il s’agit d’une autre caractéristique dominante des mouvements nationalistes d’extrême droite que le goût affiché pour les querelles intestines, les scissions, l’excommunication politique et la balkanisation en de multiples courants et organisations.
C’est ce qui arriva au nationalisme flamand. Quand le support à un Frontpartij plutôt modéré se tarit au début des années 30, le mouvement vira à l’extrême droite et explosa. Quelques dizaines de partis apparurent pour revêtir le manteau du nationalisme pur et dur, mais dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, le paysage politique fut de plus en plus dominé par trois formations profondément différentes, chacune d’entre elles étant appelée à jouer un rôle déterminant dans la formation de la Langemarck et des unités qui l’ont précédée.
PAS DE QUISLING OU DE LAVAL FLAMAND
L’histoire de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale présente un éventail de personnalités qui en vinrent à symboliser l’alliance de leur pays avec les Allemands.
Vidkun Quisling en Norvège, Pierre Laval en France, Anton Mussert aux Pays-Bas et, bien sûr, Léon Degrelle en Wallonie furent les chefs qui incarnèrent la collaboration de leurs compatriotes. Ces hommes dominèrent la politique nationale de leur pays pendant la guerre, et les volontaires qui contribuèrent dans ces pays à l’effort de guerre nazi furent fortement influencés par eux.
La collaboration flamande ne peut se résumer à une figure emblématique. Contrairement à ce qui se passa dans tous les autres pays qui collaborèrent avec l’Allemagne nazie, il y eut en Flandre pléthore de leaders qui, plus souvent qu’à leur tour, s’affrontèrent au sein de la mosaïque politique de l’extrême droite. Il y eut Joris Van Severen du Dinaso, Staf De Clercq du VNV, Jef Van de Wiele du De Vlag et Raymond Tollenaere de l’organisation paramilitaire du VNV, la Brigade Noire.
Une autre différence d’avec la norme européenne fut que, parmi tous ces leaders, seul Van de Wiele survécut à la guerre et fut jugé. Dans les autres pays, les figures emblématiques furent déférées devant les tribunaux à la fin de la guerre et moururent pendues ou face à un peloton d’exécution. Du côté flamand, Van Severen n’eut même pas la possibilité de collaborer puisqu’il fut abattu par la gendarmerie française pendant l’invasion de 1940. De Clercq mourra d’une attaque cardiaque en 1942 et Tollenaere périt sur le front russe. Il n’y aurait donc pas de figure emblématique de la collaboration flamande à jeter en pâture aux foules.
VNV, DINASO ET DE VLAG
La plus importante et la plus influente organisation nationaliste flamande fut sans conteste le Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV), l’Union nationale flamande. Ce seront ses membres et ses supporters qui se tailleront la part du lion dans l’envoi des volontaires flamands pendant la guerre. Ce parti, créé en octobre 1933, résultat de l’amalgame de plusieurs petites formations, devint le porteur de référence des aspirations flamandes à l’indépendance.
Il comprenait des sections de femmes et de jeunes à côté des gros bataillons d’hommes adultes, et était ouvertement paramilitaire dans l’apparence et le style. Conduit par un enseignant, ex-fondateur du Frontpartij, Gustave « Staf » De Clercq, le VNV devint la pierre angulaire du nationalisme flamand.
Staf De Clercq avait 49 ans quand il fonda le VNV. Jérôme Gustave Théophile De Clercq était né le 16 septembre 1884, au sein d’une famille aisée de la classe moyenne, à Everbeek, dans le Brabant. À l’instar de son « Leider » (la version VNV du Führer nazi), le VNV exposa la doctrine des « Grands Pays-Bas », dans lesquels les populations de la Hollande, de la Flandre et de la « Flandre française », seraient unies au sein d’un nouveau pays. Celui-ci devrait être profondément catholique (il faut rappeler ici que les Hollandais sont fortement attachés à leur foi protestante) et autoritaire, la finalité étant la création d’un état fasciste dont la devise serait celle du VNV : « Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus » (AVV, VVK), tout pour la Flandre, la Flandre pour le Christ.
Le VNV était fortement inféodé à l’Allemagne nazie et adopta le salut nazi, bras tendu et paume ouverte. Il professait également un violent antagonisme envers la Wallonie et la France. Le VNV possédait sa milice en uniforme, les chemises grises de la « Grijze Werfbrigade » (Brigade grise de Défense) et un journal, le « Volk en Staat » (Peuple et État), édité par un membre de l’ex-Conseil des Flandres, Antoon Meeremans.
La milice et le journal, à l’instar des membres du parti, étaient de fervents pro-nazis, mais, chose intéressante, ne professaient qu’un antisémitisme tiède. La tolérance religieuse était un sentiment bien partagé dans le plat pays, où l’antisémitisme apparaissait comme une question relativement marginale, sentiment partagé par les rexistes wallons de Léon Degrelle, le Nationaal-Socialistische Beweging d’Anton Mussert aux Pays-Bas, et les Flamands nationalistes de De Clercq.
Staf De Clercq était peut-être le plus puissant des leaders nationalistes, mais il n’était pas le plus charismatique. Dans ce domaine, la palme revenait à l’avocat et ancien officier Joris Van Severen.
George Van Severen est né le 19 juillet 1894 dans le petit village de Wakken, en Flandre occidentale. Brillant étudiant, il s’inscrivit à l’université de Gand, où il changea son prénom en Joris, trouvant qu’il sonnait plus flamand. Il y fut vite mêlé aux cercles d’étudiants nationalistes avant la Première Guerre mondiale. Il s’engagea comme volontaire lors du déclenchement des hostilités, et servit avec suffisamment de brio pour devenir un des rares officiers flamands commissionnés dans l’armée belge. Il était également un ardent partisan du Frontpartij, et quand le fait arriva aux oreilles de ses supérieurs, il perdit sa commission d’officier dès la fin du conflit. Il devint avocat, et entra comme député au Parlement, où il siégea de 1921 à 1929. Il y réalisa que la démocratie parlementaire n’était pas à son goût, et que l’attitude modérée du Frontpartij ne pourrait conduire à des changements radicaux pour la Flandre. Impressionné par les succès du parti nazi en Allemagne, Van Severen quitta le Front en octobre 1931 et créa son propre mouvement, affublé de l’encombrante dénomination « Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen » (Union de la solidarité nationale néerlandaise – Dietsche recouvrant une notion plus élargie que celle des seuls Pays-Bas).
C’est sans surprise que la dénomination originale ne fut que rarement utilisée, l’organisation fut plus connue sous l’abréviation « Verdinaso ». Une ultime simplification en fit le Dinaso, qui ne fut pas une formation politique, compte tenu du peu d’intérêt manifesté par Van Severen aux jeux qui se jouaient dans les enceintes parlementaires. Sa vision était celle d’un état fasciste et un de ses slogans favoris était : « Flamands, souvenez-vous toujours que la Belgique n’est pas votre patrie. » Il rêvait d’une union de tous les néerlandophones du monde, celle-ci englobant l’Afrique du Sud et les Indes Néerlandaises. Contrairement au VNV, le Dinaso était fortement anticlérical. Les nazis d’Hitler étaient cités en exemple, et comme le VNV, le salut bras tendu fut adopté par ses membres, en même temps qu’un effort particulier fut consenti à l’aile paramilitaire du mouvement, forte de 3 000 membres, des chemises vertes de la Dietsche Militante Orde. La DMO avait son propre slogan, Recht en Trouw (droit et loyauté), qui était également le titre du journal que le mouvement publiait, et elle était conduite par Joseph « Jef » François, qui s’engagera plus tard dans la légion SS Flandre.
Le Dinaso n’était pas un rassemblement de masse, mais était réputé pour la discipline et la dévotion de ses membres. Suffisamment pour que le mouvement ne se désintégrât pas après la volte-face politique annoncée en 1935 par Van Severen, déclarant que Wallons et Flamands ayant une origine commune franque, la Belgique était indivisible en tant que nation. Moins d’un tiers des membres se retirèrent dans le dégoût et la confusion, mais le reste demeura aux côtés de Van Severen jusqu’à la déclaration de guerre.
Le dernier (et le plus extrémiste) des trois principaux mouvements nationalistes flamands qui influencèrent la Langemarck et les unités qui la précédèrent fut le Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap (Communauté de travail Flandre-Allemagne) connue sous son abréviation « De Vlag » (le Drapeau). Apparemment un mouvement culturel inoffensif, fondé en 1935 pour promouvoir des échanges culturels transfrontaliers entre artistes flamands et allemands, De Vlag était en réalité un groupe de pression politique ouvertement pro-nazi.
Son chef était le fanatique Jef Van de Wiele, qui se voyait devenir le Führer d’une province des Flandres élargie, aux confins du Reich allemand. Idéologiquement proche de son rival, le Dinaso, De Vlag n’était pas un parti politique, mais plutôt un « ordre » de ces nationalistes décidés à se débarrasser de l’État belge et à l’incorporer dans une Europe nationale-socialiste.
Ces trois mouvements dominèrent le paysage du nationalisme flamand avant la guerre.
Il y eut également des formations marginales, la plupart d’entre elles farouchement antisémites, en même temps qu’ouvertement pro-fascistes ou pro-nazies, mais leurs effectifs étaient réduits et leur influence négligeable. Cependant, l’essentiel est que le nationalisme flamand représentait un authentique mouvement de masse, et n’était pas le refuge d’une poignée de mécontents.
Le résultat du VNV aux dernières élections précédant le conflit frôla les 10 % de votants. Pour donner une idée de l’importance de ce vote, il faut examiner les résultats enregistrés à la même époque par le parti d’extrême droite, le PPF en France. Avec ses 250 000 voix, il ne représentait que moins de 5 % de l’électorat français.
Le mouvement nationaliste flamand n’était pas seulement celui du souhait d’une Flandre « germanique », il était également radicalement tourné à droite. Il était pro-allemand, paramilitaire et autoritaire par nature, un costume taillé sur mesure pour la Waffen SS lors du recrutement de volontaires. Sur ce terrain fertile, la Langemarck demeura longtemps en gestation, n’attendant qu’un déclic pour éclore. Ce déclic fut le début de la guerre.
DEUX NOMS À RETENIR
L’histoire de la Langemarck est plus que celle de mouvements nationalistes flamands, luttant entre eux pour le pouvoir et la reconnaissance dans un pays qui les ignorait. Elle est également plus que celle du mouvement légionnaire Waffen SS.
Au cœur de cette histoire, il y a celle de milliers de jeunes Flamands qui prirent en toute connaissance de cause la décision de rejoindre les rangs de leurs anciens conquérants, et de porter l’uniforme d’un corps que le Tribunal de Nuremberg qualifiera d’organisation criminelle. Ses membres, de toutes les nationalités, se verront privés de leurs droits civiques, accordés au reste de la Wehrmacht.
Comment en arrivèrent-ils à prendre cette décision ?
La Langemarck fut constituée assez tard, après que la fortune des armes eut déserté l’Allemagne nazie, mais les hommes qui en firent partie servaient sous l’uniforme allemand depuis des années. Les Flamands avaient vu leur pays balayé par une tornade militaire, symbolisée par l’élan des premières unités SS, et quand l’opportunité de rejoindre ce corps d’élite fut offerte, ils la saisirent.
Les horreurs des camps de concentration et les brutalités inouïes du front de l’Est étaient quelque part dans le futur quand furent semées les graines de la Langemarck. Qui étaient ces Flamands qui affluèrent sous le drapeau ennemi, et quelle fut leur histoire ?
Quand Rémy Schrijnen fut photographié pour figurer sur les affiches de recrutement de la Waffen SS à la fin de la guerre, le moins que l’on puisse dire est qu’il ne représentait pas l’archétype du guerrier teuton, un géant blond aux yeux bleus. Schrijnen ne mesurait qu’un mètre soixante-quatre, alors que le minimum exigé au départ pour la SS était d’un mètre quatre-vingt (la taille d’Himmler). Il était de constitution assez frêle et avait une expression intense et sérieuse, qui ne le quitta jamais. Il était issu d’une famille ouvrière, au nationalisme profondément enraciné. Né à Kumtich le jour de Noël 1921, le jeune Rémy avait sept frères et sœurs. Les Schrijnen étaient une famille heureuse, sans histoires, profondément fière de sa « flamanditude » et de son sentiment de parenté avec les Allemands d’au-delà de la frontière. Tout de suite, le jeune Rémy fut séduit par les visées du nationalisme flamand, puisque son cheminot de père était un militant de la première heure du Frontpartij, avant de soutenir le VNV.
Après ses études secondaires, l’avenir de Rémy semblait limité à un métier manuel, et au militantisme de base. Tout cela allait basculer pendant l’été 1940.
Un autre jeune homme destiné à jouer un rôle phare dans la Langemarck et l’histoire des volontaires flamands, fut Georg D’Haese. Né le 4 août 1922 à Lede, le jeune D’Haese était également le rejeton de parents nationalistes flamands. Il fit de bonnes études d’allemand après ses humanités, mais l’influence dominante de sa jeunesse fut la cause nationaliste, et son affiliation au VNV, qu’il garda pendant la guerre. Cet attachement à la cause nationaliste, envers et contre tout, eut des conséquences inattendues des années plus tard dans sa carrière militaire. En tant qu’individu, D’Haese était intelligent, populaire et doté d’un tempérament artistique. Il avait un visage souriant, était toujours partant pour une bonne blague, et bien que mature pour son âge, il n’avait pas cet air trop sérieux qu’affichait Schrijnen.
Une manifestation VNV durant l’occupation de la Flandre.
1940, GUERRE ÉCLAIR ET EFFONDREMENT BELGE
À Paris en 1932, un ancien sergent de l’armée française, vieux de 55 ans, mange sans le savoir des huîtres contaminées par la typhoïde. Il tombe malade pendant la nuit et décède rapidement. Il s’appelle André Maginot, et la ligne de fortification dont il a ordonné la construction, en tant que ministre de la Défense, porte son nom. Cet ouvrage, long de 314 km, étiré le long de la frontière est de la France, est toujours en construction. Ce coûteux ouvrage défensif a été construit pour protéger la France d’une possible agression allemande, et d’éviter ainsi au pays les horreurs des tranchées de la Première Guerre mondiale. La boucherie de Verdun ne fut, en effet, pas rééditée, mais, comme protection de la « Douce France », la ligne Maginot fut un échec retentissant, et ce, pour deux raisons.
En premier lieu, ses concepteurs n’avaient pas tiré la leçon essentielle du conflit précédent, en n’étendant pas la couverture à une invasion allemande passant par la Belgique. Cette stratégie était pourtant l’essence même du plan conçu en 1906 par le chef d’état-major, général des armées allemandes, le comte Alfred von Schlieffen.
Ensuite, et plus important encore, sa construction donna aux Français une fallacieuse sensation de sécurité, qui se sentaient à l’abri de ses tourelles, blockhaus, champs de mines et fil de fer barbelé. Ils étaient persuadés que les Allemands n’oseraient jamais s’attaquer à la plus formidable ligne de fortification de l’Histoire. Mais à l’instar de chaque mur de l’histoire militaire, celui-ci priva les défenseurs de l’esprit offensif sans lequel on est condamné à la défaite. Pour Patton, « des fortifications fixes sont des monuments élevés à la stupidité humaine ».
L’OPÉRATION GELB
Le 10 mai 1940, les Allemands prouvèrent définitivement l’inanité de la ligne Maginot, en démarrant leur guerre éclair à l’Ouest par l’envahissement des Pays-Bas et de la Belgique. Ils violaient ainsi un traité de non-agression signé à peine trois ans plus tôt avec la Belgique, mais Hitler ne fut jamais l’homme qu’un traité aurait privé d’une bonne invasion. À cette époque, la croyance française était que la ligne de fortification construite par les Belges sur leur territoire national était de nature à compléter le dispositif entre la ligne Maginot et la Mer du Nord.
Le plus formidable des forts belges, celui d’Eben-Emael, avait une importance stratégique vitale. Ce mastodonte de 810 mètres de long et 700 mètres dans sa plus grande largeur protégeait les trois ponts traversant le canal Albert, ainsi que la route d’invasion vers le sud, connue sous la dénomination du Goulet de Visé.
Prendre Eben-Emael c’était s’ouvrir une voie royale à travers la Belgique, et le plan d’attaque allemand était un plan de génie.
(Note du traducteur : Si une fortification est un monument élevé à la stupidité humaine, Eben-Emael l’était doublement puisque tous ses plans avaient été généreusement offerts à