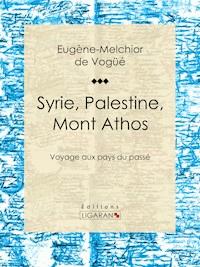
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "« Faites voille, de par Dieu !» criait Joinville à ses « notonniers » en s'embarquant sur la nef qui devait le porter en terre sainte. – Je jetterais volontiers le même cri aux matelots de la Minerva, grand bateau du Lloyd autrichien à bord duquel nous prenons place, mon ami d'A... et moi ; la vapeur a remplacé les vieilles voiles qui nous enlevaient furtivement et sans secousses aux lieux accoutumés."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054583
©Ligaran 2015
À Monsieur Henri de Pontmartin
Mon cher ami,
Je vous envoie ces études de voyage, telles qu’elles ont paru à diverses reprises dans la Revue des Deux Mondes : c’est une vieille dette que j’acquitte. Le jour où, libre enfin de partir pour mes courses lointaines, je vous ai demandé de venir les partager avec moi, vous m’avez répondu que des devoirs impérieux vous retenaient en France ; mais vous m’avez fait promettre de vous rapporter un récit fidèle de mes caravanes et de ne vous faire tort ni d’une impression, ni d’un étonnement. J’ai vaillamment accompli ma promesse, je vous l’assure. J’ai dû me la rappeler bien des fois, durant les soirées de la tente, après une longue journée de cheval, pour lutter contre le sommeil et prendre la plume : il en est résulté ce volume de notes, recueillies sans ordre et sans suite, au hasard de l’heure, sous la tente, sur une table d’auberge ou un pont de bateau, sur le pommeau de la selle et le bât du chameau, sur les colonnes affaissées de Baalbeck et de Byblos. Parfois la pluie ou les retards du voyage me laissaient le loisir de rêver et d’écrire ; plus souvent, quand mes moukres impatients me pressaient de quitter l’étape, j’indiquais d’un mot des idées dont j’ai peine aujourd’hui à retrouver le fil. Enfin, je vous l’ai rapporté comme je vous l’avais promis, ce pauvre compagnon, bien sali, bien illisible, bien avarié par les mois passés dans les fontes de la selle. Alors, vous m’avez dit : Il faut publier cela.
Vous savez si j’ai bondi d’abord à l’idée de jeter dans une vitrine de librairie toutes ces intimités. Je vous ai opposé les mille raisons qui m’en devaient détourner. On croit communément en France que tout a été dit sur l’Orient, que le sphinx a livré tous ses mystères, qu’il n’y a plus rien à faire de ce côté. À moi plus qu’à un autre il était téméraire de venir parler de la Palestine, quand de remarquables travaux, signés du même nom qui figurera au bas de ces pages, l’ont décrite avec tant de science et d’amour. Que d’éléments d’intérêt m’étaient d’ailleurs interdits ! Des convenances de situation, la nécessité de ne pas troubler l’œuvre laborieuse, faite surtout de prudence et d’abnégation, qui se poursuivait ici auprès de moi, m’obligeaient à réserver mes appréciations sur les hommes et les choses de la Turquie, à glisser sur les côtés politiques, sociaux et religieux que notre époque demande avant tout aux récits de voyage. Quelle audace, enfin, de jeter à l’heure présente, si rude aux lettres, dans ce pays troublé, affolé de regrets, de craintes ou d’espérances, ces calmes études ! Plus sévère que celle de Platon, notre république reconduit à la frontière ceux qui viennent lui parler d’art et de poésie, sans même les couronner de fleurs.
Je vous ai dit tout cela, et vous ne m’avez pas fait grâce. Vous m’avez répondu que toute tentative consciencieuse est sûre de trouver un petit nombre d’amis inconnus, d’esprits de même famille qui la fêtent en secret. Vous m’avez rappelé, avec raison, je l’avoue, que de cet Orient soi-disant si épuisé on ne sait pas le premier mot chez nous ; qu’un récit de voyage est œuvre d’utilité publique, s’il peut inspirer aux jeunes gens de loisir et de fortune le goût des pérégrinations lointaines. Le Français ne sort plus de son boulevard, où il voit tout à son image : on s’en aperçoit tristement dans ces contrées reculées dont nous avons oublié le chemin et où notre langue, nos mœurs, nos idées, notre action perdent chaque jour du terrain au profit des peuples voyageurs, et plus tristement encore chez nous, où l’on se fait de l’autre côté de la frontière les idées les plus fausses, sinon les plus grotesques ; nous avons chèrement payé le droit de nous dire ces vérités.
J’ai cédé, en partie du moins. Encouragé par la bienveillante hospitalité que ces notes ont trouvée à la Revue, je les réunis aujourd’hui sans m’écarter de la forme modeste et commode du récit au jour le jour ; elles seront gardées contre les inexpériences d’un simple touriste par un séjour de cinq années en Orient et mériteront peut-être à ce titre une indulgente attention. J’ai fait suivre mes courses en Syrie d’une étude sur cette vieille épave byzantine du mont Athos, curieuse à tant d’égards. Elle a été inspirée par l’idée dominante qui relie ces pages, si diverses de forme et de sujet : la préoccupation de reconstituer avec le présent la physionomie réelle du passé. La grande surprise et le grand bienfait de chaque journée de voyage en Orient, c’est de nous mettre en contact avec les choses et les hommes d’autrefois, qui se sont à peine modifiés. Il n’est que de parcourir cette terre pour la voir s’éclairer d’une lumière inespérée, pour replacer dans son vrai jour toute cette histoire que la distance, l’ignorance des pays, des races et des mœurs ont si souvent faussée pour nous. Le présent immobile nous fournit la clef du passé, les lieux nous aident à saisir la légende, comme les planches donnent le sens du texte dans un ouvrage abstrait : les grandes lignes reprennent leur juste valeur, les détails se coordonnent, les figures s’humanisent, tout ce qui semblait impossible, incroyable ou merveilleux apparaît naturel, véridique et accessible. Les doutes tombent, les inquiétudes s’apaisent, le calme se fait dans l’esprit illuminé, la raison n’a plus à lutter contre ses évidences intimes pour accepter des interprétations dont les faits se passent fort bien, une fois replacés dans leur cadre.
Et ce n’est pas sa seule histoire que ce pays éclaire ainsi ; l’état de ses sociétés arrêtées reproduit parfois avec une singulière fidélité l’état de nos sociétés occidentales à certaines périodes de leur développement : les mobiles qui les mènent encore et dont nous surprenons le jeu peuvent être attribués sans témérité à nos ancêtres, aux évènements dont ils ont été les instruments. La pratique attentive de l’Orient contemporain a confirmé ma foi dans cette formule qui résumera ma pensée : pour l’ensemble de la famille humaine, les phases de l’histoire ne sont pas successives, mais bien plutôt synchroniques. En cherchant judicieusement autour de lui, dans ce vaste monde, l’historien peut toujours trouver chez les races attardées les types vivants des sociétés disparues, de même que l’astronome, en interrogeant le système céleste, arrivera à reconnaître dans quelques-unes des planètes les types actuels des métamorphoses par lesquelles a passé la nôtre à ses origines. L’esprit du passé est moins dans des chroniques douteuses que dans les lieux, les œuvres, les hommes qui lui survivent autour de nous ; c’est avec ces éléments que la science recomposera un à un les anneaux qui forment la chaîne de l’histoire et la déroulera sûrement jusqu’à ces origines humaines dont la connaissance peut seule apaiser la grande angoisse de ce siècle. Dans cette voie féconde, l’immuable Orient sera toujours le grand initiateur. Le secret de l’histoire ! c’est peut-être celui que garde son sphinx à l’entrée de ses déserts.
Mais que voilà, mon cher ami, de grands mots, de gros soucis et de longues explications pour ma facile promenade ! Je n’y voudrais convier que de rares esprits comme le vôtre, impartiaux, calmes et désintéressés, amoureux seulement d’art et de poésie, de vérité et de lumière. Je viens des sources où l’on en trouve, et je leur en apporte un peu, tout ce qu’il m’a été donné d’y puiser. Si même ceux-là me faisaient mauvais accueil, il me resterait encore la meilleure récompense d’une entreprise de ce genre : le plaisir d’avoir vécu un peu plus longtemps parmi ces chers souvenirs. Que de fois, durant les journées grises et sombres de climats moins bénis, je suis retourné en pensée sur les bienheureuses grèves d’Asie me réchauffer à leur clair soleil ! Quand c’était l’âme qui était grise et triste, je revenais en Palestine, la terre des apaisements et des consolations. Enfin, mon cher ami, vous me croirez sans peine si je vous dis que ma meilleure tentation a été de causer plus longuement avec vous ; en revoyant ces notes écrites d’abord pour vous, j’ai cru bien souvent, malgré tant de terres et de mers qui nous séparent, reprendre nos ardentes causeries d’autrefois, durant ces jeunes soirées, déjà si lointaines, que nous passions au coin de mon feu, dans la vieille bibliothèque, à lire nos poètes chéris, à deviser de voyages et d’histoire, de projets et d’espérances, mettant nos deux vingt ans ensemble pour apprendre la vie et la parer de plus de rêves ; j’ai cru plus d’une fois m’appuyer sur votre bras, par les matinées de printemps, dans le petit chemin dont chaque pierre a gardé une de nos joies, un de nos mauvais vers et un de nos bons rires, vous savez, le petit chemin qui monte entre les pins de la Mûre, et que nous ne referons plus.
Constantinople, décembre 1875.
« Faites voile, de par Dieu ! » criait Joinville à ses « notonniers » en s’embarquant sur la nef qui devait le porter en Terre sainte. – Je jetterais volontiers le même cri aux matelots de la Minerva, grand bateau du Lloyd autrichien à bord duquel nous prenons place, mon ami d’A… et moi ; la vapeur a remplacé les vieilles voiles qui nous enlevaient furtivement et sans secousses aux lieux accoutumés. Rien n’est triste comme les apprêts durs et brutaux d’un navire en partance, les gémissements contenus de la chaudière, les râles du piston, les trépidations de l’hélice, les grincements de l’ancre ramenée par le cabestan : il semble qu’on entend lentement se briser sous le marteau, un par un, les anneaux de la chaîne qui vous lie à la terre abandonnée : c’est toujours l’heure des fortes impressions. Enfin le bâtiment s’ébranle, se dégage péniblement du fouillis de mâts pressés dans la rade, et gagne la haute mer : alors le souci du départ se dissipe, et de quel vol joyeux la pensée s’élance vers ce provoquant infini !
Cette fois la mienne me précède à tire-d’aile sur les mers de Syrie : j’entre en possession du plus ancien de mes rêves. Je vais donc toucher du pied toutes ces terres, filles gâtées de la légende, de la poésie et de l’histoire, voir surgir dans leur réalité ces lignes prestigieuses que, tout enfant, je suivais amoureusement du doigt sur la carte, et qui me semblaient saillir du papier en relief d’or : les échelles du Levant, les fleuves d’Asie, les pics du Liban, les plaines de la Judée, Jérusalem ! – Nous voyons encore une fois le soleil descendre au fond de la Corne d’or, traînant sur les collines d’Hass-Keuï et de l’Ok-Meïdan de larges bandes jaunes, déchirées par les minarets de Sultan Bayezid et de la Suleïmanieh. Le bateau tourne les cyprès de la pointe du Séraï : les contours des lieux s’effacent dans le crépuscule d’octobre. L’amphithéâtre des trois villes s’étoile de feux qui leur donnent l’aspect vague des cités inconnues : les lumières défaillantes se fondent bientôt elles-mêmes dans la buée douteuse. Adieu donc et à l’avant, nos regards et nos pensées ! Une fraîche brise nous pousse en Marmara, aidant la vapeur. « Et chascun jour, dit encore le bon sénéchal, nous esloigna le vent des païs où nous avions esté nez. »
En nous éveillant à l’aube, nous dépassons Gallipoli, les Dardanelles, les lourds châteaux aux murailles ventrues, où les vieux canons bâillent d’ennui sur les piles de boulets de marbre. Voici les falaises mornes et nues derrière lesquelles court le Scamandre. La Troade, je l’avoue, m’a toujours laissé froid. Que, dix siècles avant notre ère, une tribu hellène ait chassé de ces plateaux une tribu pélasge, c’est affaire à elles : je n’irai jamais chercher des pierres douteuses dans ces landes désolées. La pratique des Grecs modernes rend un peu méfiant dans la lecture des Grecs anciens : les bulletins de la guerre de l’Indépendance donnent peut-être la mesure de la véracité qu’il faut attribuer à ceux de Thémistocle et d’Alcibiade. Qu’est-ce donc quand il s’agit des héros de l’époque mythologique ? N’oublions jamais que pendant plusieurs siècles les Grecs ont parlé seuls dans le monde barbare. Si, aujourd’hui, des civilisations parallèles, d’un sens critique très chatouilleux, ne veillaient pas sur le développement de la légende, nos petits-neveux feraient à Botzaris et à Colocotroni, dans l’histoire moderne, la place que nous laissons à Léonidas et à Miltiade dans l’histoire ancienne : et l’on verrait sans doute Hadji Stavros et Arvanitaki se mêler dans la mémoire des hommes au prudent Ulysse et au bouillant Achille. On irait fort loin dans cette voie révolutionnaire, et l’on risquerait de n’y pas épargner grand-chose d’Hérodote et de Thucydide : on y serait appuyé par ceux qui connaissent l’Orient, l’immutabilité de ses races, les lois constantes et toujours identiques avec elles-mêmes qui président à ses évolutions historiques. Je m’arrête, n’étant pas autrement destructeur, et croyant qu’il ne faut pas toucher au peu d’idéal que l’humanité garde encore : n’est-ce pas à lui qu’elle doit Homère et Virgile, son plus noble et plus doux patrimoine ! Ce sont leurs noms seuls que j’ai voulu me rappeler, chaque fois qu’un vaisseau m’a promené le long de ces terres désormais silencieuses.
Nous sortons du détroit en mettant le cap sur Ténédos : à droite et dans le lointain, on entrevoit les sommets de Lemnos, toute retentissante du bruit des armures divines martelées sur la forge d’Ephaïstos. Le Lloyd relâche à Ténédos : nous stoppons une demi-heure à l’entrée sur la crique. Je n’ai jamais vu roche plus nue et plus grillée que cette île fameuse. Un château turc domine de ses gros murs crénelés et de ses canons pansus l’amas de pauvres maisons étagées sur la petite baie ; dans le port, « dangereux aux navires », des mahonnes et des télémaques, aux mâts semés de flammes rouges, se balancent à l’endroit même où ont mouillé les vaisseaux grecs et n’ont pas changé la forme d’un agrès depuis Ulysse. Aujourd’hui encore les pêcheurs de ces côtes mettent chaque soir leurs embarcations à sec sur le rivage au moyen de claies de bois en pente douce qu’on appelle dans le pays kysaques : ainsi faisaient chaque nuit les marins de l’Iliade pour leur flottille. Les Grecs de l’île qui viennent à notre bord charger leurs peaux de chèvre et leur vin amer ne se doutent guère que le bruit de leur nom remplit la vieille Europe, que les enfants l’épellent sur les bancs de tous les collèges, et qu’ils ont inspiré à la sculpture l’un de ses plus dramatiques chefs-d’œuvre.
Nous entrons après midi dans le canal de Lesbos, et nous mouillons à la nuit devant Mételin. On se sent envahi par les souvenirs païens de cette terre voluptueuse : cette tiède et splendide soirée, ce ciel indulgent, qui nous permettent de veiller fort tard, assis sur le pont comme dans nos nuits de juin, nous parlent de Sapho et de Lesbie, de toutes les ardentes figures que la poésie est venue chercher là : sous un ciel pareil, on ne peut qu’aimer et chanter. Nous quittons la patrie des poètes et des courtisanes pour entrer dans le golfe de Smyrne : demain à l’aube nous mouillerons dans le port.
Nous nous sommes réveillés en rade de Smyrne au son des cloches ; elles sonnaient le glas du jour des morts. Pour la seconde fois la patrie d’Homère me reçoit au seuil de l’Asie : la voilà bien toujours la même, coquettement couchée au pied du mont Pagus, nonchalante et molle dans son air doux. Smyrne ne mérite guère de nous arrêter : comme la plupart des villes turques, il faudrait la voir du pont du bateau, sans descendre, pour garder ses illusions. C’est d’ailleurs une vieille connaissance, et nous comptons employer la journée de relâche à voir les ruines d’Éphèse. Nous allons donc, hélas ! prendre le chemin de fer. J’ai bien dit : le chemin de fer, et le plus anglais des railways. Matériel, personnel, buffet, tout est anglais, on ne parle qu’anglais sur la ligne. Je laisse à penser si cette administration britannique paraît monstrueuse sous le ciel d’Ionie : et cependant elle donne lieu à de curieux contrastes. La première station est au Pont-des-Caravanes : des centaines de chameaux encombrent la voie et les abords. Rien ne saurait exprimer le trouble jeté dans l’esprit par cette association disparate : les chameaux, chargés de coton et de figues, agenouillés ou posant lentement leurs larges pieds entre les rails, les wagons, les locomotives fumantes et menaçantes. Ajoutez qu’à cet endroit la ligne traverse un champ des morts turc, tout ombreux et silencieux de ses grands cyprès. Trois ou quatre des lourds et gauches animaux, conduits par un nègre abyssin d’une rare puissance de type, s’arrêtent près de notre wagon et promènent leur tête, avec ce balancement rythmé qui leur est particulier, tout contre notre portière ; homme et bêtes nous regardent de ce grand regard étonné et résigné, commun aux races humaines et animales de l’Orient, et semblent se dire avec tristesse : Ceci tuera cela.
Après avoir dépassé le joli village de Boudjah, dont on aperçoit sur la gauche les maisons blanches entre les cyprès, le train court deux ou trois heures dans les vallées marécageuses et désolées du Mélès et du Caystre, entre des montagnes calcaires nues et escarpées, violemment secouées par les tremblements de terre. La fièvre, la pâle souveraine de toute l’Asie Mineure, habite presque seule ces humides vallées : on pourrait représenter cette pauvre Asie sous les traits d’un spectre fiévreux assis sur des ruines. Nous descendons à Aya-Souluk, où l’on remarque les restes d’une belle mosquée du dix-huitième siècle, sœurs des élégantes et nobles constructions de Nicée et de Brousse. Après un quart d’heure de cheval, on entre dans la plaine d’Éphèse, où se déroule tout autour du mont Prion un amas confus et considérable de ruines. Que dirai-je de ces pierres ? Presque pas une qui ait une beauté propre et vivante encore : des débris seulement, pâture d’archéologue.
Cependant on a trouvé ici même une des plus merveilleuses reliques de l’art grec : c’est une tête séparée de son corps et déposée aujourd’hui au musée de Sainte-Irène, à Constantinople, parmi des fragments informes et des restes d’un médiocre intérêt. Ce fruit exquis de l’art ionien, plus humain, sinon plus vrai, que l’art attique, ce chef-d’œuvre d’un Lysippe anonyme est digne de rivaliser avec les marbres historiques de nos galeries d’Europe. Plus on regarde cette figure pensive, plus elle apparaît profonde : ce n’est pas une femme, c’est la femme. Je ne sais quel est son âge ; sa beauté est toute jeune, sa mélancolie est déjà mûre : on sent que ses jours ont été pleins, partant mauvais. La lèvre de l’Ionienne est sensuelle, ironique un peu ; son œil vague regarde on ne sait où, et sur son front un nuage de tristesse n’a pu éteindre un rayon d’espérance. La tête est penchée et à demi tournée, comme si elle regardait dans le passé ; elle a beau sourire dédaigneusement de tout ce qu’elle y a trouvé, on sent qu’elle y regrette quelque chose : elle sait la vie, en souffre et espère quand même. J’ai passé plus d’une heure à contempler ce bijou antique, me demandant où le grand artiste inconnu entrevit cette figure idéale. Était-ce un portrait ou une conception du génie ? Ne serait-ce pas Diane, la grande déesse d’Éphèse ? Je comprends alors qu’on accourût des extrémités du globe pour l’adorer.
Nous ne trouvons dans cette plaine de plusieurs lieues de tour que des matériaux dispersés, des arasements de temples, des indications d’édifices : les quelques heures qui nous sont accordées entre deux trains ne nous laissent pas le temps d’une étude fructueuse. Nous voyons vite et sottement, comme les Américains qui nous accompagnent et demandent au vieux cicerone grec le temple de Diane, dont ils semblent surtout préoccupés. M. Wood, le patient explorateur des ruines d’Éphèse, vient enfin de le découvrir à droite de la ville, entre le mont Prion et Aya-Suluk ; ses ouvriers extraient des fouilles d’énormes colonnes cannelées de plus d’un mètre et demi de diamètre. Partout des matériaux d’une richesse inouïe, colonnes de vert antique, chapiteaux de belle brèche rosée, fûts de ce superbe granit de Syène vert et rouge qu’on retrouve dans toute l’Asie, magnifiques témoins d’une civilisation morte, moins attachants pour moi néanmoins que ces champs de pierres pulvérisées où il ne reste pas un bloc entier ; voilà l’éloquent commentaire des menaces bibliques que nous retrouverons à chacune de nos étapes dans le vieux monde : « Il ne restera pas pierre sur pierre. » La parole est littérale : la folie des hommes et les sourdes fureurs de la terre ont bien fait leur œuvre. Comme dans les champs de la Crau, que ceux-ci rappellent, des chevriers font paître leurs maigres troupeaux ; assis sur les roches escarpées du mont Prion, ils semblent écouter, comme le pâtre de Virgile, écouter le bruit qu’a fait dans le monde tout ce passé disparu : le temple célèbre jusqu’aux confins de l’univers, le crime d’Érostrate, qui le brûla pour faire survivre un nom qu’ils ignorent à coup sûr ; la gloire d’Alexandre, la parole de Paul, les querelles religieuses et le brigandage d’Éphèse, les invasions répétées du Croissant et les hauts faits des princes latins. Que leur en chaut-il, à ces raïas, pourvu que les figuiers donnent et que les chevreaux viennent bien !
Sur les gradins à demi enfouis de ce théâtre, Paul a prêché la bonne nouvelle qui nous a faits ce que nous sommes : c’est de là que Démétrius l’argentier et la foule courroucée vinrent l’arracher pour le conduire à une prison dont on voit les restes sur un monticule isolé. Ces souvenirs dominent de beaucoup tous les autres ici. Que n’est-il resté aux apôtres de notre temps quelque chose de ces persuasions toutes-puissantes et merveilleuses qui jetaient aux pieds du converti les populations entières de l’Asie ? Je vais y songeant longtemps, tandis que mon cheval se fraye difficilement un chemin dans les roseaux du Caystre. Cependant le crépuscule se fait, et la lune monte lentement entre les sommets du Coressos et du Prion : magna Diana Ephesiorum.
Il faut, au sortir du stade, remonter dans l’odieux wagon, après avoir lunché avec du pale ale chez un juif anglais ! Nous nous retrouvons à Smyrne, assez morne et silencieuse ce soir, malgré les fêtes de l’ouverture du Ramazan. Ce peuple grave ne connaît pas nos saturnales du mardi gras : pour montrer sa joie, il illumine ses temples. Nous cherchons longtemps la fameuse rue des Roses, et j’épuise vainement tout mon grec de la décadence sans la découvrir, jusqu’à ce qu’un Français me l’indique, en m’expliquant que de son vrai nom elle s’appelle odos Kopriès, « rue du fumier ». Je crois bien qu’on ne m’entendait pas ; mais qui se serait douté d’un pareil euphémisme ?
Après avoir remonté le golfe de Smyrne et tourné le cap Kara-Bournou, le paquebot s’est engagé dans le boghâz (canal) de Chio pour mouiller à la nuit devant cette île. Quelques pêcheurs chiotes viennent vendre à bord du mastic et du glyco, doux commerce de cette terre indulgente, qui vit du suc de ses fruits et de ses fleurs. Groupés sur le pont, à la lumière de leurs lanternes, avec leurs figures en bec d’aigle, leurs haillons colorés et leur marchandise odorante dans des pots de verre rouges et blancs, ils crient et gesticulent au grand scandale d’un pasteur américain. Ce pieux voyageur se rend en mission à Jérusalem : debout dans une longue robe de chambre à ramages, cravaté de blanc, la physionomie triste et le regard mystique, il feuillette sa Bible à la lueur d’une bougie et pose pour Rembrandt ou Holbein, comme les Grecs pour Delacroix. Un peu plus loin, le patriarche d’Antioche, qui revient du synode de Constantinople, est assis dans un grand fauteuil. Ce vieillard, vêtu et coiffé de noir, à la longue barbe blanche, aux traits émaciés, au regard atone, roide et solennel comme une mosaïque byzantine, est réellement imposant dans son immobilité pontificale ; en revanche, ses deux acolytes sont très remuants, très bavards et très sales. Ils psalmodient tout le long du jour l’office orthodoxe sur un ton nasillard, avec la même patience que met l’Américain à lire sa Bible. À côté d’eux, des Arabes de Damas font gravement la prière sur le pont, aux heures prescrites : un serviteur apporte un tapis qu’il déploie, et les croyants se prosternent trois fois en s’orientant vers la Mecque, sans beaucoup de succès, je dois le dire, car la boussole leur donne de flagrants démentis ; mais c’est la foi qui sauve.
Il n’y a que l’Orient pour réunir dans un cadre aussi étroit les spécimens les plus frappants de races et de religions si différentes. On sent bien vite, à voir les abîmes qui les séparent, combien les rêves d’unification sociale et religieuse du monde sont chimériques ; on y saisit, dans le relief d’une vive lumière, les lois nécessaires et divergentes auxquelles obéit, dans chaque race, le développement du sentiment religieux.
Les Chiotes descendent dans un long caïque, qui s’éloigne invisible et silencieux. Ainsi, il y a cinquante ans, dans la nuit du 23 mars 1822, sur cette même rade où nous sommes, le brûlot de Canaris se glissa parmi la flotte turque, et réduisit en cendres les vaisseaux de Sélim. Les plus vieux de nos marchands de confitures ont pu voir flamboyer les rochers de l’île aux reflets de l’incendie libérateur.
Nous avons laissé derrière nous Cos, éclatante et souriante tache blanche au milieu des bois, avec ses remparts turcs et ses toits en terrasse, éblouissants sous leur crépi de chaux, Samos, le golfe Céramique, les restes d’Halicarnasse et de Cnide. Après avoir doublé le cap Krio, nous rangeons de près la côte de Caramanie, entre des îles nombreuses, avec la longue chaîne de Rhodes pour horizon. Le ciel, un peu brouillé ce matin par un orage qui courait sur le Taurus, emplissant tour à tour de ténèbres et d’éclairs les forêts profondes et les sauvages ravines de ces sommets, est maintenant d’une sérénité indescriptible. À notre gauche, la charpente osseuse et tourmentée des montagnes de Caramanie, descendant par grandes tables dorées dans la mer, fait valoir vigoureusement le bleu dur et poli des flots ; à droite, des bouquets d’îles rocheuses, baignant dans une brume chaude, émergent de l’eau. Ce sont les aspects de l’Archipel et du golfe de Salamine, avec un ciel plus mou et plus éclatant, une grâce plus asiatique. Il faut avoir vu les mers de Grèce pour se douter des paysages qu’on peut obtenir avec des pierres et de l’eau, mais de l’eau tour à tour sombre comme du lapis en fusion ou étincelante comme de la poussière de diamant, des pierres saturées de soleil, chauffées par un ciel blanc, rongées par les flots, où la moindre veine étrangère, le moindre filon minéral, s’accusent avec des couleurs éclatantes, où une mousse marine, un figuier pendant, prennent une valeur hors de toute proportion. On comprend, en regardant ces paysages encadrés dans un éternel fond d’or, comment les procédés des peintres byzantins leur ont été tout naturellement inspirés par la nature ambiante.
Quelle fête en plein novembre, tandis que nos amis, en France, se blottissent frileusement dans la cheminée attristée ! quelle fête pour les sens de se laisser glisser sur cette nappe d’azur aux reflets dorés, d’emplir ses yeux de fous ces rayonnements et de humer cette tiède lumière, pénétrante comme celle que le poète latin place dans les champs Élysées…, lumine vestit purpureo…, c’est littéralement vrai, et on le comprend ici ; elle drape les montagnes comme une gaze palpable.
Avant de condamner en bloc le paganisme, il faut avoir passé sous ce ciel clément dont il semble l’émanation naturelle. Insensiblement le genius loci vous y envahit et vous pénètre : on se sent devenir païen, fatal, heureux ; on se demande avec regret pourquoi l’on ne vit plus de cette vie assurée et bénie, sous la consolante tolérance de ces divinités gracieuses, pourquoi le Christ souffrant a passé là, apportant ses dures vérités, repoussant ces aimables fantômes et nous laissant, à son image, laborieux et mélancoliques, attristés de cette vie et effrayés de l’autre. Dans un pareil climat, la morale semble un mot vide de sens, le sacrifice une absurdité ; l’ascétisme et le renoncement n’y sauraient pas plus venir que le bouleau ou le sapin, et l’on conçoit l’étonnement irrité des populations quand elles entendirent pour la première fois les enseignements austères, incompréhensibles, de Paul et de Barnabé. Insanis, Paule, disait Festus.
Rhodes s’annonce, comme beaucoup de villes de l’Archipel, par ses moulins ; ils s’avancent jusque dans la mer, le long d’une langue de sable, avec leurs grands bras agités : si don Quichotte eût été Hospitalier, il les eût pris pour des Turcs et pourfendus en conséquence. À mesure que la terre monte à l’horizon, des palmiers dressent leurs têtes entre les moulins, puis des platanes, des cyprès, des orangers, des lauriers, toute une végétation luxuriante et nouvelle, cachant les blanches villas des faubourgs, enfin la ville elle-même, cerclée dans son enceinte de murailles, hérissée de tours à créneaux, enserrant son petit port de fortifications démantelées.
Rhodes est la perle des mers du Levant. La beauté de son ciel justifie le mythe antique qui la donnait pour amante au soleil. Nous mouillons dans l’après-midi, et le capitaine nous donne quelques heures pour parcourir la ville. Nous pénétrons dans l’enceinte par une poterne pratiquée dans le rempart, et nous nous trouvons en face de l’hôpital Saint-Jean et de la rue des Chevaliers. – Qu’on se figure une de nos vieilles villes de province immobilisée à la fin du quinzième siècle, et apparaissant de toutes pièces dans une île d’Asie. Voilà bien la maison du temps, peu élevée, percée de trois fenêtres carrées, partagées en quatre par une croix et encadrées d’un cordon de pierre, la porte exhaussée sur trois degrés, à linteau en saillie écussonné des armes du maître, les gargouilles en forme de guivres, et aux angles les tourelles en encorbellement, les petites chapelles en cul-de-lampe : partout une fantaisie déjà plus sobre qui sent la Renaissance.
Hélas ! l’explosion de 1856 a détruit presque tous les monuments témoins des luttes héroïques de nos aïeux ; cependant, par une galanterie fortuite, elle a laissé debout ceux qui rappellent plus directement la France. La France ! c’est elle dont tout nous parle ici, et je suis, je le confesse, profondément ému en retrouvant sur toutes ces portes des devises, des noms, des emblèmes français et l’écusson fleur-delisé écartelé de Saint-Jean. Voici « l’auberge » de France, la seule épargnée par la destruction, la maison de Pierre d’Amboise, celle de Francois de Flotte ; « prior de Tholoze ». Sur la seule porte des murailles restée intacte, entre deux grosses tours crénelées, voici les figures en haut relief de trois prieurs, et encore et toujours l’écu de France. De la cathédrale, où était le magasin de poudre qui amena la catastrophe de 1856, il n’est demeuré qu’un campanile isolé. Çà et là, aux alentours, des dalles projetées par l’explosion livrent les noms des héros obscurs dont la poudre turque est revenue troubler la cendre après trois siècles et demi de paix dans la mort. Derrière la cathédrale, les remparts de la ville sont restés tels qu’au jour du dernier assaut : aux embrasures, les canons de l’Ordre s’effritent sous la morsure de la rouille ; la sentinelle turque se promène d’un air ennuyé parmi ces chères conquêtes de ses pères, regardant parfois vers la haute mer, comme si elle craignait de voir poindre encore le pavillon à la croix blanche sur les galères de Pierre d’Aubusson ou de Villiers de l’Isle-Adam.
En redescendant par les rues moins silencieuses du bazar, nous retrouvons toujours, encastrés dans les murs des maisons, des mosquées, dès fontaines, quelques modillons, quelques chapiteaux d’origine franque, quelque pierre tombale où s’agenouille une gauche et pieuse figure, bon soldat qui prie sur son lit de mort sans s’être dévêtu de sa cotte de fer.
Ah ! je disais ce matin que le renoncement et le sacrifice ne pouvaient pas fleurir sur cette terre amollie : ces pierres m’infligent vite un démenti formel. C’étaient bien des hommes de renoncement et de sacrifice, ces aïeux dont chaque pan de mur respecté par le temps raconte la gloire modeste et la mort héroïque ; dévoués au service des « infermes », remparts vivants du monde menacé, ils sont tombés par milliers de ces murailles sous les flèches tartares, mourant pour défendre leur croix. Je sais qu’il est de mode dans plus d’une école historique de condamner en masse les guerres chrétiennes, c’est-à-dire la défense séculaire de l’Occident contre la barbarie, et de biffer le long martyrologe qui va de Pierre l’Ermite à Villiers de l’Isle-Adam ; mais, si les historiens qui du fond de leur cabinet décrètent les croisés de folie avaient suivi, comme moi, leurs traces de Nicée à Damiette et retrouvé dans toute l’Asie le vivant respect de notre plus honnête et plus vaillante gloire, ils les salueraient sans doute, comme je fais, de leur piété la plus émue.
Nous quittons Rhodes sur le soir et regardons longtemps s’enfoncer dans la mer la jeune ville turque, ses vieilles murailles franques, ses hauts palmiers et ses riantes campagnes.
Je n’ai pas « sailli de mon lit tout deschaux », comme le bon saint Louis, pour voir Chypre. Il est vrai que ma nef n’a touché aucun écueil, et que je me suis trouvé tranquillement mouillé, à mon réveil, en face d’une côte nue et sablonneuse, au pied de falaises carrées, sans végétation et sans grâce. Au bord de la mer, la Marine, rangée de maisons grises avec des estacades en bois ; à un kilomètre en arrière, la ville de Larnaka, signalée par quelques clochers à figure italienne sous leur crépi de chaux oriental et ponctuée de rares palmiers. Nous descendons à terre, et nous nous rendons au consulat : on nous dit à la chancellerie que notre agent est à sa maison de Larnaka. Les rues et le bazar de la Marine sont assez vivants ; nous y trouvons un grand mouvement de grains, de vins et de cotons.
En revanche, Larnaka est la ville des Sept Dormants. Rien de triste comme ces maisons en cailloux et en torchis, grises, carrées et plates, au bord de ces rues désertes. Dans quelques-unes cependant, habitations des consuls ou des riches négociants, on trouve, en franchissant ces murs silencieux, une sorte de patio à l’arabe, en forme de cloître, entourant d’arcades latérales une grande cour, tout ombreuse et parfumée de lauriers, de grenadiers, d’orangers et de myrtes. À la maison consulaire, une vieille Grecque, à figure d’oiseau de proie en cire blanche, nous annonce que son maître est parti pour le port ; nous y retournons entre de maigres jardins de nopals et de lauriers-roses, et des labours poudreux qui rappellent la Champagne Pouilleuse. Tout ce que nous voyons, murs, maisons, végétaux, sol des rues, semble s’émietter en poussière blanche sous l’action d’une inexorable sécheresse : les cataractes du ciel s’effondreraient sur l’île sans éteindre les ardeurs de cette terre altérée depuis le commencement des siècles.
Le consul nous reçoit, et nous causons de l’état de l’île. On m’apporte des « antiquités ». J’achète pour quelques piastres des têtes et des bustes, les uns frustes et hiératiques, produits monstrueux de l’art phénicien, les autres délicats et charmants, drapés avec toute la science et la noblesse attiques, fils légitimes du génie grec.
Je ne sais point d’étude plus curieuse que celle de l’art chypriote, plus propre à éclairer les origines et la formation de l’art grec. À sa lumière, on acquiert la conviction que les arts de la Grèce lui sont venus non pas, comme on l’a tant dit, d’Égypte ou d’Asie Mineure, mais surtout de Phénicie et d’Assyrie, par les îles de la Méditerranée, ces étapes intermédiaires où se sont rencontrées les deux races. Les colonies asiatiques apportaient là, avec leurs procédés de travail primitifs et imparfaits, leur idéal religieux, conventionnel et barbare ; le génie hellène, naturaliste, souple et fin, s’emparait de ces rudiments et les rapportait chez lui transformés et perfectionnés. Entrez dans notre salle chypriote au Louvre et suivez attentivement cette série de têtes, de bustes, de fragments, de vases, si ingénieusement disposés à l’appui de la thèse que je viens d’énoncer : une gradation insensible vous mènera de faces informes, grotesques, ouvrages des potiers phéniciens, assyriens peut-être, jusqu’aux purs et nobles profils du siècle de Phidias. Sans sortir de cette chambre, il semble qu’on suive avec un guide certain l’essor du génie humain descendant des plaines de la Mésopotamie aux côtes de la Grèce, pour rayonner de là sur tout l’Occident. Le consul d’Amérique, M. Gesnola, vient de découvrir à Golgos, dans des temples enfouis, des statues de grandeur naturelle, des fragments d’architecture, des tombeaux, des restes de tout genre et d’un haut intérêt, destinés à appuyer ces idées par des arguments nouveaux.
On nous apporte aussi de ces verreries délicates, aux reflets irisés, que tout le monde connaît. Ces jeux de lumière sont dus à la lente décomposition des couches supérieures du verre. Ces fragiles objets, qu’on trouve dans l’île en très grand nombre, sont bien la plus écrasante ironie que je sache. De ces races fortes et puissantes entre toutes, Phéniciens, Égyptiens, Grecs, Romains, qui ont passé là avec leurs civilisations, leurs monuments, leurs littératures, leurs religions, leurs arts, le meilleur et plus complet témoin qui nous reste, c’est une feuille de verre tombant en poussière sous le doigt. Peut-être qu’un grand ancien, un conquérant, un orateur ou un poète, a tenu ce verre que voilà, croyant qu’il lui servirait une heure et escomptant pour lui-même l’immortalité : or le nom de l’homme est perdu depuis des milliers d’années, et le verre est là entier dans ma main ! Éternelle vanité des efforts de l’homme pour se survivre à lui-même. Le vieux Montaigne a raison, qui « loue une vie glissante, sombre et muette ».
Nous visitons l’église grecque, de construction franque, à lourds piliers percés d’espèces de portes cintrées et supportant des arcatures romanes. On y montre dans une crypte le tombeau de saint Lazare ; je n’ai pas d’objections à y faire ; pourtant, je croyais que le vrai, le seul bon saint Lazare était celui de notre Provence. Les villes curieuses qu’il faudrait voir sont Nicosie et Famagouste : cette dernière surtout est restée, paraît-il, figée dans la désolation du premier jour de la conquête. Les mêmes canons sont braqués dans les mêmes embrasures, et il n’a pas été dérangé une pierre aux brèches depuis l’assaut des soldats de Sélim.
Nous revenons nous embarquer à travers de grands magasins de blé, qui me rappellent la naïve admiration de Joinville devant les approvisionnements faits dans l’île pour les croisés : « les fourments et les orges mis par monciaux emmi les champs, et quand on les véoit, il sembloit que ce feussent montaignes. » Cette terre est toute pleine des souvenirs de saint Louis, qui y passa l’hiver de 1248-1249. Que d’autres souvenirs encore de l’épopée chrétienne dans l’île renégate : les barons français et les patriciennes de Venise, Guy de Lusignan et Catherine Cornaro !
Nous achetons du « vin de commanderie », âgé de cinquante ans, à ce que prétend le propriétaire de la cave ; il nous fait goûter ses divers crus, et, comme j’élève des doutes sur la sécurité d’une pareille étude pour des gens à juen : Kamni kalo to proï, me dit-il avec assurance, « cela fait du bien le matin. »
Nous partons à la nuit tombante, guidés par le feu du mont Sainte-Croix, l’ancien mont de Vénus. Les bons pèlerins du Moyen Âge croyaient que la terrible déesse habitait encore ce sommet en fort joyeuse compagnie, et particulièrement avec le héros souabe à qui Richard Wagner a fait une retentissante notoriété. Écoutez plutôt le récit du cordelier d’Ulm dans son Evagatorium : « Le bruit court parmi le peuple, en Allemagne, qu’un noble de Souabe, appelé Danhuser, de Danbusen, ville près de Dünkelspückel, vécut quelque temps sur cette montagne avec Vénus. Pressé par le remords, il vint se confesser au pape ; mais l’absolution lui étant refusée, il retourna sur la montagne et ne reparut plus ; il y vit, dit-on, dans les délices, jusqu’au jour du jugement… Pourtant Vénus est morte et damnée, sans aucun doute. »
Tandis que je relis les adorables récits et le latin baroque du frère Faber, pèlerin de la fin du quinzième siècle, qui a écrit sur la Palestine, en 1483, la plus curieuse peut-être des relations que nous possédions, un orage balaye le ciel, la pluie fouette les hublots, et le vent fait rage : patience, demain nous serons en Syrie !
Quand les bons pèlerins allemands, dit encore le frère Faber, arrivèrent à l’aurore en vue des côtes de Syrie, ils furent éveillés par ces cris de la vigie : « Ô seigneurs pèlerins, levez-vous et montez, voici apparaître la terre que vous avez tant désiré voir, la Terre sainte, la terre de Chanaan, la terre glorieuse ! » Si les mousses de la Minerva ne nous ont pas donné ce pieux éveil, le nôtre a été pourtant touchant et singulier en son genre. En ouvrant les yeux au bruit de la chaîne d’ancre grinçant sur les écubiers, je reconnais la diane sonnée par des clairons français ; je saute sur le pont et j’aperçois, mouillés tout autour de nous, les quatre bâtiments de l’escadre arrivée d’hier en rade de Beyrouth, la Gauloise, la Reine-Blanche, la Thétis et le Desaix. Ils saluent le soleil levant en hissant à leur corne les couleurs nationales, bien douces à voir si loin du pays. C’est justice et plaisir d’apercevoir pour la première fois à travers des mâts français cette terre où nous allons retrouver à chaque pas les vestiges de notre sollicitude séculaire, des trophées, des pierres, des idées qui crient notre nom.
Cette première émotion donnée à l’apparition imprévue de la patrie, nous embrassons d’un regard Beyrouth, la plage et les sommets du Liban. Eh bien ! faut-il l’avouer ? la première impression a été médiocre, comme celle de tout rêve ardemment caressé qui se réalise, c’est-à-dire qui meurt. Le ciel est chargé de pluie, de lourds nuages voilent, sur notre gauche, la longue chaîne du Liban, de Beyrouth à Batroun. En face, la ville, adossée à une colline, vient baigner ses dernières maisons dans la mer ; mais ces maisons européennes, à toits de tuiles, ont un aspect trop civilisé. Je ne peux comparer Beyrouth, vue du large, qu’à Hyères, Cannes ou toute autre station d’hiver de la Méditerranée. Quant à la fertile végétation des campagnes, mes yeux, que le désert n’a pas encore rendus indulgents, la trouvent bien maigre.
Nous débarquons à l’abri d’un petit brise-lames, qui s’appuie aux assises rocheuses d’une grosse tour, reste des fortifications de l’émir Fakhr-ed-Din. Les drogmans des hôtels nous entourent depuis le pont du paquebot et se disputent nos effets et nos personnes. Ce sont tous de jeunes Maronites, de mine fière et intelligente, portant avec recherche l’élégant costume syrien, la veste courte et les pantalons bouffants. Ils parlent notre langue avec aisance, et rien ne rappelle chez eux la servilité basse et l’affreux baragouin des Grecs ou des Juifs qui servent de drogmans dans les autres échelles d’Orient.
Un guide plus persuasif que ses confrères nous pousse dans l’Hôtel de l’Europe





























