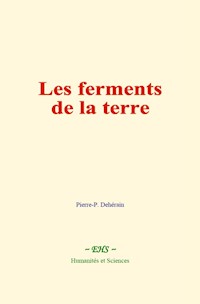
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Englisch
On sait quelle a été l’admirable évolution de la médecine et de la chirurgie depuis qu’elles ont été éclairées par le génie de notre illustre compatriote, Pasteur ; on sait que les pansements antiseptiques, la découverte des vaccins, ont préservé de la mort des millions d’êtres vivants ; on sait encore que nombre d’industries, la fabrication de la bière, celle du vinaigre, ont acquis des méthodes sûres de travail ; on espère que bientôt il en sera de même de l’art de faire le vin. Enfin, comme pour montrer qu’aucune des branches de l’activité humaine, tenant à l’exploitation des êtres vivants, ne peut se dérober à la puissance des ferments, la culture elle-même doit compter avec eux. Comment interviennent-ils pour fixer dans le sol un des plus puissants éléments de fertilité : l’azote ? Comment agissent-ils pour modifier, transformer les résidus qui proviennent des végétations antérieures ou ceux qu’ils élaborent eux-mêmes et les rendre assimilables par les végétaux ?...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les ferments de la terre
Les ferments de la terre
Chapitre I.
LA FIXATION DE L’AZOTE DANS LE SOL.
Il y a quarante ans, les notions acquises sur la fermentation tenaient dans un court chapitre des traités de chimie ; aujourd’hui que M. Pasteur a démontré que la génération spontanée est une chimère, que les liquides les plus altérables persistent à leur état primitif tant qu’ils sont préservés des germes des bactéries ou des végétaux crytogamiques, qu’il a fait voir que la matière organisée n’est ramenée aux formes simples qui permettent à ses éléments de rentrer dans la circulation générale que sous l’influence des micro-organismes, on comprend quel rôle immense remplissent dans ce monde les infiniment petits dont le microscope seul nous révèle la présence.
On sait quelle a été l’admirable évolution de la médecine et de la chirurgie depuis qu’elles ont été éclairées par le génie de notre illustre compatriote ; on sait que les pansements antiseptiques, la découverte des vaccins, ont préservé de la mort des millions d’êtres vivants ; on sait encore que nombre d’industries, la fabrication de la bière, celle du vinaigre, ont acquis des méthodes sûres de travail ; on espère que bientôt il en sera de même de l’art de faire le vin. Enfin, comme pour montrer qu’aucune des branches de l’activité humaine, tenant à l’exploitation des êtres vivants, ne peut se dérober à la puissance des ferments, la culture elle-même doit compter avec eux. Comment interviennent-ils pour fixer dans le sol un des plus puissants éléments de fertilité : l’azote ? Comment agissent-ils pour modifier, transformer les résidus qui proviennent des végétations antérieures ou ceux qu’ils élaborent eux-mêmes et les rendre assimilables par les végétaux ? C’est là ce que je veux étudier dans ces articles.
I.
La terre renferme les germes d’une multitude de micro-organismes, parfois ils appartiennent aux espèces pathogènes. Les personnes qui ont habité la campagne et particulièrement les départements comme celui d’Eure-et-Loir, de l’Oise ou de Seine-et-Marne, où sévissait la maladie connue sous le nom de charbon ou de sang de rate, ont entendu parler de champs maudits, sur lesquels les vieux bergers se refusaient à conduire les animaux ; on a cru longtemps à des préjugés,.. il a fallu se rendre ; les champs maudits existent. Ce sont les endroits où ont été enterrés les animaux morts du charbon. Les germes de la maladie infectieuse persistent dans le sol pendant de nombreuses années, ils sont ramenés à la surface par les vers de terre, et quand les fosses où ont été enfouis des animaux charbonneux sont cultivées en céréales, elles restent, après la moisson, couvertes de chaumes, et sont à ce moment particulièrement dangereuses. Les pointes aiguës des pailles coupées blessent fréquemment les moutons qui ont l’habitude de flairer le sol ; le virus s’introduit par les légères piqûres que se font les animaux, et les troupeaux paient un large tribut à la maladie.
Les végétaux eux-mêmes, développés sur ces terres contaminées, sont dangereux. Un mouton charbonneux est enfoui dans un champ ensemencé en trèfle, la plante devient luxuriante au-dessus de la fosse. Une femme dérobe ce trèfle et le donne à manger à une chèvre et à une vache, restées l’une et l’autre à l’étable ; les deux animaux meurent.
Cette persistance des germes virulents dans le sol est assez longue ; on parque sept moutons sur une terre où, douze ans auparavant, ont été enfouis des animaux charbonneux ; deux périssent, bien que la terre fût nue et que les moutons ne reçussent aucune nourriture sur le sol infesté. Les bactéries sous leur forme active ne vivent pas dans le sol, mais les germes, les spores brillantes que connaissent toutes les personnes qui ont suivi les cultures des microbes et qui sont la semence de ces redoutables organismes, ont, au contraire, une vitalité prolongée.
Au reste, les dangers que faisait courir aux troupeaux la persistance dans le sol de ces virus disparaissent peu à peu, depuis qu’ont été découverts les vaccins qui rendent les animaux inoculés insensibles à l’action des virus les plus violents.
C’est ce qui a été démontré avec une admirable netteté dans la célèbre expérience du 2 juin 1881, connue sous le nom d’expérience de Pouilly-le-Fort, organisée par MM. Pasteur, Chambreland et Roux pour démontrer l’efficacité du vaccin charbonneux. Cinquante moutons furent partagés en deux bandes, vingt-cinq moutons vaccinés résistèrent à l’inoculation d’un virus charbonneux qui fit périr en deux jours les vingt-cinq autres moutons non vaccinés. En détruisant par l’acide sulfurique les cadavres des animaux charbonneux, en procédant largement aux vaccinations préventives, on a vu déjà cette maladie qui décimait les troupeaux devenir plus rare et on peut prédire que, dans peu d’années, elle aura complètement disparu.
Bien d’autres maladies infectieuses paraissent être dues aux germes qui conservent leur vitalité dans le sol. Sans parler des fièvres intermittentes, du paludisme, peut-être de la fièvre jaune, le tétanos est également une maladie microbienne et atteint surtout les personnes dont les blessures sont en contact direct avec le sol, particulièrement lorsqu’il a été contaminé par les déjections solides des chevaux.
De très bons esprits ont été effrayés des irrigations aux eaux d’égout établies aux portes de Paris, dans la presqu’île de Gennevilliers, ils ont craint que le sol ne retînt les germes des maladies infectieuses et ne devînt une source constante d’insalubrité. Il ne semble pas que ces craintes soient fondées ; si, en effet, les germes pathogènes persistent souvent dans le sol pendant plusieurs années, surtout lorsqu’ils sont enfouis dans les profondeurs, ils s’atténuent quand, les terres étant cultivées, remuées par les instruments, ces spores amenées au jour sont soumises à l’action de l’air et de la lumière.
Nous n’insistons pas au reste sur ces ferments pathogènes du sol, car, si intéressante que soit leur étude, elle n’exerce aucune influence sur la production végétale, que nous avons seule en vue.
II.
Quand on soumet des graines, des grains de blé, par exemple, à l’analyse, de façon à connaître leur composition, on y distingue facilement trois matières principales : de l’amidon, la poudre blanche bien connue, qui, gonflée dans l’eau chaude, fournit l’empois, employé pour donner au linge la rigidité nécessaire à quelques parties de notre ajustement ; de la cellulose, qui reste dans le son, séparé de la farine par le blutage ; et enfin du gluten, matière grisâtre, molle, élastique, se prenant facilement en une pâte liante.
Si on cherche quelle est la composition élémentaire de ces trois matières, si, en d’autres termes, on détermine le poids des divers corps simples qui constituent ces trois principes : amidon, cellulose, gluten, on trouve que, tandis que les deux premiers sont exclusivement formés de carbone, d’hydrogène et d’oxygène (ces deux éléments dans les rapports de poids qu’ils présentent dans l’eau), le gluten renferme, outre le carbone, l’oxygène et l’hydrogène, un quatrième corps simple : l’azote. Quand on brûle l’amidon ou la cellulose, on ne perçoit aucune odeur forte. Il n’en est plus de même du gluten. La calcination dégage ces produits à odeur nauséabonde que connaissent tous ceux qui, par mégarde, ont brûlé de la laine, des poils ou des plumes. La combustion des grains de blé entiers laisse en outre des cendres particulièrement formées de phosphates de potasse et de magnésie, et la présence de ces phosphates, reconnue dans toutes les graines depuis Th. de Saussure, fait comprendre l’utilité agricole des phosphates et l’immense commerce qui se fait aujourd’hui de ces précieux engrais.
Pour savoir comment le blé acquiert les éléments nécessaires à sa croissance, comment un grain confié au sol s’y développe et donné une plante qui, au moment de la moisson, renfermera vingt ou trente grains semblables à celui qui a germé, on sème ce grain de blé dans un sol formé exclusivement de sable calciné, on y ajoute des substances minérales : phosphate de potasse, sulfate de magnésie, chlorure de potassium, carbonate de chaux et, en outre, de l’azotate de chaux. On arrose régulièrement et on réussit à obtenir une récolte analogue à celle que fournit une bonne terre ordinaire ; comme le carbone, qui forme les quatre dixièmes environ du poids total de la récolte, ne figure dans les matières ajoutées au sable que sous forme d’acide carbonique, on est convaincu que cet acide est l’origine du carbone contenu dans les végétaux. La petite quantité d’acide carbonique contenue dans notre atmosphère suffit, en effet, à l’alimentation carbonée des plantes, qui décomposent l’acide carbonique, s’en assimilent le carbone et rejettent l’oxygène, aussitôt que leurs parties vertes, que les cellules à chlorophylle sont soumises aux radiations lumineuses.
La culture du blé en sable calciné ne réussit pas, si le sol ne renferme que des matières minérales, si on n’y ajoute pas un azotate, de l’azotate de chaux, par exemple ; quand ce sel fait défaut, la plante reste petite, chétive, elle meurt généralement avant d’avoir pu former des graines nouvelles ; cet azotate exerce une influence tellement décisive sur le développement de la plante que, lorsqu’il est distribué parcimonieusement, mais en doses croissantes, le poids de la récolte augmente régulièrement avec la quantité de nitrate employée.
Ces faits, notés par tous les observateurs, méritent une sérieuse attention. Il est curieux de constater que les végétaux utilisent les très minimes quantités d’acide carbonique que renferme notre atmosphère et que, malgré son abondance, l’azote, qui forme les quatre cinquièmes de l’air atmosphérique, paraisse ne pouvoir exercer aucune influence sur la croissance du blé. La plante dépérit, bien que sa tige s’élance dans cette atmosphère riche en azote, tant que sa racine ne trouve pas dans le sol l’azote combiné à l’oxygène et à une base et constituant un azotate.
Si cette expérience, répétée à bien des reprises différentes, démontre clairement que l’azote atmosphérique n’est pas directement utilisé, par le blé ou les plantes semblables, à la formation de leurs matières azotées, il n’est pas douteux cependant que l’azote atmosphérique ne contribue parfois, au moins d’une façon indirecte, à l’alimentation végétale. Cela ressort de toute évidence de la luxuriance des forêts tropicales, de la persistance pendant des siècles de la végétation herbacée des steppes, des grandes plaines herbues du continent américain : dans cette immense étendue qui commence seulement à être mise en culture, la terre, bien qu’elle n’ait jamais reçu aucun engrais azoté, présente une richesse en azote combiné, bien supérieure à celle que décèle l’analyse de nos terres cultivées, régulièrement fumées.
En France, les terres de prairies ont été étudiées comparativement aux terres arables qui sont travaillées chaque année et reçoivent des engrais, et contrairement à ce qu’on aurait pu penser, ce sont les terres maintenues en prairies permanentes qui présentent la plus haute teneur en azote combiné. Tandis que nos terres arables ne renferment guère que 1 à 2 millièmes d’azote appartenant à des matières organiques, on dose 4 5, 6, jusqu’à 10 millièmes d’azote dans le sol des prairies permanentes, même des prairies hautes de montagne sur lesquelles il est absolument impossible de faire arriver des engrais.
Or, quand on calcule le poids d’azote combiné que renferme la terre d’un hectare, d’après les données fournies par l’analyse, on trouve qu’en moyenne la terre d’un hectare prise jusqu’à une profondeur de 0m,35 pèse environ 4000 tonnes de 1000 kilos ; on voit, par suite, qu’un millième correspond à 4000 kilos, et 10 millièmes constatés, ainsi qu’il vient d’être dit, dans le sol de quelques prairies, à 40000 kilos : visiblement ce stock énorme de matière organique azotée ne peut avoir pris son élément le plus précieux, son azote, qu’à l’immense réservoir de l’atmosphère.
Cette fixation de l’azote atmosphérique dans les sols des prairies permanentes est au reste assez rapide pour qu’il soit possible de le constater par l’expérience.
Sir J.-B. Lawes, correspondant de notre Académie des Sciences, a consacré, depuis cinquante ans, le domaine qu’il possède à Rothamsted, en Angleterre, à une faible distance de Londres, à une série d’expériences que connaissent et qu’admirent tous les agronomes. Secondé par M. le docteur Gilbert, il a largement contribué à éclairer nombre de questions relatives à la croissance des végétaux cultivés, à l’entretien des animaux domestiques. Parmi les nombreuses expériences exécutées à Rothamsted, l’une d’elles nous intéresse particulièrement. En 1856, MM. Lawes et Gilbert transformaient en prairie une portion du domaine de Rothamsted qui, depuis de longues années, n’avait servi qu’à la culture des céréales. Le sol renfermait alors 1 gr. 52 d’azote par kilo de terre ; on l’a fumé régulièrement et à doses telles que toujours l’azote des engrais dépassât celui des récoltes fauchées, de 15 kilos environ chaque année.





























