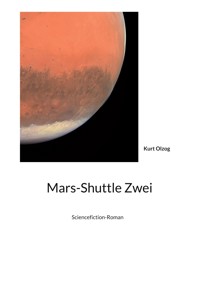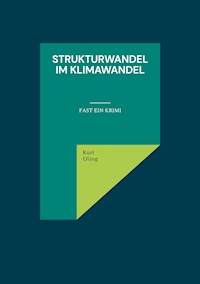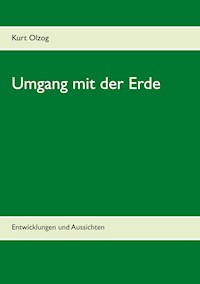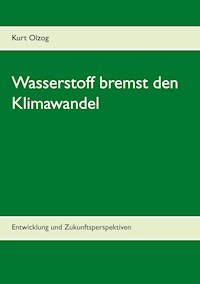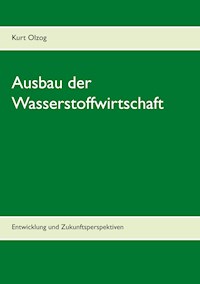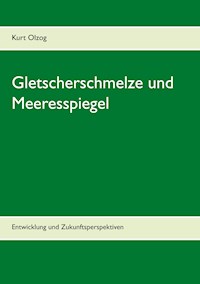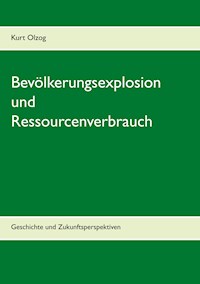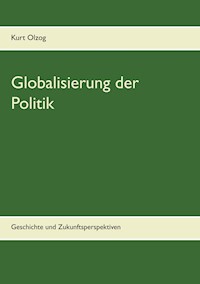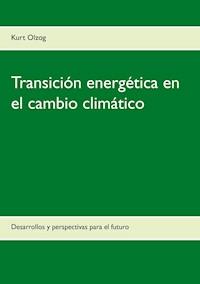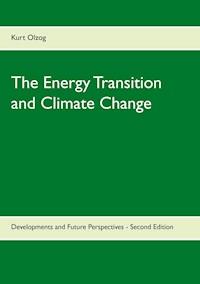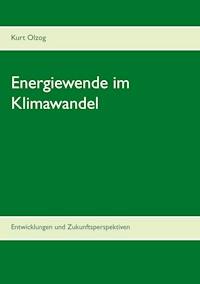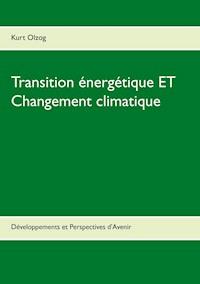
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Au fil des décennies, les signes des premières conséquences négatives de l'utilisation intensive des matières premières issues de l'énergie fossil : le Charbon, le Pétrole brut et le Gaz naturel commencent à se faire sentir. Les effets sur le climat commencent à apparaître. Une fois les consultations intensives achevées, l'auteur s'est pleinement consacré au sujet de l'économie énergétique en comparant les différents développements de la production d'énergie à partir des matières premières fossiles, y compris l'Uranium, et les énergies renouvelables devenues de plus en plus importantes. Par comparaison des deux sources, le rapport entre le changement climatique pendant ces cent dernières années et la nature die la consommation d'énergie par les humains est impressionnant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Durant ses études de mathématiques et de géographie pour la certification professorale, l’auteur s’était occupé intensément par de maints sujets et en particulier, celui du développement de l'économie énergétique en rédigeant ses premières conclusions dans ce domaine.
Pendant les années où il enseignait comme professeur principal dans les écoles supérieures privées, en tant que maître de conférence dans le secteur privé ainsi que ses tâches de management, ou encore comme conseiller en gestion et administrations d’entreprises, il avait suivi le développement de l'économie énergétique publié dans les journaux, les hebdomadaires et les médias publics correspondants.
Au fil des décennies, les signes des premières conséquences négatives de l'utilisation intensive des matières premières issues de l'énergie fossile : le Charbon, le Pétrole brut et le Gaz naturel commencent à se faire sentir. Les effets sur le climat commencent à apparaître.
Une fois les consultations intensives achevées, l’auteur s'est pleinement consacré au sujet de l'économie énergétique en comparant les différents développements de la production d’énergie à partir des matières premières fossiles, y compris l’Uranium, et les énergies renouvelables devenues de plus en plus importantes.
Par comparaison des deux sources, le rapport entre le changement climatique pendant ces cent dernières années et la nature de la consommation d’énergie par les humains est impressionnant.
Table des Matières
Développement de l’Économie Énergétique.
Développement de l’Économie Nucléaire.
Développement des Sources d’Énergies Renouvelables.
Le développement du climat au cours du dernier siècle.
Perspectives d’avenir.
La Conférence sur le climat, à Paris 2015.
Liste de références bibliographiques.
1. Développement de l’Économie Énergétique.
Les sources d'énergie fossiles ont été de plus en plus utilisées pour le chauffage, l'électricité et pour le transport depuis la révolution industrielle. En particulier, le pétrole, développé au siècle dernier devenant la plus importante source d'énergie dans l'économie mondiale. Ainsi, sa part de consommation au sein de l'énergie mondiale en 1976 était près de 45%, tandis que tous les combustibles solides ensemble (charbon, lignite ou encore la tourbe... etc.) en représentaient que 30% des sources naturelles et le gaz naturel ne dépasse même pas les 18%.1
Lorsque le pétrole commence à faire son apparition dans l'industrie dès la seconde moitié du 19ème siècle (aux États-Unis et en Russie, l'industrie pétrolière est née presque en même temps), la demande de cette matière première, polyvalente et peu coûteuse a toujours augmenté de façon croissante. Particulièrement en Amérique du Nord où le pétrole, de plus en plus consommé, fait croître rapidement la demande et donne naissance à une industrie pétrolière en pleine expansion. L'apparition et le boom de la voiture après 1911, comme étant le moyen de transport de monsieur tout le monde, a amené les compagnies pétrolières à développer leur marché qui est entré en constante expansion, de sorte que l'exploration pétrolière a commencé à s'étendre sur toute la planète pendant les années vingt et trente du XXème siècle.
Adapté de: EVERS 1976, p. 106
En Iran, en Irak, au Venezuela et en Indonésie le pétrole a été promu rapidement et son exploration est devenu de plus en plus intense. Cependant, les États-Unis reste entre les deux guerres mondiales comme le pays du pétrole par excellence puisque, d'une part, il avait des réserves de pétrole importantes et d'autre part à cause de son importante consommation ainsi qu'une puissante industrie pétrolière .
Peu de temps avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le Koweït et l' Arabie saoudite ont également pu commencer l'exploitation des gisements énormes découverts surplace.
Les activités prometteuses des compagnies pétrolières au Moyen-Orient ont été interrompues par la Seconde Guerre mondiale. En revanche, les champs de pétrole américains ont été exploités de telle sorte que les exportations de pétrole américaines ont dû être ajustées progressivement.
Après la guerre, la production du pétrole au Moyen-Orient a connu un nouvel élan, d'autant plus que l'Amérique du Nord était en train de devenir une zone déficitaire. Ainsi, non seulement la consommation du pétrole en Europe occidentale était en forte augmentation, mais les importations du pétrole des pays producteurs comme les États-Unis l'était aussi. Tous ont donc été couverts par le pétrole du Venezuela et du Moyen-Orient.
Dans une succession rapide, d'énormes réserves de pétrole ont été découvertes au Moyen-Orient, à tel point qu'au milieu des années 1950, la proportion des réserves de pétrole au Moyen-Orient par rapport à l'ensemble des réserves de pétrole découvertes dans le monde entier est passé à plus de soixante pour cent.
Les avancées des compagnies pétrolières américaines et britanniques ont permis de développer des méthodes de pointe de telle sorte qu'ils aient contribué à la crise iranienne (1951-1954) .
Les tentatives infructueuses d'émancipation de l'Iran auraient au préalablement intimidé les autres pays producteurs de pétrole, mais les influences soviétiques dans la région arabe augmentent de plus en plus, concurrençant ainsi le pouvoir des pays industrialisés et les compagnies pétrolières multinationales qui travaillent pour eux (il suffit de penser à l’Égypte dans les années 1950).
La crise de Suez causée par Jamal Abdel Nasser en 1956 témoigne du changement progressif de l'ancien pouvoir colonial de l'Angleterre et de la France qui perdait évidemment de son influence au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Pendant ce temps, les pays producteurs de pétrole se sont rendu compte que la défense de leurs intérêts les rendent moins forts face à l'arbitraire des pays industriels et leurs compagnies pétrolières malgré quelques tentatives de résistance isolées.
À ce moment là, ils ont découvert qu'ils étaient moins vulnérables à cet arbitraire grâce à une défense commune. Ainsi, l'OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) a finalement vu le jour en 1960.
Les pays producteurs ont d'abord utilisé ce nouvel outil pour se faire respecter et en tirer des revenus stables des compagnies pétrolières. Plus tard, immédiatement après la Guerre des Six Jours contre Israël en 1967, ils ont testé leur premier embargo pétrolier contre les États-Unis, le Royaume-Uni et la République Fédéral d'Allemagne. Cependant, malgré une durée de trois mois, cet embargo avait peu d'effet : en premier lieu, à cause des politiques dans les pays concernés qui prévoyaient suffisamment de stocke de réserves, ce qui signifie que l'embargo pourrait être accablant pour un certain temps. Mais la deuxième raison, c'est la demande d'augmentation du double de la production vénézuélienne et iranienne.2 Résultat : cet événement a été vu comme un phénomène périphérique à la guerre, organisé par des arabes impuissants du Moyen-Orient.
Par-dessus tout, cela a conduit à l'abandon de la politique de stockage car on a supposé que les pays producteurs n'auraient pas utilisé plus longtemps la méthode de l'embargo en raison de son inefficacité et les inconvénients qu'elle a causés aux pays producteurs de pétrole eux-mêmes.
Au début des années 1970, l'OPEP a soudainement commencé à attirer l'attention : les prix du pétrole ont augmenté à répétition et de façon régulière, ce qui provoquait à chaque fois une vague d'indignation dans les sphères publiques des pays industriels occidentaux à chaque fois. Ce rebondissement a atteint son apogée après le déclenchement de la quatrième guerre au Moyen-Orient, celle de la fête juive de Yom Kippour, le 06 octobre 1973, pendant laquelle l’Égypte a reconquis une grande partie de ses territoires perdus au Sinaï durant la guerre des Six jours, y compris les grands champs de pétrole.3
Même lorsque l'ancienne Union Soviétique a découvert de vastes gisements de pétrole en Sibérie occidentale au début des années 1970, la part du Moyen-Orient n'a pas été en dessous de 50% et ensuite a augmenté encore légèrement peu de temps après. À ce jour, le Moyen-Orient est la plus importante zone productrice de pétrole, ce qui se réfléchit également dans l'étendue de la production. L'embargo pétrolier a de nouveau été utilisé comme une arme de pression et a provoqué cette fois-ci une panique majeure parmi les pays importateurs, en particulier aux États-Unis, au Japon et en Europe de l'Ouest, où la consommation de pétrole était passée de 1,5 milliard de tonnes en 1967 à plus de 2,3 milliards en 1973.4
Les pays producteurs sont allés plus loin : afin de freiner la production de 12%, lors d'une succession de conférences tenues rapidement, pendant une période de trois mois, ils se sont mis d'accord pour augmenter progressivement le prix du pétrole de 400 %.5
L'opinion publique dans les pays occidentaux industrialisés était particulièrement choquée, jusqu'au bouleversement des situations politiques, économiques, et provoquant une baisse de la croissance économique dans ces pays : « Les instruments commerciaux et la balance des paiements tombent en plein désarroi, les taux d'inflation augmentent, le chômage se développe et se répand, le P.I.B, Produit Intérieur Brut des pays occidentaux industrialisés ne présentent qu'une croissance minimale et chaque fois que la menace de la guerre au Moyen-Orient devient réelle encore, les voix larmoyantes des politiciens, des médias publics et des citoyens concernés en tant que susceptibles consommateurs d'énergie sont élevés .»6
Alors que les efforts de paix étaient en cours au Moyen-Orient, les pays occidentaux industrialisés faisaient de plus en plus d'efforts pour analyser la crise pétrolière, appelée finalement la Crise de l’Énergie, ses causes et ses conséquences, afin d'être le mieux capable de faire face à des événements similaires à l'avenir. Ainsi, l'Agence Internationale de l’Énergie (AIE), une sous-organisation de l'OCDE, a été mise en place.
Cette AIE devait être un instrument de protection pour les pays adhérents contre les inconvénients émanant de l'OPEP, mais elle doit aussi rechercher, continuer à développer un dialogue avec les pays producteurs de pétrole et enfin, trouver des sources d'énergies alternatives d'une manière plus ciblée qu'auparavant pour atteindre une plus grande indépendance de l'OPEP.
La crise du pétrole et la forte augmentation de ses prix ont permis d’intensifier l'attention portée aux pays en voie de développement, pauvres en matières premières, qui avaient eu des difficultés significatives de paiement , de sorte que leurs prêts sont montés en flèche, leur laissant parfois, à peine payer leurs intérêts.
Ainsi, l'OPEP et l'AIE ont essayé, par tous les moyens disponibles, d'aider ces pays déjà vulnérables, ayant été sérieusement touchés par l'évolution négative de l'économie mondiale et par leur propre passivité, ainsi que la famine de masse.
Les intérêts énergétiques et économiques des membres les plus importants de l'AIE ont toujours considérablement varié. Le Japon devait importer tout le pétrole qu'il consomme, représentant plus de 74% de sa consommation annuelle d'énergie en 1974.
emprunté à : FERNAU 1976, p. 94
L'opinion publique japonaise avait de sérieuses réserves quant au développement de l'énergie nucléaire à ce moment-là. L'économie américaine, traditionnellement légèrement dépendante des importations, n'était et n'est toujours pas aussi dépendante des marchés étrangers que l'économie en Europe occidentale ou au japon. Cependant, dans le contexte politique générale, les États-Unis, en tant que puissance leader du monde occidental, est particulièrement sensible aux interactions entre les problèmes économiques et la liberté d'agir à l'égard des politiques étrangères. Par conséquent, les intérêts non seulement économiques, mais encore politiques, plus généralement, motivent les États-Unis à coopérer avec l'Agence Internationale de l'Énergie.
L'attitude de l'Europe occidentale envers l'AIE était tout à fait différente. À la fin des années 1960, des réserves considérables de pétrole sont découvertes dans la mer du Nord, au large des côtes britanniques et norvégiennes. De plus, le Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne ont des gisements de charbon considérables. En outre, les Pays-Bas et, dans une certaine mesure, le Royaume-Uni possèdent des gisements de gaz naturel, qui couvriraient près de la moitié de la consommation de l'énergie primaire des Pays-Bas. Contrairement à cela, la France et l'Italie sont très pauvres en sources provenant des sources d'énergie primaires et doivent couvrir une part significative de leur consommation d'énergie primaire par les importations.
Le rôle des compagnies pétrolières et gazières a considérablement changé depuis la crise du pétrole. « Les compagnies pétrolières ne possèdent plus l'Huile brute extraite dans les pays de l'OPEP. D'une part, elles sont devenues des acheteurs de pétrole brut pouvant contractualiser certaines options d'achats sécurisés, à long terme. D'autre part, elles sont devenues des fournisseurs de services - à nouveau sur une base contractuelle - en effectuant des activités de production et d'exploration de pétrole brut pour les pays pétroliers ».7 Ainsi, le fait que ces compagnies pétrolières contrôle le prix imposé aux acheteurs par l'OPEP devient simplement une nécessité.
Les tâches impliquées dans l'exploration et l'exploitation de nouveaux champs pétroliers, devenues de plus en plus coûteuses et nécessitant des technologies encore plus complexes, ont exigé d'énormes capitaux d'investissement, de telle sorte que les grosses compagnies ont agi avec plus de détermination pendant la crise, même si elles ont contribué un peu à la hausse des prix. Ce n'était pas la première alternative discutée autour des sources d'énergie, et pas seulement l'énergie nucléaire, qui avait parfois causé un malaise avant même la crise du pétrole. L'épuisement prévu des réserves de pétrole (à un taux de production constant de trois milliards de tonnes par an pour l'huile découverte jusqu'ici, cela durerait encore 30 ans), impose huit méthodes alternatives forcées pour la production d'énergie à reconsidérer.8