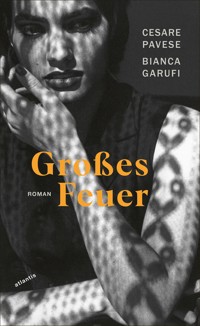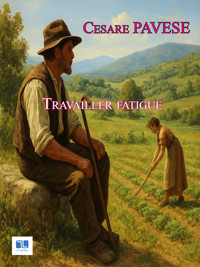
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: A verba futuroruM
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Ces poèmes du recueil, uniques et atypiques dans le répertoire poétique contemporaine, débouchent sur un nouveau mode narratif, celui de la poésie-récit, constituant le début d’une nouvelle expérimentation, tant du point de vue technique que du point de vue métrique. L’idée d'utiliser un vers très cadencé de treize ou seize syllabes lui vient en partie du vers familier des crépuscules et du vers libre whitmanien, dans une résolution toutefois très personnelle et innovante.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Cesare Pavese (1908-1950) est un écrivain, poète et traducteur italien. Passionné par la littérature américaine, il traduit Melville, Faulkner et Joyce, et fait connaître ces auteurs en Italie. Arrêté pour activités anti-fascistes, il est exilé en Calabre, où il amorce son Journal "Le Métier de vivre".
Après la guerre, membre du Parti communiste, il travaille aux éditions Einaudi et publie ses œuvres majeures : "Le bel été", "Dialogues avec Leuco" et "La lune et les feux". Marqué par la solitude, il se suicide à Turin en 1950, laissant un poème posthume, "La mort viendra et elle aura tes yeux".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
CESARE PAVESE
Travailler fatigue
ANCÊTRES
LES MERS DU SUD
à Monti
Un soir nous marchons le long d’une colline,
en silence. Dans l’ombre du crépuscule qui s’achève,
mon cousin est un géant habillé tout de blanc,
qui marche d’un pas calme, le visage bronzé,
taciturne. Le silence c’est là notre force.
Un de nos ancêtres a dû être bien seul
- un grand homme entouré d’imbéciles ou un malheureux fou -
pour enseigner aux siens un silence si grand.
Ce soir mon cousin a parlé. Il m’a demandé
de monter avec lui : du sommet on distingue,
au loin, quand la nuit est sereine, le reflet
du phare de Turin. « Toi qui habites à Turin... »
m’a-t-il dit, « tu as raison. Il faut vivre sa vie
loin de chez soi: profiter, jouir de tout
et puis, quand on revient comme moi à quarante ans,
plus rien n’est pareil. On n’oublie pas les Langhe. »
Il m’a dit tout cela et il ne sait pas l’italien,
mais il parle lentement le dialecte qui, comme les pierres
de cette même colline, est tellement rugueux
que vingt ans de langages et d’océans divers
ne l’ont pas entamé. Et il gravit la côte
avec ce regard recueilli qu’enfant j’ai souvent vu
dans les yeux des paysans un peu las.
Pendant vingt ans il s’est baladé par le monde.
Il partit quand j’étais un enfant que les femmes portaient
et on dit qu’il était mort. Puis j’entendis parfois
les femmes en parler sur un ton de légende ;
mais les hommes, plus graves, l’oublièrent.
Un hiver, pour mon père déjà mort arriva une carte
nous souhaitant une bonne vendange, avec un grand timbre verdâtre
qui montrait des bateaux dans un port. La surprise fut grande
mais l’enfant qui avait grandi expliqua avidement
que le mot provenait d’une île appelée Tasmanie
qu’entoure une mer plus bleue, aux féroces requins,
dans le Pacifique, au sud de l’Australie. Il ajouta que le cousin
pêchait certainement des perles. Puis il ôta le timbre.
Tous donnèrent leur avis, mais tous, ils conclurent
que s’il n’était pas mort, il mourrait.
Puis tous ils oublièrent et bien du temps passa.
Oh ! Depuis que j ‘ai joué aux pirates malais,
que de temps est passé. Et depuis celte fois
où je suis descendu me baigner dans des eaux périlleuses
et où j’ai poursuivi un camarade de jeux sur un arbre,
brisant ses belles branches, où j’ai cassé la gueule
d’un rival, où j’ai été roué de coups,
que de vie est passée. D’autres jours, d’autres jeux,
d’autres séismes du sang devant des rivaux
plus fuyants : les pensées et les rêves.
La ville m’a appris des terreurs infinies :
une foule, une rue, m’ont donné le frisson,
parfois une pensée, épiée sur un visage.
J’ai encore dans les yeux la lumière railleuse
des milliers de réverbères sur la cohue des pas.
Mon cousin est rentré, gigantesque, à la fin de la guerre,
un des rares survivants. Et il avait de l’argent.
Les parents murmuraient à voix basse : « Dans un an
tout au plus, il aura tout claqué et il repartira.
C’est comme ça que les têtes brûlées meurent toujours. »
Mon cousin a un air énergique. Il acheta un rez-de-chaussée
au village et y fit prospérer un garage en ciment
et devant, flamboyante, une pompe à essence,
et bien en évidence, sur le pont, au tournant, un grand panneau-réclame.
Il installa un gars pour encaisser l’argent
et lui, se balada dans les Langhe en fumant.
Entre-temps, il s’était marié au village. Il choisit une fille
blonde et mince comme les étrangères
qu’il avait dû sans doute rencontrer par le monde.
Mais il continua à sortir toujours seul. Habillé tout de blanc,
les mains derrière le dos, le visage bronzé,
il explorait les foires le matin et d'un air sournois
marchandait les chevaux. Plus tard il m’expliqua,
quand son plan échoua, qu’il avait projeté
de faire disparaître toutes les bêtes de la vallée,
et d’obliger les gens à lui acheter des moteurs.
« Mais la plus grosse bête, disait-il, c’était moi,
qui ai eu cette idée. J’aurais dû m’en douter
qu’ici gens et bœufs sont une même race. »
Nous marchons depuis bientôt une heure. Le sommet est tout près ;
Autour de nous, toujours plus fort, le vent siffle et murmure.
Mon cousin s’arrête tout à coup et se tourne « Cette année,
je mettrai sur l’affiche : - Santo Stefano
a toujours triomphé dans les fêtes
de la vallée du Belbo - que ceux de Canelli
se le tiennent pour dit. » Puis, il reprend sa marche.
Un parfum de terre et de vent nous enveloppe dans le noir,
au loin, quelques lumières : des fermes, des autos
que l’on entend à peine ; et je pense à la force
qui m’a rendu cet homme, l’arrachant à la mer
et aux terres lointaines, au silence qui dure.
Mon cousin ne parle pas des voyages qu’il a faits.
Il dit, tout juste, qu’il a été dans tel ou tel endroit et pense à ses moteurs.
Seul un rêve
lui est resté dans le sang : une fois, comme chauffeur,
il a croisé sur un bateau hollandais, le Cétacé ,
et il a vu les lourds harpons voler sous le soleil,
les baleines s’enfuir au milieu d’une écume de sang,
il a vu la poursuite, les queues se dresser, la lutte en baleinière.
Quelquefois, il m’en parle.
Mais lorsque je lui dis qu’il est de ces heureux à avoir vu l’aurore
sur les plus belles îles de la terre,
au souvenir il sourit et répond que le soleil
se levait sur un jour qui pour eux était vieux.
ANCÊTRES
Stupéfié par le monde, il m’arriva un âge
où mes poings frappaient l’air et où je pleurais seul.
Écouter les discours des hommes et des femmes
sans savoir quoi répondre, ce n’est pas réjouissant.
Mais cet âge a passé lui aussi : je ne suis plus tout seul,
si je ne sais répondre, je m’en passe très bien.
J’ai trouvé des compagnons en me trouvant moi-même.
J’ai découvert qu’avant de naître, j’avais toujours vécu
dans des hommes solides, maîtres d’eux,
dont aucun ne savait que répondre et qui tous restaient calmes.
Deux beaux-frères ont ouvert un commerce - le premier
coup de chance en famille - l’étranger était sérieux,
calculant sans arrêt, mesquin et sans pitié : une femme.
Quant au nôtre, au magasin, il lisait des romans
- au village c’était quelque chose - et les clients qui entraient
s’entendaient déclarer par quelques rares mots
qu’il n’y avait pas de sucre et pas plus de sulfate,
que tout était fini. Et c’est lui qui plus tard
a donné un coup de main au beau-frère en faillite.
Quand je pense à ces gens, je me sens bien plus fort
que si devant la glace je roule les épaules
et forme sur mes lèvres un sourire solennel.
J’eus, dans la nuit des temps, un grand-père
qui, s’étant fait rouler par un de ses fermiers,
se mit alors lui-même à bêcher les vignobles - en été -
pour avoir un travail bien fait. C’est ainsi
que toujours j’ai vécu et toujours j’ai gardé
un visage intrépide et j’ai payé comptant.
Et dans notre famille, les femmes ne comptent pas.
C’est-à-dire que chez nous elles restent à la maison
et nous mettent au monde et ne disent pas un mot
et ne comptent pour rien et nous les oublions.
Chaque femme répand dans notre sang quelque chose de nouveau
mais elle s’anéantit entièrement dans cette œuvre
et nous seuls subsistons, ainsi renouvelés.
Nous sommes pleins de vices, de tics et d’horreurs
- nous les hommes, les pères - certains se sont tués,
mais il y a une honte qui jamais n’a touché l’un de nous :
nous ne serons jamais femmes, jamais l’ombre de personne.
J’ai trouvé une terre en trouvant des compagnons,
une terre mauvaise où c’est un privilège
de ne pas travailler en pensant à l’avenir.
Car rien que le travail ne suffit ni à moi ni aux miens ;
nous savons nous tuer à la tâche, mais le rêve de mes pères,
le plus beau, fut toujours de vivre sans rien faire.
Nous sommes nés pour errer au hasard des collines,
sans femmes, et garder nos mains derrière le dos.
PAYSAGE 1
au poulet.
Ici sur la hauteur, la colline n’est plus cultivée.
Il y a les fougères, les roches dénudées et la stérilité.
Le travail ne sert à rien ici. Le sommet est brûlé de soleil
et la seule fraîcheur, c’est l’haleine. Le plus dur
c’est de monter là-haut : l’ermite est venu une fois
et il y est resté depuis pour reprendre des forces.
L’ermite est vêtu de la peau d’une chèvre
et il a une odeur faisandée de bête et de tabac
qui a imprégné la terre, les buissons et la grotte.
Quand il fume la pipe au soleil à l’écart,
je ne peux plus le voir si je le perds des yeux, car il a la couleur
des fougères brûlées. Des visiteurs y montent
qui s’affalent sur une pierre, haletants et en nage
et le trouvent étendu, l’œil fixé dans le ciel,
respirant largement. Son unique travail :
sur son visage hâlé, il a laissé sa barbe s’épaissir,
quelques touffes roussâtres. Il laisse ses excréments
dans un coin dénudé pour qu’ils sèchent au soleil.
Coteaux et vallées de cette colline sont verts et profonds.
Entre les vignobles, les sentiers conduisent des filles vêtues
de violentes couleurs qui viennent, en folles bandes,
pour cajoler la chèvre et crier vers la plaine.
Quelquefois apparaissent des files de paniers pleins de fruits
mais jamais ils ne montent jusqu’en haut : recroquevillés,
les paysans les emportent chez eux, sur le dos,
et ils plongent à nouveau au milieu du feuillage.
Ils ont bien trop à faire pour aller voir l’ermite,
les paysans, ils montent, ils descendent, et ils piochent sans trêve.
S’ils ont soif, ils lampent un peu de vin : le goulot enfoncé
dans la bouche, ils lèvent les yeux vers le sommet brûlé.
Le matin, à la fraîche, ils reviennent déjà, harassés
par le travail de l’aube, et si un pouilleux passe,
toute l’eau que déversent les puits au milieu des récoltes
est pour lui, pour qu’il boive. Ils ricanent vers les bandes de femmes
et se demandent quand, vêtues de peaux de chèvre, on les verra assises
sur toutes les collines se hâlant au soleil.
DÉPAYSEMENT
Trop de mer. Nous l’avons assez vue cette mer.
Le soir, quand l’eau s’étend délavée et se perd
dans le néant, mon ami la regarde fixement,
je fixe mon ami et personne ne parle. La nuit,
on finit par aller s’enfermer dans le fond d’un bistrot,
perdus dans la fumée, et on boit. Mon ami a ses rêves
(les rêves qu’accompagnent les vagues qui déferlent sont un peu monotones)
où l’eau n’est qu’un miroir, entre une île et une autre,
de collines que diaprent cascades et fleurs sauvages.
C’est comme ça quand il boit. En regardant son verre, il se voit
élevant des collines de verdure sur la plaine marine.
J’aime bien les collines ; je le laisse parler de la mer
car c’est une eau bien claire où l’on voit même les pierres.
Je vois seulement des collines et pour moi, proches ou lointaines,
elles remplissent ciel et terre de leurs flancs fermement dessinés.
Mais les miennes sont âpres et striées de vignobles
qui poussent avec peine sur un sol calciné. Mon ami les accepte
mais il veut les vêtir de fleurs et fruits sauvages
pour y découvrir, en riant, des filles plus nues que les fruits.
Ce n’est pas nécessaire : un sourire ne manque pas à mes rêves les plus âpres.
Si demain, de bonne heure, nous nous mettons en marche
pour rejoindre ces collines, peut-être pourrons-nous rencontrer dans les vignes
une fille au teint sombre, hâlée par le soleil,
et l’ayant abordée, manger de son raisin.
LE DIEU-BOUC
La campagne est un pays de verts mystères pour l’enfant
qui y passe l’été. Il y a des fleurs, si la chèvre les mord,
qui lui gonflent le ventre et il faut qu'elle coure.
Quand l’homme a joui avec une fille - ils ont des poils
là en bas -, l’enfant gonfle son ventre.
Lorsqu’ils gardent les chèvres, ils se font des bravades et ricanent entre eux,
mais chacun commence au crépuscule à épier tout autour.
Les enfants savent voir qu'une couleuvre est passée
à la trace sinueuse qui subsiste par terre.
Mais qu’elle passe dans l’herbe, personne ne le voit.
Il y a des chèvres qui s’arrêtent dans l’herbe,
juste sur la couleuvre, et qui jouissent de se faire sucer.
Les filles aussi jouissent de se faire toucher.
Quand la lune se lève, les chèvres sont inquiètes,
il faut les regrouper et les mener à la ferme,
sinon le bouc se dresse. Bondissant dans les prés,
il éventre les chèvres et puis il disparait.
Des filles en chaleur viennent seules, la nuit, dans les bois
et si couchées dans l’herbe elles bêlent, le bouc accourt les retrouver.
Mais que pointe la lune : il se dresse et les éventre.
Et les chiennes qui aboient sous la lune,
c’est qu'elles ont entendu le bouc qui bondit
sur les cimes des collines et flairé l’odeur du sang.
Et dans les étables, les bêtes s’agitent.
Seuls les chiens plus costauds mordent leur corde
et certains se libèrent et courent suivre le bouc,
qui les asperge et les enivre d’un sang plus rouge que le feu,
et puis ils dansent tous en se tenant dressés et en hurlant à la lune.
Quand le chien reparait au matin, tout pelé et grondant,
les paysans lui donnent la chienne à coups de pied au derrière.
Et la fille qui erre dans le soir, et les enfants qui rentrent
à la brune, avec une chèvre en moins, ils leur cognent dessus.
Ils bourrent les femmes ct bûchent sans vergogne, les paysans.
Ils sont toujours dehors, le jour comme la nuit, et n’ont même pas peur
de piocher sous la lune ou d’allumer un feu
de chiendents dans le noir. C’est pour ça que la terre
est si belle et si verte et que, piochée, elle a, quand vient l’aube,
la couleur des visages hâlés. On va faire les vendanges,
et l’on mange et l’on chante ; on effeuille le maïs
et l’on danse et l’on boit. Il y a des filles qui rient
car quelqu’un a évoqué le bouc. Tout là-haut, dans les bois,
sur les crêtes rocheuses, les paysans l’ont vu
qui cherchait une chèvre et donnait dans les troncs des coups de tête.
Car si une bête ne sait pas travailler
et qu’elle sert seulement d’étalon, elle aime détruire.
PAYSAGE 2
La colline déploie aux étoiles la blancheur de sa terre dénudée ;
tout là-haut, on verrait les voleurs. Dans le creux du vallon,
les rangées sont dans l’ombre. Là-haut, il y a de la terre
et ce n’est pas la terre de ceux qui ont la vie dure, mais personne n’y monte :
ici où c’est humide, sous prétexte d’aller chercher des truffes,
ils pénètrent dans la vigne et saccagent le raisin.
Mon vieil homme a trouvé deux grappes jetées entre les ceps
et il ronchonne cette nuit. La vigne est déjà pauvre :
jour et nuit dans cette humidité, seules poussent des feuilles.