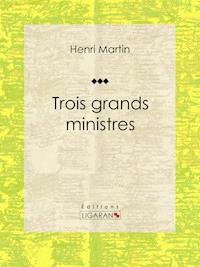
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "Depuis que son abjuration (1593) lui avait valu le trône de France, Henri IV avait de tous côtés des embarras, avec ses capitaines qui le servaient mal, avec les grands qui, au moindre revers, se remettaient à cabaler contre son autorité, avec les catholiques qui ne respectaient pas les édits de tolérance, avec les protestants mécontents de son changement de religion, et toujours en plainte et en méfiance."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335049817
©Ligaran 2015
Depuis que son abjuration (1593) lui avait valu le trône de France, Henri IV avait de tous côtés des embarras, avec ses capitaines qui le servaient mal, avec les grands qui, au moindre revers, se remettaient à cabaler contre son autorité, avec les catholiques qui ne respectaient pas les édits de tolérance, avec les protestants mécontents de son changement de religion, et toujours en plainte et en méfiance. Mais l’embarras par-dessus tous les embarras était celui des finances.
Sous Henri III, l’administration financière avait été le pillage organisé. Après la mort du surintendant François d’Ô, Henri IV avait remplacé la surintendance, c’est-à-dire le ministère des Finances, par un Conseil dont les membres ou n’entendaient pas les affaires financières, ou les entendaient trop bien à leur profit.
Henri, depuis longtemps, avait l’œil fixé sur Maximilien de Béthune, baron de Rosny (depuis duc de Sully), comme sur un des conseillers qui seraient les plus capables de servir à la réorganisation de la France. C’était un caractère rude, obstiné, orgueilleux, intéressé ; ses manières lui faisaient peu d’amis ; mais Henri IV, sous cette dure écorce, avait deviné de précieuses qualités. L’orgueil inspirait à Rosny cette confiance imperturbable, cette promptitude de résolution, cette impétuosité d’action qui perdraient un homme médiocre, mais qui rendent invincible un homme supérieur. Son humeur calculatrice, ce que les courtisans nommaient son avarice, s’associait au génie même de l’ordre, de l’économie, de la bonne administration. Intéressé et intègre à la fois, que le roi fasse sa fortune, et il fera celle de l’État. Quant à sa rudesse « mal gracieuse », ce sera une vertu pour l’œuvre qu’il doit accomplir. Il poussera devant lui, à travers les haines, les clameurs, les intérêts froissés et meurtris, comme un sanglier à travers les broussailles ; ne cédant à aucune considération, ne ménageant et ne connaissant personne, pourvu qu’il sente le bras du roi derrière lui ; assez adroit toutefois pour ne donner du boutoir qu’à propos et à coup sûr. C’était là un terrible pionnier à lâcher dans la forêt d’abus qui couvrait et stérilisait nos champs.
Un entier dévouement à la personne de Henri IV achevait de rendre Rosny essentiellement propre à devenir l’exécuteur de la pensée du roi.
Henri ne remit pas sur-le-champ toute l’administration financière à la discrétion de Rosny. Le choc eût été trop violent. Henri fit monter par degrés jusqu’au faîte le futur ministre. C’était la manière dont Rosny gouvernait sa maison qui avait d’abord fait pressentir au roi en lui l’homme capable de gouverner le trésor de l’État : Henri avait employé, tour à tour et accidentellement, ce « bon ménager » comme intendant militaire, comme inspecteur, comme munitionnaire. Un mémoire rédigé par Rosny, sur le « rétablissement du royaume », dès 1593 avait achevé de révéler à Henri IV ce qu’il valait. En 1595, le roi avait introduit Rosny, sans titre officiel, dans le Conseil des finances ; mais les autres conseillers avaient trouvé moyen de le faire déguerpir. En 1596, au retour du siège de La Fère, le roi revint à la charge, et Rosny entra au Conseil avec brevet.
Gabrielle d’Estrées racheta, ce jour-là, les fautes qu’elle avait suggérées au roi : ce fut elle qui décida Henri à tenir ferme en faveur de Rosny. À la vérité, Gabrielle avait moins en vue le bien public que la chute de Sancy, son ennemi personnel. L’ambitieuse favorite n’aspirait à rien moins qu’à monter au trône, après que le pape aurait cassé le mariage du roi avec Marguerite de Valois, qui vivait reléguée au fond d’un vieux château d’Auvergne. Sancy s’était exprimé sur ce projet avec une franchise un peu brutale, tandis que l’âpre Rosny avait su faire plier sa rigidité pour gagner les bonnes grâces de la maîtresse toute-puissante. Quoi qu’il en fût, la France profita des petites passions de Gabrielle.
Il fallait à la fois rétablir l’ordre dans les finances et demander à la France de nouveaux sacrifices. Il s’agissait de substituer l’impôt régulier aux contributions extraordinaires, aux rançonnements. Ce fut un moment solennel dans la vie du chef de la dynastie des Bourbons. Il était temps encore de faire rentrer la France dans la voie du gouvernement libre, et personne n’avait, plus que l’adroit, l’éloquent, le sympathique Béarnais, les qualités nécessaires pour réussir à gouverner avec le concours de la nation. Il ne le tenta point : il ne se décida pas à convoquer les États Généraux. Il prit un moyen terme, et convoqua, pour l’automne de 1596, une assemblée de notables.
Il n’y a lieu ni de s’en étonner, ni de s’en irriter contre sa mémoire : Henri IV se conduisit par des raisons au moins spécieuses et glissa sur une pente toute naturelle ; mais il n’en est pas moins certain que l’absence de réunion d’États Généraux à l’issue des guerres civiles eut des conséquences incalculables ; que la monarchie pure, le despotisme de Louis XIV, fut dès lors en perspective, et que tout contribua dorénavant à y entraîner la France.
En attendant la réunion des notables, le roi autorisa Rosny à tenter une sorte de grande reconnaissance ou de voyage de découverte dans quelques-unes des principales divisions financières du royaume, « afin de s’instruire bien particulièrement des valeurs de toutes les sortes de revenus, des améliorations qui s’y pouvoient faire, de l’ordre qui s’y étoit tenu jusqu’à présent », et de tâcher de rassembler immédiatement quelque argent au-delà des recettes ordinaires. D’autres commissaires furent envoyés dans les autres généralités ; mais, arrêtés dès les premiers pas, ils revinrent presque tous les mains vides. Rien n’arrêta Rosny : il brisa de haute lutte la coalition des officiers subalternes des finances, il les suspendit presque tous de leurs fonctions, révisa leurs registres des quatre dernières années, et « grapilla » si bien, qu’il rassembla environ 500 000 écus, et les ramena triomphalement au roi sur soixante-dix charrettes.
Rosny retrouva le roi à Rouen, où les notables furent réunis parce qu’une épidémie régnait à Paris. Henri IV avait fait son entrée solennelle, le 28 octobre, à Rouen : il paya sa bienvenue aux Rouennais en leur accordant la démolition du fort de la montagne Sainte-Catherine. « Je ne veux, dit-il, d’autre citadelle à Rouen que le cœur des habitants. » Le 4 novembre, Henri ouvrit l’Assemblée des notables dans l’abbaye de Saint-Ouen. Le roi avait mandé environ cent cinquante personnes, outre ses conseillers ordinaires ; il s’en trouva quatre-vingts à peine le jour de l’ouverture.
Henri adressa aux notables une de ces harangues courtes et vives, brusques et adroites, comme il les savait si bien faire. Il les invita à l’aider à sauver la France de la ruine, après l’avoir aidé à la sauver de la destruction.
« Je ne vous ai point appelés, ajouta-t-il, comme faisaient mes prédécesseurs, pour vous faire approuver leurs volontés. Je vous ai assemblés pour recevoir vos conseils, pour les croire, pour les suivre, bref, pour me mettre en tutelle entre vos mains, envie qui ne prend guère aux rois, aux barbes grises et aux victorieux. »
Le chancelier prononça ensuite un assez long discours sur les nécessités et les périls de l’État, et sur les sacrifices que le roi, si prodigue lui-même de ses efforts et de sa vie, avait droit d’attendre de ses sujets.
Les notables présentèrent au roi le cahier de leurs demandes en janvier 1597. Le roi, dans son discours, avait reconnu devoir en partie sa couronne à l’épée de sa noblesse : aussi la noblesse parlait-elle haut et avait-elle pris la prépondérance dans l’Assemblée. Elle réclamait la préférence pour les évêchés et les charges de magistrature, et l’interdiction aux roturiers d’entrer dans les compagnies d’ordonnance (de grosse cavalerie).
Le cahier des notables estime le total de l’impôt nécessaire à environ trente millions. Le surintendant de Henri III n’en avait demandé que vingt-sept aux États de 1588, qui s’étaient fort récriés. Les notables demandaient que le roi convoquât les États Généraux le plus tôt possible. Ainsi, même ces dignitaires et ces fonctionnaires non élus par le peuple réclamèrent les droits de la nation.
Sully nous apprend, dans ses Œconomies royales, quels furent les règlements proposés par les notables. C’était le partage de l’administration du trésor entre le Conseil royal des finances et un Conseil électif, qui serait choisi, la première fois, par les notables et, dans la suite, par les cours souveraines. Le Conseil des finances disposerait des 5 millions d’écus formant la part du roi : « le Conseil de raison », ainsi nommé « d’autant qu’il rendrait raison à un chacun », réglerait la distribution de l’autre moitié du revenu public.
Les notables voulaient charger une Assemblée au petit pied d’attaquer les mêmes abus sur lesquels le roi commençait à lancer un homme d’un génie spécial, ayant, avec l’unité de la pensée, l’unité de l’action. Le but était le même ; mais le moyen du roi était le meilleur, à part même ce qu’avait d’illogique cette division arbitraire de l’administration des finances.
Les notables offrirent en même temps au roi, afin de compléter les 29 millions 400 000 livres d’impôt qu’ils jugeaient nécessaires, l’établissement d’une taxe d’un sou pour livre sur toutes les marchandises à l’entrée des villes, bourgs, bourgades et dans les foires. C’était s’arroger un droit qui n’appartenait qu’aux États Généraux.
Henri IV ne se fit pourtant pas scrupule d’accepter le sou pour livre : il accepta aussi le « Conseil de raison », malgré les clameurs de son Conseil, qui s’était levé en masse contre cette invention attentatoire à l’autorité royale. Henri tint en apparence la parole donnée aux notables de se « mettre en tutelle entre leurs mains » ; mais il se réserva, de concert avec Rosny, les moyens d’annihiler une innovation malsonnante. Rosny lui fit prendre, pour sa part, les plus claires sources de revenus, celles qui étaient de nature à s’améliorer : le roi ne laissa au « Conseil de raison », à la tête duquel avait été placé le cardinal de Gondi, que les revenus les moins assurés, entre autres le sou pour livre, dont l’expérience était à faire.
Les notables en avaient estimé le produit à 5 millions : on se trouva loin de ce compte. La pancarte, ainsi qu’on nomma ce nouvel impôt, établie pour trois ans par édit de mars 1597, fut fort mal accueillie, d’abord par la Cour des aides, qui ne consentit qu’à grand-peine à l’enregistrer pour un an, puis par les populations : plusieurs villes la repoussèrent par des émeutes ; d’autres, par des remontrances pacifiques, comme n’ayant point été votée par les États Généraux. Bref, la pancarte fut très peu productive.
Le Conseil de raison fut ainsi arrêté dès les premiers pas. Un grave évènement, qui éclata sur ces entrefaites, ajourna les réformes pacifiques et compliqua encore les difficultés que Rosny s’appliquait à multiplier pour dégoûter ses concurrents. Le Conseil de raison fut trop heureux de résigner ses pouvoirs entre les mains du roi.
Le roi était revenu de Rouen à Paris, au mois de février, après avoir fermé l’Assemblée des notables et imposé au Parlement de Rouen l’enregistrement de l’édit de 1577 en faveur des protestants : le Parlement de Rouen avait repoussé jusqu’alors cet édit avec obstination. Rosny et les autres membres du Conseil des finances travaillaient à réunir dans Amiens les provisions et l’artillerie nécessaires pour le siège d’Arras, que le roi voulait entamer au printemps. Une victoire remportée par les Hollandais sur les Espagnols, à Tournhout, semblait de bon augure (janvier 1597). Henri, en attendant, achevait l’hiver à Paris dans les plaisirs.
Tout à coup, retentit comme le tonnerre cette fatale nouvelle :
« Amiens est pris ! » Dans la nuit du 11 au 12 mars, on éveilla le roi pour lui apprendre que les Espagnols étaient entrés dans Amiens le 11 au matin. Les Amiénois, en vertu de leurs privilèges, avaient obstinément refusé une faible garnison suisse que le roi les priait de recevoir. Il leur en coûta cher. Un ligueur exilé, qui avait conservé des intelligences dans Amiens, avertit le gouverneur espagnol de Doullens, Porto-Carrero, que les Amiénois se gardaient avec soin pendant la nuit, mais avec négligence pendant le jour. Trois ou quatre mille soldats d’élite, réunis sans bruit autour de Doullens, vinrent, le 11 mars, avant le jour, s’embusquer aux environs d’une des portes d’Amiens (la porte de Montescut).
À huit heures du matin, lorsqu’on ouvrit la porte, une quarantaine d’officiers et de soldats, déguisés en paysans, et chargés de sacs et de fardeaux, se présentèrent pour entrer : un d’eux laissa, comme par mégarde, s’ouvrir son sac, d’où s’échappèrent des noix. Les gens du guet se jetèrent dessus en riant et se battirent à qui ramasserait les noix. Au même instant, parut une charrette conduite par quatre autres faux paysans, qui arrêtèrent la charrette sous la herse, pour qu’on ne pût fermer la porte. Tous les faux paysans tirèrent des épées et des pistolets de dessous leurs souquenilles, donnèrent le signal et tombèrent sur la garde, qui fut massacrée ou mise en fuite. Porto-Carrero et ses troupes accoururent, entrèrent quasi sans obstacle, culbutèrent quelques bourgeois accourus au bruit, et, divisés en plusieurs corps, marchèrent à la grande place, à la cathédrale, à l’arsenal et aux divers points fortifiés de la ville.
On était en carême : le peuple, assemblé dans les églises pour le sermon du matin, fut tellement stupéfié quand il entendit les tambours ennemis aux portes de Notre-Dame d’Amiens, qu’il n’opposa presque aucune résistance.
Henri IV resta quelques moments abasourdi sous ce coup terrible ; puis, songeant un peu, il dit : « C’est assez faire le roi de France ! il est temps de faire le roi de Navarre ! »
Il était bien nécessaire, en effet, que « le roi de Navarre », le roi d’Arques et d’Ivry, se retrouvât tout entier ! Henri avait à combattre, en effet, non pour la gloire, mais pour l’existence même. La confiance en sa fortune, qui avait tant fait pour lui, fut profondément ébranlée, en France et au dehors, par la perte d’Amiens, succédant ainsi aux pertes de Doullens, de Cambrai, de Callais. Ses ennemis étaient dans l’allégresse.
Le duc de Savoie, rompant une trêve qu’il avait demandée au roi, le duc de Mercœur, qui se maintenait dans une partie de la Bretagne, se concertèrent avec Philippe II pour une attaque dans l’Ouest et dans le Sud-Est. Des complots ligueurs furent découverts et des gens pendus à Paris, à Rouen, à Poitiers. La masse du peuple était loin de favoriser ces complots ; toutefois, elle souffrait, et elle était mécontente. Les alliés étaient froids, sauf les Hollandais. Les protestants réclamaient des garanties plus solides et un nouvel édit en leur faveur.
Henri fit face à tout en grand roi et en grand capitaine. Il déclara aux négociateurs employés par le pape qu’il ne traiterait plus qu’après la reprise d’Amiens. Il partit, avec toute la noblesse de cour, pour aller rassurer et mettre à l’abri le reste des places picardes : il fit entamer sur-le-champ le blocus d’Amiens par Biron, avec quatre ou cinq mille soldats qu’il avait sous la main ; ce corps de troupes, posté à Longpré, au nord de la Somme, se grossit peu à peu des gens de guerre qui arrivèrent de tous les points du royaume, et, de simple corps d’observation, devint armée de siège.
Les meilleures dispositions militaires eussent avorté, si l’on ne se fût assuré du « nerf de la guerre ». Le soin de la subsistance des troupes fut confié spécialement à Rosny. Il ne s’agissait pas seulement d’assurer la solde de l’armée : tout était à recréer, l’artillerie, les magasins. On n’avait pas le choix des moyens. Rosny suggéra au roi les expédients les plus prompts, sinon les plus conformes à la saine économie : c’était de demander au clergé un décime ou deux ; de créer et de mettre en vente un certain nombre d’offices ; de lever un emprunt forcé sur les plus aisés des membres des cours souveraines et des habitants des grandes villes, en assignant le remboursement et les intérêts sur une amélioration considérable que Rosny avait déjà obtenue dans les baux des gabelles et des cinq grosses fermes ; de demander aux provinces du Nord trois régiments entretenus à leurs frais ; de contraindre les traitants à financer, en les menaçant d’une Chambre de justice qui poursuivrait leurs malversations ; enfin d’établir une crue de quinze sous par minot de sel. Ce dernier expédient était le moins excusable de tous, car il augmentait une charge qui pesait surtout sur le pauvre.
Les Parlements adressèrent au roi de virulentes remontrances, surtout relativement à la création de nouveaux offices. Le roi raccourut dans la capitale pour obliger le Parlement de Paris à enregistrer les édits bursaux (12 avril). Une scène très vive eut lieu entre Henri et le premier président de Harlai : ces parlementaires, comme le roi le leur reprocha, ne savaient pas sortir un moment « des formalités des lois et ordonnances » pour comprendre les nécessités du salut de l’État. La résistance se prolongea plus d’un mois : la vérification des édits fut refusée au connétable et au chancelier ; il fallut que le roi allât en personne forcer l’enregistrement (21 mai) et demander l’emprunt aux principaux membres des Cours souveraines et de la bourgeoisie parisienne. Il partit ensuite pour le camp, laissant Paris si agité qu’il crut devoir interdire, pour cette année, les élections municipales et maintenir arbitrairement en charge les magistrats dont les fonctions étaient expirées.
Henri était bien assuré que toutes ces rumeurs s’apaiseraient s’il revenait vainqueur. Grâce à l’énergique intervention du roi, Rosny, qui avait promis que les troupes ne manqueraient de rien, eut les moyens de tenir parole et put se tirer, à son honneur, de cette rude épreuve. Jamais un si bel ordre n’avait régné dans les armées de Henri IV. Le camp royal semblait un « second Paris ». On y trouvait toutes les commodités de la vie. Les soldats, bien payés, bien nourris, bien soignés lorsqu’ils étaient blessés ou malades, supportaient gaiement les fatigues et les dangers. Durant six mois que dura le siège, il n’y eut pas trace d’épidémie dans l’armée.
Les affaires allaient bien dans l’Ouest et le Sud-Est. Une tempête avait empêché la flotte espagnole de descendre en Bretagne, et les gens de Mercœur avaient été battus par les royaux. Le duc de Savoie, non seulement n’avait pu envahir le Dauphiné, mais avait vu la Savoie envahie par Lesdiguières.
La garnison d’Amiens, cependant, résistait opiniâtrement. Elle comptait au moins quatre mille hommes d’élite, et son commandant, Porto-Carrero, se montrait aussi énergique à défendre Amiens qu’il avait été adroit à le surprendre.
Malgré la belle défense des Espagnols, les Français avançaient peu à peu ; ils étaient logés au bord des fossés de la place et battaient les remparts avec quarante-cinq canons. L’archiduc gouverneur de Belgique se préparait de son mieux à secourir la place ; mais le grand effort de Philippe II contre la France était déjà à bout. Philippe II avait fait banqueroute, pour la seconde fois, en abolissant tous les intérêts des capitaux qu’il avait empruntés et en reprenant tous les gages qu’il avait assignés à ses créanciers (novembre 1596). La conséquence en était qu’il ne pouvait plus se procurer un écu à l’avance. L’archiduc Albert n’eut d’argent qu’après l’arrivée des galions qui apportaient le tribut des mines d’Amérique. Il ne put mettre en mouvement son armée avant le mois de septembre. Les Français eurent tout le temps de se préparer à le recevoir.
Le brave gouverneur d’Amiens, Porto-Carrero, fut tué le 3 septembre. Le bruit de l’approche de l’archiduc empêcha la garnison de perdre courage. L’archiduc arriva à Doullens avec vingt mille hommes. Le roi en avait au moins vingt-cinq mille, et croyait si peu que l’archiduc osât l’attaquer, qu’il partit pour la chasse le 15 septembre au matin. L’ennemi parut vers midi, et ce fut Mayenne qui mit l’armée française en défense durant l’absence du roi. Henri IV n’eut pas à se repentir de l’avoir bien traité, lui et son neveu de Guise.
L’archiduc ne tenta point d’assaillir les lignes françaises, ni d’emporter le pont de Longpré, qui lui eût donné passage pour ravitailler Amiens par la rive sud de la Somme. Il jeta un pont sur la Somme un peu plus bas, entre Saint-Sauveur et Ailli ; mais le roi était revenu, et les dispositions prises. Le premier corps espagnol qui essaya de franchir la rivière fut vigoureusement repoussé. L’archiduc battit en retraite, et la garnison d’Amiens se rendit le 25 septembre.
Le mal était plus que réparé, et la foi dans la force et dans l’avenir de Henri IV redevint plus grande qu’avant la perte d’Amiens. L’obstination de Philippe II céda enfin. Il se sentit vaincu et, pour la première fois, souhaita la paix.
Pendant qu’on négociait, Henri partit pour la Bretagne. Toute la partie de la Bretagne qui reconnaissait encore pour chef le duc de Mercœur, Nantes, Vannes, etc., obligea ce duc à se soumettre sans combat (mars 1598). Ainsi disparurent les derniers restes de la Ligue.
Le roi, pendant son voyage dans l’Ouest, termina aussi la grande affaire des protestants.
Aucune affaire ne donna jamais plus de peine à Henri IV ; il passa bien des nuits sans sommeil avant de parvenir à trouver une transaction acceptable et pour l’intolérante majorité catholique et pour l’exigeante et défiante minorité huguenote. Après deux ans de négociations, les commissaires du roi réussirent enfin à s’entendre avec l’Assemblée générale des protestants, et Henri IV signa, le 15 avril 1598, le fameux ÉDIT DE NANTES.
Il y déclarait qu’afin que tous ses sujets pussent adorer Dieu, sinon encore en une même forme de religion, au moins d’une même intention, et sans qu’il y eût pour cela de trouble ni de tumulte entre eux, il donnait sur cette matière un édit PERPÉTUEL ET IRRÉVOCABLE.
Ce fut la fin des grandes Guerres de Religion. L’Édit de Nantes commençait une nouvelle ère de l’histoire. Au Moyen Âge, l’unité de culte avait été la base de la société ; la société religieuse, alors, était une, et la société politique était fractionnée. Maintenant, c’était l’État, la patrie qui était une, et l’Église qui était partagée et diverse.
L’Édit de Nantes ne devait pas être PERPÉTUEL ET IRRÉVOCABLE, comme l’avait voulu Henri IV. Son petit-fils, Louis XIV, devait le révoquer, et rétablir violemment, pour un temps, l’unité de l’État et de l’Église ; mais la pensée de Henri IV, qui était celle des temps nouveaux, était destinée à vaincre finalement la pensée rétrograde de Louis XIV.
La paix avec l’Espagne fut signée à Vervins quinze jours après l’Édit de Nantes (2 mai 1598). L’Angleterre et la Hollande n’avaient pas voulu y prendre part.
Les Espagnols rendirent Calais et quelques autres places qu’ils avaient gardées en Picardie, et Blavet (Port-Louis) en Bretagne. Ils ne gardèrent de leurs conquêtes que Cambrai, qui n’était pas du royaume de France et qui était fief de l’Empire. Pour tout le reste, on se remit sur le pied du traité de Cateau-Cambrésis en 1559. Le duc de Savoie fut compris dans le traité.
Philippe II céda la Belgique et la Franche-Comté à sa fille, l’infante Isabelle-Claire-Eugénie, qu’il n’avait pu faire reine de France, et la maria à son cousin, l’archiduc Albert. La couronne d’Espagne gardait la suzeraineté des pays cédés, avec garnisons dans les citadelles d’Anvers, Gand et Cambrai.
Philippe II mourut bientôt après, le 13 septembre 1598, emporté par une affreuse maladie, dont les longues tortures avaient semblé une expiation des supplices infligés par son ordre à tant de milliers de malheureux.
Philippe II avait échoué dans toutes les entreprises par lesquelles il avait bouleversé l’Occident, sauf dans une seule, la conquête du Portugal. Mais cette conquête même fut stérile entre ses mains ; il ne fut pas capable de réunir l’Espagne et le Portugal en un puissant empire ibérique, et ne sut que ruiner le Portugal sans profit pour l’Espagne. Il ne savait que détruire et non fonder.
La cause du fanatisme et celle de la monarchie universelle avaient été vaincues avec Philippe II. La cause des nationalités indépendantes triomphait avec Henri IV, Élisabeth d’Angleterre et les républicains de Hollande. La cause de la tolérance religieuse triomphait avec Henri IV seul, et c’est là sa vraie gloire.
Après la paix avec l’Espagne et l’Édit de Nantes, qu’on peut appeler la paix de religion, Henri IV se donna tout entier à deux choses, le rétablissement de l’ordre et de la prospérité publique à l’intérieur, et la préparation de grands desseins politiques à l’extérieur.
Voyons d’abord ce qu’il fit à l’intérieur de la France.
Le grand mal, c’étaient les finances ; il y avait là de tels abus, que le peuple payait aux receveurs et aux fermiers des impôts presque le double de ce que recevait le gouvernement du roi. Le gouvernement était accablé sous une dette immense, qui montait à environ 340 millions, représentant en valeur relative 3 milliards d’aujourd’hui. Par rapport aux ressources de ce temps-là, c’était effrayant.
Henri IV, aidé par son énergique et fidèle conseiller Rosny, attaqua le mal en face. Il nomma Rosny, en 1599, surintendant des finances et grand voyer de France, c’est-à-dire ministre des finances et directeur général des routes, ponts et chaussées ; puis il lui confia la direction de l’artillerie, des bâtiments et des fortifications, et lui conféra le titre de duc de Sully et de pair de France en 1606, afin de lui donner un rang égal à son autorité. Rosny devint de la sorte premier ministre en fait, sans en avoir le titre.
Rosny fut mis par Henri IV en mesure d’exécuter un plan de réforme qu’il lui avait présenté depuis longtemps, et que la paix rendait enfin réalisable. Il consistait principalement en ceci : 1° faire le tableau de tous les revenus du royaume et rechercher toutes les améliorations praticables ; 2° dresser l’état des dettes de toute origine, et aviser au moyen de les régler, diminuer et acquitter peu à peu ; 3° faire la liste de tous les officiers royaux, afin de reconnaître quels étaient ceux dont on pouvait se passer, et de réduire peu à peu leur nombre et leurs gages ; 4° faire la liste de toutes les forteresses royales et seigneuriales, avec spécification de celles qu’il faudra démolir, quand on le pourra sans résistance dangereuse ; 5° faire la visite générale des frontières de terre et de mer, en marquant surtout les lieux où existent ou pourraient se faire de bons ports et havres, afin d’essayer de rendre la France aussi puissante sur la mer qu’elle l’est sur la terre.
Rosny se mit vigoureusement à l’ouvrage. Il commença par empêcher que l’on continuât à manger d’avance les revenus, comme on faisait, et par attribuer à chaque partie de la dépense une certaine partie de la recette. Il assura avant tout les services publics, et, les services une fois assurés, il réunit le reste des recettes dans une caisse destinée au paiement des intérêts de la dette et à l’extinction des charges.
Une partie de l’intérêt de la dette fut ainsi quelque temps en souffrance ; mais c’était pour mieux assurer le paiement dans l’avenir. Rosny, en effet, améliora promptement les recettes. Une partie des impôts étaient affermés à vil prix ; il les fit dorénavant affermer par enchères et en doubla presque le produit. Pour les tailles et autres impôts qui n’étaient point donnés en ferme, il obligea les receveurs généraux à rendre des comptes détaillés, qui ne leur permirent plus de frauder l’État. Il remit dans les mains du gouvernement tous ceux des revenus qui avaient été aliénés, en payant aux aliénataires la rente de ce qu’on leur devait.
Après avoir mis fin aux vols des financiers, le roi et le ministre en finirent aussitôt avec les exactions des gouverneurs militaires, et leur défendirent de lever de l’argent dans leurs gouvernements sans autorisation royale.
Beaucoup d’offices inférieurs de judicature et de finance furent supprimés (1603). Puis Rosny entreprit la vérification et la réduction des rentes sur l’État. Beaucoup étaient ou fondées sur des créances susceptibles de légitimes réductions, ou même frauduleuses. Rosny avait déjà annulé ces dernières autant qu’il l’avait pu ; il réduisit la plus grande partie des autres dans des conditions qui n’étaient pas toutes équitables ; mais les vrais principes du crédit public n’étaient pas encore bien établis (1604).
En même temps que la dette de l’État, Rosny vérifia, réduisit, éteignit, tant qu’il put, les dettes des provinces, des villes, des communautés diverses.
À la suite de la vérification des rentes, le ministre procéda à la vérification des aliénations du domaine. Là aussi il annula ce qui était frauduleux, réduisit ce qui était susceptible de réduction, et assura le paiement du reste, avec le recouvrement du fonds par l’État.
Relativement à la magistrature, Rosny conseilla au roi une mesure où il ne vit qu’un accroissement de revenus pour l’État, mais qui eut des conséquences graves sous d’autres rapports. La vénalité des charges, dans les tribunaux, avait subsisté habituellement en fait depuis François Ier, quoique le chancelier de L’Hospital l’eût un moment fait abolir. Les magistrats qui avaient acheté leurs charges du roi les revendaient à leurs successeurs ; mais tout cela se passait d’une façon très irrégulière. Rosny décida Henri IV à concéder aux officiers de justice, et de finance la propriété héréditaire de leurs charges, moyennant un droit annuel du soixantième de la valeur de chaque office.
Cela fit que les charges de présidents et conseillers aux parlements ne furent plus accessibles qu’aux riches. Les parlements, constitués définitivement en aristocratie héréditaire, n’y gagnèrent pas sous le rapport des lumières, mais ils y gagnèrent en indépendance vis-à-vis du pouvoir royal, et leur esprit de corps en fut renforcé.
En même temps que les finances, l’armée fut réorganisée. Elle était fort brave, mais mal disciplinée et peu instruite dans l’art de la guerre. On la réduisit à de bons cadres en temps de paix, et l’on reporta l’économie de cette réduction sur le matériel de l’artillerie, sur les travaux de fortification et sur la création d’une bonne administration militaire et de bons corps d’officiers et d’ingénieurs, afin de remettre les Français, dans l’art des ingénieurs, au niveau des Italiens et des Hollandais.
En 1609, Henri IV demanda à Rosny, devenu duc de Sully, un rapport général sur la situation du royaume. Au commencement de 1610, le ministre put lui répondre que 100 millions de dettes étaient acquittés, et 30 à 35 millions de domaines et de rentes rachetés. Le revenu disponible, toutes charges déduites, était monté de 9 millions à 20, et le roi avait à sa disposition immédiate une réserve de 20 à 22 millions, dont 16 ou 17 en argent dans les tours de la Bastille. Les arsenaux regorgeaient d’armes et de munitions. Une flotte de galères avait été armée dans nos ports de la Méditerranée ; on avait négligé provisoirement l’Océan, parce que, là, on pouvait compter, en cas de guerre, sur les flottes des Hollandais.
C’étaient là de beaux résultats. Le roi et le ministre les avaient obtenus non pas seulement en rétablissant l’ordre dans les finances, c’est-à-dire en réglant mieux l’emploi des revenus publics, mais aussi en favorisant le travail, qui augmente les revenus et produit la richesse publique de l’accroissement des richesses particulières.
Sully disait que « labourage et pâturage sont les deux mamelles qui nourrissent la France », et il fit tout ce qui dépendait de lui pour aider au développement de l’agriculture et à la multiplication du bétail.
Des mesures énergiques furent prises pour protéger les paysans contre les soldats licenciés qui maraudaient dans la campagne. Le peuple était accablé sous les tailles arriérées dont les percepteurs réclamaient le paiement. La moitié des arrérages fut remise aux contribuables. La taille annuelle fut diminuée. L’arbitraire inique avec lequel on répartissait la taille, bien plus que l’impôt lui-même, écrasait les pauvres gens. Un règlement excellent établit une espèce de Jury, choisi par les parties, afin de juger sans frais les procès pour surtaxe et fausse répartition. Des peines sévères frappèrent les répartiteurs qui prévariquaient, et tous les gens aisés, parmi les taillables, durent être répartiteurs et collecteurs de l’impôt chacun à leur tour.
Chaque paroisse devant payer une somme déterminée, il y avait solidarité pour le paiement, c’est-à-dire que tous les habitants répondaient les uns pour les autres. Les riches, par la connivence des répartiteurs, rejetaient souvent la solidarité sur les pauvres. Des dispositions furent prises pour que ce fût dorénavant le contraire. Le même règlement autorisa les paroisses à racheter, au prix de vente, leurs biens communaux aliénés pendant la guerre civile. Henri IV et Sully pensaient que l’aliénation des communaux est un grand mal pour les communes (1600).
Beaucoup de gens, sans être nobles, s’étaient fait donner ou avaient usurpé un des privilèges des nobles en matière d’impôt, à savoir : l’exemption de taille. On les remit à la taille, ce qui diminua d’autant la charge des autres.
La libre exportation des blés, des vins et des eaux-de-vie fut autorisée par toutes les frontières. Sous les derniers Valois, il avait été le plus souvent défendu de faire sortir les blés du royaume.
Sully recommanda aux percepteurs et aux commissaires de la gabelle une grande modération dans les poursuites et dans les amendes, en attendant qu’il pût, d’accord avec le roi, réaliser le projet d’acheter les salines de l’Ouest, afin d’en faire un domaine de la couronne et de vendre le sel comme marchandise libre, au lieu de forcer chaque famille à l’acheter par forme d’impôt. Le temps manqua pour exécuter ce plan, qui eût bien soulagé le peuple.
Des édits furent publiés pour l’entretien des eaux et des forêts, qui avaient été fort dévastées pendant la guerre civile, puis pour le dessèchement des marais et pour l’exploitation des mines. Henri IV et Sully voulaient que la France fît usage de toutes ses richesses naturelles. Dans les édits relatifs à l’ouverture de nouvelles mines, il est dit que le trentième du produit net doit être réservé pour les secours à donner aux ouvriers blessés ou malades, et que les ouvriers doivent être payés avant les autres créanciers.
Sully fit beaucoup aussi pour les routes, les ponts, les chaussées. Il fit border d’ormes les grands chemins, et l’on voit encore çà et là sur nos collines quelques grands arbres isolés, qui ont autrefois servi de jalons au géographe Cassini pour dresser la carte de France. Ce sont les derniers restes des plantations du grand ministre, et, de son nom, on les appelle encore des Rosnis.
Sully établit des relais de chevaux sur les routes, et fit beaucoup travailler pour rendre les rivières plus facilement navigables. Le roi et lui avaient conçu le grand dessein de joindre les mers du Nord à la Méditerranée par des canaux qui réuniraient la Seine à la Loire, la Loire à la Saône, la Saône à la Meuse. Ils exécutèrent la première partie du projet en faisant creuser le canal de Briare, qui joint la Loire à la Seine (1604).
Le plan de Henri IV et de Sully n’a été achevé que bien longtemps après, avec ce changement qu’au lieu de réunir la Saône à la Meuse, on a réuni la Saône au Rhin, et l’Oise à l’Escaut.
Le projet de réunir l’Océan et la Méditerranée par un canal joignant l’Aude et la Garonne fut aussi adopté par Henri IV, mais ne fut réalisé que sous Louis XIV.
C’était l’ingénieur provençal Adam de Crapone, qui, du temps d’Henri II, avait eu le premier ces grandes vues sur la canalisation de la France, et qui avait inventé le système des canaux à point de partage, par lequel on élève graduellement les eaux, au moyen d’écluses, jusqu’au niveau du point de séparation entre les bassins des rivières qu’on veut réunir.
L’espoir de Henri IV et de Sully ne fut pas trompé. L’agriculture française prit un très grand essor, et la France exporta, pendant la plus grande partie du XVIIe siècle, une quantité croissante de blés et de grains.
Une partie de la noblesse s’attacha sérieusement et fructueusement aux travaux des champs, ce qui était nouveau parmi nous, et un gentilhomme protestant du Languedoc, appelé Olivier de Serres, donna tout à la fois aux laboureurs le meilleur modèle pratique dans son manoir du Pradel, près Villeneuve en Vivarais, et les meilleurs préceptes dans son livre intitulé : Théâtre d’agriculture et ménage des champs (1600). C’est lui qui a propagé la création des prairies artificielles. Il engagea Henri IV à en établir dans le domaine royal.
Il recommanda aussi très vivement la culture du maïs et du houblon, alors peu répandus encore chez nous. Beaucoup d’arbres, de plantes et d’animaux étrangers ont été introduits en France au XVIe siècle et au commencement du XVIIe. On peut citer le tabac, la betterave, le marronnier d’Inde, le robinier, qu’on appelle communément acacia ; et, parmi les oiseaux, le dindon et la pintade.
Ce grand agriculteur, Olivier de Serres, était en même temps très partisan du progrès de l’industrie, et poussa fort Henri IV à propager en France les plantations de mûriers, afin d’élever chez nous les vers à soie, et de faire de la soierie une industrie tout à fait nationale, en nous appropriant la matière première au lieu d’aller l’acheter en Italie.
Sully n’était pas favorable au développement de l’industrie ; il eût voulu prohiber les soieries et toutes les étoffes de luxe au lieu de les naturaliser dans le royaume. Mais le roi, sur ce point, ne l’écouta pas, et publia plusieurs édits pour exciter à la culture des mûriers. Il en remplit le jardin des Tuileries, et établit des magnaneries, ou ateliers pour l’éducation des vers à soie, aux Tuileries et au château de Madrid, dans le bois de Boulogne. Il ordonna la formation d’une pépinière de mûriers dans chaque élection ou arrondissement financier, et invita le clergé à en planter dans toutes ses terres (1600-1605).
Une chambre de commerce fut instituée « pour vaquer au rétablissement du commerce et manufacture » (1601). Des manufactures de cristaux et verreries, de draps et toiles d’or, d’argent et de soie, de fils d’or, de tapisseries façon de Flandre, de toiles fines façon de Hollande, de cuir doré et drapé, d’acier fin, etc., furent établies avec l’aide du gouvernement et avec privilèges. Avec les habitudes d’alors, on n’eût pas trouvé d’entrepreneurs, si on ne leur eût accordé des privilèges et des monopoles, au moins pour un temps, et des prohibitions contre la concurrence étrangère. Mais, par compensation, des mesures libérales soustrayaient les ouvriers de ces établissements privilégiés aux entraves du régime des corporations.
De cette époque datent les manufactures des Gobelins et de la Savonnerie.





























