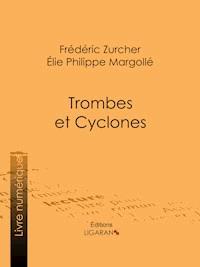
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Extrait : "Dans les sociétés primitives, l'homme, placé presque sans défense devant les phénomènes de l'atmosphère, dut s'attacher surtout à l'observation de ceux qui le menaçaient, et qui, sur une terre à peine cultivée, se produisaient sans doute plus fréquemment qu'aujourd'hui. Le danger passé, il devait aussi revoir avec un sentiment de religieuse reconnaissance les signes qui lui annonçaient le retour du beau temps, du calme, de l'ordre, de l'harmonie..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Croyances primitives. – Superstitions. – Culte des météores. – Typhon. – Les Vents. – Tourbillons décrits par les anciens. – Temps modernes. – Observations des navigateurs. – La Science.
Dans les sociétés primitives, l’homme, placé presque sans défense devant les phénomènes de l’atmosphère, dut s’attacher surtout à l’observation de ceux qui le menaçaient, et qui, sur une terre à peine cultivée, se produisaient sans doute plus fréquemment qu’aujourd’hui. Le danger passé, il devait aussi revoir avec un sentiment de religieuse reconnaissance les signes qui lui annonçaient le retour du beau temps, du calme, de l’ordre, de l’harmonie, et le premier culte fut ainsi fondé sur les mystérieuses relations qui semblaient exister entre les manifestations diverses des forces de la nature et la puissance des Dieux. La crainte de cette puissance ne fut pas l’unique source du sentiment qui fit élever les premiers autels ; redoutée dans le désastreux conflit des éléments, dans les ténèbres du mal, elle était bénie dans tous les biens dont elle comblait déjà le monde, et qui remplissaient les âmes d’une vivifiante lumière, d’un fortifiant espoir. L’Égypte, l’Inde, la Perse nous offrent dans leurs mythes des exemples frappants de la croyance qui divisait les êtres invisibles en puissances du mal et en puissances du bien, et promettaient à ces dernières le triomphe qui devait mettre fin à la lutte entre les éléments, et aux discordes, plus désastreuses encore, d’où était sortie la guerre entre les humains.
Dans l’Inde, les génies des vents, les Maruttes, passent avec la tourmente sur les sommets des montagnes, pressent les flancs du nuage qui retient les eaux captives, et déchaînent sur la plaine le tourbillon des tempêtes au milieu de torrents de pluie. – Mais bientôt reparaît la lumière, le Soleil, l’Archer céleste qui a vaincu les ténèbres, le démon pluvieux. « Je chanterai la victoire d’Indra, dit le Rig-Véda, celle qu’hier a remportée l’Archer ; il a frappé Ahin (le nuage noir), il a frappé la première des nuées. » – Ce retour de la sérénité, du calme après la tempête, est célébré d’une manière touchante dans un cantique des Védas : « Que les vents nous soient doux ! Que la nuit, le crépuscule, le ciel, l’air, le roi des plantes, le Soleil, les troupeaux, tout soit rempli de douceur ! » – On comprend ce chant agreste des pasteurs, des bergers, des tribus patriarcales qui parcouraient les vastes plateaux de l’Asie, et qui, dans leur vie nomade, avaient à lutter contre les intempéries et les bourrasques des hautes régions.
En Grèce, la Théogonie d’Hésiode, dans laquelle la lutte de Jupiter contre les Titans est l’action fondamentale du poème, nous fait assister aux mêmes scènes naturelles, et, comme l’a très bien dit un de nos éminents professeurs, « au dernier effort des puissances désorganisatrices pour détruire l’ordre naissant du monde par l’action irrégulière et violente des vents, des ouragans, des volcans. » Cette poétique histoire des grands combats de la nature se lie dans la Théogonie à une conception symbolique qui en montre le but principal, l’affermissement des croyances religieuses communes aux tribus, aux cités helléniques, tendant alors à s’organiser en un corps de nation, sous l’égide tutélaire des mêmes lois.
Comme l’indiquent leurs noms grecs, les Titans, les Cyclopes et les Hécatonchires sont la foudre et l’éclair, les ouragans et les tremblements de terre, les orages souterrains. Après la grande lutte décrite par Hésiode et la victoire des Dieux, les Titans sont précipités dans le Tartare, au fond d’un gouffre immense et ténébreux. Mais la Terre engendre encore Typhon, le dernier de ses enfants. « Les vigoureuses mains de ce dieu puissant travaillaient sans relâche, et ses pieds étaient infatigables ; sur ses épaules se dressaient les cent têtes d’un horrible dragon, et chacune dardait une langue noire ; des yeux qui armaient ces monstrueuses têtes jaillissait une flamme étincelante ; toutes, hideuses, proféraient mille sons inexplicables, quelquefois si aigus que les dieux même pouvaient les entendre, tantôt la mugissante voix d’un taureau sauvage, tantôt le rugissement d’un lion, les aboiements d’un chien ou des clameurs perçantes dont retentissaient les hautes montagnes. »
« Devant cette monstrueuse apparition, Jupiter, père des hommes et des dieux, lance son rapide tonnerre, qui fait terriblement retentir la terre, le ciel, l’océan et les abîmes souterrains. Il s’avance et le grand Olympe tremble sous ses pieds immortels. La terre féconde gémit, la sombre mer est envahie par les tourbillons des vents enflammés, par la foudre et l’éclair. La terre, le ciel et la mer bouillonnent sous le choc des terribles rivaux ; les grandes vagues se brisent contre les rivages, secoués par un irrésistible ébranlement. Dans le Tartare, les Titans tremblent au fracas épouvantable de l’effrayant combat. Enfin le roi du ciel rassemble toute sa force, le tonnerre, les éclairs, la foudre ardente, les lance du haut de l’Olympe sur Typhon et frappe ses têtes formidables. Vaincu par ces coups redoublés le monstre tombe mutilé, et Jupiter le plonge dans le profond Tartare. » – De Typhon naquirent les tempêtes qui « soufflent de tous les côtés, dispersent les navires et font périr les matelots ; ou, déchaînées sur la terre fleurie, détruisent les travaux des humains ».
Dans la mythologie de l’ancienne Égypte, Typhon, frère des vents funestes, personnification du mauvais principe, est en lutte avec Osiris, considéré comme le Nil et le Soleil tout à la fois. Ce mythe, dit Creuzer, a pour fond la révolution physique et astronomique de l’année. Au temps des grandes chaleurs, de mars en juillet, tout en Égypte est sous l’empire de Typhon, le vent brûlant du désert de Libye, qui embrase l’air et dessèche la terre. Mais au solstice d’été, l’inondation bienfaisante du Nil vient tout ranimer ; Osiris est vainqueur de Typhon, et par lui l’Égypte retrouve sa fertilité. – En automne elle est presque entièrement cachée sous les eaux avec les espérances de l’année ; les jours décroissent, et Typhon devient le génie ténébreux de l’hiver, le vent du nord qui souffle de la mer, amène les tempêtes et obscurcit le soleil. Osiris semble avoir succombé, et les fêtes religieuses de l’automne sont consacrées au deuil et à la tristesse. Mais ces fêtes, qui sont en même temps les fêtes des semailles, sont accompagnées d’espoir. Bientôt le soleil remonte dans les cieux, les eaux s’écoulent, les jeunes semences commencent à sortir de terre, et une période d’allégresse s’ouvre avec les premiers jours de janvier, qui commencent une vie nouvelle, de lumière et de sérénité.
Si toutes les influences malfaisantes étaient attribuées à Typhon, dont l’empire embrassait à la fois les déserts brûlants et les plages malsaines situées aux bouches du Nil, ces influences étaient surtout redoutées dans le souffle dévorant des vents du midi. Suivant M. Jomard, l’un des savants collaborateurs du grand ouvrage français sur l’Égypte, les sables de la Libye, apportés par des vents impétueux dans les gorges profondes de la chaîne arabique, s’y engouffrent et y forment des tourbillons terribles, de véritables trombes, météore qui n’est pas rare dans le pays qui sépare le Nil de la mer Rouge, et dont les ravages, l’aspect formidable, ont donné naissance au mythe de Typhon. « Il n’est personne, dit Creuzer, qui puisse refuser à cette explication un haut degré de vraisemblance locale et physique. Et réellement, l’un des principaux devoirs du mythologue, c’est de scruter la nature, d’étudier ses phénomènes et d’y rechercher les profondes racines des traditions populaires. »
Les anciens attribuaient aux Titans, à Typhon, les formes tortueuses des serpents. Les poèmes grecs, les hymnes védiques, représentent ainsi les lignes en spirale de la foudre ; les tourbillons, et quelquefois les épais nuages, formés par les vapeurs du sol humide, qu’on voit s’entasser les uns sur les autres, et, pour ainsi dire, escalader le ciel.
« Les Japonais, dit Kœmfer, s’imaginent que les typhons, les trombes, sont une espèce de dragons d’eau qui ont une longue queue, et qui, en volant, s’élèvent dans l’air d’un mouvement rapide et violent. »
On verra plus loin combien les symboliques images que nous venons de reproduire se rapprochent des observations exactes qu’enregistre aujourd’hui la science.
La mythologie scandinave, comme les mythologies de l’Orient, personnifiait les phénomènes atmosphériques. Le redoutable Odin « ne respire que la tempête et les combats ; ses yeux brillent comme des flammes sur son visage ténébreux, sa voix est le bruit d’un tonnerre lointain. » Son premier fils, le dieu Thor (la foudre), est aussi le génie des tempêtes, qu’il gouverne : il frappe les hautes cimes, la tête des géants. D’autres fils d’Odin répandent la lumière, calment les flots, donnent les saisons favorables.
Les Calédoniens plaçaient dans les nuages le séjour des âmes, et comme elles conservaient les goûts, les passions qu’elles avaient sur la terre, les vaillants conduisaient encore, dans leur demeure aérienne, des armées fantastiques qui combattaient au sein des nuées orageuses. Les bourrasques étaient ainsi produites par des esprits se transportant d’un lieu à un autre et disposant à leur gré des éléments. Fingal dit à l’ombre qui se dresse devant lui : « Sombre esprit, crois-tu m’effrayer par ta forme gigantesque ? Quelle force a ton bouclier de nuages et le météore qui te sert de glaive ? Vaine illusion dont les vents se jouent dans l’espace !… »
Chez les Celtes, les âmes coupables, jugées indignes des célestes demeures, étaient condamnées à errer dans les airs, où elles prenaient des figures extraordinaires, et revenaient sur la terre sous la forme de vents désastreux, jetant l’épouvante sur leur passage. – Au Moyen Âge, les noires nuées qui, la nuit, se déroulent en longues traînées dans le ciel orageux, et tourbillonnent sur les sommets, emportées par des rafales, étaient regardées comme la ronde menaçante des démons et des sorcières se rendant au sabbat.
Mais dans ces superstitions l’observation des phénomènes avait aussi une part de plus en plus grande, et quelques lois simples, relatives à la succession et à la rotation des vents, étaient déjà entrevues. Ainsi, par exemple, à Athènes, une tour octogone en marbre blanc, située à peu de distance de l’Agora ou place publique, portait sur chacune de ses huit faces, à la partie supérieure, une figure sculptée représentant un des Vents principaux. Les noms de ces huit figures sont gravés près d’elles en grands caractères ; elles portent, en outre, des attributs qui les font reconnaître au premier aspect. Apéliotès, le vent de l’est, qui amène une pluie douce et favorable à la végétation, est représenté sous les traits d’un jeune homme dont les cheveux flottent de tous côtés ; il tient de ses deux mains les bords de son manteau rempli de fruits, d’épis de blé et de rayons de miel. Notus, vent du sud brûlant et humide, est représenté vidant un vase d’eau. Libs, vent du sud-ouest qui souffle à Athènes du golfe Saronique et de toute la côte de l’Attique, est figuré avec l’aplustre d’un vaisseau qu’il semble pousser devant lui ; c’était ce vent qui amenait les galères au Pirée. Les autres personnifications sont toutes dans ce style.
« Au-dessous de chacun des vents on avait tracé un cadran solaire ; et il résulte, tant de la disposition de celui du sud que ceux de l’est et de l’ouest, que la tour est parfaitement orientée. Enfin une clepsydre ou horloge d’eau placée à l’intérieur de la tour suppléait aux cadrans lorsqu’ils ne pouvaient servir. Ainsi l’édifice indiquait aux habitants d’Athènes, non seulement la direction des vents, mais les heures par le moyen des cadrans pendant les beaux jours, et à l’aide de la clepsydre après le coucher du soleil ou pendant les jours nébuleux. » Dans son ensemble la tour des vents réunissait l’élégance et la solidité convenable à un édifice d’utilité publique. L’architecte Andronicus Cyrrhestes, avait placé sur le faîte un triton de bronze tournant avec le vent, et tenant en main une baguette qui indiquait sa direction. Après les trois Vents déjà cités : Apéliotès, Notus et Libs, les figures ailées sculptées sur chacun des fronts de la tour, orientés suivant la région céleste d’où soufflent les vents principaux, étaient : au nord, Borée, ayant pour attribut une conque ; au nord-est, Cœcias, avec un disque d’où tombe la grêle ; au sud-est, Eurus couvert d’un large manteau ; à l’ouest, Zéphyre, portant une corbeille de fleurs ; au nord-ouest, Sciron, versant la poussière et le feu. – Les anciens avaient aussi personnifié les brises (Aurœ), filles de Zéphyre, bienfaisant génie couronné des blanches fleurs du printemps, et qui fait mûrir les fruits merveilleux de l’Élysée. – Il est à remarquer que dans l’Odyssée le Zéphyre est souvent désigné par l’épithète d’impétueux, et, compagnon de Borée, se plaît comme lui à troubler les airs : – « Les vents orageux ballottent le radeau d’Ulysse. Tantôt le vent du midi le laisse à l’Aquilon, et tantôt le vent d’orient le cède au Zéphyre. » Ulysse dit dans le même passage : « Tous les vents ont rompu leurs barrières ; on ne voit qu’orages de tous côtés. De quels noirs nuages Jupiter a couvert le ciel ! comme il bouleverse les flots ! » Il est évident qu’Homère décrit ici un tourbillon dans lequel les vents, également violents, soufflent de tous les points de l’horizon.
Dans l’Iliade et l’Odyssée, les vents ont leur séjour tantôt au nord, où Éole, leur gardien, les tient enfermés dans les antres ténébreux de la Thrace ; tantôt au midi, où ils sont enchaînés par lui dans une profonde caverne des îles Lipari. La Méditerranée, où l’on voit se reproduire en partie, sur une échelle restreinte, les phénomènes atmosphériques de l’Océan, est en effet battue, durant la mauvaise saison, par les vents du nord descendant des montagnes neigeuses, et par les vents du sud, qui prennent naissance dans les déserts de l’Afrique. La rencontre de ces deux vents, de température différente, forme fréquemment les tempêtes tournantes, dont on trouve d’assez nombreuses descriptions dans les anciens auteurs, et que les navigateurs sont très exposés à rencontrer dans les parages de l’archipel grec ou de la Sicile. – Virgile, dans l’Énéide, a décrit une de ces tempêtes, par lesquelles la flotte des Troyens, au moment où elle perd de vue la Sicile, est assaillie et dispersée sur la mer Tyrrhénienne. Au signal d’Éole, « les vents déchaînés, comme un bataillon tumultueux, se précipitent en tourbillons, et se répandent sur les terres en soufflant avec violence. L’Eurus et le Notus, l’Africus fécond en orages, soulèvent la mer profonde, la creusent et la couvrent de vagues énormes qui vont déferler sur ses bords. Les cris des matelots se mêlent au sifflement des cordages. D’épaisses nuées dérobent aux Troyens le ciel et le jour ; une nuit noire pèse sur les eaux ; les cieux tonnent, des feux incessants sillonnent l’éther ; tout présente aux malheureux navigateurs une mort menaçante. »
Théocrite, dans une de ses idylles, décrit la tempête qui assaillit les Argonautes peu après leur départ, et durant laquelle, au moment où le calme allait renaître, on vit deux flammes briller sur la tête des Dioscures : « … Les autans déchaînés soulèvent des montagnes humides, courent de la poupe à la proue et lancent les vagues sur le navire, qui s’entrouvre de toutes parts ; l’antenne gémit, les voiles se déchirent, le mât brisé vole en éclats ; des torrents précipités du haut des nuages augmentent l’horreur des ténèbres ; la vaste mer mugit au loin sous les coups redoublés de la grêle et des vents. C’est alors, fils de Léda, que vous arrachez les vaisseaux à l’abîme, et à la mort le pâle nautonier qui se croyait déjà aux sombres bords. Soudain les vents s’apaisent, le calme renaît sur les ondes, les nuages se dispersent, les Ourses brillent et les constellations favorables promettent aux matelots une heureuse navigation. »
Lucrèce, dont le beau poème est en réalité un traité de physique destiné à combattre les erreurs de la superstition en faisant connaître les lois naturelles qui régissent le monde, a donné une remarquable description des trombes : « Ce que nous avons dit de la foudre doit te faire connaître de quelle manière ces trombes que les Grecs nomment prestères, à cause de leurs effets, viennent d’en haut fondre sur la mer. Quelquefois elles descendent des cieux sur les eaux, comme une longue colonne autour de laquelle bouillonnent les flots soulevés par un souffle impétueux les vaisseaux surpris par ce terrible météore sont exposés au plus grand péril. C’est que le vent, n’ayant pas toujours assez de force pour rompre ce nuage contre lequel il fait effort, l’abaisse peu à peu comme une colonne dirigée du ciel vers la surface de la mer, ou plutôt comme une masse précipitée du haut en bas et qui s’étendrait sur les eaux ; enfin, après avoir crevé la nue, le vent s’engouffre dans la mer et y excite un bouillonnement incroyable…
Il arrive aussi qu’un tourbillon de vent, après avoir ramassé dans l’air les éléments qui forment la nue, s’y enveloppe lui-même et imite sur terre la trombe marine. Le nuage, après s’être abaissé dans les plaines, et s’y être brisé, vomit de ses flancs un horrible tourbillon, un ouragan furieux. Mais ces phénomènes sont très rares sur terre, parce que les montagnes s’opposent à l’action du vent. »
Pline, dans son Histoire naturelle, décrit en ces termes la trombe marine : « D’épaisses vapeurs se répandent sur les flots ; un nuage les surmonte, et, semblable à un monstre dévorant, menace les navigateurs. Bientôt les vapeurs se condensent, et sans autre appui qu’elles-mêmes, s’élèvent en long tuyau jusqu’au nuage qui les aspire. On lui donne alors le nom de colonne. »
Sénèque dit des tourbillons : – « Tant qu’un fleuve coule sans obstacle, son cours est uniforme et en ligne droite ; s’il va heurter contre un rocher qui s’avance du rivage dans son lit, il rebrousse en arrière, replie circulairement ses eaux, qui s’absorbent en elles-mêmes et forment un tourbillon : de même le vent, tant qu’il ne trouve pas d’obstacles, pousse en avant ses efforts ; réfléchi par quelque promontoire, ou resserré par la convergence de deux montagnes, dans un canal étroit et incliné, il se roule sur lui-même à plusieurs reprises et forme un tourbillon semblable à ceux des fleuves.
Les tourbillons ne sont donc qu’un vent mû circulairement, qui tourne sans cesse autour du même centre, et ranime ses forces par ce tournoiement même : quand cette circonvolution a plus de force et de durée qu’à l’ordinaire, elle produit une inflammation et forme le météore que les Grecs appellent Prestère. Ce n’est qu’un tourbillon de feu, mais il produit tous les effets des vents élancés du sein des nuages. Ces tourbillons emportent les agrès des vaisseaux et soulèvent quelquefois les navires eux-mêmes dans les airs. »
Aristote, dans le troisième livre de la Météorologie, décrit aussi la formation des tourbillons : – « Lorsque le vent (pneuma) sort des flancs d’un nuage et va frapper le nuage voisin, qui le repousse, il se transforme en giration aérienne ; tel on voit le vent s’engouffrant dans les gorges des montagnes, s’y réfléchir et se résoudre en un Tourbillon. Si le vent ne peut rompre son enveloppe nuageuse, il s’y roule, descend vers la terre, où il s’échappe brûlant. Si cette portion du phénomène s’accomplit sans feu, c’est un typhon, une tempête informe… Mais lorsque le pneuma, ce souffle subtil, rompt sa prison, il se nomme Prestère, c’est-à-dire brûlant, parce qu’il enflamme l’air et le colore de ses nuances. »
Nous retrouverions la trace de ces relations de l’antiquité dans les récits du Moyen Âge et les superstitions qui y sont jointes. Le monstrueux phénomène des trombes y garde presque toujours l’empreinte d’une sorte de personnalité, ou tout au moins d’une action directe des puissances malfaisantes. Cette croyance persistait encore lorsque déjà les progrès de la science et de la navigation avaient conduit les marins à une observation plus réfléchie des phénomènes météorologiques.
Dans sa vie de Christophe Colomb, Herrera décrit une effrayante tempête qui assaillit la flottille espagnole dans le golfe du Mexique, sur la côte de Veragua. Une trombe monstrueuse s’avançait sur les bâtiments. Colomb fit arborer l’étendard royal et la conjura en disant avec son équipage les premiers versets de l’Évangile de saint Jean. « L’ayant ainsi coupée, dit Herrera, ils s’en crurent garantis par la vertu divine. » – Colomb se décida à retourner au port après cette tempête extraordinaire, « n’osant pas attendre, dit-il, l’opposition de Saturne sur des mers aussi bouleversées et sur une côte si terrible, parce que presque toujours elle amène des temps violents. »
Camoëns, dans le cinquième chant des Lusiades, a joint au récit de la glorieuse navigation de Vasco de Gama la poétique description d’une trombe.
« Te dirai-je les inexplicables phénomènes dont la mer est le théâtre, les bourrasques subites, les noirs ouragans, les nuits ténébreuses, les longs éclairs qui sillonnent le ciel, les éclats de la foudre qui ébranle le monde ? Immense et vaine entreprise qui tromperait les efforts d’une voix de fer et d’une poitrine infatigable.
L’inculte raison du nautonier, bornée aux leçons de son art, s’abandonne au rapport trompeur des sens. Pour lui tout est prodige ; il n’appartient qu’au génie, éclairé par le savoir, d’apprécier d’un coup d’œil les accidents variés de ce mystérieux univers.
J’ai vu des feux brillants s’élever du sein des tempêtes, et d’un cercle de lumière environner nos mâts. Heureux présages d’un calme prochain, le matelot, battu par l’orage, les prend pour des génies secourables qui ramènent la paix sur les mers.
J’ai vu… non, mes yeux ne m’ont point trompé, cette fois j’ai partagé la commune épouvante : j’ai vu se former sur nos têtes un nuage épais qui, par un large tube, aspirait les vagues profondes de l’Océan.
Le tube, à sa naissance, n’était qu’une légère vapeur rassemblée par les vents ; elle voltigeait à la surface de l’eau. Bientôt elle s’agite en tourbillon, et, sans quitter les flots, s’élève en long tuyau jusqu’aux cieux, semblable au métal obéissant qui s’arrondit et s’allonge sous la main de l’ouvrier.
Substance aérienne, elle échappe quelque temps à la vue ; mais à mesure qu’elle absorbe les vagues, elle se gonfle, et sa grosseur surpasse la grosseur des mâts. Elle suit, en se balançant, les ondulations des flots ; un nuage la couronne, et dans ses vastes flancs engloutit les eaux qu’elle aspire…
Tout à coup la trombe dévorante se sépare de la mer, et retombe en torrents de pluie sur la plaine liquide. Elle rend aux ondes les ondes qu’elle a prises ; mais elle les rend pures et débarrassées de la saveur du sel. Grands interprètes de la nature, expliquez-nous la cause de cet imposant phénomène.
Si les anciens philosophes, que l’amour de la science entraîna loin de leur patrie, si les Sages de la Grèce eussent, comme moi, confié leurs voiles à tant de souffles divers, quel vaste champ d’observation se fût ouvert pour eux ! Que de précieuses découvertes enrichiraient leurs écrits ! »
C’est dans ce « champ immense d’observations », sur l’immense étendue de l’Océan, ouverte aux navigateurs par la glorieuse découverte de Colomb, que nous conduirons maintenant nos lecteurs. Ils pourront voir dans la série des relations dont nous avons fait choix, le progrès de l’art nautique déterminer peu à peu le progrès de la météorologie, et l’interprétation de ses phénomènes se dégager du symbolisme mythologique, des superstitions et des légendes, pour entrer dans le domaine moins poétique mais non moins merveilleux de la science, qui nous découvre aujourd’hui, comme les intuitions religieuses des premiers temps, les rapports mystérieux des choses. Ces rapports, mêlés jadis à de nombreuses erreurs, deviendront la source d’une foi nouvelle, quand la science, sortie des voies purement expérimentales qu’elle a dû suivre d’abord, remontera vers la cause des phénomènes, et nous dévoilera dans sa grandeur infinie, dans son incomparable beauté, la bienfaisante action du pouvoir divin, la participation de l’humanité à ce pouvoir suprême.
Un éminent officier de la marine hollandaise, ami et collaborateur de Maury, le commandant Jansen, a exprimé cette pensée dans une belle description des trombes qui se forment fréquemment dans la mer de Java, à l’époque du renversement des moussons :
« L’électricité qui se dégage des masses au sein desquelles elle accomplit mystérieusement, dans le calme et le silence, la puissante tâche que la nature lui impose, se révèle alors avec une éblouissante majesté. Ses éclairs et ses éclats remplissent d’inquiétude l’esprit du marin, sur lequel aucun phénomène atmosphérique ne fait une impression plus profonde qu’un violent orage par un temps calme.
Nuit et jour le tonnerre gronde. Les nuages sont en mouvement continuel, et l’air obscur, chargé de vapeur, tourbillonne. Le combat que les nuages semblent à la fois appeler et redouter les rend, pour ainsi dire, plus altérés, et ils ont recours aux moyens les plus extraordinaires pour attirer l’eau. Lorsqu’ils ne peuvent l’emprunter à l’atmosphère, ils descendent sous la forme d’une trombe et l’aspirent avidement à la surface de la mer. Ces trombes sont fréquentes aux changements de saison, et surtout près des petits groupes d’îles, qui paraissent faciliter leur formation. Elles ne sont pas toujours accompagnées de vents violents. Fréquemment on en voit plus d’une à la fois, et il arrive alors que les nuages d’où elles proviennent se dispersent dans toutes les directions en même temps que la trombe se courbe en se redressant et se brise par le milieu.
Le vent empêche souvent la formation des trombes d’eau. Mais, à leur place, des trombes de vent s’élèvent avec la rapidité d’une flèche, et la mer semble faire de vains efforts pour les abattre. Les vagues furieuses se soulèvent, écument et mugissent sur leur passage ; malheur au marin qui ne sait pas les éviter !
… En contemplant la nature dans son universalité, où l’ordre est si parfait, que toutes les parties, par le moyen de l’air et de l’eau, paraissent se prêter un mutuel secours, il est impossible de ne pas admettre l’idée de l’unité d’action. Nous pouvons donc conjecturer qu’au moment où cette union des éléments est troublée ou détruite par l’influence de causes externes ou locales, la nature montre sa toute-puissance dans les prodigieux efforts qu’elle fait pour combattre les forces perturbatrices, pour rétablir l’harmonie par l’action des forces souveraines, mystérieuses, qui maintiennent l’ordre et l’équilibre. »
Description des phénomènes. – Trombes de faible puissance. – Trombes dévastatrices. – Effets destructifs de l’électricité. – Explications théoriques. – Trombes internubaires. – Théorie électrique de Romas et de Peltier. – Expériences de M. Planté. – Formation de la grêle. – Tourbillons des cours d’eau. – Théorie de M. Faye. – Influence du magnétisme terrestre. – Théorie de M. Blasius. – Trombe de West-Cambridge. – Trombes de poussières.
Dans les descriptions du chapitre précédent règne une confusion entre d’eux genres de trombes qu’il importe de distinguer quand on veut s’enquérir des causes auxquelles la production de ces météores doit être attribuée. À côté des terribles typhons, des prestères dévastateurs, on observe un phénomène qui ne présente nullement leurs dangers. On le reconnaît dans le tableau tracé par Camoëns, en le dégageant de certains traits que la crainte et l’exagération y ont presque toujours ajoutés. Voici, d’après une remarquable notice du commandant Mouchez, qui résume de nombreuses observations personnelles, ce qu’il considère comme constituant le type de ce genre de trombes.
Elles prennent toujours naissance au bord inférieur d’un nuage, d’un nimbus fort dense et très bas dont elles ne sont qu’un appendice, et paraissent ne pouvoir se former qu’en calme plat ou par une très faible brise ; un vent même modéré les dissipe immédiatement. En général le ciel est alors dégagé en quelque point de l’horizon, couvert dans d’autres de nuages très denses, terminés inférieurement par une ligne droite horizontale et dans la partie supérieure par des masses floconneuses beaucoup plus claires ; la ligne inférieure se dessine souvent sur un ciel bleu ou voilé de légers cirrus.
« Quand ces circonstances se présentent, dit le commandant Mouchez, avec d’autres encore inconnues, on voit se former près de la partie inférieure du nuage une protubérance qui descend lentement vers la mer et prend bientôt la forme d’une colonne ou tube, qui reste verticale si le calme est absolu et s’ondule légèrement s’il existe quelque souffle de brise. Lorsque ce tube, dont la partie supérieure est toujours enveloppée d’un second tube ou manchon plus diffus, a atteint les quatre cinquièmes environ de la hauteur du nuage, on voit la surface de l’eau commencer à bouillonner légèrement sous la trombe si celle-ci est verticale, et en faisceau oblique faisant l’angle de réflexion égal à l’angle d’incidence si la trombe est inclinée. Pendant que cette émission de vapeur ou d’eau a lieu, le tube s’éclaircit de plus en plus et finit par ne plus apparaître que sous la forme de deux traits noirs très déliés. Quand le jet de vapeur a cessé, la trombe paraît avoir terminé son œuvre, car elle commence à se dissoudre par sa partie inférieure et à remonter vers le nuage dans lequel elle va bientôt se perdre. »
Le phénomène présente divers cas particuliers : « Quelquefois, au lieu d’un seul tube, on en voit deux ou trois l’un dans l’autre, tous parfaitement concentriques, réguliers et toujours limités par des lignes fort nettes. La finesse et la netteté de ces lignes noires est un fait très curieux et très caractéristique. Il arrive fréquemment que l’axe lui-même est dessiné par une ligne centrale se prolongeant en dehors du tube jusqu’à la mer. »
Dans une des trombes observées, après la cessation du et de vapeur, le tube, au lieu de se dissoudre, conserva sa forme intacte et se transforma en une sorte de cheminée d’appel. On distinguait nettement dans l’intérieur de petits flocons de vapeur remontant lentement vers le nuage en oscillant d’un côté à l’autre. Ce mouvement d’ascension, assez lent, ne présentait toutefois rien de tourbillonnant.
Plusieurs trombes peuvent naître d’un même nuage ; le plus souvent il y en a alors qui se dissipent sans avoir atteint leur complet développement.
Quelquefois des trombes ont leurs deux extrémités évasées en forme d’entonnoir ; leur bouche inférieure paraît s’élargir comme sous une forte pression, et le jet devient divergent comme celui qui sort d’une pomme d’arrosoir.
Le commandant Mouchez n’a jamais vu ni éclairs ni tonnerre accompagner les trombes. La pluie précédait rarement le phénomène, mais lui succédait presque toujours. Il a mesuré plusieurs trombes vues à un ou deux milles dans le golfe Persique et les îles de la Sonde. Le diamètre inférieur du tube variait entre 5 et 20 mètres ; le diamètre supérieur était deux ou trois fois plus grand. La hauteur du nuage était comprise entre 200 et 500 mètres. Le clapotis de la mer formait un cercle quatre à cinq fois plus grand que le diamètre du tube ; la hauteur des vagues soulevées sous la trombe n’atteignait jamais un mètre, de sorte que le seul inconvénient qu’une embarcation y aurait rencontré se serait probablement borné à une forte douche de vapeur ou d’eau. Aucune des trombes aperçues ne pouvait présenter de danger pour un navire.
D’après l’impression produite sur les personnes qui entouraient l’observateur, la cause de la formation des trombes était la chute d’une masse de vapeur, d’eau ou simplement d’air refroidi à travers un nuage dont elle entraînait une partie. C’est ce que faisait conclure la présence constante de nuages très noirs et très circonscrits au lieu d’origine de la trombe. Ces nuages devaient être d’une force de cohésion toute particulière pour céder sans se déchirer et s’allonger en forme de sac ou de tube. Quand, à mesure qu’il s’allongeait ainsi, le tube devenait plus mince, il finissait par se déchirer vers le bas pour laisser échapper son contenu en jet vers la mer.
L’amiral Page a signalé cet écoulement par l’orifice inférieur de la trombe dans la description d’un de ces météores qu’il rencontra en naviguant dans le détroit de Bahama. Le jet avait l’apparence d’un cône dont la base se trouvait à la surface de la mer, agitée par un fort clapotis, et dans lequel la lumière du soleil se réfléchissait. On avait remarqué que jusqu’au moment où l’eau commença à tomber en gerbe, la couleur de la trombe s’était de plus en plus assombrie jusqu’au gris très noir ; mais à mesure que la pluie s’écoula, elle reprit une teinte plus claire.
Le phénomène inverse se produisit dans une trombe observée sur la côte d’Algérie par le docteur Bonafous. La colonne descendit vers la surface de la mer dont l’eau parut venir à sa rencontre en s’élevant à une certaine hauteur. « À peine avait-elle touché la masse liquide que celle-ci fut fortement agitée dans une grande étendue et qu’un mouvement d’ascension, pareil à celui d’un siphon où le vide a été fait, s’établit dans l’intérieur de la colonne. Le mouvement, que nous avons vu distinctement, se faisait en spirale, depuis le sommet, en forme de suçoir, jusqu’à sa base qui se confondait avec le nuage. Cette spirale, dans laquelle on distinguait le courant ascendant et rapide de l’eau, suivait les dimensions de la trombe qui, très étroite à sa partie inférieure, allait en s’élargissant. Parvenu à la partie supérieure, le volume d’eau semblait se raréfier pour se confondre avec le nuage qu’il grossissait à vue d’œil. »
Suivant plusieurs relations, un vent violent a paru sortir de l’extrémité conique de certaines trombes en déterminant une dépression plus ou moins profonde dans l’eau qui s’élevait autour en rempart circulaire ou jaillissait en une grande gerbe écumeuse à laquelle on a donné le nom de buisson et dont l’approche peut être dangereuse.
Passons maintenant de la catégorie des trombes, relativement bénignes, à celle des météores qui occasionnent de terribles désastres par la grande puissance mécanique qu’ils recèlent et les redoutables manifestations électriques dont ils sont accompagnés. Ces trombes sont caractérisées par des mouvements giratoires plus ou moins rapides qui les rapprochent des grandes tempêtes tournantes appelées cyclones, dont nous aurons à parler dans les chapitres suivants. Cette circonstance est bien visible dans la relation d’une très faible trombe, facilement observable, qui a apparu près de Dijon en 1843. Le temps était orageux. Un nuage blanchâtre, de forme conique, se détacha d’une grosse couche de nuages noirs et se rapprocha de la terre en faisant entendre un bruit ressemblant à celui de chariots roulant dans un chemin pierreux. Il parcourut trois kilomètres en un quart d’heure, sous l’apparence d’un feu très pâle, sans faire entendre de détonation sur tous les points où il était en rapport avec le sol. En passant près d’un cerisier il en tordit les branches autour du tronc ; plusieurs gerbes furent enlevées et on trouva le chaume entortillé autour de ceps de vignes violemment tordus eux-mêmes. Des hottes remplies d’herbe et divers vêtements appartenant à des laboureurs, furent enlevés à une hauteur de vingt mètres. La largeur de la bande où l’on observait des dégâts était de six mètres seulement. Un des témoins laissa la trombe s’approcher de lui jusqu’à cinq mètres ; mais comme il commençait à sentir le vent qui se produisait dans son voisinage, il s’éloigna rapidement. À une certaine distance l’air était tout à fait calme.
On a vu des bandes ravagées par ces sortes de trombes, longues de 15 kilomètres et ayant jusqu’à 300 mètres de largeur. Les dégâts causés s’observent ordinairement sur les arbres et les édifices. Pour donner une idée des principaux effets produits, nous extrayons les détails suivants d’une excellente instruction de M. Ch. Martins, sur l’observation des phénomènes produits par ces météores.
Un grand nombre d’arbres, même de haute futaie, sont brisés. Le plus souvent ils sont déchaussés, leurs racines formant une motte saillante, mais encore adhérente au sol. Généralement on voit les troncs renversés dans le sens de la marche du météore, les cimes inclinées, de droite et de gauche, vers la partie centrale de la bande sur laquelle il a passé. Il y a toutefois des cas où les troncs abattus sont orientés dans les directions les plus diverses, effet qui témoigne de la grande complexité des forces en jeu. De gros arbres ont été lancés à près de quarante mètres de distance, brisant devant eux de très forts obstacles et tellement retournés qu’ils présentaient leur cime du côté du point de départ.
À côté d’arbres cassés on voit des arbres tordus. Un des effets les plus singuliers consiste dans le clivage du bois, qui à partir du sol, ou de 0m. 50 du sol, est divisé sur une longueur de 2 à 7 mètres en lattes ou lanières minces quelquefois comme des allumettes. On trouve ces assemblages de fragments complètement desséchés et privés de sève : ainsi affaibli, le tronc se brise toujours au milieu de la partie élevée. Ce phénomène paraît dû à l’action de l’électricité, car on a pu le reproduire artificiellement par de fortes décharges. C’est la sève qui se vaporise en grande partie et fendille le bois en tous sens. « Les arbres clivés, dit M. Martins, sont comparables aux chaudières brisées par l’expansion de la vapeur d’eau. » La sève vaporisée ressemble à une épaisse fumée qui se maintient au-dessus de la partie dévastée de la forêt, et dont la couleur brune provient probablement des particules terreuses entraînées dans l’air par le courant électrique.
L’action de l’électricité est d’ailleurs prouvée par ce fait remarquable que les arbres résineux, mauvais conducteurs, ne sont jamais clivés. Le courant passe d’ordinaire dans une partie seulement du tronc, qui se dessèche pendant que l’autre partie reste vivante ; d’un côté les feuilles sèchent sur les branches attenantes, de l’autre elles restent vertes. Souvent, sur des arbres demeurés debout, on remarque une multitude de feuilles noircies et desséchées aussitôt après le passage de la trombe, ce qui est probablement encore un effet du passage de l’électricité. On a nommé routes de vent les tranchées quelquefois fort longues que trace le passage des trombes à travers les forêts en abattant les arbres sur une largeur assez grande, mais nettement limitée.
Les dégâts produits dans les édifices placés sur le passage des trombes vont jusqu’au renversement d’assez gros murs, au soulèvement et au déplacement des toits, dont les ardoises sont emportées au loin avec une grande vitesse, à des projections en hauteur du carrelage des parquets, à la torsion des barres de fer, au bris des poutres, à la fusion des menus objets métalliques et à la plupart des puissants effets du passage de la foudre.
M. Ch. Martins signale comme circonstance météorologique précédant l’apparition d’une trombe la baisse rapide du baromètre, et fort souvent une chaleur étouffante se manifestant dans l’atmosphère. Beaucoup de trombes ont été accompagnées du singulier phénomène de la foudre globulaire, qui a des propriétés très différentes de celles de la foudre ordinaire. Dans les récits où elle figure on la décrit comme arrivant sous la forme d’une boule de feu, marchant avec assez de lenteur pour que cette forme puisse être parfaitement reconnue, suivant des routes dont il est difficile de se rendre compte, s’arrêtant même pendant près d’une minute avant d’éclater et de produire les effets les plus terribles du tonnerre.
Avec les trombes apparaissent aussi d’abondantes averses de grêle dont la formation paraît liée, comme nous le verrons, à l’électricité, ainsi qu’au mouvement giratoire de ces météores. La pointe de leur cône paraît souvent avoir l’éclat d’un métal rougi au feu, et être le siège d’énergiques attractions ou répulsions. Son passage au-dessus d’une étendue d’eau peut déterminer des décharges fulminantes assez fortes pour tuer les poissons qu’elle renferme et pour vaporiser une grande partie du liquide.
Les trombes ont été l’objet de diverses explications, souvent d’un caractère trop exclusif, et aujourd’hui encore il y a peu d’accord dans les ouvrages qui en traitent, tant à l’égard de leur mode de formation que de l’influence plus ou moins prédominante des différentes forces naturelles auxquelles on doit attribuer les phénomènes que nous avons décrits. Nous allons entrer dans plus de détails sur les théories produites, en faisant connaître les découvertes nouvelles, propres à les rectifier et à étendre l’horizon étroit dans lequel leurs auteurs se sont généralement tenus.
Nous mentionnerons d’abord une tentative d’explication due à Monge, qui fait naître les trombes des forces mécaniques des vents. Elles résultent suivant lui de l’action de deux courants de directions contraires et d’une grande rapidité, communiquant à la masse d’air qui les sépare une rotation autour d’un axe vertical. De semblables mouvements se présentent dans les eaux courantes, et on a souvent l’occasion de les observer dans les tourbillons de poussières qu’ils soulèvent. Le mouvement giratoire établi, les molécules d’air entraînées acquièrent bientôt une force centrifuge qui, en les écartant vers la circonférence, diminue la pression de celles qui se trouvent près de l’axe. « Le premier effet de cette diminution de pression, lorsqu’elle est assez considérable, est de porter l’air qui avoisine l’axe au-delà du point de saturation, de le forcer à abandonner une certaine quantité d’eau, de perdre sa transparence et de présenter l’aspect d’un nuage en colonne verticale… Les molécules d’eau abandonnées, se réunissant en vertu de l’inégalité de leurs vitesses centrifuges, composent les gouttes qui se dispersent latéralement, et forment une pluie, dont l’abondance dépend de la rapidité du mouvement de rotation et qui peuvent se convertir en grêle, lorsque leur vitesse de projection ou la hauteur de leur chute est suffisante. L’air, qui afflue par les deux extrémités de la colonne pour entretenir le phénomène, entraîne avec lui les objets qui ne peuvent lui faire résistance. » Les nuages sont ainsi introduits par en haut, et quelquefois, dans un passage sur la mer, l’eau monte par en bas. Mais cette double aspiration soulève de grandes difficultés, que le commandant Mouchez évite dans des vues théoriques analogues aux précédentes en admettant un mouvement unique suivant l’axe ascendant ou descendant.
« Le sens de ce mouvement, dit-il, sera généralement commandé par la direction des forces qui ont donné naissance au couple initial. Dans les tourbillons des rivières formés en aval des obstacles, la chute de l’eau donne naissance à une force verticale du haut en bas qui décide du sens descendant du mouvement. À la surface et près du sol, au contraire, les tourbillons d’air seront toujours ascendants, parce que la présence du sol, s’opposant au mouvement de haut en bas, une masse d’air et de poussière, entraînée dans le centre du tourbillon, n’a d’autre issue que par en haut. Mais il n’en sera pas de même pour les tourbillons qui pourraient se former dans les hautes régions ; là le mouvement pourra être ascendant ou descendant, selon la direction des forces initiales. »
Il y a lieu de citer comme exemple de mouvement giratoire produit par la rencontre de masses d’air les tourbillons indiqués par les couronnes de fumée que font souvent naître les coups de canon. Un mouvement de translation s’ajoute au mouvement très visible de giration.
Le P. Secchi fait au sujet des mouvements giratoires cette remarque importante que les trombes doivent se former et se transporter suivant les lois du mouvement ondulatoire, c’est-à-dire qu’il n’y a pas transport d’une même masse d’air en rotation, mais transmission graduelle des mouvements giratoires à travers les couches successives d’une portion déterminée de l’atmosphère, comme cela a lieu pour les vagues de la mer, pour les tourbillons d’un fleuve ou les tourbillons de poussière. Il cite à l’égard de ces derniers l’exemple suivant. « Procédant un jour sur la voie Appienne à la mesure d’une base, je vis s’élever du côté de la mer un tourbillon de poussière vertical très mince, de deux mètres de diamètre environ ; il traversa la route en un point voisin de notre station et alla se perdre dans les montagnes à une distance de six kilomètres au moins. L’air était parfaitement calme, et nous ne remarquâmes aucun courant contraire pouvant expliquer la formation de ce tourbillon. »
On ne pourrait comprendre, si les trombes ne se propageaient pas ainsi, comment dans le trajet de plusieurs lieues elles pourraient lancer des torrents de pluie, alors qu’une seule décharge suffirait pour débarrasser la masse d’air tournoyante de toute l’eau qu’elle renferme à l’état de vapeur. Il y a cette différence entre la propagation des tourbillons et celle des ondes que dans ce dernier cas il y a seulement déplacement autour de la position d’équilibre, tandis que dans le premier un mouvement de translation dont la vitesse est une composante de celle du tourbillon s’y ajoute. Nous verrons d’ailleurs plus loin que les tourbillons comme les ondes, à mesure qu’ils s’éloignent du centre d’ébranlement, gagnent toujours en étendue ce qu’ils perdent en vitesse.





























