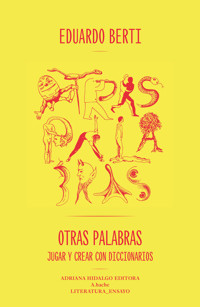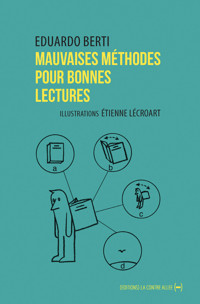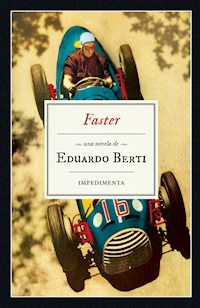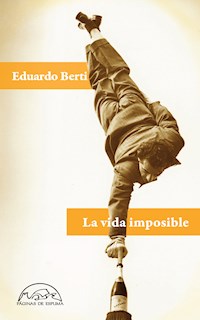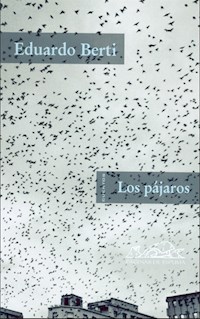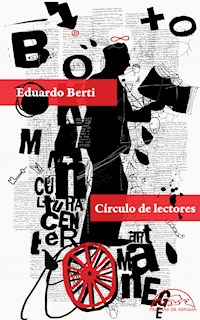Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Contre Allée
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Fils d’ un immigré roumain installé à Buenos Aires, le narrateur, écrivain, décide de partir vivre à Paris. Dans un café, il prend l'habitude de lire les lettres que son père lui envoie et se remémore alors l’histoire de sa famille. Quand il apprend que son père est lui aussi en train d’ écrire un livre, il se sent dérouté. Et voilà que vient s’intercaler une autre histoire, celle de Józef et de son épouse, Jessie, tous deux installés dans le Kent. Józef est écrivain lui aussi, d’origine polonaise, exilé en Angleterre : l’ immense écrivain Joseph Conrad pourrait bien devenir le personnage du prochain roman de notre narrateur argentin.
Eduardo Berti, avec son humour et son sens de la formule, imbrique les histoires et, tissant une toile fine et captivante, nous entraîne au cœur de questionnements sur l’identité, la transmission, l’exil et l’écriture.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Eduardo Berti est né en Argentine en 1964, il est l’auteur d’une œuvre traduite en dix langues, notamment en langue française par Jean-Marie Saint-Lu.
Un père étranger est son deuxième ouvrage aux éditions La Contre Allée, après
Inventaire d’inventions (inventées), écrit en collaboration avec le collectif Monobloque, en 2017. Eduardo Berti est membre de l’Oulipo depuis juin 2014.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À Mariel À Ulises À la mémoire de mon père
Il est très dur pour un homme de se trouver dans un pays étranger, sans défense, sans personne qui comprenne sa langue, en provenance d’un mystérieux pays situé dans un coin reculé de la terre.JOSEPH CONRADAmy Foster
Tout homme veut engendrer de nouveau ses parents. C’est de cette tentative manquée que naissent des enfants.Vieux proverbe bengali
Cimetière Club, 1
Quelques heures avant l’enterrement de ma mère, l’après-midi où on la veillait, et alors que l’usage aurait voulu qu’on expose son cadavre, mon père donna l’ordre de laisser le cercueil fermé. Puis, sans demander la permission à personne, il brancha un électrophone dans un coin de la pièce et fit retentir, à un volume considérable mais cependant respectueux, un morceau triste de Gustav Mahler : une musique qu’il continua à écouter – comme dans une sorte de gymnastique autoflagellante – pendant les premiers mois de son veuvage, au cours desquels il se consacra à boire plus que son compte et à battre des records d’insomnie.
Outre qu’il était prévisible, l’enterrement avait quelque chose d’une nouvelle reportée. Ma mère était morte après une longue agonie : une lutte perdue d’avance contre un cancer. Sa ténacité avait remis l’échéance à plusieurs mois au-delà des pronostics les plus optimistes. Mais son long combat avait failli tuer aussi mon père. Un soir, il l’avait admis devant moi : « Je n’en peux plus, cette histoire nous liquidera tous les deux. » Tous les deux : ma mère et lui.
Lors de l’enterrement, mon père refusa catégoriquement qu’un prêtre qui se trouvait là, tout sourire, ouvre la bouche, bien que dans l’« offre » fût inclus un bref sermon en plus des services du fossoyeur et autres prestations de rigueur. Cela se passait dans un cimetière privé des environs de Buenos Aires : une sorte de terrain de golf avec des tombes ; une espèce de jardin planté d’arbres aux belles frondaisons, avec des dalles funéraires à fleur de sol. Belle ironie : durant ces douze dernières années, le travail de ma mère avait consisté à vendre des tombes (des « parcelles », dans le jargon qu’on lui faisait répéter) dans ce même cimetière.
À l’enterrement, en fin d’après-midi, je ne remarquai pas ce détail un peu macabre : autour de la « parcelle » ouverte comme un piège pour ma mère s’étendaient d’autres tombes, dans lesquelles reposaient ou reposeraient bientôt certains des plus fidèles amis de ma famille, qu’elle avait convaincus grâce à sa cordialité et à des arguments de vente, des avantages supposés d’un cimetière privé.
Mon père n’eut pas beaucoup de mal à s’éloigner de la tombe. On ne compte plus les cas où le survivant ne peut quitter l’endroit où l’on vient d’enterrer son compagnon ou sa compagne ; mon père, lui, avec une grimace difficile à déchiffrer, tourna le dos à la sépulture, qui n’aurait pas de dalle avant une ou deux semaines, le temps de la fabriquer et de la placer sur le sol, au ras du gazon, et il s’éloigna d’un pas ferme. Durant les mois qui suivirent, je l’entendis plusieurs fois dire que ma mère n’était pas là-bas, dans « ce cimetière de merde », phrase qu’il proférait avec mépris, je suppose, pour se convaincre qu’il n’y avait rien dans ce cercueil qui fût ou méritât de s’appeler « personne aimée ».
Comme Miguel (assurément le meilleur ami de mon père) désirait lui aussi quitter le cimetière dès que possible, j’eus l’idée de les prendre avec moi dans le taxi qui m’attendait ; de cette façon, mon père passerait un moment avec la personne qui le faisait le plus rire, y compris dans des circonstances aussi graves que des funérailles. Lui et Miguel étaient des amis d’enfance. Ils s’étaient connus très loin de là, dans leur Roumanie natale, puis s’étaient perdus de vue, car avant même d’imaginer qu’il finirait en Argentine, mon père était allé faire ses études dans des universités de Belgique et de France. L’anecdote de leurs retrouvailles à Buenos Aires était célèbre dans la famille : environ dix ans après son arrivée en Argentine, par un après-midi pluvieux, mon père se promenait dans le centre et traversait la plaza de Mayo, à plus de onze mille kilomètres de Bucarest, quand il vit son ami Miguel venir à lui et, comme dans un agréable mirage, lui tendre une main fine et osseuse, avec une frémissante familiarité.
C’est en cette fin d’après-midi, à l’enterrement de ma mère, que je vis Miguel pour la dernière fois. Bien qu’il ait beaucoup blagué, comme à son habitude, il me sembla qu’il se tenait la tête très basse, et surtout je remarquai que son historique moustache à la Clark Gable ne fleurissait plus avec vigueur et qu’elle ressemblait plutôt à une pâle ligne en pointillé.
De quelques mois plus jeune que mon père, Miguel était arrivé à Buenos Aires après avoir passé six mois à Sobibor, humilié par les nazis. Mon père racontait que son ami avait non seulement été témoin de la révolte du camp d’extermination, en octobre 1943, mais encore qu’elle lui avait donné l’occasion de s’enfuir. Je n’ai jamais pu avoir la confirmation de ce récit, mais je me rappelle le jour, je devais avoir alors neuf ans, où Miguel me montra les chiffres tatoués sur son bras.
Quand Miguel mourut, un an après ma mère environ, mon père et moi assistâmes ensemble à son enterrement, dans le même cimetière. La tombe où il devait être inhumé était proche, à cent pas, de celle de ma mère, sur laquelle ni mon père ni moi n’étions retournés durant tout ce temps. Cette fois, il ne put s’opposer à ce qu’un rabbin, un rabbin vieux et maigre, ouvre la bouche et débite des balivernes que mon père ponctuait de soupirs d’impatience. Le pauvre Miguel n’avait-il pas voulu finir dans un cimetière juif ? Le discours du rabbin était une punition bien méritée pour ça, pensait mon père.
Après que nous eûmes salué les enfants de Miguel et sa veuve, femme sèche et assez intraitable, mon père parut hésiter entre quitter une bonne fois pour toutes ce « cimetière de merde » ou se planter devant la pierre tombale de ma mère, que nous n’avions pas encore vue et qui – lui et moi le savions d’avance – était certainement aussi petite et discrète que toutes celles de ce cimetière ouvert à toutes les croyances, selon les dépliants publicitaires, mais rétif au plus petit promontoire ou mausolée susceptible de gâcher son élégance.
Je voulus aider mon père et lui proposai de marcher jusqu’à la tombe de ma mère, même si les os enterrés là nous étaient pour ainsi dire étrangers. Mon père se laissa entraîner, en soupirant comme si le rabbin n’avait pas cessé de parler, mais au bout de quelques minutes, un peu moins troublé et un peu plus en colère, il fit signe que non de la tête et me guida en direction de la voiture.
Nous fîmes presque tout le trajet de retour à Buenos Aires en silence. À un moment donné je pensai mettre de la musique, peut-être quelque chose de Mahler, mais mon père, d’un brusque éclat de rire, fit avorter ma manœuvre tout juste naissante. Je lui demandai ce qu’il avait, ce qu’il trouvait si drôle. Il me répondit que Miguel se serait tordu de rire devant ce rabbin à tête de tortue, en entendant ses paroles pompeuses.
Le soir, le téléphone sonna chez moi. Il était tard. C’était mon père et, au ton de sa voix, je compris qu’il avait beaucoup bu. « Je te demande de me promettre que tu n’iras jamais sur la tombe de ta mère ni sur la mienne, d’accord ? » D’accord, papa, lui répondis-je, promis. « Je te demande de ne jamais me permettre de retourner dans ce cimetière de merde… Sauf quand je casserai ma pipe. » D’accord, dis-je, d’accord, bien qu’il nous restât encore deux ou trois amis qui, comme Miguel et d’autres amis déjà morts, avaient eu la bonne ou la mauvaise idée de s’y acheter une parcelle.
Ce soir-là nous bavardâmes plus d’une heure au téléphone. À un certain moment mon père me raconta, au sujet de Miguel, une histoire que je n’avais jamais entendue. Contrairement à lui, Miguel adorait le tango : il idolâtrait Roberto Goyeneche (dont la moustache prétendait ressembler à celle de Clark Gable), il aimait les orchestres et dans sa jeunesse, tout juste arrivé au pays, il fréquentait les bals populaires. Dans ces bals, à l’époque, les femmes entraient gratis et les hommes, en échange d’une somme minime, ne recevaient pas un ticket de papier comme au cinéma, mais devaient tendre la main, paume vers le bas, pour accuser le coup bien asséné d’un tampon qui, à l’encre noire, apposait une contremarque : cinq ou six chiffres qui changeaient tous les jours. Si les danseurs sortaient fumer ou prendre l’air, ils pouvaient rentrer ensuite en montrant leur main. Mon père me raconta que Miguel, au lieu de payer, de recevoir le coup de tampon et d’exhiber sa main au contrôleur, comme tout le monde, allait directement à la porte et montrait les chiffres que les nazis lui avaient tatoués sur le bras. Personne n’avait jamais osé lui dire que son tampon n’était pas correct, que son tampon n’était pas valable.
Après avoir longuement parlé ce soir-là avec mon père, je pensai que Miguel avait été enterré avec son tatouage. Avec Miguel était aussi morte une inscription, une trace de l’histoire ; chose évidente et sensée : à chaque ensevelissement, c’est beaucoup plus qu’un corps qu’on enterre. Dans le cas de ma mère, par exemple, je sentais que ce que le fossoyeur avait recouvert de terre et mis hors de toute atteinte, c’était ce quota de retenue, de sagesse, d’équilibre que durant des années, des dizaines d’années, mon père avait trouvé ou voulu trouver chez elle.
Au cours des mois qui suivirent l’enterrement de ma mère, je vis mon père faire des choses étranges ou, du moins, que je ne lui avais jamais vu faire. De l’idée que sans elle il allait à la dérive, je passai à l’idée opposée et conclus qu’il se montrait enfin tel qu’il était. Ne s’adaptait-il plus à l’image que ma mère s’était forgée de lui ? Ne s’en tenait-il plus à l’image qu’il avait voulu forger pour elle ? L’explication se trouvait entre les deux hypothèses : il était vrai qu’il avait fait de ma mère une sorte d’ancre, image plus qu’appropriée pour quelqu’un qui était arrivé en bateau dans un pays où il ne connaissait personne ; mais il était tout aussi vrai que, secoué à soixante-dix-neuf ans par la mort de sa femme, il se disait qu’il devait s’accorder quelques plaisirs avant qu’il soit trop tard.
Il reprit alors certaines activités qu’il avait pratiquées dans sa jeunesse. Il se mit à cuisiner des plats dont les recettes étaient un vague héritage familial. Il se mit à fumer la pipe et à se préparer des tabacs spéciaux. Il voulut acheter un voilier et reprendre la navigation comme passe-temps, mais son hernie discale ne le lui permit pas.
Quand en juillet 1994 une bombe explosa dans le centre de Buenos Aires, une bombe destinée à la mutuelle israélite, l’Amia, et que l’attentat fit plus de victimes encore que l’attaque de l’ambassade d’Israël en 1992, mon père, très remué, se mit à faire des sculptures, la plupart allusives. Je me rappelai qu’avant ma naissance, longtemps avant, quand il vivait encore en Europe, il avait passé des heures devant une glace pour compléter une série de quatre ou cinq têtes qui le représentaient jeune : sur plusieurs photos de cette époque on peut encore voir ces têtes alignées et, j’ignore pourquoi, toutes noires.
Peu après, en 1998, mon père se mit à écrire un roman. Sur le moment, cette nouvelle me perturba. Que mon père sculpte, fume la pipe ou cuisine des plats étranges aux noms imprononçables, tout cela me semblait fort sympathique et normal. Mais écrire ? Un roman ?
Un ou deux mois après que mon père m’eut dit qu’il avait entrepris d’écrire, je décidai de traverser l’Atlantique et de m’installer pour un temps à Paris. Au début, je pensai que je prenais cette décision pour une série de raisons plus ou moins complémentaires : (a) mon père avait commencé une nouvelle relation (des fiançailles, ai-je failli écrire) et il n’avait plus autant besoin de moi ; (b) avec la mort de ma mère, j’avais moi aussi perdu une sorte d’ancre ; (c) on allait éditer en français mon premier roman, Le Désordre électrique, chose si miraculeuse et si inouïe que pour rien au monde je ne voulais la manquer ; (d) le président de service avait décidé qu’un peso argentin équivalait à un dollar, décision si miraculeuse et si inouïe elle aussi (beaucoup plus que la traduction de mon roman) qu’elle rendait possible quelque chose qui des décennies durant avait été économiquement parlant irréalisable, et surtout(e) je venais de rencontrer celle qui allait devenir ma femme et, lors de notre première conversation, nous avions découvert que nous caressions tous les deux le projet de passer un temps à Paris, ce qui plus tard, quand nous fûmes installés dans le quartier Denfert-Rochereau, devint la plaisanterie rimbaldienne d’une saison à Denfert1.
Nous partîmes pour Paris courant septembre 1998. Nous avions réservé par téléphone un studio que m’avait recommandé une connaissance éloignée d’une connaissance proche. La petite note qui accompagnait la recommandation disait « Laurent Pinard », avec un numéro que j’appelai de Buenos Aires. Comme c’était un téléphone portable, cet appel me coûta un bras, disons un sixième du montant du loyer. L’homme qui me répondit ne s’appelait pas, en fait, Laurent Pinard (la connaissance, éloignée ou proche, avait noté son nom de façon approximative), mais comme il avait un nom voisin, Florent Pignal, il supposa que c’était bien à lui que la voix étrangère désirait parler, et il joua le jeu. Il ne m’épela son vrai nom qu’à Paris, quand il nous remit les clés et empocha les francs du loyer – nous étions dans les dernières années de l’ère Avant l’Euro (A. E.).
Bien que ma décision d’aller en France fût prise, avant d’acheter les billets d’avion et de l’annoncer à mon entourage, je voulus parler à mon père, pour voir comment il réagissait. Depuis quelques mois, il avait nettement meilleur moral. Il me donna rendez-vous, je m’en souviens, dans un café équidistant de chez lui et de chez moi : un café au nom ampoulé et pseudo-français (comme s’il soupçonnait quelque chose) qui se trouvait à trois cents mètres environ de son appartement et du mien, vu que nous habitions tout près l’un de l’autre. C’était dans ce café, des années plus tôt, quelques jours après l’enterrement de ma mère, qu’il m’avait dit, avec une espèce de nœud dans la gorge qui s’était révélé hautement contagieux, qu’il n’aurait jamais imaginé que ce serait lui le survivant du couple. Comme ma mère avait dix ans de moins que lui, il avait conçu un futur dans lequel elle était veuve, et non l’inverse.
La réaction de mon père, je pense, n’aurait guère été très différente si je lui avais annoncé que je partais pour une autre ville européenne. Mais le choix de Paris était spécial pour lui. Dans la maison où j’ai grandi, à Buenos Aires, dans une petite pièce où ma mère passait des heures et des heures à lire, à repasser, à écouter la radio ou à téléphoner, et que pourtant nous appelions un peu officiellement « le bureau de papa », il y avait un immense plan de Paris que quelqu’un, ma mère ou mon père, avait affiché au mur. Comme nous étions à l’ère Avant le Téléphone Portable (A. T. P.), il m’arrivait de m’installer moi aussi dans le « bureau », pour téléphoner surtout, et en le faisant, je m’en souviens, mon regard se perdait dans les rues de ce plan. Il est possible que ce soit pour cette raison, parce que j’avais ainsi mémorisé cette topographie, que depuis toujours Paris m’était familier. Une ville connue et inconnue à la fois : j’ignorais l’apparence des choses, je n’avais jamais parcouru ses rues, mais je savais à la perfection que si je tournais à gauche en arrivant à tel carrefour, je tomberais sur tel musée ou tel monument, et que si je tournais ensuite à droite, je me retrouverais sur telle place ou tel boulevard.
Une fois installés en France, ma femme me raconta un soir que chez elle, quand elle était enfant, il y avait aussi un grand plan des rues de Paris affiché sur un mur. Je ne connais personne d’autre en Argentine qui ait eu un tel plan chez lui.
Théoriquement, nous devions passer environ six mois à Paris. Ou, tout au plus, un an. Nous y restâmes dix ans.
Grâce au miraculeux peso argentin, qui en se regardant dans la glace voyait un dollar, je vécus la première année à Paris avec ce qu’on me payait à Buenos Aires pour écrire des articles de presse et des scénarios de documentaires pour la télévision. Pour ces derniers, l’organisation était tout sauf simple. Internet en était à ses premiers balbutiements et les courriels encore peu volumineux, si bien que chaque semaine je recevais par la poste un paquet contenant trois ou quatre vidéocassettes avec les enregistrements bruts de neuf ou dix interviews. Chacune d’elles durait une heure ou une heure et demie et, comme un puzzle, je devais monter un scénario de cinquante-deux minutes au maximum.
Les documentaires traitaient de l’histoire du tango, de Gardel ou Troilo à Piazzolla, sans oublier l’idole de Miguel : Goyeneche. Il m’arrivait de passer des heures de suite à regarder parler ces chanteurs dans leur irréprochable argot de Buenos Aires, jusqu’à ce que, brusquement affamé, je descende au supermarché ou aille acheter un peu de pain, toujours dans la même boulangerie* du coin. Quand je sortais, j’avais du mal à me souvenir que j’étais à Paris. Je me sentais comme le personnage de cette nouvelle de Cortázar qui, sans transition aucune, parvient à passer de Buenos Aires à Paris ou vice-versa, comme on ouvre une porte et change de dimension.
Une fois terminée notre saison à Denfert*, ma femme et moi emménageâmes aux Gobelins, toujours rive gauche. Nous y louâmes aussi un studio, un peu plus petit que le précédent (un mètre carré de moins), mais dont l’espace était mieux aménagé, au point que dans la salle de bains il y avait une baignoire et non une douche. Nous ne tardâmes pas à savoir que la baignoire fonctionnait mal ou, comme nous aimions le dire en plaisantant, qu’elle était en fait une douche déguisée et que celui qui se douchait, c’était le pauvre voisin du dessous, à cause de cette baignoire incontinente qui répandait son eau à travers le plancher.
Notre studio se trouvait à quelques mètres de la place d’Italie, au nom presque semblable à celui de la plaza Italia de Buenos Aires. À l’époque, je m’accrochais encore aux analogies : après avoir vécu des années non loin de la plaza Italia, dans un quartier de Buenos Aires qui s’élève au-dessus d’un ruisseau enfermé dans une canalisation, le Maldonado, je vivais maintenant non loin de la place d’Italie, dans un quartier qui s’élève au-dessus de la Bièvre, enfermée dans une canalisation, ce quartier qu’on trouve dans plus d’un roman de Balzac.
Je ne téléphonais que très rarement à mon père de Paris. En revanche, je lui écrivais, et je recevais ses réponses écrites dans un espagnol correct, bien que parsemé de fautes. En lisant ses lettres, et en me heurtant à ces fautes, moins de grammaire que d’orthographe, il m’était impossible de ne pas entendre sa voix grave et râpeuse, de ne pas entendre cet accent étranger qui ne semblait jamais lui causer la moindre inhibition.
Dans les lettres que j’envoyais à mon père, je lui décrivais, surtout, mes promenades à travers la ville. Ce n’étaient pas des promenades aléatoires. Souvent, il me demandait de me rendre à tel ou tel endroit et de le lui décrire ensuite. Manifestement, il comparait mes récits avec ses souvenirs lointains. Et ma description, j’en ai peur, lui semblait un peu étrange et assez décevante. Autres yeux et autres temps.
D’une certaine manière, l’expérience de ma première année à Paris fut médiatisée par ces verres épais : les comparaisons que j’établissais avec Buenos Aires ; les comparaisons que mon père établissait entre le Paris de mes lettres et celui qu’il thésaurisait dans sa mémoire.
Il y eut un moment, sans que je m’en rende compte, où ces deux verres finirent par se dissoudre. Cela coïncida avec un fait plus ou moins lié : un jour, je m’aperçus que je n’avais plus besoin de me pencher en avant quand on me parlait en français ou quand je m’asseyais devant le téléviseur, non pour regarder de vieux chanteurs de tango, mais des programmes français récents. Assurément, ma posture corporelle avait dû se redresser de manière progressive, comme une sorte d’aiguille qui peu à peu se positionne perpendiculairement au sol, mais je n’avais pas été conscient du processus, du moins pas avant d’avoir atteint un point très éloigné de ma posture initiale.
Parmi les diverses nouvelles qu’il me donnait dans l’une de ses dernières lettres, mon père me racontait qu’il commençait le sixième cahier de son roman et qu’il avait l’intention de me le faire lire (ou du moins une partie) dès que je rentrerais à Buenos Aires. Ce fut la première et la seule mention de son roman dans la cinquantaine de lettres qu’il posta pour Paris. J’avoue que je ne l’avais plus jamais interrogé moi-même à ce sujet. Pas même lors de ma visite d’un mois, en août 1999. Ce fut Claudia, sa nouvelle compagne, qui me parla de ce roman, et elle le fit comme en passant, en profitant d’un instant où mon père s’était absenté. D’après Claudia, écrire lui faisait du bien, beaucoup de bien. Il y avait là, comment dire, quelque chose de thérapeutique.
Il est très probable, et je le reconnais comme une faute, que mon attitude par rapport au roman de mon père ait été distante, mesquine et peu aimable. En tout cas, il est clair que cela me troublait un peu de penser à mon père en train de jouer (ou pas) à être écrivain.
À Paris, j’avais pris l’habitude d’aller toujours dans le même café pour lire, sitôt ouvertes, les lettres que m’envoyait mon père. C’était un café du boulevard Arago où, proclamait une affiche, « le prix attire la clientèle, la qualité seule la retient* », et pourtant c’était ma constance, et non le café-moka amer et froid qu’un garçon servait sans sourire, qui me poussait à y revenir ; cela et les lettres de mon père, bien sûr, que mon impatience me faisait souvent ouvrir dans la rue, sur le chemin de ce café, comme un enfant qui déchire l’emballage d’un cadeau.
C’est dans ce café, je m’en souviens, que j’ai lu un après-midi la dernière lettre qu’il m’envoya. J’étais alors incapable d’imaginer que c’était la dernière, incapable de concevoir que des années plus tard, plus de dix ans plus tard, je ferais un voyage concret à Paris avec l’objectif de passer des heures dans ce café du boulevard Arago, à une table face au boulevard relativement calme, avec dans la bouche le goût âpre et amer du moka froid, à lire quatre des six cahiers du roman de mon père.
S’il est quelque chose que j’ai toujours déploré à Paris, c’est le manque d’amabilité dans les relations sociales ; tout le contraire de Madrid, avec son tutoiement facile et son immédiate complicité, qui peut parfois devenir, à l’inverse, envahissante. À Madrid, les inconnus se lient comme des amis ; à Paris, c’est plutôt le contraire, et j’avais beau faire des efforts, les premiers mois, j’avais beau aller tous les matins acheter ma baguette* à la même boulangerie, où les boulangères se gratifiaient mutuellement d’un « vous » inébranlable, je me sentais comme dans ce film de Harold Ramis où chaque nouveau jour ne suppose ni un échelon ni aucune progression par rapport à la veille, et j’avais beau saluer chaque matin les boulangères, avec un sourire toujours égal et un peu exagéré, pour obtenir mon pain, je devais recommencer, repartir de zéro, mon jour sans fin : demander ma baguette*, s’il vous plaît, entendre la question « bien cuite ou pas trop cuite, monsieur* ? », répondre pas trop cuite, remercier, puis demander le pain d’épeautre qui faisait alors les délices de ma femme et entendre la question « tranché ou pas tranché, monsieur* ? », tous les jours comme ça, de même qu’au café du boulevard Arago où je devais chaque jour demander, « s’il vous plaît* un verre d’eau et un peu plus de lait » dans mon café-moka froid, suite à quoi le garçon borgne me contemplait comme s’il ne m’avait jamais vu.
Un jour je fis un test avec ce garçon. Je lui demandai mon café, mon verre d’eau, comme d’habitude, et quand il revint avec le plateau, avant qu’il pose le tout, avec sa longue figure rébarbative, il suffit que je lui demande en souriant si ça allait, « tout se passe bien, monsieur* ? » pour qu’il en reste interdit, perdu, sans voix. Il me voyait pour la première fois, avec le seul de ses yeux apte à voir, et dès lors quelque chose changea. Quelque chose d’infime, bien sûr. Quelque chose sans autre importance, peut-être… Mais que le garçon de café borgne me salue désormais le matin et qu’une fois même il m’apporte mon verre d’eau sans que je le lui aie rappelé, cela n’avait pas seulement un goût de victoire ; c’était aussi, voulus-je croire, un fait symbolique (je commençais à faire partie du décor) qui s’ajoutait à un autre fait plus tangible et bureaucratique : ma première carte de séjour* avec permission de travailler sur le territoire français quand je déciderais enfin de le faire ou quand le peso argentin, se réveillant de ses rêves de grandeur, ne vaudrait plus un dollar et qu’il me faudrait trouver un employeur français.
Devenu étranger, pensai-je un jour, après avoir écrit à mon père une assez longue lettre au café du boulevard Arago, devenu étranger, enfin, par décision unanime de l’État français et d’un vieux serveur borgne, je venais d’acquérir dans un autre pays le statut que mon père possédait en Argentine.
Ce que je ne pensai pas alors, ce qui m’échappa totalement, c’est qu’il existait un prodigieux équilibre dans cette situation : mon père semblait rivaliser avec moi en écrivant un roman ; moi je rivalisais avec lui avec mon titre d’étranger flambant neuf.
1. Les mots et expressions en italique et suivis d’un astérisque sont en français dans le texte. (N. d. T.)
Pent Farm, 1
I
Étranger et mauvais caractère. C’est ce que pensaient certains de son mari et c’est exactement ce que dit Jessie pour expliquer à ce dernier à quoi ressemblait le visiteur, mélange de mendiant et de cycliste, qui était décidé à faire sa connaissance. Tout s’était passé en quelques mois. Un nouveau livre était arrivé au courrier (une réédition, en fait), tout juste sorti de l’imprimerie et débordant de cette odeur qui, bien qu’elle l’aimât beaucoup, arrachait à Jessie des éternuements à demi enfantins. Il y avait dans ce livre, au moins, deux récits magistraux. C’était ce que pensait Mr Pinker, l’agent de son mari. Et aussi Mr Hueffer, mais sans être d’accord avec Pinker sur le choix de ces deux récits. Jessie n’avait aucun recul par rapport à l’œuvre de Józef et elle aimait autant toutes ses nouvelles. Ou plutôt presque toutes, car l’une d’elles, Falk, avait sa préférence. Elle ne pouvait expliquer pourquoi.
Une fois le livre à Pent Farm, et passé une brève euphorie, Józef avait subi un blocage sérieux, le cauchemar récurrent de rester des heures et des heures sans rien écrire d’autre qu’une phrase qui ne sert à rien, et des semaines après, des mois après, il eut une nouvelle crise. Il en avait cinq par an, six tout au plus. Certaines étaient légères. D’autres si violentes que, plié en deux par la douleur, transporté de fièvre – c’étaient des crises de goutte, ou du moins l’affirmait-il –, Józef se mettait soudain à parler en polonais. Enfin, c’était ce que croyait Jessie, qui ne parlait qu’anglais. Lui, il était né en Pologne et il y revenait avec la fièvre, en grimaçant de souffrance. Ou bien était-ce la Pologne qui revenait à lui. Ou simplement la langue de la Pologne. Il y avait des choses que Jessie n’était pas sûre de comprendre.
Cela faisait presque sept ans qu’ils étaient installés à Pent Farm, dans le Kent. Ils étaient mariés depuis neuf ans et tout avait commencé alors qu’ils vivaient encore à Londres et qu’il l’avait invitée un après-midi à la National Portrait Gallery, dont le nouveau siège venait d’ouvrir, Saint Martin’s Place. Parmi les œuvres qui s’accumulaient dans ce musée, il appréciait particulièrement, lui avait-il expliqué, les autoportraits d’Hogarth et un tableau célèbre qui montrait Shakespeare, si l’on acceptait que c’était Shakespeare et non quelqu’un autre : il y avait des doutes à ce sujet.
À l’époque, Jessie et Józef ne se connaissaient pas depuis longtemps : un ami, Mr Hope, les avait récemment présentés. Ils n’étaient pas fiancés, du moins pas que Jessie le sache, mais cet après-midi-là au musée elle avait vu qu’il regardait les tableaux sans trop d’attention et qu’il était plus songeur que d’habitude. Brusquement il lui demanda, de la façon la plus imprévue du monde, si elle était d’accord pour qu’ils se marient le mois suivant et partent aussitôt en voyage en France, pas pour une nouvelle émigration, non, rit-il, décidé à éviter qu’elle ne s’inquiète, simplement pour une lune de miel. Pour leur lune de miel. Ou alors, qu’ils se marient un mois et demi après ? Ou deux mois, au plus tard ? Il ne lui restait, croyait-il, plus très longtemps à vivre.
En sortant du musée, après leur conversation échevelée, il l’emmena dans une sorte de cafétéria. Il était impossible de dire non à cet homme. Ils trinquèrent. Ils mangèrent quelque chose au goût un peu étrange, le repas ne leur réussit pas et Jessie, intoxiquée, passa deux jours au lit. Elle eut de la fièvre, quarante degrés la première nuit, et tant qu’elle ne se sentit pas remise elle n’annonça pas à sa mère son mariage imminent avec cet homme, avec ce barbu étranger qui fronçait les sourcils même quand il était de bonne humeur et observait le monde avec l’œil droit, plus qu’avec le gauche, à travers un minuscule monocle qui était comme un minuscule œil-de-bœuf.
Alors qu’elle annonçait, à brûle-pourpoint, son mariage à sa mère, et que celle-ci ne savait pas si elle devait rire ou pleurer à cette nouvelle, Jessie se demanda si ce qu’elle était en train de dire était vrai. Si c’était vrai ou si c’était un effet hallucinant de la fièvre. La fièvre qui fait parler certains en polonais et qui l’avait poussée, elle, à s’imaginer mariée.
Bien qu’elle refusât de penser que Józef lui avait menti, il n’était pas vrai que celui-ci n’avait plus très longtemps à vivre. Elle en était certaine. À part ces crises de goutte qui lui rongeaient l’humeur, il pouvait se vanter d’avoir une santé de fer : la santé qu’on pouvait attendre d’un ancien marin. Ou, plus qu’une santé de fer, n’exagérons rien, une forte personnalité, si forte qu’il donnait l’impression d’être quasiment invulnérable. Excepté lorsqu’on l’observait de près, comme elle l’avait fait, ou lorsqu’il succombait aux distractions, oubliait des cigarettes dangereusement allumées, perdait le peu d’argent qu’il avait sur lui ou confondait deux personnes et, dans le meilleur des cas, parlait avec un religieux convaincu qu’il parlait avec un amiral. Tout cela toujours avec ces gestes ampoulés en quoi se résumait souvent sa courtoisie vieillotte.
Józef, assurait Jessie, était le premier étranger qu’elle fréquentait. Ce qui n’était pas tout à fait vrai parce qu’elle excluait, sans s’en rendre compte, les Américains qui fabriquaient et commercialisaient la machine à écrire Caligraph, ces gens de l’American Writing Machine Company, au sein de laquelle elle avait rempli pendant trois saisons, après la mort de son père, les fonctions de secrétaire et de dactylographe.
À vrai dire, Józef était le premier homme qu’elle entendait parler anglais avec un clair accent étranger. Le premier homme né dans une autre langue et transplanté en anglais. Le premier homme amputé – à demi amputé, préférait-elle – de son étrange langue maternelle : ce polonais pas entièrement évaporé car il survivait dans son accent, dans les gestes dont il ornait son discours, et peut-être dans la structure de certaines phrases un peu alambiquées ; ce polonais pas entièrement évaporé parce que la fièvre le faisait revivre.
Un jour, une de ses connaissances lui avait raconté une histoire au sujet d’un sous-lieutenant : un ami de la famille qui, après avoir perdu une jambe dans un épisode guerrier, sentait régulièrement la présence du membre désormais inexistant. Il y avait un terme médical pour cela : membre fantôme.
Jessie pensait que Józef possédait une langue fantôme qui n’était pas tout à fait amputée, mais que la société ne devait pas voir et qu’il essayait de rendre la plus invisible possible. C’était peut-être pour cela qu’il avait choisi de vivre loin de Londres. À deux heures, ou plus, en voiture. Pour cela qu’il s’exprimait le plus souvent par écrit. Avait-il embrassé la profession d’écrivain parce que, étant ainsi en retrait de l’activité orale, il n’avait pas tout le temps à exposer son anglais maladroit ? Avait-il pris l’habitude de dicter ses textes à d’autres – bien que son terrible accent s’interposât entre sa voix et ces doigts qui, d’une certaine façon, traduisaient – pour éluder les fautes d’orthographe qui auraient pu massivement le trahir ?
Comme si elle n’avait jamais renoncé à l’American Writing Machine Company, Jessie s’asseyait devant la Yost et tapait les mots (light, right, fight, night, bright, brought, cought) que Józef, dans ses quelques manuscrits, persistait à écrire avec la terminaison tgh.
Au cours des deux dernières années, après la naissance de Borys et quelques problèmes de santé de Jessie, Józef avait de plus en plus souvent insinué l’idée de s’offrir les services d’une sorte de secrétaire, une dactylo appointée, mais il le faisait prudemment, sans impatience, pour ne pas irriter cette autre secrétaire-dactylo dont dépendait leur fils et dépendait, plus encore, leur harmonie conjugale.
Dans le même temps, il dictait aussi à Hueffer tel ou tel manuscrit pour ne pas abuser de Jessie et pour rompre la routine, mais toutefois dans un cadre différent, parce que Hueffer, comme écrivain, comme collègue, avait l’audace et le droit de donner son avis.
Hueffer, visiblement, ne revenait pas à Jessie. Elle appréciait son soutien et la stimulation mentale qu’il apportait à Józef avec sa ferveur, sa jeunesse et son anglais. Elle appréciait que dans un élan de générosité, Hueffer leur ait loué sa maison de famille, une ferme appelée Pent Farm, pour une somme dérisoire (vingt livres par trimestre que Józef ne payait pas toujours – et lorsqu’il le faisait, ce n’était presque jamais à temps) et qu’il ait emménagé avec sa femme Elsie et leur fille Christina dans un logement moins confortable, ou du moins Jessie le concevait-elle ainsi : une maison à Aldington, à une heure de bicyclette. Mais Hueffer était vaniteux et se vantait, croyait Jessie, d’être l’auteur caché de nombreuses idées de Józef. Et Elsie lui revenait encore moins. Moins encore que n’importe quelle dactylo que Józef aurait pu trouver.
II
Pent Farm, Pent Farm… Voilà des semaines que j’essaie d’écrire l’histoire de Józef, de sa femme et de leur fils Borys, tout en étant incapable de comprendre quelle impulsion me porte à le faire, quelles raisons m’ont poussé à en être obsédé, jusqu’à ce que, brusquement, je comprenne qu’entre Józef et mon père les ressemblances abondent : rien à voir avec l’office littéraire, encore moins avec la renommée artistique ou la légende marine, non, il s’agit d’autres causes, qui tiennent à sa condition d’étranger, au fait que mon père, comme Józef, s’était installé dans un pays lointain, avait appris une langue nouvelle et s’était marié avec une femme plus jeune que lui, plus jeune d’une dizaine d’années : une femme qui ignorait son passé et ignorait aussi sa langue maternelle.
Pent Farm, Pent Farm… Je passe plusieurs heures sur Google à essayer de savoir comment aller à Pent Farm depuis Madrid, où je vis aujourd’hui après avoir vécu à Buenos Aires et à Paris, et comme je déteste l’avion ou plutôt que j’ai la manie, disons, de ne pas prendre l’avion quand je peux l’éviter, je finis par tracer sur une feuille de papier un itinéraire possible quoique un peu fou : Madrid-Paris en train de nuit, pause de quelques heures à Paris, Paris-Londres en Eurostar, pause de quelques minutes à Londres, Londres-Hythe par un autre train, avec mini-escale à Hythe, et de là, quoi ? un taxi ? De là quelque chose jusqu’à la ferme de Pent Farm qui, j’ai pu le vérifier, est encore à peu près debout, plus ou moins rénovée, sorte de relique tenue et protégée par une association culturelle mi-anglaise, mi-polonaise dont il n’est pas difficile de trouver le site web.
Je fais mes comptes, bien que je n’aie jamais excellé dans cet exercice, et j’en arrive à la conclusion que je n’ai pas les moyens de m’offrir un voyage de ce genre. Ou plutôt, que je pourrais le payer si cela en valait la peine, mais je préfère en financer une partie ou pourquoi pas la totalité avec une sorte de bourse, une demande de soutien : une de ces aides qu’il faut ensuite rappeler, expliquer avec des remerciements dans un coin donné du livre, bien que, il faut en convenir, cette espèce d’écusson ou de sceau institutionnel exigé par ceux qui déboursent l’argent, aussi peu que ce soit – les mécènes semblant être plus friands de ces flatteries que des œuvres qu’on écrit et publie grâce à eux – enlaidisse le livre.
Je me demande, après avoir fait mes comptes, si cela vaut vraiment la peine d’aller à Pent Farm, s’il n’est pas possible de s’y prendre autrement pour écrire ce que je souhaite écrire, ou s’il ne vaut pas mieux ne pas y aller, renoncer à mes recherches et faire confiance à la fantaisie, de façon que Pent Farm soit une terre imaginée à ajouter à celles que j’ai l’habitude de développer dans mes romans, ces terres imaginées où je ne me rends d’ordinaire qu’après avoir écrit et publié le livre et qui me causent, lorsque je les visite, une triste désillusion qui ressemble à la triste résignation que j’éprouve toujours en relisant, une fois terminé, ce roman qui promettait tant de choses, tant de romans possibles, tant de possibles terres imaginées, mais qui finalement se trouve réduit à une simple matière insipide qui se résume avec le mot « ça ».
Je finis par décider que j’irai à Pent Farm par curiosité, par caprice personnel ou pour être en règle avec ma conscience, peu importe, mais en aucun cas parce que cette visite est impérative. Pas, du moins, pour le livre que je projette d’écrire. Je me rendrai dans le sud de l’Angleterre, dans le Kent, et je verrai la ferme de mes propres yeux.
Je pense soudain à un autre écrivain anglais – vraiment anglais, suis-je sur le point de me dire malgré moi – selon lequel le passé est un pays étranger où les gens font les choses autrement, et je comprends que dans ce nouveau roman que j’essaie d’écrire l’extranéité se manifeste doublement, et ce n’est pas la première fois que cela m’arrive, bien au contraire, comme si au fond écrire était, pour moi du moins, un vaste pays étranger avec sa vaste langue fantôme.
Je décide de loger à Hythe, où j’ai vu qu’abondent auberges, hôtels et même maisons à louer. Grâce à ma patience et à Google, j’obtiens le numéro de téléphone de l’association britannico-polonaise qui maintient Pent Farm en état. Je suis tenté, j’aime imaginer que cette association fonctionne dans les murs même de la ferme, cela n’aurait rien d’insolite, et j’appelle avec l’espoir qu’on me serve sur un plateau un conte fantastique : que ce soit la voix de Józef qui réponde ou, sinon, la voix d’un membre de sa famille, un descendant peut-être, et même un descendant mort comme Borys. L’individu à qui je parle (peu amateur de dialogue, et moins encore de contes fantastiques) me dit sur un ton sec que pour visiter Pent Farm je dois prendre contact avec une autre association de spécialistes de la vie et de l’œuvre de Józef car, manifestement, il existe un réseau très complexe d’associations et de sociétés littéraires les concernant. Les spécialistes en question se chargeront d’accepter ou de refuser ma demande. Et, bien entendu, de m’informer des tarifs. Je ne m’attendais pas à ce dernier détail : des tarifs ! Quelle envie de capituler. Mais, soyons sincère, je veux aussi savoir si je suis accepté à Pent Farm, dans la ferme véritable, après m’être installé sans demander la permission à personne (à force de rêverie, à force d’heures passées à écrire et à imaginer) dans une ferme fictive, mais à coup sûr réelle, à la façon dont je comprends les choses.
Pour plus de sûreté, je contacte l’autre association. J’envoie un courriel. Je parle au téléphone avec un homme du nom de Cockburn. Je remplis même une sorte de formulaire d’immigration où on me demande ma taille et la couleur de mes yeux (de quelle couleur, au fait ? peut-être veulent-ils savoir si un écrivain se contente de mettre « marron » ou s’il choisit des solutions comme « amande », « noisette », « miel » ou autres choses encore pires), j’écris sans aucune vérification 1,81 m pour ma taille et je m’assieds, disposé à attendre, attendre longtemps. Mensonge : pas si longtemps que cela, mais l’attente, pour moi, dure presque une éternité. Jusqu’à ce qu’enfin, un mardi, assez tard, un peu après neuf heures du soir, m’arrive un courriel. Admis, sous certaines conditions. Je sais maintenant que je pourrai visiter Pent Farm.
III
Ce que Jessie préférait à Pent Farm, c’était sa végétation, le chemin vert d’accès à la ferme, le beau jardin du devant et, surtout, l’auvent de bois au-dessus de la porte, toujours couvert de lierre, été comme hiver.
Ce matin-là, elle et Borys avaient sorti le petit train dans le jardin et maintenant les wagons roulaient au pied d’une fourmilière que Borys appelait montagne et que, dans sa tête, Jessie appelait menace ou danger de piqûres. Le ciel était couvert et l’air, épais et chaud, ne semblait pas serein. C’était le troisième jour de la crise de goutte. Le troisième jour était en général le pire.
Au bruit que fit la bicyclette, le petit train s’arrêta.
— Maman, dit soudain Borys, et il montra de la tête un homme, un inconnu, qui appuyait une bicyclette contre la palissade en bois blanc qui entourait le jardin.
Assise dos à la scène, Jessie regarda par-dessus son épaule avant de se lever lentement. Lentement parce que sa chute de janvier lui avait laissé des séquelles au genou. Depuis lors elle portait des chaussures spéciales, qui ne supprimaient pas entièrement la gêne.