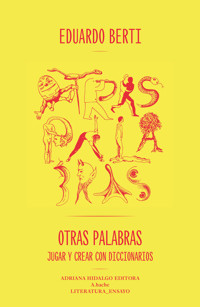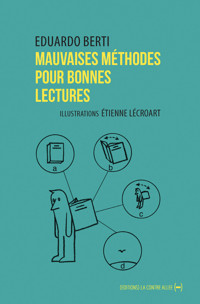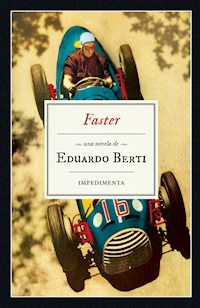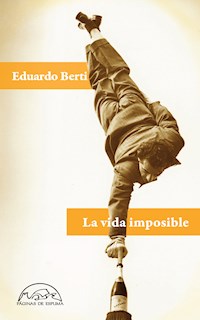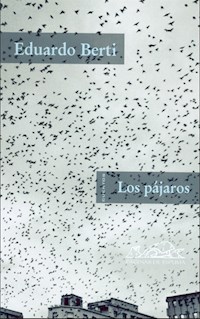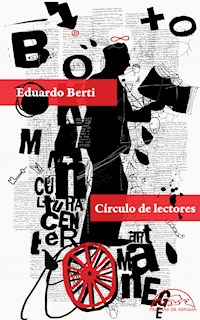Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Contre Allée
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Alors qu’il termine l’écriture de son roman Un père étranger, Eduardo Berti reçoit un colis inattendu contenant des photocopies du dossier que son père présenta à son arrivée en Argentine, dans les années 1940. Originaire de Roumanie et fuyant la Seconde Guerre mondiale, son père avait conservé jusque dans sa tombe de nombreux secrets, jusqu’à son véritable nom de famille.
Parmi toutes les révélations que comporte le dossier, la découverte de l’adresse de la maison natale de son père, dans la ville roumaine de Galati, anciennement Galatz, est comme un nouveau point de départ. Une invitation à entreprendre un voyage à la rencontre du pays natal de son père. Parti en Roumanie sans jamais imaginer qu’il naîtrait un livre de ce séjour, Eduardo Berti passe de l’autre côté du miroir, et devient l’étranger. Partir à la recherche de cette maison natale fut ainsi le premier pas vers Un fils étranger, comme un écho à Un père étranger.
Dans ce voyage à Galati, l’invention est au cœur de la reconstitution de l’histoire familiale. Pour combler les silences et les zones d’ombres imposées par le père, le fils n’aura d’autres recours que de lui inventer une histoire et d’accepter ce qui continuera de lui échapper, à l’image de cette fameuse maison familiale, au n°24, qui ne se trouve peut-être pas être celle que l’on pensait y trouver.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Eduardo Berti est membre de l’Oulipo depuis juin 2014. Né en Argentine en 1964, écrivain de langue espagnole, il est l’auteur de quelques recueils de nouvelles, d’un livre de petites proses et de plusieurs romans. Traducteur et journaliste culturel, il est lui-même traduit en sept langues, notamment en langue française où on peut trouver presque toute son œuvre : les micronouvelles de La vie impossible (prix Libralire 2003), les nouvelles de L’Inoubliable et les romans Le Désordre électrique, Madame Wakefield (finaliste du prix Fémina), Tous les Funes (finaliste du Prix Herralde 2004), L’Ombre du Boxeur et Le Pays imaginé (prix Emecé 2011 et prix Las Américas 2012), sans parler de deux textes difficiles à classer : Les Petits miroirs et Rétrospective de Bernabé Lofuedo. Ses livres sont publiés, principalement, aux éditions Actes Sud et traduits par Jean-Marie Saint-Lu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 85
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
La collection « Fictions d’Europe » est née d’une rencontre entre la maison d’édition La Contre Allée et la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société. Désireuses de réfléchir ensemble au devenir de l’Europe, La Contre Allée et la MESHS proposent des récits de fiction et de prospective sur les fondations et refondations européennes.
Christophe Niewiadomski directeur de la MESHS.
À Mariel
À Ulises, petit-fils étranger
Je viens de loin
Je viens de loin, de très loin. C’est la première fois que je viens dans ce pays. Mon père est né dans cette maison, il y a cent ans.
Voilà plusieurs jours que je murmure ces mots, comme une sorte de répétition ou d’incantation générale pour le moment où je devrai les prononcer. Je me les répète en anglais, ce qui est peut-être une erreur. Aurais-je dû les mémoriser en roumain ? Au contraire, c’est mieux ainsi, pour éviter les déceptions. Pour éviter que les autres ne me répondent en roumain et ne découvrent, un peu frustrés, qu’à part ces phrases diplomatiques, je ne comprends absolument rien.
Il est dix heures du matin. Hier soir, à peine arrivé à Galati après une journée entière de train, hier soir donc, avant de dormir à l’hôtel Kreta, simple, quatre étoiles, dont trois bien méritées, j’ai un peu modifié mon plan. J’avais pensé sonner à neuf heures ; mais non, ce sera plus sensé à dix. De ce fait, je me repose mieux.
Voilà enfin la maison : 24, strada Holban. C’est ici qu’est né mon père, il y a cent ans. Plus de cent ans, à vrai dire. Le chiffre est vertigineux.
Il y a longtemps
Il y a longtemps, très longtemps, dans une galaxie lointaine, j’ai publié un roman intitulé Un père étranger, dans lequel je parle de certains faits qui se sont produits il y a longtemps, très longtemps, dans une autre galaxie lointaine.
Pour résumer (car le lecteur est pressé et l’heure n’est pas aux retours en arrière ni aux parenthèses), j’ai raconté dans ce roman que mon père, né et élevé en Roumanie, puis éduqué en France, était arrivé en Argentine à l’âge de vingt-cinq ans, au moment où éclatait la Seconde Guerre mondiale, et qu’il avait profité du voyage pour se réinventer : pour changer de nom de famille, de date de naissance et, plus encore, de religion.
Dans la galaxie lointaine de mon père il y avait un homme très très mauvais et à l’étrange moustache qui n’aimait pas les juifs. Prévoyant, mon père avait fui l’Europe et détruit tous les documents qui auraient pu dénoncer ses racines « israélites », comme on disait alors en Roumanie. Il effaça ou raya si bien son passé que je n’ai compris tout ce que j’ignorais de lui qu’après sa mort. Et j’ai écrit un roman à partir de ça, même si je ne résumerais jamais mon roman de cette façon.
Le roman, Un père étranger, passa presque inaperçu, ou, comme on dit en espagnol, « sans peine ni gloire », quoique nous vivions une époque où cinq cents exemplaires peuvent faire la différence entre la peine et la gloire. Une époque où les deux concepts s’annulent, se superposent et où, au fond, tout n’est que peine, même la pénible gloire d’avoir vendu cinq cents exemplaires de plus.
Quoi qu’il en soit, un ami très cher eut l’idée d’acheter et de lire mon livre. Je veux parler d’un vieil ami que j’avais perdu de vue, un ex-camarade d’école. Juif pratiquant, et non juif « renégat » comme mon père, mon ami lut le roman, bien après sa sortie, sans se presser, et quelques mois plus tard il m’envoyait un courrier étonnant.
Il lui avait été facile de trouver mon adresse à Bordeaux, où je vis aujourd’hui. Il lui avait été également facile (je n’expliquerai pas pourquoi, il m’a supplié de ne pas le faire) de trouver ce qu’il m’envoya : le dossier que mon père présenta en 1952 pour demander et obtenir la citoyenneté argentine.
Ce dossier, qui m’est parvenu il y a onze mois, contient les informations que mon père nous avait cachées pendant des années. Ce qu’il a emporté dans sa tombe. Ce que j’ai dû inventer, parce que cela manquait, dans mon roman. On y trouve le nom du bateau sur lequel il traversa l’Atlantique. On y trouve la date où il mit les pieds dans le port de Buenos Aires. On y trouve les noms complets de mon grand-père et de ma grand-mère, qu’il avait toujours eu tendance à escamoter. Et, le plus émouvant pour moi, un vieil acte d’état civil, encombré de timbres carrés, ronds, triangulaires, indiquant l’adresse exacte de la maison de Galati où est né mon père.
La lumière tombe
La lumière tombe à la perfection, comme si elle fêtait mon changement de plan, sur la strada Culturii, l’ancienne rue Holban de Galati. La lumière tombe à la perfection sur le numéro 24.
J’ai quitté l’hôtel à huit heures trente. Je suis passé devant la maison à neuf heures et je l’ai vue pour la première fois (plus grande qu’elle ne m’avait semblé quand je l’avais cherchée sur Internet avec une de ces cartes big-brother-on-line), mais à cette heure matinale le soleil ne l’éclairait pas aussi bien.
Il y a un café au coin de la rue. J’y ai patienté en regardant passer les gens. J’ai vainement cherché un visage dont les traits m’évoqueraient mon père. J’ai constaté que ce café est populaire : une table avec des buveurs de bière matinaux ; une autre avec six élèves d’une école qui ne doit pas être très éloignée, tous avec le même uniforme digne d’Harry Potter.
Me voilà maintenant devant la maison, et pour la deuxième fois, irrémédiablement, je change de plan : j’avais prévu de sonner à neuf heures, puis à dix heures, et j’en viens à ne pas sonner du tout. Parce qu’il se trouve qu’il n’y a pas de sonnette. Ou plutôt il y en a bien une, mais elle ne fonctionne pas.
Un portail
Un portail, plutôt qu’une porte, donne sur une sorte de cour ou de jardin de devant. Je frappe dans mes mains. Je fais trop de bruit. Rien, personne. Deux fenêtres fermées donnent sur la rue, mais je ne veux pas y toquer. J’appuie sur la poignée du vieux portail, moins rouillé que les autres de la même rue Holban. Il s’ouvre. Je n’ose pas entrer, je le referme.
C’est le grand voyage
C’est le grand voyage, remis, reporté. Je l’ai bien souvent imaginé. J’ai bien souvent commencé à le planifier. Je l’ai remis à plus tard sous mille prétextes, qui à l’époque me semblaient logiques : mieux vaut l’entreprendre après « avoir fait le deuil » de mon père, mieux vaut le faire quand j’aurai terminé Un père étranger, mieux vaut le faire quand j’aurai réuni plus d’informations… Je me voyais arriver à Galati sans la moindre indication et cela, au lieu de m’exciter, m’intimidait.
Ce que mon ami m’envoya par la poste, d’Argentine, était beaucoup plus qu’un simple dossier. C’était une feuille de route et un défi.
Je devrais commencer
Je devrais commencer par parler du bateau. Ou peut-être que non. Je ne sais pas. Il n’y a plus d’ordre correct ou incorrect, ce serait absurde. Presque un siècle est résumé et embrouillé dans un dossier glissé de force dans une enveloppe ; glissé précipitamment, à ce que suggèrent les coins repliés d’une chemise.
Entre les deux
Entre les deux – mon roman et le courrier de mon ami – j’ai fait la connaissance d’un poète roumain. Nous nous sommes rencontrés par hasard lors d’un festival littéraire à Saint-Étienne. Nous avons sympathisé et je lui ai résumé mon histoire. Finalement, il m’a dit que je pouvais compter sur son aide si je me décidais à me rendre dans le pays de mon père.
Ionel, le poète, vit à Bucarest, tout près du parc Cismigiu qui a les plus beaux bancs publics du monde, et il m’a hébergé chez lui cette semaine parce que, au lieu d’aller directement à Galati, j’ai d’abord voulu « m’acclimater ». Mon père a vécu un temps assez bref à Bucarest, après son enfance à Galati et avant de quitter la Roumanie pour toujours : pour la France, puis pour l’Argentine. Serais-je en train de faire le même voyage, mais très lentement et en sens inverse, depuis des décennies ? Aurais-je commencé à le faire comme si le sillage laissé par le bateau de mon père dans l’Atlantique ne s’était pas effacé ?
Ionel m’a emmené en promenade, m’a présenté à ses amis, m’a prêté un livre traduit en français (le journal de Mihail Sebastian) qu’il m’a enjoint de lire pour mieux comprendre la vie et l’époque de mon père. Bien entendu, j’ai aussi voulu me promener seul. L’expérience est si différente… Un après-midi, j’ai marché jusqu’au musée d’Art contemporain, près du vieux et monumental parlement. J’ai eu un peu de mal à le trouver, et plus encore à franchir les mille mesures de sécurité. Une machine, un scanner. « Votre sac à dos, s’il vous plaît » et un gardien immense, un vrai joueur de rugby, qui me tend une boîte en plastique. « Keys, mobile, coins… », énumère-t-il. Pendant que je dépose mon téléphone dans la boîte, le gardien complète la liste : « wallet, gun ». Je ris, gun, elle est bien bonne. Mais le gardien ne rit pas. Ce n’est pas une blague.
Au cours de mes promenades dans Bucarest, j’ai compris d’une autre façon le regard que mon père portait sur Buenos Aires. Il répétait toujours une phrase d’André Malraux : la capitale d’un empire qui n’a jamais existé. Cette phrase, qui a son incontestable part de vérité, le fascinait : Buenos Aires comme miroir et, en même temps, revers de New York. Mais en me promenant dans les anciens quartiers de Bucarest, j’ai eu l’impression, guère différente, de parcourir les vestiges d’un autre empire qui n’a pas existé. Ou peut-être la périphérie d’un empire qui, par sa chute, a provoqué la naissance du XXe siècle.
J’ai visité le passage Macca, le monastère Stavropoleos, le Caru’cu bere. Je suis allé à la maison-musée de Georges Enescu. J’ai passé, en somme, à peu près une semaine à Bucarest avec Ionel, avec sa « chère quatrième femme », comme il l’appelle en public, avec son chien qui perd ses poils et éternue sans arrêt en pleine nuit et avec son fils à lui, mannequin de publicité, qui reçoit des milliers d’e-mails d’admiratrices du monde entier, du Japon surtout.