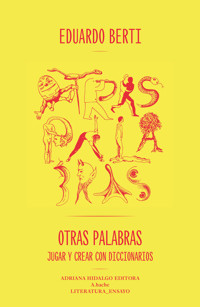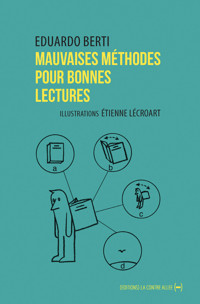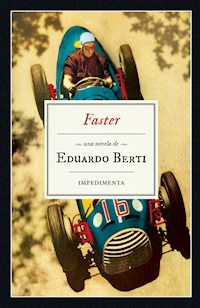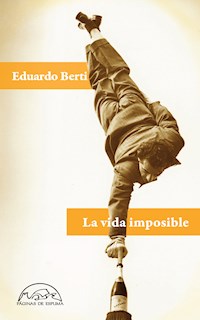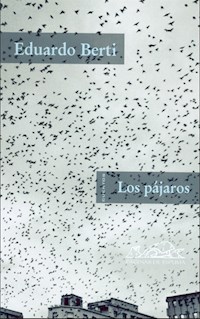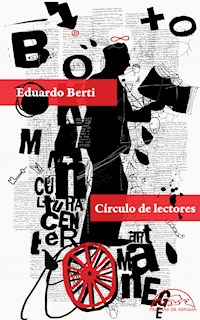Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Contre Allée
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Je ne pense pas à Une présence idéale comme un livre qui parle de la mort. Je voulais écrire un livre qui parle de la vie : de la vie professionnelle et personnelle d’un groupe de soignants."
Eduardo Berti
Aides-soignant.es, infirmières, médecins, bénévoles, brancardiers… chacun.e prend la parole et raconte : le quotidien, les soins du corps, l’accompagnement des malades en fin de vie, les moments beaux, les terribles, les familles, les annonces… Un roman choral dans lequel chacun.e cherche cette « présence idéale » qui fait les bon.nes soignant.es, plutôt que la « distance idéale » que l’on recommande trop souvent aux praticien.nes.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Eduardo Berti est né en Argentine en 1964, il est membre de l’Oulipo depuis 2014 et l’auteur d’une œuvre traduite en dix langues.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Une présence idéale
© Flammarion, 2017.
© (éditions) La Contre Allée
Collection La Sente 2022
Eduardo Berti
une présence idéale
Entre avril et décembre 2015, j’ai passé plusieurs semaines au CHU de la ville de Rouen, invité et très bien accueilli par son service de soins palliatifs. Les textes qui suivent ont été inspirés, plus ou moins librement, de ce que j’ai vu, entendu et vécu là-bas. Évidemment, les noms des narrateurs (des narratrices, en grande partie) sont faux, car il s’agit d’une fiction construite à partir d’une expérience réelle. Cela dit, ces textes veulent rendre hommage à tous les soignants de toutes les unités de soins palliatifs ; et aussi au livre Compagnie K (William March) qui a inspiré la forme de ce recueil. Je tiens à remercier toute l’unité, ainsi que l’unité d’oncologie digestive, mais aussi le service culturel du CHU de Rouen et l’équipe du festival Terre de Paroles qui ont eu l’idée de me proposer une résidence littéraire-médicale dans la ville natale de Gustave Flaubert, fils d’un ancien directeur de l’École de médecine de Rouen.
J’ai osé écrire ces textes directement en français. Cela n’équivaut pas à un changement de langue d’écriture. Je continue à écrire en espagnol et je continuerai à le faire, sans aucun doute, mais ici le français s’est imposé pour de multiples raisons, dont une en particulier : c’est en français que j’ai découvert l’univers qui a inspiré ces textes, que les premières phrases et les premières ébauches sont nées, et que chaque fois que j’essayais d’opérer une traduction, le résultat me semblait faux, artificiel.
Je ne pense pas à Une Présence idéale comme un livre qui parle de la mort. Je voulais écrire un livre qui parle de la vie : de la vie professionnelle et personnelle d’un groupe de soignants. Je voulais comprendre quelle est la place et, disons, le « rôle » de la vie dans un contexte comme celui-ci où la mort est omniprésente. Et, d’une façon semblable, j’ai essayé de comprendre quelle était la place de la fiction au sein d’une expérience d’écriture comme celle-ci, où la réalité et la documentation sont omniprésentes. Bien entendu, j’ai laissé la place à la fiction (dans chaque texte d’une façon différente, car cela a été aussi une piste de travail), mais j’ai été fidèle à la réalité (aux choses vues, entendues et apprises pendant mon séjour au CHU) en tout ce qui concerne le travail des soignants. Dans cet aspect, j’ai voulu être fidèle à leurs occupations et à leur engagement professionnel.
E.B.
À Jean-Marie Saint-Lu, qui est toujours là.
À Mariel et Ulises.
« L’espérance d’être soulagé
lui donne du courage pour souffrir. »
Marcel PROUST,
Du côté de chez Swann
PAULINE JOURDAN (Aide-soignante)
Non, je ne vais pas lire votre livre. Vous êtes venu ici, m’a-t-on dit, pour mettre en mots notre métier, notre réalité. Je n’ai rien lu de vous, je suis désolée. J’ai des préjugés, peut-être. Mais chaque fois que je vois des médecins, des infirmières, des aides-soignantes dans un roman, dans un film ou dans une série télé, j’ai envie de rire, franchement. Ou bien c’est excessif : un catalogue de coups bas. Ou bien c’est rose, embelli. Mais ce n’est jamais vrai, non, jamais. Parce que, lorsqu’ils exagèrent, lorsqu’ils s’emparent de notre travail pour offrir la souffrance humaine en spectacle, même dans ce cas-là les images sont si démesurées qu’on dirait des effets spéciaux. Alors, vous voudrez bien m’excuser, mais je ne lirai pas votre livre. J’ai peur de ne rien retrouver. De découvrir une pâle version de mon témoignage, ou, pire encore, de me sentir trahie. Cela dit, si j’ai accepté de parler avec vous, ce n’est pas seulement pour vous dire que je ne vais pas lire votre livre ; j’ai accepté, principalement, parce que je ne refuse jamais de parler de mon métier. Chez vous, ça doit se passer d’une façon très différente. Quand un écrivain, un architecte, un chef de cuisine, un avocat ou un comédien sont conviés à un repas et qu’ils se mettent à évoquer leur travail, tantôt on s’exclame « oh, comme c’est intéressant ! », tantôt on pense « oh, comme c’est ennuyeux ! », mais personne n’ose jamais dire : « Arrêtez de parler de votre métier, vous gâchez le dîner ! » Les infirmières et les aides-soignantes savent que tous le pensent dans leur cas. Cela nous arrive si souvent que beaucoup d’entre nous, à la longue, ont pris la prudente habitude de rester silencieux. Du moins en dehors de notre cercle. Avec combien de mes collègues avez-vous déjà discuté ? Ils vous ont raconté la toilette mortuaire, les vomissements, les tâches de nettoyage des agents de service hospitalier ? Vous allez décrire tout ça ? Vous allez gâcher le banquet du lecteur ? Vraiment ? Je vous le demande car je ne vous lirai pas, peu importe ce que vous me répondez.
MARIE MAHOUX (Infirmière)
Cette dame était quelqu’un de spécial. Je ne dis pas ça parce qu’elle a été ma première patiente. Je dis ça parce qu’elle était vraiment spéciale. Une femme très sensible. Sereine. Et d’une extraordinaire gentillesse, heureusement pour moi car je venais d’arriver aux soins palliatifs directement de l’école d’infirmières. C’est très inhabituel comme parcours, je sais ; en théorie, on passe d’abord par d’autres services. Mais ça n’a pas été mon cas. Je suis arrivée très jeune à l’unité. J’avais à peine 22 ans.
C’était ma cinquième journée aux soins palliatifs. Je cherchais encore mes repères quand un patient est mort. Ça fait partie de la routine. Chez nous, il y a une centaine de morts par an, je dis bien une centaine, ce n’est pas une métaphore, un mort tous les trois jours, environ. Mais celui-là était mon premier mort. Non, bien sûr que ce n’était pas ma faute. Je dis « mon » mort, j’ai le sentiment de pouvoir le dire comme ça parce qu’il s’est éteint devant moi, tout d’un coup, comme une feuille qui tombe d’un arbre. Il avait une soixantaine d’années et les poumons abîmés, partis en fumée tout comme ses espoirs.
Je n’avais pas envie de pleurer, mais j’ai senti le besoin de fermer les yeux, de retenir mon souffle et de compter : un, deux, trois, quatre… jusqu’à vingt. Après quoi, j’ai appelé Clémence, Sylvie et Pauline, qui faisaient le quart de l’après-midi avec moi. En voyant ma tête, elles m’ont conseillé de sortir un moment prendre l’air, pour me changer les idées. Elles allaient s’en occuper. J’étais à la fois reconnaissante et un peu vexée. Mais j’ai suivi leur avis. J’ai descendu les escaliers et j’ai pris un café debout, face à la machine. Le gobelet en plastique tremblait dans mes mains.
Dix minutes plus tard, Clémence m’a envoyée faire ma ronde dans les onze autres chambres. Elles ne voulaient pas que je revoie le corps, c’est clair. Je n’ai pas suivi le parcours habituel. J’ai laissé cette femme si spéciale (ma première patiente) pour la fin. Je me souviens d’avoir pensé, tandis que je faisais ma ronde, que j’étais la seule de toute l’unité à avoir ma première patiente encore à l’hôpital. Je me souviens d’avoir pensé, aussi, avec une pointe de tristesse, que bientôt je serais comme toutes les autres…
J’avais gardé ma première patiente pour la fin parce que je pensais qu’elle me calmerait. Elle semblait toujours si sereine. Comme si elle trouvait tout à fait logique et ordinaire d’être là, dans son lit. À peine m’a-t-elle vue entrer dans la chambre qu’elle a ouvert très grand les yeux.
— Quelque chose s’est passé, ma chérie ? (Elle m’appelait comme ça : « ma chérie ».) J’ai eu du mal à sourire et à répondre :
— Non. Rien du tout.
— Voyons… Il y a eu un mort, n’est-ce pas ? demanda-t-elle.
J’ai eu un moment de stupeur.
— Comment le savez-vous ?
— Ça se sent, tout simplement. Ça se sent, ma chérie.
CAMILLE ZIRNHELD (Aide-soignante)
Une fin d’après-midi, un vendredi, j’étais avec mon binôme, Awa, et un autre binôme était aussi de garde : Morgane et Solène, je crois. C’est comme ça qu’on travaille ici. On vous a déjà expliqué, je suppose. Une infirmière et une aide-soignante, en équipe. Bref, c’était vendredi, comme je vous disais, je savais que j’aurais le week-end libre, qu’Awa et moi nous ne reviendrions travailler que le lundi, alors j’ai pris le bout de papier où j’ai l’habitude de noter pour moi, comme un aide-mémoire, les noms des douze patients et le numéro de chambre de chacun d’eux, et là, tout à coup, sans trop savoir pourquoi, j’ai souligné huit noms en disant, comme ça, rapidement, en présence de mes trois collègues : « Les quatre autres, ils ne seront plus ici lundi. » Je parlais, évidemment, des patients dont je n’avais pas souligné les noms.
J’avais oublié tout ça quand le lundi, me voyant arriver, Solène m’a annoncé une chose atroce et insolite : ma prévision s’était réalisée.
Tout le monde me regardait et se demandait comment j’avais pu savoir. En fait, je n’en savais rien. J’avais simplement deviné. C’est fou. J’avais deviné. Je me sentais, maintenant, très troublée. Et mortifiée. Bien entendu, plus jamais je n’ai fait une chose pareille. Même pas pour moi, secrètement. Non, jamais.
HÉLÈNE DAMPIERRE (Infirmière)
Je suis en train de parler en toute confiance avec lui. Depuis qu’il est arrivé ici, il y a deux semaines, déjà, c’est devenu une routine : on parle un peu de tout, de la vie en général. Alors là, sans le vouloir, de façon tout à fait naturelle, je le tutoie. Je veux tout de suite faire marche arrière. Mais, comment ? Je sais que je viens de franchir la ligne blanche. Pourtant, il semble enchanté : lui aussi, il veut me tutoyer. Et l’habitude s’installe entre nous deux. Quoi qu’il en soit, j’en parle avec Mme Terwilliger. « C’est fait, Hélène », me dit-elle. C’est trop tard maintenant. Ces choses-là arrivent. Et, après tout, pourquoi pas ? Cependant, les jours qui suivent, je perçois que ça produit un déséquilibre face à mes collègues. Je suis la seule qu’il tutoie.
Une semaine après, au milieu d’une conversation banale, il laisse tomber : « C’est bien de se tutoyer. Mais je te déconseille de devenir mon amie car bientôt tu vas me perdre. » Il dit ces mots calmement. Avec une colère sereine. Avec un mélange d’aigreur et de résignation. Et là, je reste sans voix. S’il y a une chose qu’on apprend assez vite dans ce métier, c’est à garder le silence quand on n’a vraiment rien à répondre.
CATHERINE KOUTSOS (Interne)
On était six ou sept autour du lit quand Patricia Long est entrée dans la chambre.
— Madame, a lancé Patricia d’une voix un peu tremblante, car elle savait l’importance de ce qu’elle allait annoncer. Madame, c’est votre fils aîné. Il est venu vous voir.
Tout le monde à l’unité connaissait cette histoire. Mère et fils ne se parlaient plus depuis dix ans. La vieille femme, veuve, recevait régulièrement la visite d’une sœur, plus âgée qu’elle, et aussi d’une nièce très timide qui ne disait jamais plus d’un ou deux mots. L’absence de ce fils était plus puissante que la présence trop discrète, presque invisible, de ces deux femmes.
— Madame, a insisté Patricia. Votre fils… Dans la salle des familles.
Nous étions en train d’ausculter la femme. Deux infirmières, deux aides-soignantes, deux médecins externes et moi, la seule interne.
La dame, qui avait fermé les yeux pendant qu’on l’auscultait, les a rouverts avec rage et a fait « non, non », pour toute réponse.
— Vous ne voulez pas le voir ? a demandé Jacqueline Marro avec une légère note de surprise.
— Non, non, a répété la femme.
Et elle a ajouté avec rancœur :
— Bien sûr que non ! Il n’a rien à faire ici. Vous lui direz de partir, s’il vous plaît.
Je fixais la dame. Devait-on rétorquer quelque chose ou bien nous limiter à respecter son souhait ? Quand j’ai détourné le regard, j’ai vu sept paires d’yeux rivées sur moi. Par une sorte d’accord tacite, tout le monde jugeait que c’était moi qui irais parler au fils.
J’ai l’habitude d’annoncer aux gens les nouvelles les plus terribles : « Vous avez une leucémie », « Je crains qu’il ne vous reste que cinq ou six mois à vivre »… Cela ne signifie pas que je suis insensible à ça. Mais l’être humain s’habitue aux choses les plus étonnantes. Et pourtant, malgré cette expérience, mes mains étaient toutes moites, comme la première fois que j’ai dû dire à un patient qu’il avait une maladie incurable.
Le fils attendait debout, sur le seuil de la porte d’entrée de la salle des familles. Mon corps et l’expression de mon visage devaient déjà fournir une information très claire, parce qu’il m’a tendu la main et m’a directement demandé : « Elle ne veut pas me voir, n’est-ce pas ? » Il me facilitait la tâche. J’ai répondu : « Non, non… » Et, ce faisant, j’ai imité un peu, sans le vouloir, l’intonation de sa mère. Il m’a remerciée, a souri avec chagrin. Il était déjà sur le point de partir quand il est revenu vers moi.
— Je pourrais voir une autre chambre, au moins ?
Surprise, je lui ai demandé s’il entendait par là voir un autre patient. Mais non, il voulait simplement visiter une chambre. Pour se faire une idée des lieux où sa mère allait sans doute mourir ?
Il n’y avait pas de chambre vide. Ça, chez nous, c’est plutôt rare, vous savez. Il y avait, toutefois, une chambre dont le patient était parti pour une séance de chimio.
— D’accord, ai-je dit.
Quelques secondes plus tard nous étions tous les deux dans cette chambre, située à l’opposé de celle de sa mère. J’avais l’impression d’être un agent immobilier attendant que le client achève sa visite. Finalement, il a marmonné :
— Très bien, je vois. Oui, très bien.
J’ai raccompagné le fils jusqu’à la sortie. Il m’a tendu la main pour la deuxième fois. Plus moite encore que la mienne. Il n’est jamais revenu voir sa mère. Je me rappelle encore son dernier regard. C’était le regard malheureux d’un gosse qu’on a injustement puni.
AWA MODOU(Infirmière)
C’est Virginie, une collègue du service où je travaillais auparavant, qui a lancé cette idée. « C’est pour toi, insistait Virginie. Tu as un côté spirituel, tu sais écouter les patients, tu n’as pas peur de la mort. » Je n’étais pas convaincue. Bien sûr que j’ai peur de la mort, mais en même temps c’est vrai que j’aime explorer les limites. Mes limites. J’ai travaillé pendant presque deux ans dans une maison de retraite. Et plus d’un an dans un hôpital psychiatrique. Tout au début, quand j’étais infirmière libérale, j’ai accepté un boulot dont personne de ma promotion ne voulait : accompagner un homme très malade qui allait mourir chez lui, sans famille. L’homme était plutôt gentil, mais dans un état épouvantable et, en plus, il refusait que je lui fasse sa toilette. Un exercice de patience de deux semaines. L’homme avait finalement accepté la toilette : il est mort quelques heures après.
J’étais un peu insatisfaite ces derniers temps. J’avais même pensé à changer de boulot quand Virginie m’a parlé de l’unité de soins palliatifs, où sa sœur Hélène travaille depuis un moment. J’avais entendu dire, évidemment, que les soins palliatifs accueillent des patients atteints de maladies graves, chroniques, terminales. Je savais bien que l’objectif de l’unité est non seulement de soulager la douleur physique, mais aussi de prendre en considération la souffrance morale et de soutenir l’entourage. Je savais tout ça, je l’avais écrit, même, il y a presque sept ans, avec un stylo à encre bleue, à l’occasion d’un examen qui s’était plus ou moins bien passé.
Nous avons discuté avec Hélène, la sœur de Virginie. Comme moi, elle savait que dans les autres secteurs de l’hôpital, quand une infirmière s’occupe de douze ou quatorze lits, elle ne peut pas passer plus de quinze ou vingt minutes par jour avec chaque patient. « Nous, en revanche, nous arrivons à passer presque une heure avec eux », m’a expliqué Hélène, tout en précisant qu’en revanche il fallait être prête à vivre des situations limites.
J’ai postulé. L’unité des soins palliatifs m’a fixé un rendez-vous, et j’ai passé un entretien d’une heure et demie avec Mme Gosselin, cadre dans l’unité. Mme Gosselin m’a tout expliqué, tout montré : douze chambres individuelles, douze lits au total, garde de nuit de 20 h 30 à 6 h 30, garde le matin de 6 h 10 à 13 h 51, garde les après-midi de 13 h 10 à 20 h 45, une chambre avec une immense baignoire qui, aime plaisanter Mme Gosselin, est le luxe et la récompense pour les meilleurs patients, un staff d’une douzaine d’aides-soignantes et une douzaine d’infirmières. En même temps, elle me posait des questions : c’est quoi pour moi la douleur, c’est quoi accompagner un patient. Et, surtout, pourquoi cette unité.