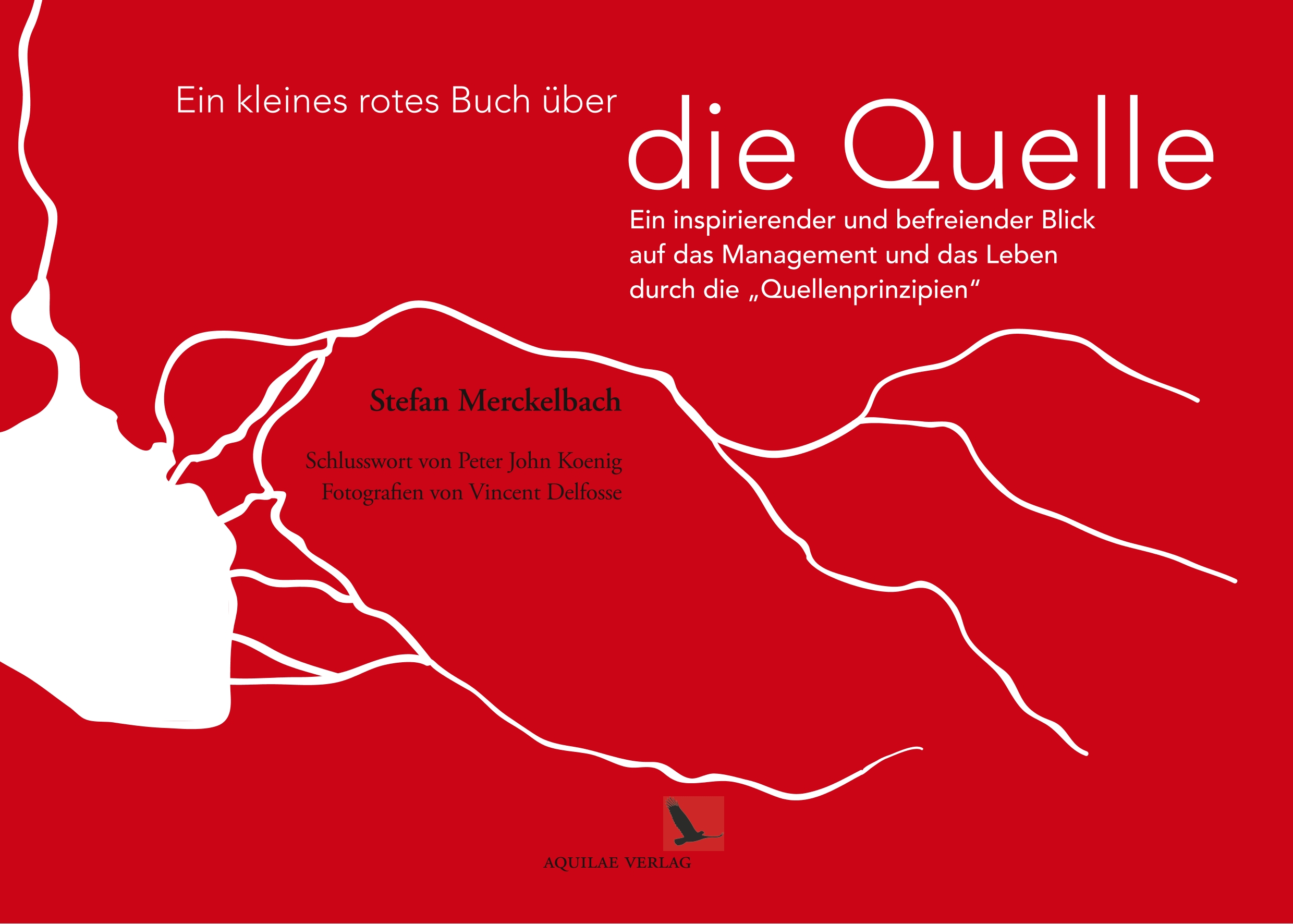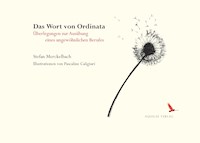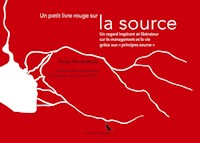
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Présentés ici pour la première fois sous forme de livre, les "principes source" insufflent énergie, clarté et créativité dans le développement de tous nos projets. La source est une personne qui a une idée et qui prend des initiatives et des risques pour la réaliser. Sa tâche principale consiste à clarifier quel est le prochain pas à faire pour développer son projet. Quand elle a besoin de soutien, elle invite d'autres personnes à participer et devenir "source" à leur tour d'une partie du projet. Tous nos collectifs sont nés ainsi. Chacun occupe plusieurs rôles de "source" dans sa vie : le manager est invité à devenir "source" de son équipe ; le collaborateur, "source" de son activité ; le sportif, "source" de sa forme. Partout où il y a un projet, il y a une "source". Les "principes source" nous aident à nous engager énergiquement dans toutes nos initiatives et à encourager ceux qui nous entourent à faire de même. Ils invitent à vivre un management plus inspiré, stimulent notre implication créative et donnent un sens nouveau à nos liens professionnels et personnels.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DU MÊME AUTEUR
Le dit d’Ordinata. Réflexions sur l’exercice d’un métier insolite,
2e édition (Aquilae/l’aigle d’Ordinata) 2017.
« La force de l’eau vient de la source. »
Proverbe persan
« Le poète ne peut créer avant que le dieu soit en lui... »
Épitaphe de Norbert Moret, compositeur
« Ce qui compte n’est pas ce que font les leaders, ni comment ils le font, mais bien leur état
intérieur, l’espace intérieur à partir duquel ils opèrent, la source de leurs actions. »
Otto Scharmer, Théorie U
Table des matières
Liminaire
Vous avez dit « source » ?
Accueillir la source
1. La « source », chacun de nous est concerné
2. Le travail de personne source
3. Se reconnaître source et en vivre
Partager la source
4. Sources globales et spécifiques
5. La source développe le collectif
6. Reconnaître la source de chacun
Transmettre la source
7. Transmettre, quand le moment sera venu
8. Concrètement, comment remettre la source ?
9. Diffuser les principes source
Épilogue
Des principes d’amour
Postface de Peter John Koenig
Des temps qui changent
Vincent Delfosse
Photographies et paroles de source
Ressources
Premières mentions des principes source
Notes de lecture au fil des chapitres de ce
Petit livre rouge sur la source
Formations sur les principes source chez Ordinata
Index
des mots-clés et des noms
Liminaire
Vous avez dit « source » ?
Q UAND je me suis rendu, le 25 septembre 2013, à une journée de formation sur « la personne source », j’étais bien loin d’imaginer à quel point cette expérience allait changer ma vie professionnelle ! Le formateur, Peter John Koenig, avait décidé de maintenir la formation malgré le petit nombre d’inscrits, ceci pour le plus grand bonheur des trois participants qui avaient dès lors toute son attention. Peter Koenig est un formateur et consultant anglais résidant à Zurich en Suisse, à l’époque déjà à l’âge de la retraite ; mais j’allais comprendre bientôt qu’avec son objectif de diffusion des « principes source », il ne songeait guère à se retirer, bien au contraire ! Au vu de ce que je découvrais lors de cette journée, je me suis immédiatement inscrit à la Master Class qu’il organisait l’année suivante pour transmettre son savoir. Depuis lors, la notion de « source » a rapidement trouvé sa place dans les accompagnements et les formations que nous organisons chez Ordinata, l’entreprise que j’ai fondée en 2001. La belle équipe d’associés que nous sommes est très motivée à faire connaître les « principes source » loin à la ronde, et je peux dire aujourd’hui qu’il ne se passe plus un jour sans que ces principes ne viennent sur le tapis d’une manière ou d’une autre… Aussi, nous ne pouvons plus concevoir d’accompagner un client sans avoir approfondi ensemble, au cours du processus, la question de la « source ». C’est ainsi que notre apprentissage des « principes source » se poursuit, jour après jour : chaque nouvelle situation de « source » rencontrée ajoute quelque chose à notre compréhension de ce thème fondamental et en confirme le bien-fondé. Le petit livre rouge que vous tenez entre les mains est le fruit de ces expériences.
Peter Koenig dit que les « principes source » sont vieux comme le monde, qu’il ne les a pas inventés, mais simplement découverts en observant la réalité et en échangeant avec de nombreuses personnes à leur propos. Cependant, il est clairement la « source » de leur mise en mots, car c’est lui qui a développé en premier le vocabulaire que vous allez découvrir dans ces pages. Ses recherches personnelles sur ce thème avaient débuté dans les années 1980 ; en 2000, il a commencé à en parler en public, et c’est en 2009 qu’il a donné ses premières présentations des « principes source », d’abord au Québec, puis à Bruxelles et à Berlin. Au départ, il s’agissait simplement, pour Peter Koenig d’échanger avec d’autres personnes sur la manière dont chacun réalise ses projets ; il s’est rapidement rendu compte que ses interlocuteurs faisaient exactement les mêmes expériences que lui, et que les constantes qu’ils découvraient avaient valeur de « principes ». Aujourd’hui, il poursuit ses recherches sur ce thème, secondé par un réseau d’intervenants internationaux (voir www.workwithsource.com*), dont je fais partie.
Les écrits sur le thème de la « source » sont encore peu nombreux ; la section « Ressources » en fin d’ouvrage en fait la maigre liste. La plupart des développements de ce livre s’appuient sur mes échanges réguliers avec Peter Koenig lui-même, ainsi qu’avec les membres de sa Master Class, entre 2013 et 2018, lors de formations et de journées de réflexion passionnantes, sans oublier nos rencontres personnelles et nos échanges écrits, ni les apports essentiels de mes associés chez Ordinata, qui ont fait de la « source » un thème central dans leur travail, et de Martine Marenne, avec qui je développe depuis de nombreuses années la méthodologie de la « dynamique participative ». En interrogeant Peter Koenig directement, j’ai pu aller « à la source de la source », pour ainsi dire. Je le remercie de tout cœur de sa disponibilité et bienveillance à toute épreuve, et aussi d’avoir relu et bonifié ce livre.
Après avoir appris quelque chose de la genèse de cette notion de « source », vous êtes sans doute impatient d’en découvrir le sens ! Je vous propose dans les pages qui vont suivre d’explorer le thème de la « source » en trois temps, trois mouvements, qui correspondent au processus naturel de sa découverte et de son appropriation. Aussi, ce petit livre rouge est-il organisé en trois parties : nous allons d’abord chercher à comprendre de quoi il s’agit afin de pouvoir (I) accueillir la « source », ensuite nous réfléchirons à (II) comment la partager avec d’autres personnes et enfin (III) de quelle manière la transmettre quand le moment sera venu. Mais arrêtons-là les préliminaires, allons-y tout de suite !
L’astérisque (*) renvoie à une notice dans la section Ressources en fin d’ouvrage (dès la p. 147).
Encore une dernière petite chose : pourquoi ce petit livre est-il rouge ? Je vous le dirai dans l’épilogue.
Première partie
ACCUEILLIR LA SOURCE
Chapitre 1
La « source », chacun de nous est concerné
UNE « personne source » est quelqu’un qui est « à la source » de quelque chose : c’est une personne qui a pris une initiative. Cela arrive bien à chacun d’entre nous, n’est-ce pas ? Dans ma vie, c’est vrai, j’ai pris de multiples initiatives : celle de faire telles ou telles études, par exemple, ou de postuler pour tel travail, ou de créer mon entreprise, ou de démarrer un projet, ou de m’associer à l’initiative d’une autre personne. Mais j’ai aussi pu prendre l’initiative d’une relation, d’une amitié, de la location ou l’achat d’une maison, du choix de la destination de nos prochaines vacances, de la venue d’un enfant… Dans toute situation où je prends une initiative, je mets quelque chose en marche qui n’était pas en mouvement auparavant. Ce faisant, je deviens « source », ou « personne source », de cette initiative.
Avant que je n’aie commencé à concrétiser mon initiative, il y a eu une idée, une intuition, une inspiration, que j’ai écoutée et que je me suis appropriée. En tant que « personne source », je suis bien la personne qui a pris l’initiative de sa mise en œuvre, mais je ne suis pas pour autant moi-même l’origine de cette initiative : l’idée m’en est venue, l’intuition m’est sur-venue, tout d’un coup l’inspiration était là. L’idée est un cadeau. Les autres diront sans doute que c’était mon idée, mon intuition, mon inspiration, et ils ont raison en ce sens que je me la suis appropriée, je l’ai faite mienne, c’est bien en moi qu’elle a pris forme et c’est aussi moi qui l’ai exprimée et communiquée plus loin. Mais en même temps ils ont tort, car cette intuition n’était pas « à moi », je l’ai reçue. La « personne source », en prenant conscience de cela, adopte une attitude humble vis-à-vis de son idée, dont elle se reconnaît le dépositaire plutôt que le propriétaire ; nous y reviendrons plus loin, car c’est important.
D’ailleurs, pour être « source » ou « personne source », il n’est pas nécessaire d’avoir eu soi-même l’idée de l’initiative, elle peut aussi venir de quelqu’un d’autre. Il existe des gens très créatifs qui ont à peu près une nouvelle idée à la minute ; cela ne fait pas automatiquement d’eux des « sources », à moins qu’ils ne prennent l’initiative de démarrer la réalisation de leur idée. S’ils ne la mettent pas en œuvre eux-mêmes, ils peuvent inspirer quelqu’un d’autre qui, en reprenant l’idée à son compte (c’est une autre manière de la recevoir), s’active à la mettre en œuvre : nous disons alors que cette dernière personne, et non pas celle qui était à l’origine de l’idée, en est la « personne source ».
L’image de la source d’eau qui jaillit des entrailles de la terre est ici parlante : l’eau ne surgit jamais spontanément du « rien », elle vient toujours de quelque part. Le reconnaître pleinement est déjà une manière de le respecter : je deviens « source » ou « personne source » en adhérant à une idée que je n’ai pas moi-même « fabriquée » (même si elle est bel et bien sortie de moi) et en prenant l’initiative de la réaliser, de la concrétiser, de la faire exister dans le monde (même si, souvent, je m’appuie sur d’autres personnes pour m’aider à la mettre en œuvre). Bref, la « source » désigne la personne qui prend une initiative sur la base d’une idée qu’elle s’est appropriée.
Ce processus est grandement facilité pour la « personne source » grâce au fait que l’idée (qui est elle-même un cadeau) vient avec un autre présent sous le bras, à savoir l’énergie nécessaire à sa prise d’initiative. C’est comme si la voie de communication de l’idée, que Peter Koenig appelle notre « canal de source », transportait aussi la sève de vie dont la « personne source » a besoin pour transformer l’idée en réalité. Cette énergie jaillit de l’intérieur de la personne, allumant ses vertus et décuplant sa capacité d’agir, si tant est qu’elle décide, par un acte de sa libre volonté, de s’approprier l’idée, d’accueillir l’énergie et de se mettre en mouvement.
Il existe fondamentalement deux manières d’être « source » ou « personne source » : soit je prends l’initiative de quelque chose de nouveau (l’on m’appelle alors « source globale » de cette initiative), soit je rejoins l’initiative de quelqu’un d’autre (auquel cas j’en deviens une « source spécifique ») ; nous y reviendrons en détail au chapitre 4. Ce dont il convient de prendre conscience dès maintenant est que, dans les deux cas, je suis « personne source » de ma présence au sein de l’initiative : ma participation est une expression authentique de ma liberté, de mon pouvoir d’agir et de ma créativité.
Prenons un exemple concret. Gilles cherchait un nouvel emploi, il a donc répondu à une annonce et se trouve maintenant en entretien d’engagement. L’entreprise était « source » de l’annonce ; Gilles est « source » de sa candidature et de sa présence à l’entretien, personne ne l’y a forcée. Le recruteur de l’entreprise est « source » d’une proposition concrète d’engagement, tandis que Gilles est « source » de sa réponse. S’il accepte, augurons qu’il puisse devenir rapidement « source » de son nouveau poste, c’est-à-dire une personne qui écoute ses intuitions et qui prend des initiatives pour faire évoluer son poste dans le sens de la mission qui lui aura été confiée.
Pour Gilles, devenir « personne source » de son nouveau poste, cela voudra dire, progressivement :
engager son pouvoir d’agir en prenant pleine possession du champ de responsabilités et de la marge décisionnelle liés à son poste, dans le respect du cadre global donné par l’entreprise ;
exercer, en s’appuyant sur ses intuitions, sa liberté et sa créativité à trouver de nouvelles voies de développement de la mission de son poste, résultant en de nouvelles initiatives ;
vivre sa « source » comme une motivation forte, une passion, jusqu’à ce qu’il aura acquis la conviction qu’il faut passer cette « source » à quelqu’un d’autre et investir lui-même sa passion ailleurs.
Aux chapitres suivants, nous allons approfondir notre compréhension de ce que c’est que d’être « source » ou « personne source » de son travail, de ses rôles et fonctions, du champ de ses responsabilités, de ses relations, de ce dont on est propriétaire ou dont on a l’usage, de ses projets... dans le but de vivre plus pleinement notre rôle de « personne source ».
Mais avant d’aller plus loin, quelques précisions de vocabulaire. À la suite de Peter Koenig, nous distinguons entre « source », « personne source » et « principes source ».
La « personne source », nous venons de la définir comme la personne qui prend une initiative sur la base d’une idée.
Le terme « source » peut être entendu en deux sens différents :
pris du côté du
sujet
, « source » est synonyme de « personne source », la personne qui prend l’initiative ; le mot « source » exprime notamment le rôle que cette personne joue par rapport à son initiative ; c’est en ces sens que Peter Koenig utilise ce terme ;
pris du côté de
l’objet
, « source » peut aussi désigner l’essence de ce dont cette personne est « personne source », c’est-à-dire la vision et les valeurs qui constituent le cœur intime de son initiative (peu importe qu’il s’agisse d’une fonction, d’une relation, d’une maison ou d’un projet) ; c’est la « source » de la « personne source », en quelque sorte ; cette vision-là et ces valeurs-là sont transmises d’une « personne source » à une autre lors d’une succession du rôle de source, un peu à la manière d’un bâton d’estafette. Pour Peter Koenig, « accueillir sa source » veut précisément dire se mettre en contact avec cette source intérieure, s’y connecter et rester en relation avec elle lors de la mise en œuvre de l’initiative.
Enfin, les « principes source » désignent l’ensemble des phénomènes qui caractérisent aussi bien l’activité de la « personne source » en tant que sujet que la mise en œuvre de la « source » en tant qu’objet. Au cours de ses recherches, Peter Koenig a découvert certaines constantes dans la manière de bien exercer la « source », et aussi certains écueils à éviter : l’ensemble de ces constats et observations sur le fonctionnement de la « (personne) source » sont regroupés dans les « principes source ».
Maintenant que le vocabulaire a été suffisamment clarifié, nous allons pouvoir enlever sans sourciller les guillemets à source, personne source, principes source !
Chapitre 2
Le travail de personne source
C OMPRENDRE ce que les mots veulent dire est un premier pas, indispensable ; mais le véritable enjeu est dans leur mise en œuvre. C’est d’autant plus vrai pour la personne source qu’elle se définit précisément par sa prise d’initiative, qui est éminemment une mise en route d’actions. Plutôt que de rester immobile devant son idée, la personne source se met en marche pour la réaliser. Elle a une œuvre à accomplir, un « ergon » comme diraient les anciens Grecs, c’est-à-dire un travail, une action, une tâche, un faire, un acte, débouchant sur une œuvre — au moins symboliquement — comme celle d’un poète ou d’un peintre. L’ergon de la personne source a deux dimensions : il comprend aussi bien le chemin de mise en œuvre (le travail) que le résultat (l’œuvre réalisée). Cependant, le travail de la personne source n’est jamais une pure fabrication de quelque chose (comme si elle n’avait qu’à suivre « machinalement » un mode d’emploi), mais un agir qui nécessite de se fixer un cap, d’ajuster ce cap suivant les aléas de l’expérience et d’aligner constamment la mise en œuvre sur le cap choisi. De ce fait, l’agir de la personne source est à la fois d’une grande force et d’une grande fragilité : il est d’abord une force formidable qui pousse la personne source en avant pour initier, entreprendre, achever son initiative ; mais son agir est aussi très fragile étant données les circonstances de l’initiative, souvent imprévisibles et immaîtrisables, auxquelles elle est sans cesse contrainte de s’adapter, sans oublier ses propres fragilités personnelles dans l’exercice du rôle de personne source, qui interfèrent à leur tour avec le bon accomplissement de son œuvre. Explorer la force de son agir et combattre ses fragilités (inhérentes à l’agir et personnelles), voilà un apprentissage clé pour toute personne source qui souhaite que son initiative avance.
Ceci étant posé, en quoi consiste plus précisément ce travail, cette œuvre, de la personne source ? En substance, elle effectue trois grandes tâches, qui correspondent aux trois principaux rôles de la personne source :
elle reçoit des intuitions (idées, vision) et s’investit dans leur réalisation en prenant des initiatives et des risques — c’est son rôle d’« entrepreneur » ;
elle inscrit son initiative dans un futur en clarifiant, tout au long de son évolution, les prochains pas qui sont à faire pour la développer, et elle communique chaque fois cette clarté aux autres — c’est son rôle de « guide » ;
elle veille à ce que le cadre de l’initiative, exprimé par des valeurs et une vision, soit respecté — c’est son rôle de « gardien ».
Regardons ces trois rôles, et leurs tâches correspondantes, d’un peu plus près.
1. La personne source comme entrepreneur. Nous avons déjà abordé ce rôle, qui correspond à la définition de la personne source du chapitre précédent comme quelqu’un qui prend une initiative sur la base d’une idée. Peter Koenig constate que la personne source continue à recevoir des idées, des intuitions, des inspirations, et aussi l’énergie nécessaire à les concrétiser, tout au long de la vie de son initiative. Ajoutons maintenant à cela la dimension de la prise de risques. Celle-ci accompagne immanquablement la prise d’initiative, qui est toujours peu ou prou un « saut dans le vide ». Au fond de toute personne source sommeille un « fou audacieux » qui croit en son initiative avec une foi parfois même un peu au-delà du raisonnable et qui se pare aussi d’une certaine naïveté, comme pour donner raison à l’expression « nous ne savions pas que c’était impossible, c’est pourquoi nous l’avons fait ! » La prise de risques fait tellement partie de son rôle d’entrepreneur qu’une personne source qui n’en prendrait pas (ou plus) cesse d’être une ressource pour son initiative et en devient un obstacle et un frein.
Au sujet du risque, mon expérience au fil des années avec l’entreprise Ordinata, dont je suis personne source depuis ses débuts en 2001, a été pour moi une leçon vivante : a posteriori, je constate que les initiatives des périodes de développement de l’entreprise ont été systématiquement accompagnées de, voire même déclenchées par, une prise de risques, parfois considérable, tandis que les initiatives des phases de stagnation ont toutes été caractérisées par une absence de prise de risques. En prendre conscience m’a beaucoup aidé à renouer avec le risque lorsque c’était nécessaire. Cette corrélation entre initiative, risque et développement me fait dire qu’en réalité, le plus grand risque pour une entreprise est… de ne plus prendre de risques ! C’est cela qui hâte son déclin, inéluctablement, même s’il peut y avoir aussi de nombreuses autres causes en jeu, bien entendu.
Certes, le risque n’est pas recherché pour lui-même, il n’a pas de valeur en soi, mais il donne de la valeur à l’initiative en lui permettant d’aller explorer l’inconnu, là où la