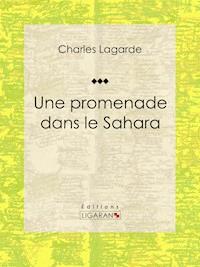
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Alger est une ville que l'on quitte avec regret. En dehors de tout intérêt, de toute attache familière, certains lieux exercent sur nous un charme que l'on ne peut définir, et dont on ne comprend la force qu'en les quittant. Si le plaisir ou le devoir nous appelle ailleurs, nous nous sentons en partant comme retenus par d'invisibles liens que nous ne pouvons briser sans une secrète douleur..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335043044
©Ligaran 2015
Je n’ai pas connu personnellement Charles Lagarde, officier au 1er régiment de Chasseurs d’Afrique, l’auteur du livre que je présente au public et que je recommande à mes confrères ; mais une correspondance suivie a établi entre moi et les siens une relation qui date de vingt années. De cette famille, aujourd’hui disparue, il ne reste que la sœur de Charles Lagarde.
C’est un préjugé de croire et une erreur de dire que le génie s’impose et que le talent s’affirme. À moins d’un coup d’éclat ou de fortune, toujours rare, il faut une vocation forte, tenace, opiniâtre, indomptable, enragée, pour se faire un nom, sortir des rangs pressés, franchir les barrières et gagner l’épaulette dans l’armée des lettres. Avec une œuvre, on arrive toujours, mais quelquefois on arrive mort. Toutefois si le public, cet être inamusable, est indifférent, il convient de dire que l’auteur de la Promenade dans le Sahara ne l’était guère moins. Son culte pour les lettres demeura constamment platonique, et aucune arrière-pensée d’ambition, de gloire ou d’argent, et même de publicité, n’y mêla le moindre alliage. Il écrivait pour écrire, comme les oiseaux et les poètes chantent, par besoin de traduire, sous la forme la plus nette et la plus élégante, les impressions d’une intelligence supérieure, sollicitée par les recherches mystérieuses de la philosophie, ouverte à toutes les aspirations idéales du beau, du vrai et du bien. Il avait donc composé son livre pour fixer ses souvenirs, pour lui, non par excès de modestie, – il avait la conscience de son talent, – mais par une sorte d’inertie naturelle, que la vie contemplative et l’expérience acquise ne pouvaient que rendre plus profonde. Il était du petit nombre de ces esprits d’élite que leur délicatesse ombrageuse, jointe à une indolence native, condamneraient à une obscurité absolue, si le légitime et juste désir de les mettre en lumière ne faisait un devoir, à ceux qui les ont connus et aimés, de réclamer pour eux une réparation tardive. Charles Lagarde aurait pu adopter pour devise ces deux vers d’Alfred de Musset :
C’est en 1869 qu’il m’envoya le manuscrit de la Promenade dans le Sahara, sur la demande de sa sœur, et je retrouve la première impression de ma lecture dans la correspondance et les notes qui m’ont été communiquées pour écrire cette préface.
« Je dois bien vous remercier, écrit-il à sa famille, ma sœur surtout, du zèle que vous mettez à épouser mes intérêts amour-propre et à suppléer à mon indolence. Je voudrais vous en récompenser en m’illustrant un peu ; mais voilà tout ce que je peux faire. Je serai toujours très content si mon livre vous intéresse ; mon plaisir a été de l’écrire ; j’en ai aussi à vous le faire lire. Le reste m’intéresse moins. Il ne m’est pas indifférent que le livre soit publié. Cette petite jouissance d’amour-propre, qui ne l’a rêvée ?
J’avais le plus grand désir de le faire publier dans un journal ou une revue, pour en favoriser l’édition en librairie ; mais le nom de l’auteur était absolument inconnu, et son livre ne rentrait pas dans les classifications des études spéciales sur l’Algérie ; ce n’était ni un ouvrage militaire ou scientifique, ni une œuvre d’imagination ou un voyage pittoresque.
C’est ce qui en fait le mérite et l’originalité ; tous ces éléments sont fondus dans l’ensemble de la composition, d’une allure familière et d’une large facture. Lois, mœurs, coutumes, idées, types, tentes arabes et gourbis des soldats, hommes, animaux et choses, tout est dans son milieu, bien à sa place, vu et observé sous son véritable jour, senti et rendu avec sincérité, dans un style naturel et d’un relief saisissant. Voilà de la peinture librement touchée, où le dessin et la couleur reproduisent, sous leurs aspects changeants, la variété des tableaux. Dans la succession de ces décors panoramiques, on voit défiler les grandes scènes du désert, la mer sèche aux vagues brûlantes, à la brise enflammée, les paysages de sable, les oasis pleines d’ombre et de fraîcheur, les villes blanches qui dorment au soleil.
C’est en vain qu’on y chercherait une figure sympathique, une émotion personnelle. Rien ne bouge, rien ne s’anime dans l’immensité silencieuse. On est loin de l’activité fébrile et de la mélancolie brumeuse de l’Occident. C’est l’impassible contemplation, l’universelle atonie du fatalisme oriental. Les passions, les sentiments et les idées ne se traduisent par aucune manifestation extérieure. Sans doute, le peintre est là. Son œil est comme un objectif braqué sur la nature immobile, endormie, morte. Sa pensée est en harmonie avec le calme imposant et la morne sérénité de la solitude. Il est lié par des affinités mystérieuses à cette terre aimée du soleil, il s’identifie avec elle, il s’enivre de sa beauté lumineuse, il semble se fondre et s’abîmer dans une rêverie d’infini, une adoration muette, une voluptueuse extase : c’est la grande poésie de l’Orient.
Il est seul. Rien d’humain. Cet isolement est désespérant, cette aridité désolante. On est tenté de regretter de ne pas voir dans l’oasis les blanches silhouettes de Daphnis et de Chloé ; on attend une confidence à un frère d’armes, un souvenir de la mère patrie. Les femmes orientales sont belles, leurs grands yeux noirs sont chargés d’amour, comme les messagers aériens ou les bouquets qui parlent. Autant vaudrait demander de la pluie, de l’ombre et des fleurs au désert. Tout repose, tout dort. La terre vierge est inféconde, le ciel d’un implacable azur est vide et sans oiseaux, le cœur marmoréen du soldat et du poète sans nostalgie et sans amour.
« Le reproche très juste, écrit-il encore, d’avoir présenté des tableaux presque inanimés, se tourne en éloge, car c’est un des effets que j’ai cherchés. Ma peinture est avant tout un paysage, et le véritable héros du roman, c’est la Nature. Les hommes ont là des poses, des attitudes et peu de vie ; je crois que c’est vrai et ressemblant : c’est l’Orient. »
Tel est, en effet, le caractère de la nature et de son observateur. Le livre, c’est l’homme. Il a raison. On ne doit demander à l’artiste que ce qu’il a voulu faire. Oui, c’est l’Orient, dans son cadre grandiose, avec ses vastes horizons, son désert sans limites, son calme profond, son atmosphère de feu, ses paysages de couleurs prismatiques ; car si on ôte à l’Orient sa lumière d’or, il ne reste que de la houe et des loques sales. La Promenade dans le Sahara est un tableau de couleur et de lumière.
Charles Lagarde eut une enfance maladive qui favorisa son irrésistible instinct, son goût pour les choses de l’intelligence. Dès qu’il sut lire, la passion de la lecture s’empara de lui. Il passait de longues journées, dans un coin bien obscur, à dévorer les Contes du chanoine Schmidt, Délicat, chétif, faible, inquiet, incapable de se mêler aux jeux des enfants de son âge, toutes ses forces vitales étaient concentrées dans le cerveau. Comme un fruit hâtif de serre chaude épuise la sève de l’arbre et tombe de bonne heure, son corps dépérissait, miné par cette culture précoce. Il vivait par la tête, et c’est à la tête que la sinistre Moissonneuse le toucha de sa faux, dans la riche floraison de ses facultés actives.
À son entrée au collège, une nouvelle passion, celle de l’école buissonnière, vînt opérer une diversion favorable et rétablir l’équilibre en alternant avec la première. Les livres classiques remplirent l’office de calmants pour neutraliser les effets des ouvrages d’imagination.
L’écolier parlait le matin, ses livres sous le bras, sans doute avec la bonne intention d’aller au collège. C’était à Grasse, ce doux pays adossé à sa colline dans une ceinture de fleurs. Le chemin était si joli, le soleil si joyeux, l’air si doux et si bon à respirer, l’herbe si verte, si fraîche et si tendre, quelque diable aussi le poussant, la tentation était trop forte, et l’instinct de vagabondage, de promenade, de flânerie, de far niente, lui faisait tout oublier. Comme Hercule entre les deux déesses, à la fourche du sentier du bois et de la classe, il choisissait la liberté, qui lui semblait plus belle. Sans hésiter, il jetait les bouquins sous un buisson et filait. Souvent le soir, à la nuit close, il n’était pas encore rentré au logis. Alors, sur la route poudreuse, les parents affolés d’inquiétude, les amis, les voisins se mettaient en quête du petit vagabond perdu. Lui, sans se soucier autrement des transes causées par son absence prolongée, et inaccessible au remords, apparaissait à un détour du chemin, aussi tranquille que s’il revenait du collège, expédiait son souper et allait s’enfermer dans sa chambre avec ses autres amis, les livres. Qu’avait-il fait, tout le jour, seul au milieu des bois ?
La solitude l’attirait comme une mystérieuse amie. Il y avait dans cette tête enfantine l’intuition des secrets de la nature ; il écoutait, il entendait le langage inconnu qu’elle murmure l’oreille de ses favoris, il était en communion intime avec elle. Il avait une prédilection pour ces humbles plantes sauvages qui semblent créées pour être foulées aux pieds, et qui croissent partout où elles trouvent une poignée de terre et un rayon de soleil. Les bêtes aussi l’attachaient ; il les étudiait avec amour, il les comprenait, il les aimait, toutes, même les plus laides et les plus dédaignées. Couché à plat ventre sous un arbre, il passait des heures entières dans une contemplation silencieuse, à suivre les allées et venues des scarabées, des fourmis, des insectes, et l’observation de la vilaine bête humaine ne devait pas modifier plus tard ses goûts, ses sentiments et ses préférences pour les êtres inférieurs, doux et inoffensifs ; leur faiblesse appelait sa sympathie, leur intelligence le charmait.
La nature et les livres furent ainsi les premiers maîtres et les premiers amis de l’écolier au cœur sans expansion, au caractère indépendant, a l’humeur d’une suprême fantaisie, doué d’une invincible répulsion pour la discipline, le travail classique et obligatoire. L’étude réglée lui déplaisait, comme ces longues routes plates et unies, aux bornes kilométriques, que Topffer appelle des rubans, et qui s’effilent dans la perspective entre deux haies d’arbres bien alignés. Au moral comme au physique, il avait horreur de la ligne droite ; il lui fallait les courses par monts et par vaux, l’imprévu des aventures de la route. Qui aurait eu le droit de lui en faire un reproche ? Sa santé fragile n’aurait pas résisté à un travail assidu ; comme une hirondelle captive, l’enfant n’aurait pu vivre derrière les barreaux d’une cage universitaire. On le comprit, on laissa cet externe trop libre en user à sa guise, et les cours du collège furent des intermèdes de pluie ou de froid dans les beaux Jours de ses années de jeunesse. Combien de fois lui dit-on plus tard en riant : « Qui croirait que tu as été un cancre ? »
À vingt ans, ce qu’il avait lu, étudié, appris, tenait du prodige. Sans maître, sans ordre et sans méthode, il avait emmagasiné des connaissances encyclopédiques, mais sans étancher cette soif ardente, sans satisfaire cet âpre désir, cette curiosité insatiable, avide de tout savoir, qui faisait dire au vieux Michel-Ange : « J’apprends encore. » En feuilletant les notes, les esquisses, les premières ébauches sorties de ce cerveau d’adolescent, on se sent pris d’un étonnement admiratif et presque douloureux. Pas un sujet qu’il n’ait effleuré, pas une question de littérature, d’art, de science, de philosophie dont il n’ait essayé de se rendre compte, pas un sentiment délicat et profond qu’il n’ait cherché à ressentir. À son début dans la vie, l’enfant s’était livré à un travail de bénédictin ; l’homme avait rêvé d’épuiser le clavier complet des émotions humaines.
Ses premières années s’écoulèrent ainsi, et dans cette fièvre dévorante d’étude et de pensée, sa santé s’altéra, sa vie faillit sombrer. Une telle surexcitation des facultés cérébrales brûle et tue ; à ce jeu mortel, l’intelligence la plus active et la plus lumineuse se paralyse. Son corps miné semblait diaphane, les sources vitales commençaient à se tarir ; seules la marche et l’équitation ranimaient l’organisme surmené. Il était rongé par une mélancolie noire, conséquence fatale de son état nerveux, et qui lui faisait rechercher de plus en plus la solitude.
La vie du régiment opéra une subite métamorphose physique, morale et intellectuelle. Le fils du colonel Lagarde était destiné à la carrière militaire, qu’il choisit moins par goût que par tradition de famille. Il en fut tout d’abord comme étourdi et s’y trouva singulièrement dépaysé. Forcé brusquement, brutalement de frayer avec des compagnons disparates et, sauf exceptions rares, inférieurs, il sut dominer toute répugnance par un énergique effort de volonté. Bravement, gaiement, troquant l’habit contre l’uniforme, jetant les bouquins aux orties comme autrefois aux buissons, le jeune savant en prit son parti, accepta sans regrets sa nouvelle existence et sourît le premier de cette transformation. Sa santé ne tarda pas à se raffermir par l’influence de l’exercice, de la gamelle et du pain de munition ; son esprit, calmé et retrempé par l’activité, prit un essor plus libre, et son humeur s’en ressentit vite. La tristesse n’habite pas la caserne et le camp, l’étude encore moins. Comment se recueillir, lire, travailler, réfléchir, penser, dans la chambrée bruyante et tapageuse, au milieu des propos grossiers, des chansons vulgaires, du va-et-vient des bottes massives chaussant des pieds lourds, lui qui ne trouvait jamais sa chambre d’étudiant assez solitaire, silencieuse et sombre ?
Cependant le jeune philosophe y trouva son compte. Obligé de renoncer à l’étude des livres, il étudia les êtres et les choses qui l’entouraient. Le côté original de la vie de soldat séduisit son imagination d’artiste, et finit par le captiver tout à fait par son caractère d’insouciance et d’imprévu, de servitude et de grandeur. Avec une verve pleine d’humour et d’entrain, il se mit à esquisser, de la plume et du crayon, les types et les scènes militaires qu’il avait sous les yeux. Il en saisit du premier coup le côté gai, comique, vivant et pittoresque. C’est au 7e Lanciers qu’il créa un journal hebdomadaire où se trouvaient relatés les menus faits de la chambrée, les épisodes du régiment et les cancans de la ville. Un camarade, devenu plus tard un des dessinateurs du Charivari, fut son collaborateur ; il illustrait les articles de charges d’une fantaisie échevelée, où pouvaient se reconnaître, chefs, sous-officiers et soldats. Le rédacteur fut pendant plusieurs années l’âme de ce régiment, où sa supériorité avait été bientôt devinée et reconnue, surs tout par ses camarades, les meilleurs juges, car il n’était lui-même que dans l’intimité familière ou dans un milieu sympathique.
On retrouve vivante, sous ses aspects lamentables et amusants, tristes et fous, sa vie de bohème militaire, dans cet album humoristique, écrit et crayonné d’une main fine et légère. Ici, dans l’homme encore jeune comme dans l’enfant, on retrouve toujours l’être nerveux, sombre, taciturne, inquiet, chercheur. Seulement, nu contact de la vie, son caractère s’était arrondi, assoupli, apaisé. Une extrême douceur, une mansuétude universelle avaient remplacé sa froideur glaciale et sa réserve armée. Une raison supérieure, toujours maîtresse d’elle-même, modérait et refoulait ses révoltes sourdes contre le mal, le faux, le banal, le laid. Indulgent, bienveillant, d’un commerce sûr, capable de s’attacher avec un entier dévouement, il se montrait très exclusif dans le choix de ses relations ; sans repousser la sympathie, il ne la recherchait pas, il n’en avait pas besoin ; mais si ses amitiés étaient rares, elles étaient vraies. Il avait aussi des antipathies violentes dont il ne revenait guère, pour les gens et pour les choses. Par exemple, un parapluie était sa bête noire ; il regardait cet utile et prosaïque engin comme le type du trivial. Tout petit, quand sa mère prévoyante le munissait de cet accessoire, son premier soin était de le jeter dans le bois, ainsi que ses livres. C’était sa ressource suprême, ce fameux bois, et dans la suite, il ne s’était jamais corrigé de l’habitude d’égarer volontairement les parapluies.
Par un contraste de sa nature rêveuse et placide, il avait parfois des élans de gaieté irrésistibles. Observateur par goût et par habitude, il était vivement frappé des côtés comiques, ridicules et grotesques, et ses remarques donnaient à sa conversation une saveur piquante et un attrait particulier. Certains travers bourgeois, certaines faiblesses le trouvaient impitoyable. D’un trait de plume ou de crayon, il avait vite fixé une charge ou une caricature d’une vérité mordante ; mais son ironie un peu triste était sans amertume ; il n’empoisonnait pas ses flèches, et si elles piquaient l’épiderme, elles pénétraient rarement dans la chair, et sans y faire ces blessures profondes que rien ne peut cicatriser.
Nous ne suivrons pas Charles Lagarde à travers ses cantonnements dans presque toutes les places de l’Alsace et de la Lorraine. Il devait y retourner une dernière fois, aux jours de la défaite et de la captivité, pour faire ses adieux aux deux sœurs séparées. Pendant une douzaine d’années, errant de garnison en garnison, le jeune philosophe promena son insouciante gaieté, vivant au jour le jour, et tirant le meilleur parti possible de cette existence nomade, souvent un peu dure. Pourtant, à mesure qu’il avançait vers la maturité, il se sentait gagner par cette influence que Leopardi appelle le plus noble attribut de la nature mortelle : l’ennui ; la lassitude commençait à émousser sa belle humeur, signe avant-coureur du dégout et du découragement.
C’est dans cette disposition d’esprit assez morose qu’il fut envoyé en Algérie, avec le grade d’officier, au 1er régiment de Chasseurs d’Afrique, en garnison à Blidah. On va le suivre jour par jour, heure par heure, dans sa Promenade au Sahara. Là encore, après avoir parcouru huit ans toute la province d’Alger et être descendu, dans sa dernière colonne, jusqu’aux confins du Maroc, il devait revoir ce séjour enchanteur, mais il y revenait pour mourir.
Depuis longtemps l’Algérie l’attirait. La vue de ce pays du soleil fut une révélation, et l’explosion de vie nouvelle qu’elle fit jaillir en lui ne devait s’éteindre qu’avec la flamme de sa pensée. Comme un voyageur errant de pays en pays, de site en site, fatigué de ce perpétuel changement de décor qui le distrait sans le fixer, s’arrête soudain en face d’un nouveau paysage en se disant : « C’est là », le jeune officier se sentit enchaîné au premier regard. L’Océan a ses Sirènes, la mer de sable à ses Salamandres : elles chantaient. Ces divinités charmantes lui parurent si douces, si attirantes, si amoureuses dans leur beauté dormante ; leur chanson monotone, au rythme lent et sourd, était d’un charme si pénétrant, qu’il en fut enivré. L’Orient rassasiait toutes les aspirations de son cœur d’homme et de son imagination d’artiste. Cette terre chaude et blonde était son Inconnue. Il voyait marcher son rêve dans la splendeur de sa réalité. C’était le coup de foudre. La France ne sera plus pour lui qu’une mère bien-aimée, mais une patrie secondaire. Quand plus tard, prisonnier des Barbares, sous un ciel d’hiver, il soupirera pour elle, c’est en Algérie que s’envolera sa pensée de retour : « Qu’il doit faire beau, là-bas, au soleil, et que les collines doivent être vertes maintenant ! »
L’Orient était son élément, c’était son univers. Tout lui plaisait, surtout l’absence de civilisation, et il était heureux de ne point y retrouver ses traces. « Je crois qu’après réflexion, écrivait-il, deux choses seules sont capables de fixer notre attention : les grands spectacles de la nature, l’Orient, le désert, la forêt vierge, ou les chefs-d’œuvre sortis des mains de l’homme, les Arènes, les Propylées, le Parthénon. En dehors de cela, je fais peu de cas des divers carrés de légumes qu’on appelle la campagne. Je les estime à leur point de vue utilitaire ; mais que dirait-on d’un voyageur qui, visitant un palais superbe, s’inquiéterait de la cave et des celliers ? »
Cette antipathie instinctive, injuste quelquefois, pour tout ce qui touche à la vie matérielle et bourgeoise, se retrouve à chaque page du livre. Sa colère, en découvrant une correcte habitation européenne, plantée comme par miracle au milieu d’un décor sauvage, a quelque chose de comique : « Qui me délivrera, s’écrie-t-il, de cette vilaine bête qu’on appelle l’Homme ? »
Misanthrope, il l’était sûrement ; mais sa misanthropie n’était ni farouche ni maussade. Il faut que le cœur se brise ou se bronze, quand il ne se replie pas, et il justifiait l’amère pensée de Chamfort : « Celui qui, à quarante ans, n’est pas misanthrope, n’a jamais aimé les hommes. » Et comment ne pas le devenir un peu ou beaucoup au spectacle du monde, quand on a le cœur noble, l’esprit élevé, l’épiderme sensible, quand on a été heurté, froissé, déchiré dans la mêlée humaine ? Qui donc a livré le combat de la vie, soutenu la lutte pour l’existence sans mécomptes, sans défaites et sans blessures ? Chamfort a dit vrai ; il suffit d’avoir aimé.
Il y a deux sortes de misanthropie : l’une, particulière, égoïste, vindicative, la haine des hommes ; l’autre, générale, désintéressée, méprisante, la haine de l’homme. Pour compléter cette définition, on doit convenir venir que s’il fallait être meilleur que les autres pour avoir le droit de les haïr, il y aurait moins de misanthropes. Aussi faut-il bien marquer la différence entre l’amertume et l’aigreur d’un égoïste, dérangé dans le train-train de ses petites affaires par l’égoïsme d’autrui, et la pitié attristée, la compassion tranquille d’un philosophe qui connaît l’homme et les hommes, observe avec une indifférence ironique leurs petitesses, leurs mesquineries et leurs turpitudes, les juge sans fiel et sourit volontiers au spectacle de leurs rares vertus. Celui qui sait tout comprendre sait tout pardonner.
Nous avons soulevé un coin du voile de ce caractère énigmatique, de cette âme ombrageuse et fière ; l’hommage rendu à sa mémoire n’exige rien de plus. Il est des confidences qui peuvent être murmurées, mais qui ne s’écrivent pas, des pensées intimes que la plume déflore. Dans les choses de cœur, la parole est toujours une mauvaise traduction. Ce qu’on peut dire, c’est qu’aucun sentiment bas n’a jeté son ombre dans ce cœur désenchanté, et la vase que l’expérience dépose au fond des âmes les plus pures n’en a pas troublé la limpidité. Cœur mortellement triste, sous des apparences insouciantes et malgré des gaietés soudaines. La vie ne lui a pas été douce ; il ne lui en a pas voulu, ni à elle, ni à la vilaine bête humaine ; mais il en faisait bon marché : la vie, pensait-il, ne vaut pas la peine qu’on vive.
C’est au retour de sa dernière expédition dans le Sud qu’il reçoit la nouvelle de la guerre d’Allemagne. Sans prendre un jour de repos, son régiment s’embarque pour la France et marche droit au Rhin. Condamné à l’inaction pendant un mois, il n’entre en ligne que pour prendre une part héroïque et glorieuse à cette néfaste journée qui se résume en un mot : Sedan. L’histoire a enregistré cette sombre page ; elle a dit le rôle que joua dans la retraite la brigade de cavalerie légère, sous les ordres du général Margueritte. Chacun y fit son devoir, simplement, largement, sans mesure, Charles Lagarde avec et comme les autres. Il eut deux chevaux tués sous lui. Jeté dans un fossé, et par miracle sans blessure, un régiment au galop lui passa sur le corps sans même l’effleurer. On n’en meurt pas toujours, de ce beau métier de soldat.
Interné au Camp de la Misère, il apprend à connaître toutes les souffrances physiques et morales que peut subir un prisonnier de guerre. Quinze jours de marche le séparent d’Erfürth, ville désignée comme lieu de captivité. La plupart des hommes qui survivent sont dans un état lamentable ; il reste encore quelques chevaux qu’on cède tour à tour aux plus épuisés. C’est ainsi que sans revendiquer son droit de rester libre en signant la capitulation, il veut aller, étape par étape, station par station, jusqu’au terme du Calvaire. Il arrive malade à Erfürth avec un de ses camarades, M. Leseur, qui tombe malade à son tour. Les deux compagnons d’armes louent un petit logement, se soignent, se soutiennent, s’encouragent, se réconfortent, et partagent, comme le reste, les amertumes de l’exil et de la captivité. Elle dura sept mois pour Charles Lagarde. Toujours simple et fort, il estimait qu’il faut aller jusqu’au bout de son devoir, ne s’arrêter qu’après avoir fait le possible et l’impossible, qu’un soldat doit savoir supporter les revers immérités et ne rougir que de ses défaillances.
Nous regrettons de ne pouvoir donner, dans celle notice, sa Correspondance pendant la campagne et les jours de captivité qui la suivirent. En ce temps de surexcitation morale où tous les masques tombaient, où les hommes se montraient à découvert, le jeune philosophe militaire apparaît dans ses lettres. Son courage froid, son abnégation réfléchie, sa force de résistance énergique, su patience endurante, révèlent la dignité stoïque et la virile douceur du modeste héros.
Nous espérons qu’un jour cette Correspondance sera publiée, avec une série d’Études intéressantes dont voici les titres :
Les Bohémiens de province, – Avril 1866,
Contradictions, – Janvier 1867.
De la lactique, (Leçon militaire.) – Médéah, 1869.
Notes d’Allemagne (1870-1871). – Erfürth. Novembre 1870.
Du goût français, – Erfürth. Novembre 1870.
Sans date :
Les Mœurs et le théâtre en province.
La Province.
Assez de poètes.
Contre les orphéons.
De retour en France, Charles Lagarde ne passe que quelques jours dans sa famille, rappelé en Algérie où l’insurrection de 1871 vient d’éclater. Sans avoir le temps de se reconnaître, après sept longs mois de repos forcé, il revoit l’Orient, il trouve presque du charme à se replonger dans sa vie active et aventureuse. On l’envoie à Marengo, une des villes les plus malsaines de la province, où le feu dévore tout. Pris d’une insolation violente, en escortant à Cherchell des colons français, en plein mois de juillet, il est forcé de s’arrêter. Il tombe, lui trente-huitième, après les trente-sept hommes qu’il commande, et qui payent de leur vie ou de leur santé le mortel tribut d’un double incendie, celui de l’implacable soleil et des flammes allumées par les Arabes. À peine en convalescence, il sort de l’hôpital de Blidah, retourne à son poste de combat, et y reste ferme jusqu’à l’extinction du fléau et la répression de la révolte. À la suite de ces évènements, il est fait chevalier de la Légion d’honneur.
Tant d’efforts, de fatigues et de souffrances avaient détendu le ressort de son organisation nerveuse, dompté son énergie morale, la seule force qui le soutenait. Cette dernière campagne l’avait abattu ; la lame ne devait plus redresser le fourreau. Sa vue fut attaquée ; il lui fallut renoncer au service actif et entrer comme substitut au Conseil de guerre. Là, comme partout, il fut l’homme du devoir. Il apporta dans ces nouvelles et modestes fonctions les qualités supérieures qu’il avait montrées au cours de sa carrière de soldat, et qu’il aurait développées dans les lettres, s’il s’était enrégimenté sous cet autre drapeau. Il leur appartient aujourd’hui par son livre ; il suffit pour donner la mesure d’un écrivain de race, d’un penseur et d’un poète.
Nous l’avons dit : Charles Lagarde n’avait aucune ambition, si ce n’est celle de vivre tranquille et de ne jamais quitter sa chère Algérie. Ce vœu a été réalisé, mais il n’a pas duré bien longtemps. Le soleil africain avait laissé sur son front une ineffaçable empreinte. Depuis, il ne mena plus qu’une vie languissante ; ses forces déclinaient insensiblement, comme dévorées par un feu intérieur ; puis sa faiblesse toujours croissante le laissa désarmé contre la fièvre. Terrassé, foudroyé par une méningite, il est emporté en quelques jours, le 23 janvier 1870, dans ce même Blidah enchanteur que, huit aimées auparavant, il saluait joyeux, plein d’espérances d’avenir, comme une patrie d’élection, comme une mère adoptive. Il mourut ainsi, sans avoir revu les siens, sans qu’une dernière étincelle jaillit de son regard obscurci, de son front sans pensée.
Mais le souvenir de Charles Lagarde vivra dans le cœur de ceux qui l’ont connu, son nom dans la mémoire de ceux qui liront son livre. Il est écrit sur ce petit monument, consacré par l’affection d’une sœur chérie, comme un autel solitaire à l’ombre d’une oasis.
Qu’il repose !
Charles JOLIET.
Mai 1885.
Alger est une ville que l’on quitte avec regret. En dehors de tout intérêt, de toute attache familière, certains lieux exercent sur nous un charme que l’on ne peut définir, et dont on ne comprend la force qu’en les quittant. Si le plaisir ou le devoir nous appelle ailleurs, nous nous sentons en partant comme retenus par d’invisibles liens que nous ne pouvons briser sans une secrète douleur. Il n’y a là ni force d’habitude ni regret des personnes, mais une tendresse inexprimable pour des objets en apparence inanimés ; sans doute nous en avons compris à demi l’âme mystérieuse. Voyageurs nous en avons tous éprouvé de ces passions singulières pour des sites, des ombrages, des murailles qui nous sont devenus chers comme des êtres. Nous avons épié avec mélancolie les derniers contours d’une plage hospitalière fuyant sous l’horizon, nous avons adressé de muets adieux aux mers qui nous ont bercé ; en maint endroit nous avons senti s’apaiser notre humeur vagabonde, et rêvé, comme un libertin soudainement épris, des fidélités impossibles.
Nous gravissons les hauteurs de Kouba qu’une brise embaumée caresse à celle heure matinale. Une verdure joyeuse nous environne : le caroubier verse son ombre épaisse, le tremble argenté frissonne, et dans l’olivier qu’enlace un réseau de lianes, mille oiseaux chantent suspendus aux mailles de ces lacs flottants. L’aloès robuste, projetant vers le ciel ses liges pareilles à des lampadaires, mêle ses tons pâles et froids au vert éclatant du fenouil ; le hardi liseron escalade les raquettes du figuier de Barbarie dont il adoucit la tristesse. Au-dessus de nous, festonnant la croupe des collines, s’élèvent les dûmes des grands pins sur leurs confuses colonnades.
Au bas du versant s’épanouissent les jardins du Hamma, les blanches villas de Mustapha, à demi ensevelies dans leurs feuillages. Une traînée de poussière marque la route jusqu’au-delà d’Hussein-Dey ; puis se déploie la nappe azurée du golfe tout constellé de petites voiles. Nous contemplons Alger une dernière fois dans ce cadre enchanteur.
La ville, reflétée par les eaux du port ou s’enfonce sa pointe extrême, n’a rien où l’œil se puisse arrêter d’abord. On ne voit qu’une grande complication de rectangles superposés, jusqu’à ce beau mur ruiné de la Casbah, saisissante image d’une grandeur déchue. Point de mosquées, de minarets, rien qui dépasse cet amoncellement de gradins blancs, cette ébauche de cité qui ressemble à une carrière de gypse, et pourtant quelle harmonie, quelle lumière, quelles ombres !
De la distance nous sommes nous ne voyons que la ville moresque, avec ses majestés, ses coquetteries, son mystère et ce grand air de poésie qui évoque le souvenir de toutes les féeries où notre enfance s’est bercée. L’éloignement, qui accroît cet effet, soustrait heureusement à notre vue l’empreinte hideuse dont nos architectes ont souillé ce joyau arabe. Il faudrait un examen attentif pour découvrir d’ici les maisons françaises avec leurs toits criards et leurs stupides alignements de fenêtres. Cela, c’est l’Alger de l’avenir. Je le voue par avance à la malédiction des artistes. Il faut remercier le ciel qui nous aura retirés de ce monde avant le jour où l’Angleterre et la France seront entièrement parvenues à enlaidir la surface du globe et l’espèce humaine elle-même. Nous pouvons pressentir l’issue de la lutte engagée entre les nations à vapeur, dont nous sommes fiers de tenir la tête, et tout ce qui garde encore une trace de couleur, un accent primitif. Je suis venu ici, pensant m’accrocher un instant à tant de choses qui s’en vont ; mais de la libre nature, d’un peuple original, que reste-t-il ? des épaves. Où aller, où fuir, en quel lieu se soustraire à la prose du génie moderne, ennemi passionné de ce qui est beau selon l’ordre divin, et qui sans cesse gagne, s’agite, fouillant, rasant, nivelant. Le Saxon, le sont partout, la pioche et la truelle en main. L’Union américaine implante ses usines au cœur des plus beaux sites qu’ait enfantés la grande palette ; l’Anglais sème à travers les pays vierges la sauvage et confortable architecture éclose sous des brouillards. En vain les cieux sont purs, la nature parée, le climat tiède, l’atmosphère parfumée, le conquérant blafard aura raison de ces splendeurs, de ces ivresses. Alger, la cité de la belle chevalerie arabe, la perle de la Méditerranée, voluptueuse et guerrière, qui chaque matin, comme en cet instant, voit se lever le soleil oriental derrière les cimes du Djurjura, Alger a changé d’idéal, et va devenir un petit Marseille. Je fais un vœu impie, j’espère qu’un bon tremblement de terre aura raison de pareilles monstruosités, et que la mer aura l’obligeance d’engloutir ce que nous avons déposé sur cette plage.
Détournons notre pensée et nos yeux de ces bords outragés. Les portes du Sahara sont ouvertes. Là-bas s’étend, neuf encore, à l’abri des insultes du colon, la contrée lumineuse, redoutée, méconnue, le pays de la soif. Mes regards s’attachent sur le Sud, et quand nous descendons la pente méridionale du Sahel, une poignante sensation de curiosité a déjà adouci dans mon cœur les amertumes du départ.
Le paysage du Tell offre peu d’attrait. On y voit dominer l’olivier qui en forme en quelque sorte la base végétale. Cet olivier a la feuille plus petite, plus touffue, il est plus élancé, plus ombreux que le nôtre. Ce n’est pas d’ailleurs un arbre pratique ; son fruit n’est pas bon à grand-chose et j’aime assez ses airs d’indépendance. Mais il récrée peu la vue au premier abord, et n’a rien pour nous d’exotique, de plantureux. Mêlé aux caroubiers, aux pins, aux chênes verts, il fait dominer une note sévère dans cette gamme des feuillages persistants. On voit tout de suite qu’on est dans un pays où l’hiver est la saison aimable. Alors les coteaux du Sahel ont un manteau de verdure très noble, sinon gai. Par comparaison, en venant en France, tout est riant. Mais en été les tons clairs font un peu défaut : la végétation, bien qu’abondante, a quelque chose de pénible, de dur, de contraint. On aimerait sous ce soleil plus d’expansion, plus de sourires. J’ai déserté avec joie les pâturages bêtes de la patrie, les fades points de vue de nos régions du juste milieu, mais je pensais trouver des effets plus doux sur ce continent. Il m’a fallu quelque temps pour reconnaître que la nature africaine a de tout autres beautés, un style autrement grand, et fait peu regretter, à la comprendre, nos banales campagnes et nos tendres prairies. Aux abords d’Alger, les villas, enchâssées dans leurs jardins où s’épanouissent toutes les essences du monde, entretiennent les yeux dans le goût des verdures claires ; de là l’espèce de déception qu’on ressent plus loin : on rêve le joli, et le beau surprend plus qu’il ne charme.
Entre le Sahel et l’Atlas, la Mitidja, une vaste plaine insignifiante qui ne demande qu’à bien faire. Il paraît qu’on ne l’ensemence pas assez. J’y vois cependant d’assez belles cultures ; mais il y a auprès de grands espaces où croissent l’asphodèle, le jujubier, le lentisque et ce charmant petit arbuste, désespoir de l’agriculture, le palmier nain. Les beaux endroits sont ceux-là justement. Il y a des eaux sans issue, des marécages sous d’épais fourrés, trésor des chasseurs, des fermes d’aspect fort peu réjouissant, par-ci par-là des tentes arabes, des troupeaux.
J’aperçois des huttes de feuillage pressées en tas, aux trois quarts défoncées, misérables, roussies ; alentour, un rempart de ronces coupées ou de cactus ; au milieu de tout cela des femmes sales, des enfants nus, des chiens hargneux, quelques hommes couchés ; c’est un douar.
La portion de la plaine que nous découvrons au matin, ensevelie sous des brouillards rampants, ressemble à un grand lac. Sur l’autre rive se dressent les premières chaînes de l’Atlas, masse uniforme, imposante, de contours nobles, et qui devient gigantesque vers la Kabylie. Là se découpent les crêtes sauvages du Djurjura. Sous les rayons naissants du soleil, elles ont d’abord des tons roses très radieux ; le gros du massif est violacé, d’une transparence inimitable : on dirait une vapeur, une nébulosité éclairée par derrière. Le fond du ciel est éblouissant de pourpre et d’or. Le soleil monte, la lumière blanche inonde les cimes, accuse les reliefs. La trame vaporeuse s’évanouit, le mont colossal apparaît majestueux, sinistre, ruisselant de clartés. Ce lever de soleil est une Orientale ; pour l’étranger c’est une révélation : on s’est toujours figuré que ces couleurs existent seulement dans la fantaisie des peintres.
D’Alger à Blida la route est très parcourue, en dépit du chemin de fer. Toute la vie de la province circule par cette artère. On y voit défiler les indigènes de toutes les régions : le berger des Aribs y pousse son troupeau galopant, lui-même d’un jarret infatigable détale en arrière avec de grands cris ; le montagnard y mène ses mulets chargés de fagots énormes, d’un maigre jardinage, d’outres pleines, battant dans de larges couffes. De petits ânes innombrables écrasés de fardeaux, avec l’ânier en surcroît, s’en vont résignés, trottant leur petit amble serré, soutenu ; la cruelle matraque résonne sur leur croupe amaigrie, leur flanc saigne sous les harnais grossiers, et l’Arabe, pour activer l’allure, fourrage dans ces plaies béantes. On l’a dit, l’Afrique est le purgatoire des ânes, l’enfer des femmes. Pour confirmer ce dernier point, voici des familles en marche : le père, les garçons se prélassent sur les bêtes de somme, fument et devisent nonchalamment ; les femmes vieilles et jeunes, suivent, courbées, l’œil bas, s’appuyant sur un long bâton, ployant sous le faix de leur marmaille. Il passe de longues caravanes du Sud, qui vont échanger leurs laines ou reviennent chargées de grains ; les chameaux roux, indolents et pressés, balancent leur long cou tendu en avant, s’arrêtent, se croisent, s’entassent, ne s’effrayant de rien et toujours gémissants. Les chameliers, leurs longs mouckalas sur l’épaule, leur parlent une langue étrange accompagnée de coups redoublés.
Tout cela révèle un peuple nomade, et son incurable paresse ne se montre aucunement dans ce va-et-vient pittoresque. Pour l’Arabe le déplacement n’est pas un travail ; il y trouve un charme singulier ; tout lui est prétexte à voyager. Pour une consultation puérile au bureau arabe, il entreprend des pérégrinations insensées sans vivres, bien entendu sans argent : en eût-il, il ne le dépenserait pas. Nous en rencontrons qui portent pour cinq ou six sous de marchandises, quelques herbes, du charbon, une souche ; ils font quinze lieues pour aller vendre à Alger ce modeste butin, marchant jour et nuit. L’âne broute les ronces du fossé, la charge au dos, l’homme avec son flissa déterre quelques racines, avale une gorgée d’eau à chaque ruisseau, fait de petites siestes au soleil, et rentre avec le produit intégral de son trafic. Il y a même de simples touristes qui marchent non pour voir, ils ne regardent rien, mais pour marcher, mendiants, braconniers, maraudeurs, vrais bohèmes en proie à une horreur instinctive de la vie sédentaire, à une aversion plus grande encore pour toute espèce d’industrie. Ce sont les gens les moins pratiques qu’il y ait sous le soleil : ils font sans profit pour eux, au détriment de la colonie, un méfier à tuer en quatre jours un facteur rural. Qu’on les arrête, qu’on les mette dans des chantiers au grand air, avec une pioche et de bonnes rations bien réglées, ils prennent une figure résignée, font le moins qu’ils peuvent de besogne et s’évadent un beau matin. La souffrance, la maladie ne sauraient davantage les fixer : ils se font surprendre par la mort au fond d’un ravin, où leurs corps deviennent la proie des chacals.
Le nombre de ces réfractaires s’est beaucoup accru dans ces derniers temps. Est-ce la cause ou la conséquence de la famine ? Le fait est là. Le fléau se dresse à chaque pas devant nous, sombre et navrant. Qui reconnaîtrait les fils d’une race vaillante et martiale dans ces passants décharnés traînant comme des suaires leurs burnouss éraillés ? Voilà donc l’habitant de cette contrée sereine qui déploie autour de nous sa parure et son exubérance ! Contraste saisissant ! C’est un des premiers désenchantements de ce pays où la nature, sous ses grâces caressantes, est marâtre pour ses enfants, comme une vieille coquette. Elle les élève dans les langueurs d’un ciel sans nuages, leur infuse l’apathie et la volupté dans les veines, les confine sous ses tièdes ombrages, les pétrit à la contemplation, à la mollesse, et finalement leur refuse le pain journalier. Plus cruelle encore par instants, elle fait fondre sur eux toutes les calamités, les sauterelles dévorantes, les longues sécheresses, la disette, le choléra, la peste.
Tout un peuple de fantômes circule par ce chemin. Nous voyons passer comme des ombres ces paysans hébétés par le jeûne, lents, taciturnes, affaissés sur leurs membres vacillants, les jambes nues, sales, amaigries, déchirées. Les os semblent trouer leurs guenilles ; on les dirait vêtus de toiles d’araignée. La vermine les dévore au-dehors, la faim au-dedans. Ils ont, avec leurs longs liras, des allures simianes. Comme la bête, ils sont sans pudeur, sans dignité de maintien, indifférents, mornes, sans paroles. Ils n’entendent venir ni les chevaux ni les voitures, malgré les cris, et pour les écarter de son passage il faut les battre ; alors ils courbent l’échine sans maugréer, humbles, peureux, avilis.
Il y a pire, il y a l’écume de cette écume, infirmes, vagabonds, estropiés, orphelins, prostituées, vieillards, lie impure, douloureuse, racolée aux abords des villes. Ceux-là n’ont rien, pas même de vêtements quelquefois. On ne peut guère compter sur le travail pour les relever d’une telle abjection : leurs mains débiles, leurs âmes ramollies ne comportent plus aucun effort ; tout ressort est usé en eux. On les parque, on leur distribue chaque jour un quart de pain de munition, juste pour ne pas mourir, et quand il y en a trop, on les renvoie entre deux files de soldats dans leur patrie ingrate. On les appelle des mesquinos. J’en ai vu à Alger des bandes horribles. Il y avait des haillons dignes de Callot, des têtes émaciées de fakirs, des cas monstrueux d’éléphantiasis, des plaies bizarres. Une seule femme traînait ou portait jusqu’à cinq enfants. Je me rappelle un adolescent très blanc, grêle, à l’air doux : il portait son père comme on porte un sac ; les bras et la tête du vieux lui pendaient sur la poitrine, les jambes dans les reins ; le pauvre être écrasé sous ces ossements, se soutenait à peine. Le plus effrayant était le silence de ces déshérités. Les figures exprimaient l’abattement, la prostration, l’indifférence, non la douleur ; les tout petits seuls geignaient lamentablement sur le sein tari des femmes. La population d’Alger, qui hait cette engeance, paraissait oppressée devant ce spectacle, comme par un remords. Les zouaves d’escorte, hommes aux façons dures, semblaient avoir mis leur rudesse de côté ; ils s’arrêtaient volontiers, soutenaient les traînards ; l’un d’eux portait un enfant et, grave, laissait le marmot familier lui caresser la barbe. C’était une grande pitié.
Près de Douéra nous rencontrons une de ces bandes. J’entends un gaillard à la mine éveillée, qui parle français. Je lui fais la remontrance habituelle :
– Que ne travailles-tu ?
Il me répond que c’est en cherchant de l’ouvrage qu’il s’est fait ramasser par la police. C’est leur refrain, dit-on. Pourtant, c’est possible.
À la queue du convoi sont les femmes, les filles, et sur les mulets des cacolets chargés de petits enfants, pauvres créatures innocentes des vices paternels. L’enfant arabe est toujours joli ; ceux-ci paraissent beaux dans leur infortune prématurée. Cette injustice du sort est poignante. Nous savons ce qu’il meurt de ces générations en herbe. Sur un convoi de soixante enfants, neuf sont morts à la première étape, ayant été surpris par un orage sur la grande route. J’en ai vu mourir un sur un omnibus ; on l’avait ramassé par pitié dans le fossé. Partout dans la montagne on trouve de ces petits cadavres près des sentiers. Quand on fait l’autopsie, on ne découvre rien dans l’estomac. On ne sait qui ils sont. Leurs parents sont morts, la tribu les a chassés ; ils ne sont pas mûrs pour la vie sauvage, et succombent. Je considère tristement cet équipage mené par des hommes du train. Y a-t-il réellement des destinées maudîtes, une réprobation divine et des races condamnées sans merci ? Est-ce là le fruit du fatalisme ou de l’implacable loi des sélections ? La réponse est peut-être dans l’œil de ce petit Maure, fixe, grand ouvert, démesurément agrandi par la maigreur du visage.
Une petite fille se détache du groupe et vient prendre le pas de mon cheval. Elle s’est composé un air dolent, et me tend sa main ouverte.
– Sidi, toi bono, me dit-elle tout en courant, moi makach mandgearia, moi mesquino…
– Et ton père ?
– Morto !
– Ta mère ?
– Morto !
Et redoublant de larmes, elle ajoute :
– Moi kif kif morto ! (C’est comme si j’étais morte aussi.)
Il existe un jouet bien connu qui consiste en menus objets de bois figurant des arbres, des maisons toutes pareilles, une église et divers bonshommes, le tout d’une naïveté très comique. Le bambin, heureux possesseur de la boîte, en retire avec amour chaque pièce qu’il dispose symétriquement. L’église est au milieu entourée d’arbres ; les maisons bien alignées forment de petites rues où se tiennent gravement des personnages dépourvus de jambes. C’est l’image exacte d’un village algérien.
Imaginez une cinquantaine de maisons exiguës, carrées, avec un étage surmonté d’un toit rouge, toutes semblables, toutes contemporaines, toutes flanquées du même jardin, du même platane et d’une enseigne de cabaretier. Point de ces annexes, de ces petites constructions édifiées peu à peu, comme dans nos communes, à mesure que la famille, le cheptel, la prospérité se sont accrus. Aucune extension domestique n’a encore produit ce besoin. L’étroit espace assigné dès le début au colon lui suffit et au-delà. En maint endroit les herbes sauvages envahissent le champ, et semblent revendiquer leurs anciens droits. On a le spectacle désolant de quelque chose de neuf qui menace ruine ; déjà quelques demeures écroulées n’ont pas été rebâties : elles servent d’asile à des familles parasites d’Arabes installées là comme des rats dans les décombres. Ce neuf garde un air de propreté qui en augmente la tristesse. Rien ne vit. Les arbres n’ont pas grandi. Le soleil refoule la population dans les intérieurs. C’est une nécropole sans grandeur, sans poésie, une ville morte avant d’avoir vécu. Je parlais de tristesse, c’est plutôt l’ennui qu’exhale ce séjour morose et ridicule. L’église, d’un affreux style espagnol, est de pure formalité : on sent qu’il n’y a rien de ce côté. La foi ne naît pas dans de pareils édifices, bien plutôt elle y mourrait. Le curé l’air d’un zouave. Il y a un culte régulier, et c’est out. Je me demande ce qui peut ici attacher des hommes, quelles racines une société peut avoir enfoncées dans ce sol. Je pense que chaque habitant rêve l’exil comme une délivrance. Triste sort que celui du colon ; sans parler de ses luttes contre mille obstacles, comme la terre rebelle, les intempéries, les catastrophes ; il faut qu’il se passe de traditions, de souvenirs, de ces nombreuses parentés, de tous ces liens qui font la vraie patrie. Une nationalité ne se fonde pas en un jour. La patrie algérienne n’existe pas. Le colon n’est qu’un soldat ; en a les traits, l’énergie, les vices.
Ces réflexions peuvent s’appliquer à Douéra ; mais du moins le pays est excellent : il y a, comme on dit, de ressource. Plus avant, dans l’intérieur, on a fait bâtir de ces villages par le génie militaire ; on y a mis tout ce qu’on a pu, même des habitants ; mais la vie s’en tire tous les jours. J’en ai vu un dans la montagne, il appelle Bir-bab-allou. Il n’y reste pas quatre familles.
Le tremblement de terre a renversé les maisons, les sauterelles ont mangé les plantes, la sécheresse a tari les sources, le choléra a frappé la moitié de la population ; le reste s’est enfui. Sauf quelques Juifs, un café maure deux fermes, il n’y a plus rien. J’oubliais un grand cimetière entouré d’arbres morts.
Ces désastres, ce dépeuplement sont les bonnes fortunes de l’Arabe. Il excelle à tirer parti de nos reliefs, ivre de nos miettes. La ferme abandonnée devient proie. Loin de lui la pensée de la restaurer, de l’entretenir seulement. Comme on le laisserait faire volontiers ! Au contraire, il la laisse crouler avec amour ; il brûle les portes, les fenêtres, s’y arrête un temps et repart, ne laissant pour toutes traces que des immondices. Vous est-il arrivé, croyant surprendre une jolie couvée dans un nid coquet, d’y trouver un tas d’insectes noirs et grouillants ? Tel est l’Arabe vagabond dans la maison délaissée. Autant il a de style, de couleur dans son douar enfumé, autant le cadre d’une demeure blanche et correcte le rend hideux et repoussant. C’est le cas de dire : Chacun chez soi.
Les villages ont leurs destins. En voici un, Boufarik, qui par hasard a réussi, et auquel semblait promis un sort tout autre. C’était encore, il y a quinze ans, le point de la plaine le plus marécageux et le plus pestilentiel. Une végétation perfide cachait le sol vaseux d’où s’exhalait la fièvre en émanations subtiles. Des miasmes terribles, prompts, implacables, couchèrent sans merci les hôtes aventureux qu’attiraient là l’abondance de l’eau et tant de sourires trompeurs. Le voyageur lui-même était frappé au passage. Jamais lieu plus charmant ne fut plus redoutable et n’opposa une résistance plus tenace, plus cruelle à la conquête de l’homme. Combien périrent dans cette lutte sourde contre un insaisissable ennemi ? Cette statistique ferait frémir. Peut-être n’existe-t-il plus quatre personnes qui puissent raconter ces combats douloureux et sans éclat où la victoire pourtant est restée au colon. Ici, au moins, ce soldat de la paix peut maintenant se regarder à bon droit comme chez lui, à des titres autrement respectables que la force des armes. Il a creusé, drainé, comblé, canalisé, créé tout un système de circulation pour cette eau meurtrière devenue ainsi bienfaisante. C’était là le grand assaut : ces marais déjà dangereux, une fois troublés, remués dans leurs profondeurs, devenaient inabordables et répandaient non plus la fièvre, mais la mort foudroyante. On tint bon et la place fut enlevée. Alors se dressèrent de tous côtés des jardins, des cottages, de belles allées ; on vit pousser comme par enchantement les trembles, les platanes, versant l’ombre sur de frais canaux. Le village fut bâti suivant un plan élégant et nullement mesquin ; toutes les cultures réussirent. La confiance gagna les populations voisines qui vinrent peu à peu grossir le noyau décimé des premiers occupants. Il y eut de sages administrateurs qui surent faire la part du sentiment dans des questions municipales, c’est-à-dire qu’ils ne ménagèrent ni l’espace, ni la dépense pour embellir les promenades, égayer les rues, charmer la vue, moyens excellents d’exciter et d’entretenir l’amour-propre local et l’affection au pays. Aujourd’hui le marché de Boufarik est le plus important de tout le Tell, et sa fête patronale où ma bonne étoile m’a conduit l’année dernière, remporte sur les plus belles des environs de Paris. On peut prédire à cet ancien cloaque l’avenir d’une grande ville. Pourquoi faut-il que ce soit là une exception ?





























