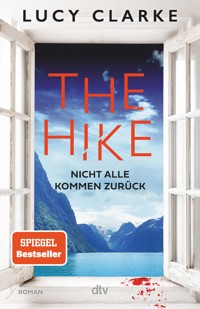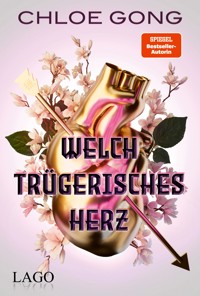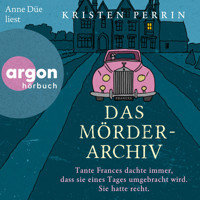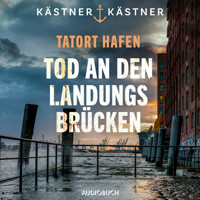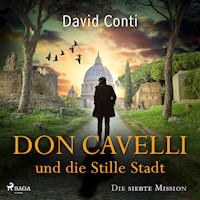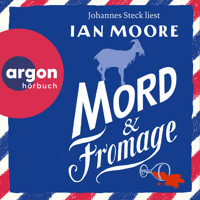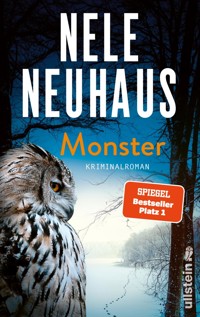Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Geste Éditions
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Dans un milieu rural hostile, l'inspecteur Castellon essaie de faire progresser son enquête au sujet d'une paysan assassiné.
Un paysan est retrouvé assassiné dans un bois. Lorsque l’inspecteur Castellon prend en charge le dossier, un suspect est déjà inculpé, c’est André Roure, un jeune Réunionnais. Le policier s’interroge sur cette conclusion aussi rapide avec une culpabilité qui arrange tout le monde. L’enquête progressera de rebondissement en rebondissement dans un milieu hostile, peu ouvert à la confidence.Un retour dans la Creuse des années soixante qui hésite entre progrès et conservatisme. Les foires rythment la vie rurale, les réseaux publics d’eau potable ne desservent pas encore toute la population, les tracteurs et les diverses machines agricoles modernes apparaissent aux côtés des chevaux et des boeufs.
Afin de réduire les effets de l’exode rural qui saigne les campagnes, les autorités font appel à des enfants originaires de l’île de la Réunion.
Afin de réduire les effets de l’exode rural qui saigne les campagnes, les autorités font appel à des enfants originaires de l’île de la Réunion. L'auteur du crime est-il bien le jeune Réunionnais inculpé ?
EXTRAIT
Le rapport du médecin légiste et le PV des constatations de la scène du crime n’apportaient pas beaucoup d’informations, du fait qu’un violent orage avait éclaté avant l’arrivée des spécialistes, emportant toutes les traces et les indices. La victime avait été retrouvée couchée sur le ventre avec une large plaie dans l’abdomen, le poignet droit cassé et une fracture à l’arrière du crâne. Le rapport du médecin légiste mentionnait que la blessure dans le bas-ventre avait provoqué la mort en vidant la victime de son sang. Pour l’arme, le rapport d’autopsie émettait l’hypothèse d’une hache ou d’un coupe-coupe. L’heure du crime était estimée au milieu de l’après-midi, aux alentours de 15 ou 16 heures.
Ce jour-là, Maxime Ténégrier travaillait dans ce bosquet depuis 14 h 30 afin de préparer une coupe de sapins prévue dans les jours suivants.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jacques Jung est retraité d’une carrière dans la fonction publique au service de la défense du consommateur, il a également exercé les activités de correspondant de presse et de chroniqueur radio. L’auteur a déjà publié un roman historique
« La Brême d’Or » sur l’histoire tourmentée d’une famille en Moselle. Ce roman figurait dans la première sélection du Goncourt lorrain 2013 (prix Erckmann-Chatrian). Il vit à Saint-Gély-du-Fesc (34).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VENGEANCES
EN CREUSE
Collection dirigée par Thierry Lucas
© 2016 – Geste éditions – 79260 La Crèche
Tous droits réservés pour tous pays
www.gesteditions.com
Jacques JUNG
VENGEANCES
EN CREUSE
Avant-propos
La décennie des années soixante est souvent magnifiée par ceux qui ne l’ont pas connue et regrettée par certains nostalgiques. Ébranlée par la guerre d’Algérie, la France connaît un développement économique sans précédent, avec une industrie consommatrice de main-d’œuvre. L’exode des jeunes saigne les départements ruraux comme la Creuse où ces nouvelles générations rêvent de confort moderne et de distractions citadines.
À La Réunion, nombreux sont les enfants que leurs familles pauvres peinent à nourrir, et les autorités éprouvent des difficultés pour assurer leur enseignement. La solution envisagée est alors de les soustraire de leur environnement afin de les scolariser tout en repeuplant certaines campagnes de la métropole. Une idée généreuse au départ dont la mise en application va parfois se traduire par des souffrances et des drames.
1 615 enfants seront ainsi exilés entre 1963 et 1982.
Avertissement
Ce roman est une pure fiction : le crime ainsi que l’enquête policière qui y sont relatés n’ont jamais existé et toute ressemblance avec la réalité ou avec des personnes vivantes ou ayant vécu serait pure coïncidence et totalement fortuite.
Il n’existe aucun lien entre les lieux et les événements décrits.
Le récit sur la vie quotidienne d’André Roure s’inspire de témoignages d’enfants réunionnais déplacés en métropole, témoignages mentionnés dans la bibliographie en fin d’ouvrage.
Jeudi 4 septembre 1969
L’inspecteur Diégo Castellon était un flic bien noté. Âgé de 39 ans, il avait beaucoup de charme avec son physique méditerranéen typé, son mètre quatre-vingt et son visage qui rappelait celui du chanteur Mick Jagger. À la PJ de Limoges où il était affecté depuis douze ans, ses supérieurs lui attribuaient toujours les enquêtes les plus délicates.
Fils unique, né dans un petit village andalou des environs d’Albacete, Diégo était arrivé à l’âge de 2 ans à Clermont-Ferrand, où son père venait d’être embauché chez Michelin. Après des études secondaires au lycée Blaise-Pascal, il entama un DEUG de droit avant d’entrer dans la police en septembre 1952. Affecté à Troyes, il rencontra Henriette, ouvrière dans la bonneterie. Le couple resta sans enfant et s’installa à Limoges en 1957 à la suite d’une demande de mutation formulée par Diégo qui souhaitait se rapprocher de ses parents. À peine arrivés, ils firent construire une petite villa à Panazol, dans la proche banlieue de Limoges. L’inspecteur recherchait avant tout la stabilité, il préféra se fixer dans une ville, au détriment de sa carrière. Toujours sans enfant, Henriette ne s’adapta pas à la région. Pour tromper l’ennui, elle devint serveuse dans un restaurant, mais rapidement elle s’enferma dans une longue dépression. Petit à petit, les horaires de travail décalés éloignèrent les époux qui vécurent chacun des aventures sans lendemain. Le divorce fut prononcé au mois de juillet 1969 et la maison de Panazol vendue rapidement. Henriette retourna à Troyes et Diégo s’installa dans un appartement vieillot du centre-ville de Limoges, boulevard Gambetta.
L’inspecteur Castellon n’était donc pas au mieux de sa forme ce jeudi matin 4 septembre 1969, lorsque son chef, le commissaire Peuleux, entra dans son bureau, un volumineux dossier sous le bras. Comme il était court sur pattes, le dossier n’en paraissait que plus imposant. Depuis son passage au grade de commissaire, Peuleux avait tendance à s’encroûter, son visage s’épaississait, son tour de taille s’arrondissait au même rythme que sa trouille, à tel point qu’on le surnommait « le petit père peureux ». Diégo Castellon ne se doutait pas encore que l’enquête qui allait lui être attribuée ce jour-là resterait le seul véritable échec de toute sa carrière.
— Bonjour, inspecteur, vos vacances se sont-elles bien passées ?
— Bof ! Je suis resté ici pour régler des formalités à la suite de mon divorce.
— Eh bien, voilà qui tombe bien mon ami, vous allez voyager un peu !
Il posa le pavé sur le bureau et tapota dessus avec son index :
— J’ai là un dossier qui devrait vous intéresser, il s’agit d’un crime dans la Creuse. Les gendarmes ont arrêté un suspect : il est passé aux aveux pendant sa garde à vue, mais il s’est ensuite rétracté devant le juge d’instruction. Comme ils manquent de preuves, ils nous demandent de compléter l’instruction. Un petit tour à la campagne vous fera le plus grand bien et vous fera un peu oublier vos ennuis conjugaux.
— Je vais regarder ça. Je dois laisser tomber le reste des affaires en cours, je suppose ?
— Oui, je vais les répartir entre vos collègues, un crime c’est plus important. Ce sera rapide, l’affaire est a priori bouclée, il ne s’agit que d’apporter un complément d’information. Vous reviendrez me voir après avoir pris connaissance du dossier.
La découverte d’une nouvelle enquête criminelle passionnait toujours Diégo, il était fait pour ce métier, et celle que venait de lui confier son commissaire lui fit immédiatement oublier tous ses tracas. Cette fois-ci encore plus que d’habitude, il était disposé à se jeter dans le travail, à tourner la page de ses soucis qui le dévoraient. Il ouvrit le classeur avec gourmandise.
La victime se nommait Maxime Ténégrier, il était agriculteur dans les environs de Chénérailles, un chef-lieu de canton de 840 âmes à 18 km de la petite sous-préfecture d’Aubusson. Le cadavre avait été découvert par son fils aîné Gustave le samedi 12 août vers 16 h 30, dans un bosquet des environs de sa ferme. Il avait 46 ans. Originaire de la Corrèze, il avait épousé en 1950 la fille de la maison, Sophie Lagace, du même âge, fille de Léon et Germaine Lagace. De leur union étaient nés deux garçons, Gustave, en 1952, et Antoine, en 1958. En 1961, Maxime Ténégrier avait pris la direction de l’exploitation, lorsque le beau-père avait perdu ses forces et ne pouvait plus travailler.
Le rapport du médecin légiste et le PV des constatations de la scène du crime n’apportaient pas beaucoup d’informations, du fait qu’un violent orage avait éclaté avant l’arrivée des spécialistes, emportant toutes les traces et les indices. La victime avait été retrouvée couchée sur le ventre avec une large plaie dans l’abdomen, le poignet droit cassé et une fracture à l’arrière du crâne. Le rapport du médecin légiste mentionnait que la blessure dans le bas-ventre avait provoqué la mort en vidant la victime de son sang. Pour l’arme, le rapport d’autopsie émettait l’hypothèse d’une hache ou d’un coupe-coupe. L’heure du crime était estimée au milieu de l’après-midi, aux alentours de 15 ou 16 heures.
Ce jour-là, Maxime Ténégrier travaillait dans ce bosquet depuis 14 h 30 afin de préparer une coupe de sapins prévue dans les jours suivants.
Deux gendarmes avaient arrêté un suspect lundi 14 août en milieu de matinée, dans le garage de Montluçon où il travaillait. Les militaires l’avaient transporté immédiatement à la brigade de Chénérailles. Il s’agissait d’André Roure, né le 20 juin 1948 dans le quartier « La Source » à Saint-Denis-de-la-Réunion.
Les procès-verbaux établis lors de sa garde à vue étaient longs, ils reproduisaient avec précision les déclarations du jeune homme sur sa vie antérieure. D’une extrême pauvreté, la famille Roure vivait avec ses huit enfants dans une case sans confort, sans eau ni électricité, gorgée de boue lors des grosses pluies. Le père, Robert, réparateur de vélos, apportait un maigre salaire et proposait souvent ses services dans les plantations de bananes et de cannes à sucre pour améliorer l’ordinaire. La mère, Francette, brisée par le poids du ménage, limitait l’éducation à d’incessantes réprimandes. Les contraintes quotidiennes laissaient peu de place à l’instruction et les gamins ne se rendaient à l’école que lorsqu’ils en trouvaient le temps et en ressentaient l’envie. Dans l’une de ses déclarations, le jeune homme avait insisté sur la solidité des liens qui unissaient cette famille, liens que les difficultés avaient encore renforcés. « À défaut d’être exprimés, ils n’en étaient pas moins bien réels »,avait-il mentionné. Puis tout bascula avec le décès du père, renversé par une voiture.
Le second procès-verbal d’audition était consacré à l’arrivée d’André Roure en métropole. Ce dernier avait déclaré :
« Les services sociaux ont estimé que ma mère ne pourrait plus assurer l’éducation des huit enfants et, un jour de novembre 1963, deux fonctionnaires, un homme et une femme, sont venus nous chercher, mon frère Michel et moi, pour nous envoyer en métropole où nous serions pris en charge par des familles. Nous étions censés revenir à La Réunion chaque année pour les grandes vacances scolaires. L’État devait particulièrement veiller à notre scolarité et, si nous en avions les capacités, faire en sorte qu’on poursuive jusqu’au bac et même à l’Université. Ma mère était tellement impressionnée devant ces personnes élégantes qui employaient des termes qu’elle ne comprenait pas toujours ! Je la vois encore, toute tremblante, en train d’enserrer dans son poing fermé l’élégant stylo à plume tendu par l’homme ; avec beaucoup d’attention, elle l’avait maintenu bien droit au-dessus du formulaire pour tracer maladroitement une croix dans la case indiquée.
Le gendarme :
— Ta mère était soulagée, deux bouches en moins à nourrir !
— Non, pas du tout, elle rêvait d’une vie meilleure pour nous, elle ne pensait pas nous abandonner ; au contraire, elle prenait la bonne décision pour notre avenir, c’était une chance à saisir pour ses enfants. »
La lecture de ce passage intrigua l’inspecteur. Pourquoi tant de précisions ? Quelle richesse de détails pour des faits qui remontaient à six ans ! Que de sentiments exposés dans cette déclaration ! Des regrets, de l’amour ! Pourquoi raconter tout ça à des gendarmes quand on est soupçonné de meurtre après tant d’années ?
André Roure avait expliqué ensuite qu’il s’était retrouvé à Guéret après un voyage épuisant, séparé de son frère sans la moindre explication, complètement désorienté, paralysé par le froid à sa descente d’avion, dérouté par le décor lugubre qu’il découvrait par la fenêtre du train tiré par un monstre fumant, un paysage fait d’arbres nus, de brume, d’habitations d’où s’échappaient des halots de fumée. Le voyage se termina à bord d’un autorail aux sièges en Skaï inconfortables.
Toujours avec force et émotion, il décrivait la manière dont il avait perçu son arrivée dans la famille Ténégrier.
« Dehors, les gens avaient de la vapeur qui sortait de leur bouche, un grand bonhomme m’attendait à la gare.
— C’était Maxime Ténégrier. Comment s’est passée cette première rencontre ? avait demandé l’enquêteur.
— Je m’en souviens parfaitement : lorsque nous sommes montés dans le car, tous les regards se sont tournés vers moi, je revois une femme obèse se redresser sur son siège pour mieux me dévisager. Sans doute parce que je suis noir. Le voyage s’est terminé de nuit, à bord d’une carriole tirée par un cheval. Ses sabots claquaient sur le goudron, sa crinière flottait dans l’air, il soufflait d’énormes bouffées de vapeur, comme une locomotive. Il gelait, je frissonnais, mon nez coulait, mes doigts étaient engourdis, mes oreilles brûlaient. En descendant de la charrette, j’ai glissé, je suis tombé, je n’avais jamais vu de verglas. »
Muet sur la vie d’André dans la ferme et sur la famille Ténégrier, le rapport de la gendarmerie évoquait en demi-teinte l’ingratitude du jeune homme qui dénigrait le pays et la famille qui avaient eu la bonté de l’accueillir pour lui donner sa chance.
Le suspect avait été longuement questionné sur ses fugues : pourquoi fuir alors qu’il était accueilli ? Pour aller où ? Pour faire quoi ? Il avait volé de l’argent, un vélo pour se rendre à la gare. Il était devenu violent et dangereux à tel point qu’il avait été interné. Une large place était laissée au rapport de l’administration de la DDASS, dont la conclusion présentait André en individu irresponsable et dangereux, un comportement qui avait justifié son internement à l’hôpital psychiatrique de Saint-Vaury le jeudi 10 décembre 1964. « Rétif à toute vie sociale », indiquait son dossier. Le jeune garçon était aussi présenté comme instable, « une graine de délinquance ». Les enquêteurs avaient saisi la balle au bond et ne l’avaient plus lâché en revenant sans cesse sur ce passé mouvementé pour le pousser à avouer le crime.
Une seconde famille avait accueilli André à sa sortie de l’hôpital psychiatrique, Raymond et Fernande Lebon, un couple sans enfant qui avait fini par l’adopter. Le 1er août 1967, André avait commencé son service militaire dans le génie à Illkirch-Graffenstaden, en Alsace. Il avait été affecté à l’entretien des camions et un sous-officier l’avait formé aux bases de la mécanique. À sa libération, il avait été embauché par Victor Lenoir, un garagiste de Montluçon. Depuis, il vivait seul dans un petit appartement situé rue de la République dans cette ville. Un mois avant le crime, il avait acheté une vieille Alfa Romeo « Giulietta Sprint » coupé de 1955 et mis ses talents de mécanicien à profit pour la trafiquer et la faire ressembler à un coupé sportif de luxe.
Les déclarations recueillies par la police de Montluçon auprès du couple Lebon et de la famille Lenoir étaient plutôt élogieuses, elles le qualifiaient de serviable et travailleur. Par contre, dans les bars du quartier, il était connu pour abuser de la boisson ; il pouvait alors devenir violent et proférer des menaces à l’encontre de certaines personnes. Le nom de Ténégrier avait parfois été entendu en de telles circonstances.
Le rapport de l’expert psychiatre dépeignait un individu instable, vindicatif, en guerre contre la Terre entière et surtout contre la métropole, porté sur l’alcool. Il pouvait être violent et dangereux.
Après vingt heures de garde à vue, André Roure avait avoué le crime du fermier, des aveux sur lesquels il était revenu dès son inculpation1. Il avait apporté un alibi confirmé par un témoin qui l’avait vu à Toulx-Sainte-Croix le jour du crime, ce qui avait décidé le juge d’instruction à demander un complément d’enquête.
L’inspecteur referma l’épais dossier, il en savait suffisamment pour en parler à son chef.
— Alors, que pensez-vous de cette affaire ? fit le commissaire Peuleux en nettoyant ses grosses lunettes avec son mouchoir. Pour moi, c’est tout vu, le gars a avoué et il regrette ses aveux, mais ça ne peut être que lui. Il a un mauvais fond, avec son ressentiment, il est en guerre contre tout le monde, et en plus avec ses fugues à répétition, ses vols, ses crises de folie, il ne s’agira pour vous que de compléter certains aspects pour que le juge d’instruction soit content. Moi, je pense que cette histoire de Toulx-Sainte-Croix ne tient pas la route. Vérifiez bien les heures et la moralité du témoin.
— C’est à voir, il y a effectivement le témoignage à vérifier, mais des volets de l’enquête manquent aussi. Pourquoi n’y a-t-il rien d’indiqué sur la vie du suspect lorsqu’il vivait chez les Ténégrier ? C’est étrange, surtout quand on lit la déclaration d’André Roure aussi détaillée sur son arrivée ! Il ne dit pas un mot non plus sur le fermier qui est venu l’accueillir, ce n’est pas normal ça !
— Oui, oh là là, ne vous emballez pas, ça, c’est le comportement du suspect !
— Oui, eh bien moi, j’aimerais bien retrouver les assistantes sociales qui se trouvaient dans cette gare, ce jour-là. Le paysan n’était pas seul. Ensuite, d’après l’enquête, il aurait critiqué les Ténégrier, mais rien de précis ne figure là-dessus dans les PV. C’est étrange, s’il avait des choses graves à reprocher à la victime, ça pourrait être le mobile du crime. Alors pourquoi en aurait-il parlé ? Il aurait dû se taire, se sachant le suspect no 1.
— Justement, ça prouve qu’il n’est pas très malin.
— Je m’étonne aussi de ne rien voir dans le dossier sur Sophie, la femme du mort. C’est quand même bizarre qu’on n’ait pas rapporté ses déclarations. Le juge d’instruction a raison de vouloir approfondir l’enquête.
— À vous de la rencontrer, le juge demande des informations complémentaires, ce qui n’a pas été fait comme il faut.
— Et puis, si on ne parle pas de la vie à la ferme, c’est qu’elle n’a pas été comme cela avait été promis à sa mère. Il faut quand même creuser et connaître les relations que le suspect entretenait avec les Ténégrier, et notamment Maxime, pour comprendre ses motivations, il faut en savoir plus là-dessus. S’il a par exemple été maltraité, ce serait important de le savoir.
— Écoutez, Castellon, opposa le commissaire calé dans son fauteuil. Ne commencez pas à m’emmerder, vous êtes toujours en train de fouiller la botte de paille pour y trouver le brin différent des autres. Vous êtes un formidable enquêteur, mais vous n’êtes pas diplomate, mon vieux, ne cherchez pas les embrouilles ; ces problèmes, il faut les cacher sous le tapis. C’est politique cette histoire, vous comprenez, les gouvernements successifs ont fait venir à la métropole des enfants déshérités de La Réunion pour les éduquer, leur apprendre un métier, ce qu’ils ne pouvaient pas faire dans leur île. Ça avait été décidé au plus haut niveau de l’État, alors ne vous occupez pas de ça, c’est pas notre problème.
— Tenez, encore un indice : je me demande bien pourquoi il n’y a rien sur sa scolarité. Je pense qu’il n’est pas allé à l’école, contrairement à ce qui avait été promis à sa mère. Dans ce dossier, on n’a pas défini clairement le mobile.
— Je me fous de ce que vous pensez, il était dans la misère à La Réunion, il est venu ici et il a été formé pour devenir mécanicien. La France a rempli son contrat, voilà la réalité, ou du moins la seule que je veux entendre. Que cette formation ait été dispensée du temps où il était chez les Ténégrier ou après, ce n’est pas mon problème, ni le vôtre. Quoi qu’il en soit, il avait dépassé l’âge de la scolarité obligatoire, je vous rappelle qu’elle a été portée à 16 ans pour ceux nés à partir de 53, pour les autres la limite était fixée à 14 ans. Vous me comprenez bien, Castellon, je ne veux pas de vagues et vous ne ferez aucune déclaration à la presse. Si vous êtes contacté par des journalistes, vous les renvoyez vers le juge d’instruction, nous, on ne se mêle pas de ça. Vous partez quand ?
— En début d’après-midi. Je vais retenir une chambre dans un hôtel.
De retour dans son bureau, Diégo marmonnait tout seul en secouant la tête :
— Eh bien, diplomate ou pas, moi je veux savoir ce que faisait cet André Roure à la ferme, où il vivait, quels étaient ses rapports avec les autres membres de la famille et si les paysans qui l’ont accueilli l’ont bien envoyé à l’école. On ne peut quand même pas établir sa culpabilité sans regarder ça !
L’inspecteur Diégo Castellon arriva à Chénérailles vers 18 heures, par la petite route sinueuse de Lavaveix-les-Mines. L’autoradio le saoulait avec Puppet On A String interprété par la chanteuse aux pieds nus Sandie Shaw, qui avait été lauréate au concours de l’Eurovision en 1968. L’hôtel où il avait retenu une chambre apparut au détour du premier virage, juste après le panneau annonçant l’entrée du bourg. Il déployait sa façade décrépie en bas de la place du champ de foire encombrée de manèges qui annonçaient la prochaine fête patronale. Diégo gara difficilement sa Panhard 24 BT entre un dancing installé pour la circonstance et des caravanes de forains. Cette fête présageait des nuits blanches, alors qu’il devait se concentrer sur son affaire pour la régler au plus vite. Il regretta de ne pas avoir choisi un hôtel à Aubusson ou à Gouzon. Un court moment, il hésita : dormir ailleurs ou rester ? Cette situation avait aussi son avantage, elle pourrait lui permettre de relever des informations intéressantes, et, de toute façon, demeurer sur les lieux de l’enquête ferait gagner du temps. Il se dirigea vers l’hôtel.
Il choisissait systématiquement les établissements mentionnés dans le Guide des Relais Routiers pour l’accueil et la simplicité de leur cuisine. Une jeune fille brune aux longs cheveux l’accueillit, vêtue d’un jean serré à pattes d’éléphant malgré la chaleur. Elle l’informa que le lavabo de la chambre était rempli en raison d’une pénurie d’eau. Il fallait donc la conserver pour la toilette du soir. L’eau courante n’était distribuée que jusque vers 11 heures du matin du fait de la sécheresse.
Une femme imposante aux cheveux courts apparut. C’était Monique, la patronne. S’excusant pour cette incommodité, fréquente en été, elle lui offrit la possibilité d’annuler sans frais sa réservation, ce que l’inspecteur refusa.
Avec son lit en fer, digne d’un dortoir de lycée ou d’une caserne, et son simple lavabo rempli d’eau surmonté d’une glace dont les pourtours biseautés étaient piqués en de nombreux endroits, la chambre était modeste, mais propre. Les W.-C. se trouvaient au milieu du couloir, un broc rempli du précieux liquide faisant fonction de chasse d’eau. Une pancarte indiquait : « Veuillez descendre le broc à l’accueil après usage pour remplissage. » L’hôtel avait la chance de disposer d’un puits qui fournissait de l’eau non potable. Pas de douche, donc, pour le soir – désagréable après un voyage dans une voiture surchauffée. Diégo rangea son véhicule dans une remise ouverte, bien pompeusement nommée garage, qui se trouvait au fond de la cour à l’arrière de l’hôtel. Il lut la carte publicitaire cartonnée de l’hôtel qu’il avait prise à la réception et sourit, car elle annonçait généreusement « chauffage central, eau chaude et froide ». Heureusement que nous sommes en été, pensa-t-il au sujet du chauffage.
Voilà pour les charmes de la campagne.
L’inspecteur appréciait le travail avec les gendarmes, les méthodes se complétaient et leur ancrage local apportait toujours une connaissance parfaite de la population et des usages. Sa valise posée, il se rendit à pied à la gendarmerie, distante seulement d’une centaine de mètres. Alors qu’il contournait le jardin public, des martinets et autres oiseaux l’accompagnaient en planant au-dessus des toits. Aucun bruit de véhicule ne vint perturber leur joyeux gazouillis durant le trajet et il savourait la sérénité de cette fin de journée d’été ensoleillée. La campagne renfermait aussi bien des agréments.
Le chef Georges Thierry l’attendait. Adjudant-chef était son grade exact. Bedonnant, engoncé dans un uniforme dont la taille n’avait pas eu la chance de suivre son embonpoint, la tête posée directement sur le tronc, car il n’avait pas de cou, il souleva son képi, laissant voir une masse de cheveux bruns, poivre et sel, dressés en brosse au-dessus d’un visage en forme de trapèze, ses deux yeux gris bleus scrutant Diégo derrière d’épaisses lunettes. Il l’accueillit de son accent rocailleux :
— Bienvenue, monsieur l’inspecteur, nous vous attendions avec impatience, mais je pense que l’affaire est déjà réglée, nous avons fait l’essentiel des constatations et je suis quelque peu étonné de la requête du juge d’instruction.
— Bonjour chef, fit Diégo en ôtant son chapeau, nous parlerons de l’affaire demain. Procédons par étapes. J’irai d’abord voir la scène du crime, puis j’en profiterai pour interroger la femme et les fils de la victime. Je dois me faire ma propre idée avant de vous en parler et je me rendrai d’abord sur les lieux. Le présumé coupable a-t-il été inculpé ?
— Oui, et le juge l’a mis en détention provisoire, on ne sait jamais avec ce genre d’énergumène.
— Son avocat n’a pas demandé sa mise en liberté ?
— Il n’est même pas venu, c’est un commis d’office.
Avant toute chose, l’inspecteur voulut visiter le village, rencontrer les habitants, parler avec eux, s’immerger dans la vie locale. Bien souvent, les gens de la campagne se méfient et rechignent à se livrer. Son plaisir à faire apparaître la vérité restait intact après toutes ces années dans la police et, loin de le décourager, ces difficultés rendaient sa tâche captivante. Il commençait toujours par s’imprégner de l’environnement du milieu du crime. Ensuite ou en même temps, il étudiait la psychologie des protagonistes, amis, membres de la famille. Sa première impression s’avérait toujours déterminante, il se trompait rarement, il cernait ses interlocuteurs dès les premières minutes. Aucune affaire ne ressemblait à une autre et la résolution d’une énigme devenait une sorte de jeu qui réclamait de la patience, de la méthode, du doigté. Et l’inspecteur en avait, du tact ! Contrairement à ce que prétendait son chef.
Sa montre indiquait 19 heures, le bourg était déjà endormi. Il entama sa découverte avec la grand-rue, éclairée de la lumière ocre que diffuse le soleil déclinant à la fin des chaudes journées d’été. Épiceries, coiffeurs, boulangers, bouchers, pharmacies, bars, drogueries, quincailleries, fleuristes, articles de confection, agences bancaires et d’autres encore se succédaient en enfilade de part et d’autre de la rue et dans les ruelles adjacentes. Arrivé devant l’église, il y entra pour admirer son haut relief, cité dans tous les guides. Cet édifice du xiiie