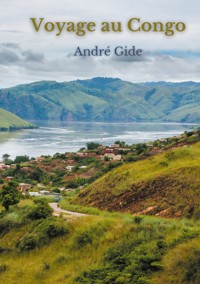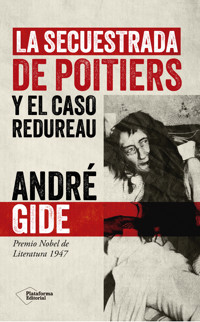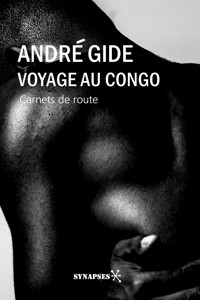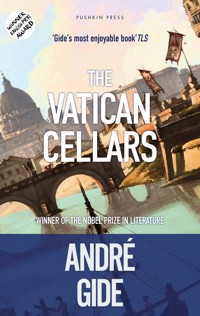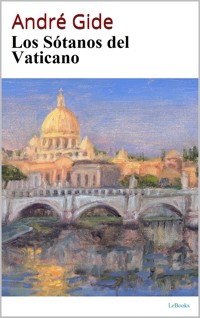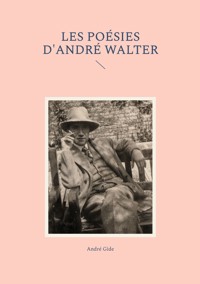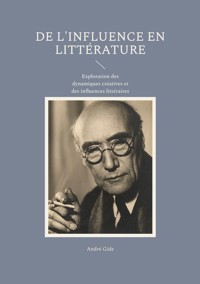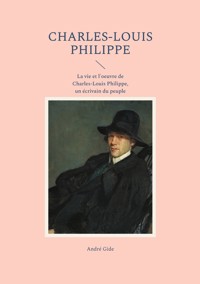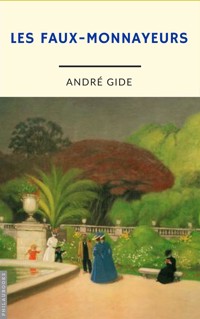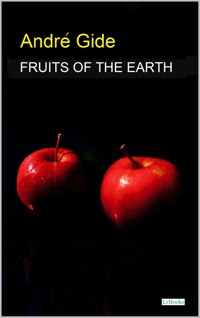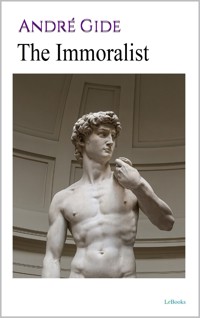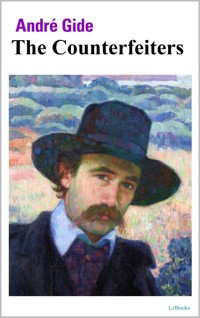1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Dans 'Voyage au Congo' et 'Le Retour du Tchad', André Gide explore les réalités complexes et souvent troublantes de la colonisation et de l'Afrique francophone. Dans un style narratif mêlant journal intime et réflexion philosophique, Gide décrit son voyage en Afrique dans les années 1920, mettant en exergue la beauté des paysages et la diversité des cultures tout en critiquant les dérives du colonialisme. Ces œuvres, appartenant au mouvement littéraire du modernisme, sont à la croisée de l'art et de l'engagement, reflet d'un esprit en quête de vérité et de sens face aux injustices du monde. André Gide, écrivain au parcours riche et controversé, a été profondément influencé par son engagement social et ses réflexions sur la morale et l'art. Élevé dans un milieu bourgeois, sa sensibilité aux questions humaines et sociopolitiques l'a conduit à effectuer ce voyage en Afrique, une manière de confronter ses idéaux à la réalité brutale qu'il observait. Gide, explorateur de l'âme humaine, assistait à une époque charnière, où le discours sur le colonialisme devait être questionné et redéfini. Je recommande vivement la lecture de ces œuvres à quiconque souhaite comprendre les enjeux moraux et politiques liés à la colonisation, ainsi que l'œuvre de Gide, qui transcende le temps par sa profondeur et sa lucidité. Son style incisif et son regard critique en font des lectures essentielles pour appréhender l'héritage complexe de la rencontre entre les cultures. Dans cette édition enrichie, nous avons soigneusement créé une valeur ajoutée pour votre expérience de lecture : - Une Introduction succincte situe l'attrait intemporel de l'œuvre et en expose les thèmes. - Le Synopsis présente l'intrigue centrale, en soulignant les développements clés sans révéler les rebondissements critiques. - Un Contexte historique détaillé vous plonge dans les événements et les influences de l'époque qui ont façonné l'écriture. - Une Biographie de l'auteur met en lumière les étapes marquantes de sa vie, éclairant les réflexions personnelles derrière le texte. - Une Analyse approfondie examine symboles, motifs et arcs des personnages afin de révéler les significations sous-jacentes. - Des questions de réflexion vous invitent à vous engager personnellement dans les messages de l'œuvre, en les reliant à la vie moderne. - Des Citations mémorables soigneusement sélectionnées soulignent des moments de pure virtuosité littéraire. - Des notes de bas de page interactives clarifient les références inhabituelles, les allusions historiques et les expressions archaïques pour une lecture plus aisée et mieux informée.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Voyage au Congo & Le Retour du Tchad
Introduction
Il arrive qu’un voyage ébranle moins des horizons que des certitudes: c’est à ce point de bascule que s’ouvrent ces pages. Ici, la route n’est pas seulement un tracé sur la carte; elle devient une épreuve pour le regard, mis à nu par ce qu’il découvre et par ce qu’il doit apprendre à nommer. La tension centrale n’oppose pas l’exotisme au familier, mais l’examen de conscience à l’aveuglement confortable. Dans ce double livre, l’itinéraire sert de cadre à une enquête morale et intellectuelle où observer, décrire et juger ne vont jamais de soi, et où l’écriture se fait instrument de lucidité active.
Si Voyage au Congo et Le Retour du Tchad ont gagné un statut de classique, c’est parce qu’ils conjuguent un art de voir, une éthique du témoignage et une force de style qui ont durablement marqué la littérature de voyage. Loin des récits d’agrément, ces textes font de la description un acte critique et, de la note de journal, un levier de mise en question. Leur impact ne tient pas seulement à ce qu’ils racontent, mais à la manière de poser les problèmes, d’installer un dialogue exigeant entre le témoin, les faits et le lecteur, dialogue qui a influencé bien au-delà de leur époque.
André Gide, l’un des grands noms des lettres françaises, conçoit ces livres à partir d’un périple entrepris en Afrique équatoriale au milieu des années 1920. Son autorité littéraire lui confère une visibilité particulière: ce qu’il voit, ce qu’il note, ce qu’il choisit de publier, entre dans l’espace public avec une intensité rare. La notoriété de l’auteur n’écrase pourtant pas le matériau du voyage; elle le cadre, l’interroge, l’expose à une discipline d’écriture. Le lecteur aborde ainsi un texte où la signature célèbre soutient une mise à l’épreuve du jugement plutôt qu’une recherche d’effet.
Le contexte de composition est précis. Gide voyage en 1925 et 1926 en Afrique équatoriale alors administrée par la France. Voyage au Congo paraît en 1927; Le Retour du Tchad le prolonge en 1928. Ces dates ne sont pas accessoires: elles situent le témoignage au cœur d’un moment où l’Europe se regarde dans son outre-mer et où la littérature s’ouvre aux formes documentaires. La publication rapprochée des deux volumes installe une continuité d’enquête et de ton, tout en laissant affleurer l’évolution d’un regard qui se décante au fil des étapes et des pages.
La prémisse est claire sans dévoiler ce que l’on découvrira: un écrivain traverse des territoires, suit des fleuves et des pistes, rencontre des populations et des autorités, observe les modes de vie et les conditions de travail, et note ce qu’il voit. La priorité est donnée à l’expérience immédiate: écouter, comparer, vérifier, décrire. À mesure que le carnet s’étoffe, la relation entre faits et valeurs devient le véritable enjeu. Le récit ne promet ni aventure romanesque ni exotisme garantis; il propose une méthode: marcher, regarder, consigner, et confronter le regard à sa propre responsabilité.
L’impact de ces livres fut aussi public. Parus dans une France qui débattait de sa présence coloniale, ils contribuèrent à faire émerger des discussions sur les pratiques administratives et économiques en Afrique équatoriale. On lut ces pages comme un document, on les discuta comme un plaidoyer, on les jugea comme une œuvre. Cette triple réception a garanti leur efficacité: œuvres littéraires par la tenue du style, documents par la précision des notations, interventions par l’orientation éthique. Leur résonance, mesurée à l’époque par les échos de presse et les débats, nourrit encore aujourd’hui l’intérêt critique.
Leur classicisme tient enfin à des thèmes qui ne s’épuisent pas: la responsabilité du témoin, l’écart entre l’intention et l’effet, la rencontre de l’altérité, le langage comme outil d’ajustement au réel. À chaque page, un choix s’impose: comment nommer sans trahir, comment juger sans simplifier? Loin d’un verdict péremptoire, l’ouvrage privilégie l’interrogation patiente. Cette patience, alliée à une fermeté dans la restitution des faits observés, a donné aux livres une autorité durable, parce qu’elle laisse au lecteur la place d’exercer à son tour son discernement.
On lit aussi Gide pour la tenue de sa prose: une syntaxe claire, des paragraphes qui avancent par touches, l’alliage de l’exact et du sensible. La forme diaristique, l’attention au détail concret, la précision des distances, des gestes et des voix, composent un style de présence. L’écriture assume la tension entre le registre personnel et l’exigence de vérification. À travers ce tressage, l’auteur défait les illusions de l’observateur tout-puissant et montre que le vrai se gagne par rectifications, scrupules et retours, ce qui confère au récit sa dynamique propre.
Le diptyque a sa logique: Voyage au Congo installe le mouvement, les terrains, la méthode; Le Retour du Tchad reprend la marche, déplace la focale, prolonge l’examen. Le second volume n’est pas un simple appendice: il élargit l’horizon, met à l’épreuve ce qui a été établi, et donne au lecteur la sensation d’un regard qui se recompose. Ensemble, les deux livres proposent une exploration continue où l’espace géographique s’accompagne d’une topographie de la pensée, chaque étape consolidant l’enquête et l’intégrité de la démarche.
L’influence s’est exercée sur des écrivains qui, après Gide, ont exploré la frontière entre récit de voyage, reportage et essai moral. On y a trouvé un modèle d’exigence: ne pas renoncer à la singularité de l’écriture tout en donnant droit au contrôle des faits; ne pas céder à la rhétorique de surplomb; maintenir l’alliance du sensible et du vérifiable. Cette manière a aidé à renouveler la littérature testimoniale en français, et demeure une référence pour ceux qui, aujourd’hui encore, cherchent une voie d’écriture solide face à la complexité du monde.
Pour le lecteur contemporain, ces livres sont à la fois documents d’une époque et laboratoires d’une attitude. Ils mettent à disposition un matériau précieux sur des lieux, des circulations et des vies, mais surtout ils offrent un protocole de lecture du réel: modestie de l’énonciation, clarté des appuis, refus des facilités. À l’heure où l’on interroge les héritages coloniaux, la place de l’image et les responsabilités de la parole publique, la méthode de Gide demeure un point d’appui, autant pour comprendre que pour discuter.
Entrer dans Voyage au Congo et Le Retour du Tchad, c’est accepter une conversation sérieuse avec le monde et avec soi. On y trouvera moins des certitudes offertes que des outils pour se former un jugement. L’attrait du livre tient à ce mélange singulier d’attention aux êtres, d’exigence de preuve et d’élégance sobre. S’il est classique, c’est qu’il ne cesse d’appeler une lecture active, capable de relier l’hier et l’aujourd’hui. Sa pertinence tient à l’éthique qu’il propose: regarder mieux, parler juste, et tenir dans la durée la promesse d’une lucidité sans complaisance.
Synopsis
Publié en 1927 et 1928, Voyage au Congo et Le Retour du Tchad rassemblent le journal de route qu’André Gide tint lors d’un périple en Afrique équatoriale française en 1925-1926. L’écrivain, attentif à la fois au détail quotidien et aux structures politiques, entreprend d’observer les réalités coloniales au-delà des images d’Épinal. L’œuvre conjugue récit de déplacement, enquête sur le fonctionnement économique et réflexion morale. Dès les premières étapes, Gide annonce une méthode fondée sur la note prise sur le vif, la comparaison entre discours officiels et pratiques locales, et le refus d’un exotisme complaisant, afin de comprendre ce que la domination coloniale produit concrètement.
Le parcours remonte les grands fleuves puis traverse l’intérieur, au gré de postes administratifs, comptoirs et missions. Gide décrit les voies d’eau, la logistique du ravitaillement et l’organisation des relais qui structurent les mouvements d’hommes et de marchandises. Les rencontres avec agents coloniaux, missionnaires et intermédiaires locaux éclairent la chaîne des responsabilités. Cette progression géographique fait apparaître la dépendance des populations à des circuits imposés et la fragilité des équilibres vivriers. Les notations sur les paysages et les gestes du quotidien sont mises en regard d’une économie d’extraction qui oriente les mobilités et conditionne les rapports sociaux.
Très vite, l’enquête se concentre sur le travail. Gide documente les réquisitions de portage, l’impôt de capitation et les obligations de prestations qui, cumulés, pèsent sur les villages. Il relève les effets démographiques, la désorganisation saisonnière des cultures et l’endettement qui s’ensuit. Les témoignages recueillis, confrontés aux instructions administratives, font apparaître l’écart entre normes affichées et application. Sans s’en remettre à des généralités, le récit juxtapose scènes observées et éléments comptables ou réglementaires, afin d’évaluer la réalité du consentement au travail, la part de coercition et les marges d’arbitraire tolérées par le système.
Au cœur du livre, Gide interroge le régime des compagnies concessionnaires et la logique des quotas imposés pour les produits de cueillette et d’exportation. Il montre comment le monopole d’achat, la fixation des prix et les exigences de rendement affectent les communautés, tout en brouillant la frontière entre autorité publique et intérêts privés. Les missions, parfois protectrices, parfois compromises, apparaissent comme des acteurs ambivalents. À travers ces observations, l’auteur met en cause l’argument de la mise en valeur qui prétend justifier les contraintes, et souligne la contradiction entre objectifs civilisateurs proclamés et pratiques économiques réellement à l’œuvre.
Parallèlement, l’ouvrage multiplie les notations ethnographiques prudentes: formes de parenté, marchés, usages locaux, circulation des langues. Gide s’emploie à ne pas ériger ses impressions en lois générales, signalant ce qu’il ignore et ce qui demeure singulier. Il insiste sur les médiations, du rôle des chefs à celui des interprètes, et sur l’importance de la santé et des soins, thèmes récurrents dans les postes et les camps. Ces observations ne visent pas l’érudition, mais à situer les effets de la contrainte dans des vies concrètes, et à discerner ce qui, dans les cultures rencontrées, résiste ou se réorganise.
Le Retour du Tchad prolonge et déplace la perspective vers les régions sahéliennes. Les paysages plus secs, l’économie de transhumance et les circulations caravanières modifient les contraintes, sans abolir la pression fiscale et les réquisitions. Gide observe la présence de l’islam, le maillage des postes militaires et le jeu des alliances locales. Cette seconde étape, conduite sur des itinéraires plus austères, renforce son souci comparatif: il confronte ce qu’il a vu en zone forestière et fluviale avec ce qu’il découvre dans la steppe, afin de mesurer l’emprise coloniale selon les milieux et les modes de vie.
Le fil critique s’épaissit: registres, correspondances et scènes de recrutement fournissent à Gide matière à préciser ses diagnostics sur la contrainte, la responsabilité administrative et les effets économiques. Les pratiques d’enrôlement, les transports et les pénuries sont replacés dans une chaîne causale où chaque niveau d’autorité compte. L’auteur esquisse des pistes jugées nécessaires pour limiter l’arbitraire, mieux protéger les populations et encadrer l’activité des concessionnaires. Il ne propose pas un programme clos, mais des exigences de contrôle, d’instruction et de justice qui, selon lui, conditionnent toute amélioration durable.
Sur le plan littéraire, l’ensemble oscille entre carnet, reportage et méditation morale. Gide réfléchit à la position du témoin, au risque d’aveuglement du voyageur et aux effets de l’écriture sur ce qu’elle prétend montrer. Les images prises au cours du voyage complètent l’entreprise documentaire tout en rappelant leurs propres limites. Le récit, tout en refusant le spectaculaire, s’efforce de faire voir les enchaînements ordinaires par lesquels s’impose la domination. La sobriété revendiquée vise à susciter examen et responsabilité chez le lecteur, plutôt qu’à produire un effet d’exotisme ou d’indignation passagère.
Sans conclure par un manifeste, ces livres donnent une forme accessible à une critique informée du régime colonial d’Afrique équatoriale française. En articulant observations, faits économiques et considérations éthiques, ils contribuent à éclairer un débat public en métropole sur la légitimité des méthodes employées. Leur portée durable tient à la précision des constats, à la prudence des inférences et à l’appel à un contrôle effectif des pouvoirs. Voyage au Congo et Le Retour du Tchad demeurent ainsi des repères pour penser les liens entre gouvernance, exploitation et responsabilité, au-delà du seul moment historique qui les a vus naître.
Contexte historique
Au milieu des années 1920, l’Afrique équatoriale française constitue le cadre institutionnel majeur des récits de Gide. Cette fédération, formée en 1910, regroupe le Gabon, le Moyen-Congo, l’Oubangui-Chari et le Tchad, sous l’autorité d’un gouverneur général à Brazzaville et d’administrateurs territoriaux. Le Code de l’indigénat, en vigueur depuis le début du siècle, confère à ces autorités de larges pouvoirs disciplinaires sur les populations « indigènes ». La doctrine officielle se réclame de la mission civilisatrice et de la « mise en valeur », orientant l’administration vers l’extraction de ressources et la construction d’infrastructures. C’est dans cet espace hiérarchisé, et sous ces normes coercitives, que s’inscrit l’itinéraire observé par Gide.
André Gide entreprend son voyage en Afrique équatoriale vers 1925, accompagné du jeune cinéaste et photographe Marc Allégret. Il tient un journal précis, nourri d’observations directes, qui deviendra Voyage au Congo, publié en 1927, puis Le Retour du Tchad, en 1928. Le projet conjugue enquête, réflexion morale et description ethnographique, avec le souci d’établir des faits vérifiables. Allégret réalise parallèlement un film documentaire, projeté à partir de 1927, et des photographies qui renforcent la dimension testimoniale. Diffusés par la Nouvelle Revue Française et par l’éditeur Gallimard, ces textes s’adressent à un lectorat métropolitain curieux, mais souvent peu informé des réalités concrètes de l’empire.
Les livres s’inscrivent dans l’histoire du « régime des concessions » instauré à la fin du XIXe siècle dans le bassin congolais. D’immenses territoires furent confiés à des sociétés privées, chargées d’exploiter caoutchouc, ivoire, copal ou essences forestières, en échange d’obligations théoriques d’aménagement. Les abus, déjà dénoncés au tournant du siècle, entraînèrent en 1905 la mission d’enquête de Pierre Savorgnan de Brazza. Malgré des réformes et quelques retraits de concessions, le système, modifié mais durable, continua à structurer l’économie de l’AEF. Gide en examine les effets concrets sur les villages, les circuits du travail et l’exercice de l’autorité coloniale.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la politique coloniale française se réorganise autour de la « mise en valeur » popularisée par Albert Sarraut (1923). Elle vise à développer routes, ports, voies fluviales et cultures d’exportation. L’impôt de capitation, généralisé plus tôt et renforcé, oblige les populations à se procurer de la monnaie, aiguillant vers le travail salarié ou des productions imposées. Les « prestations » pour travaux publics, et diverses réquisitions, encadrent juridiquement le travail forcé. Les récits de Gide mettent en évidence les décalages entre les proclamations modernisatrices et les méthodes de coercition qui, sur le terrain, conditionnent les récoltes, les déplacements et la vie des familles.
L’infrastructure est l’ossature matérielle du pouvoir dans ces régions. L’AEF dépend des voies d’eau intérieures, desservies par des vapeurs de compagnies fluviales, et d’un réseau routier encore discontinu. S’y ajoute, à partir de 1921, le chantier stratégique du Congo-Océan, destiné à relier Brazzaville à Pointe-Noire sur l’Atlantique, achevé vers 1934. Ce chantier consomme une main-d’œuvre colossale, en grande partie recrutée de force. Loin des grands axes, le portage demeure la norme. Les étapes fluviales, les ruptures de charge, les postes administratifs et commerciaux forment le décor concret du voyage de Gide et structurent ses notations sur les prix, les délais et les contraintes du transport.
L’état sanitaire pèse lourdement sur la démographie et le travail. Au début du XXe siècle, la maladie du sommeil ravage des zones entières du bassin congolais. Dans les années 1920, l’administration renforce ses services médicaux et des campagnes spécialisées se déploient, notamment sous l’impulsion de médecins comme Eugène Jamot au Cameroun à partir du milieu de la décennie. Malaria, variole et maladies vénériennes s’ajoutent aux fatigues de la corvée, aux longues marches et aux pénuries provoquées par les réquisitions. Gide constate que la pression fiscale et le portage détournent les hommes des champs, fragilisant les récoltes et exposant les villages à la faim et aux épidémies.
Les missions religieuses occupent un rôle central dans l’AEF des années 1920. Congrégations catholiques et sociétés protestantes y gèrent écoles, dispensaires et ateliers, fournissant des relais sanitaires et éducatifs qu’une administration coloniale aux moyens limités ne peut assurer seule. Elles servent parfois d’intermédiaires dans la perception de l’impôt ou la diffusion du français, et leurs rapports dénoncent à l’occasion des exactions. Gide visite postes et stations, observe l’enseignement et la catéchèse, et note les tensions fréquentes entre missionnaires, administrateurs et compagnies. Son témoignage souligne l’ambivalence d’institutions à la fois protectrices par endroits et insérées dans l’ordre colonial.
La charpente juridique de l’empire, avec le Code de l’indigénat, autorise amendes, corvées et peines administratives sans garanties comparables au droit commun. Les chefs coutumiers, reconnus par l’administration, sont requis pour relayer impôt, recrutements et réquisitions, ce qui redessine des hiérarchies locales. En pratique, la frontière entre contrainte « légale » et abus dépend du zèle des agents, du contrôle hiérarchique et de l’isolement des postes. Les notes de Gide accumulent observations et témoignages sur les sanctions collectives, la sévérité des gardes et les excès de certains auxiliaires, éclairant la mécanique ordinaire de la domination coloniale.
Les économies locales de l’AEF connaissent alors des recompositions. Le boom du caoutchouc « de cueillette » décline dès les années 1910, concurrencé par les plantations asiatiques. Les entreprises se tournent davantage vers le bois (okoumé notamment), le copal, l’ivoire ou des cultures comme le coton et l’arachide, selon les zones. L’obligation de payer l’impôt en numéraire stimule le salariat, les migrations saisonnières et les monopoles de traitants qui fixent les prix d’achat. Gide décrit boutiques, factoreries et systèmes de ristournes, montrant comment l’endettement et les tarifs imposés étranglent les marges paysannes et favorisent des circuits d’exportation asymétriques.
Le chantier du Congo-Océan symbolise aux yeux des contemporains les contradictions de la modernisation coloniale. Lancé en 1921, il mobilise des dizaines de milliers d’hommes dans des conditions éprouvantes, avec une mortalité très élevée, largement rapportée par la presse et des témoins à la fin des années 1920. Gide, qui évoque déjà la contrainte généralisée et ses effets dévastateurs, participe à rendre visible ce coût humain. Peu après ses livres, d’autres voix, comme Albert Londres dans Terre d’ébène (1929), corroborent l’ampleur des abus. L’ensemble alimente en métropole un débat sur les limites morales d’un développement fondé sur le travail forcé.
La Grande Guerre a bouleversé les équilibres impériaux. L’ex-Cameroun allemand devient en 1922 un territoire sous mandat confié en partie à la France par la Société des Nations. Le mandat impose des obligations de « bien-être et de développement » des populations. Les pratiques de réquisition et de travail obligatoire n’y disparaissent pas pour autant, bien que la rhétorique de protection y soit plus affirmée. Sans se faire étude de droit comparé, l’ensemble formé par l’AEF et les territoires voisins sert, dans les discussions métropolitaines auxquelles contribue Gide, de repoussoir et de point de comparaison pour interroger les promesses et les réalités de la tutelle coloniale.
Le Tchad, intégré militairement à l’empire au tournant de 1900 après la défaite de Rabah et organisé comme colonie au sein de l’AEF vers 1920, forme l’horizon septentrional du retour de Gide. Les zones sahéliennes et soudaniennes y sont structurées par l’élevage, quelques cultures commerciales et d’anciens circuits caravanier aujourd’hui contrôlés. La pacification, menée jusque dans les années 1910 contre des résistances comme celles du Ouaddaï, a laissé place à une administration civile légère, mais exigeante en impôts et en hommes. Gide traverse des régions où l’éloignement des marchés et postes européens renforce les coûts de la contrainte.
La question du transport illustre l’expérience vécue par les habitants. Sur les cours d’eau, la navigation à vapeur simplifie certains trajets, mais impose des ruptures de charge et des attentes qui immobilisent des équipes entières. Hors des fleuves, les routes en latérite se développent dans les années 1920, et l’automobile apparaît, encore rare et fragile. Le portage, souvent réquisitionné, demeure vital pour relier villages, postes et chantiers. Télégraphe et radio améliorent la coordination administrative, sans abolir les zones d’ombre. Gide fait sentir le poids de cette logistique inégale, où le temps et les corps des porteurs deviennent la variable d’ajustement de l’économie coloniale.
Les sociétés locales réagissent par une palette de stratégies. La fuite vers des zones moins accessibles, la fragmentation des villages, les retards collectifs au recrutement, voire des plaintes auprès de missionnaires ou de fonctionnaires perçus comme bienveillants, dessinent un répertoire de résistances ordinaires. Les migrations de travail vers des régions jugées moins dures, ou vers des emplois portuaires, existent aussi. Gide note ces tactiques de contournement et leurs coûts sociaux, du déséquilibre des foyers à l’érosion des solidarités villageoises. Il met en évidence le rôle ambigu des chefs requis, pris entre la pression administrative et la protection de leurs communautés.
En métropole, les années 1920 voient se renforcer l’attention portée aux questions coloniales. La Ligue des droits de l’homme publie des rapports, des parlementaires interrogent l’administration, et des réseaux chrétiens sociaux expriment des préoccupations morales. En 1927, la création de la Ligue contre l’impérialisme signale l’émergence d’un anticolonialisme plus radical, tandis que l’Exposition coloniale internationale de 1931 célèbre l’empire. La voix de Gide, issue d’un milieu littéraire central (NRF, Gallimard), pèse dans cet espace public. Son diagnostic, réformateur et documenté, met au défi la rhétorique officielle sans rompre d’emblée avec l’idée d’un empire amendable.
La publication et la réception des ouvrages participent d’un moment médiatique. Voyage au Congo (1927), puis Le Retour du Tchad (1928), paraissent chez Gallimard et bénéficient d’un écho critique nourri d’articles de presse, de conférences et d’images rapportées par Allégret. Gide soigne la dimension factuelle, cite des interlocuteurs, reproduit des documents et décrit des scènes observées. Cette stratégie renforce la crédibilité d’un témoignage qui se veut moins un pamphlet qu’un relevé d’irrégularités systémiques. L’ensemble installe l’auteur au cœur d’un débat public où se croisent intérêts commerciaux, impératifs administratifs et exigences humanitaires.
Les répercussions administratives existent, quoique partielles. À la fin des années 1920, des enquêtes sont diligentées sur certaines compagnies et pratiques locales, et des instructions rappellent les limites légales des réquisitions. Au début des années 1930, des textes réduisent l’accès des entreprises privées au travail forcé, sans supprimer les prestations pour travaux publics. Les grandes structures de domination, dont le Code de l’indigénat, persistent jusqu’à l’après-guerre, leur abrogation n’intervenant qu’en 1946. Le bilan, à l’échelle des réformes, confirme le diagnostic de Gide : des corrections ponctuelles sans remise en cause immédiate du cadre coercitif général de l’empire colonial français, AEF comprise. Enfin, cet ensemble agit comme miroir critique de son époque. En donnant chair aux abstractions administratives, Gide met en regard promesses de progrès et coûts humains cachés de la « mise en valeur ». Sa prose, attentive aux conditions de travail, à la santé et aux prix, documente minutieusement des mécanismes structurels. Loin de l’exotisme, il embrasse la méthode d’un observateur moral qui interpelle le lecteur métropolitain. Voyage au Congo et Le Retour du Tchad demeurent ainsi des sources pour l’histoire sociale de l’empire et des textes qui interrogent, de l’intérieur, les justifications de la domination coloniale.
Biographie de l’auteur
André Gide (1869-1951), écrivain français majeur, traverse la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe. Romancier, essayiste et diariste, il interroge la liberté individuelle, la vérité de soi et les morales instituées, en mariant classicisme de la phrase et audaces de forme. Figure de premier plan de la vie littéraire, il contribue à définir le canon moderne par son œuvre et par son action critique. Lauréat du prix Nobel de littérature en 1947, il incarne l’écrivain européen aux prises avec les bouleversements esthétiques et politiques de son temps, soucieux d’indépendance intellectuelle et d’exigence éthique.
Né et formé à Paris, Gide reçoit une éducation soignée et se tourne très tôt vers l’écriture. Ses premiers livres, marqués par l’héritage symboliste et une quête d’absolu, posent les thèmes fondateurs de son œuvre. Les Cahiers d’André Walter (1891) et Le Traité du Narcisse développent une esthétique de l’introspection et de la musique de la phrase. Les séjours en Afrique du Nord au milieu des années 1890 élargissent son horizon sensuel et moral, nourrissant Paludes (1895) et surtout Les Nourritures terrestres (1897), appel à l’émancipation et à la disponibilité, qui exerce une influence durable sur des générations de lecteurs.
Au tournant du siècle, Gide approfondit l’examen des consciences et des conflits intérieurs. L’Immoraliste (1902) met en scène une déliaison critique des normes sociales et religieuses; La Porte étroite (1909) explore les apories d’un spiritualisme intransigeant. À ces récits d’analyse s’ajoute Les Caves du Vatican (1914), sotie où la satire mord la crédulité et le conformisme. Après la guerre, La Symphonie pastorale (1919) prolonge son interrogation sur la charité, la foi et la responsabilité, dans une prose volontairement limpide. La réception alterne controverses et admiration, mais la singularité de sa voix s’impose dans le paysage littéraire européen.
Parallèlement, Gide joue un rôle décisif dans la vie éditoriale. En 1909, il participe à la fondation de la Nouvelle Revue Française, qui devient rapidement une instance de référence et s’articule aux Éditions Gallimard. Directeur d’orientation et lecteur, il promeut un idéal d’exigence et de liberté qui attire et aiguillonne les écrivains. Sa responsabilité critique est notoire, jusque dans ses erreurs reconnues, comme son refus initial d’un manuscrit de Marcel Proust, qu’il regrettera publiquement avant de soutenir l’auteur. Par ses prises de position, sa correspondance et ses préfaces, il contribue à configurer les débats esthétiques du premier XXe siècle.
Les années 1920 marquent une fécondité expérimentale et une visibilité accrues. Les Faux-Monnayeurs (1925), roman-laboratoire, interroge la fabrique du récit et la circulation des valeurs, accompagné d’un journal de genèse éclairant sa poétique. Parallèlement, Corydon (publié en 1924) avance, sous forme de dialogues, une défense argumentée de l’amour entre personnes de même sexe, en liant éthique et vérité de soi. Si le grain ne meurt (1926) retrace la formation d’un écrivain face à ses contradictions. Ses voyages en Afrique équatoriale aboutissent à Voyage au Congo (1927) puis au Retour du Tchad (1928), rapports documentés dénonçant des abus coloniaux.
À l’épreuve des idéologies des années 1930, Gide affirme son indépendance. Après un séjour en Union soviétique, il publie Retour de l’URSS (1936), puis Retouches à mon Retour de l’URSS (1937), textes critiques qui nourrissent un vaste débat européen sur l’engagement et la liberté de l’esprit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il poursuit ses journaux et essais, tout en maintenant une influence intellectuelle reconnue. Au sortir du conflit, sa place est consacrée par le prix Nobel de littérature (1947), saluant une œuvre ample, exigeante et diverse, dont la rigueur morale n’exclut ni la complexité ni la recherche formelle.
Les dernières années voient la poursuite d’un Journal qui, sur toute sa carrière, constitue un observatoire privilégié de son travail et de son époque. Gide meurt en 1951 à Paris, laissant une œuvre où se conjuguent roman d’analyse, récits, essais et écrits de voyage. Son héritage se mesure à l’influence exercée sur le roman moderne, la réflexion sur l’authenticité, l’examen des consciences et la souveraineté de l’écrivain face aux dogmes. Étudié et relu, il demeure une référence pour penser les liens entre esthétique, éthique et liberté, et continue d’éclairer les interrogations du lecteur contemporain.
Voyage au Congo & Le Retour du Tchad
Voyage au Congo
Table of Contents
Table des matières
À la Mémoire de JOSEPH CONRAD
Better be imprudent moveables than prudent fixtures.
KEATS.
CHAPITRE PREMIER – Les escales – Brazzaville
21 juillet. – Troisième jour de traversée.
Indicible langueur. Heures sans contenu ni contour[1q].
Après deux mauvais jours, le ciel bleuit; la mer se calme; l’air tiédit. Un vol d’hirondelles suit le navire.
On ne bercera jamais assez les enfants, du temps de leur prime jeunesse. Et même je serais d’avis qu’on usât, pour les calmer, les endormir, d’appareils profondément bousculatoires. Pour moi, qui fus élevé selon des méthodes rationnelles, je ne connus jamais, de par ordre de ma mère, que des lits fixes; grâce à quoi je suis aujourd’hui particulièrement sujet au mal de mer.
Pourtant je tiens bon; je tâche d’apprivoiser le vertige, et constate que, ma foi, je tiens mieux que nombre de passagers. Le souvenir de mes six dernières traversées (Maroc, Corse, Tunisie) me rassure.
Compagnons de traversée: administrateurs et commerçants. Je crois bien que nous sommes les seuls à voyager «pour le plaisir».
–Qu’est-ce que vous allez chercher là-bas?
–J’attends d’être là-bas pour le savoir.
Je me suis précipité dans ce voyage comme Curtius dans le gouffre[1]. Il ne me semble déjà plus que précisément je l’aie voulu (encore que depuis des mois ma volonté se soit tendue vers lui); mais plutôt qu’il s’est imposé à moi par une sorte de fatalité inéluctable – comme tous les événements importants de ma vie. Et j’en viens à presque oublier que ce n’est là qu’un «projet de jeunesse réalisé dans l’âge mûr»; ce voyage au Congo, je n’avais pas vingt ans que déjà je me promettais de le faire; il y a trente-six ans de cela.
Je reprends, avec délices, depuis la fable I, toutes les fables de La Fontaine. Je ne vois pas trop de quelle qualité l’on pourrait dire qu’il ne fasse preuve. Celui qui sait bien voir peut y trouver trace de tout; mais il faut un œil averti, tant la touche, souvent, est légère. C’est un miracle de culture. Sage comme Montaigne; sensible comme Mozart.
Hier, inondation de ma cabine, au petit matin, lors du lavage du pont. Un flot d’eau sale où nage piteusement le joli petit Gœthe letherbound, que m’avait donné le Comte Kessler (où je relis les Affinités).
25 juillet.
Ciel uniformément gris; d’une douceur étrange. Cette lente et constante descente vers le sud doit nous amener à Dakar ce soir.
Hier des poissons volants. Aujourd’hui des troupeaux de dauphins. Le commandant les tire de la passerelle. L’un d’eux montre son ventre blanc d’où sort un flot de sang.
En vue de la côte africaine. Ce matin une hirondelle de mer contre la lisse. J’admire ses petites pattes palmées et son bec bizarre. Elle ne se débat pas lorsque je la prends. Je la garde quelques instants dans ma main ouverte; puis elle prend son vol et se perd de l’autre côté du navire.
26 juillet.
Dakar la nuit. Rues droites désertes. Morne ville endormie. On ne peut imaginer rien de moins exotique, de plus laid. Un peu d’animation devant les hôtels. Terrasses des cafés violemment éclairées. Vulgarité des rires. Nous suivons une longue avenue, qui bientôt quitte la ville française. Joie de se trouver parmi des nègres. Dans une rue transversale, un petit cinéma en plein air, où nous entrons. Derrière l’écran, des enfants noirs sont couchés à terre, au pied d’un arbre gigantesque, un fromager sans doute. Nous nous asseyons au premier rang des secondes. Derrière moi un grand nègre lit à haute voix le texte de l’écran. Nous ressortons. Et longtemps nous errons encore; si fatigués bientôt que nous ne songeons plus qu’à dormir. Mais à l’hôtel de la Métropole, où nous avons pris une chambre, le vacarme d’une fête de nuit, sous notre fenêtre, empêche longtemps le sommeil.
Dès six heures, nous regagnons l’Asie, pour prendre un appareil de photo. Une voiture nous conduit au marché. Chevaux squelettiques, aux flancs rabotés et sanglants, dont on a badigeonné les plaies au bleu de Prusse. Nous quittons ce triste équipage pour une auto, qui nous mène à six kilomètres de la ville, traversant des terrains vagues que hantent des hordes de charognards. Certains perchent sur le toit des maisons, semblables à d’énormes pigeons pelés.
Jardin d’Essai. Arbres inconnus. Buissons d’hibiscus en fleurs. On s’enfonce dans d’étroites allées pour prendre un avant-goût de la forêt tropicale. Quelques beaux papillons, semblables à de grands machaons, mais portant, à l’envers des ailes, une grosse macule nacrée. Chants d’oiseaux inconnus, que je cherche en vain dans l’épais feuillage. Un serpent noir très mince et assez long glisse et fuit.
Nous cherchons à atteindre un village indigène, dans les sables, au bord de la mer; mais une infranchissable lagune nous en sépare.
27 juillet.
Jour de pluie incessante. Mer assez houleuse. Nombreux malades. De vieux coloniaux se plaignent: «Journée terrible; vous n’aurez pas pire»… Somme toute, je supporte assez bien. Il fait chaud, orageux, humide; mais il me semble que j’ai connu pire à Paris; et je suis étonné de ne pas suer davantage.
Le 29, arrivée en face de Konakry. On devait débarquer dès sept heures; mais depuis le lever du jour, un épais brouillard égare le navire. On a perdu le point. On tâtonne et la sonde plonge et replonge. Très peu de fond; très peu d’espace entre les récifs de corail et les bancs de sable. La pluie tombait si fort que déjà nous renoncions à descendre, mais le commandant nous invite dans sa pétrolette.
Très long trajet du navire au wharf, mais qui donne au brouillard le temps de se dissiper; la pluie s’arrête.
Le commissaire qui nous mène à terre nous avertit que nous ne disposons que d’une demi-heure, et qu’on ne nous attendra pas. Nous sautons dans un pousse, que tire un jeune noir «mince et vigoureux». Beauté des arbres, des enfants au torse nu, rieurs, au regard languide. Le ciel est bas. Extraordinaire quiétude et douceur de l’air. Tout ici semble promettre le bonheur, la volupté, l’oubli.
31 juillet.
Tabou. – Un phare bas, qui semble une cheminée de steamer. Quelques toits perdus dans la verdure. Le navire s’arrête à deux kilomètres de la côte. Trop peu de temps pour descendre à terre; mais, du rivage s’amènent deux grandes barques pleines de Croumens[2]. L’Asie en recrute soixante-dix pour renforcer l’équipage – qu’on rapatriera au retour. Hommes admirables pour la plupart, mais qu’on ne reverra plus que vêtus.
Dans une minuscule pirogue, un nègre isolé chasse l’eau envahissante, d’un claquement de jambe contre la coque.
1eraoût.
Image de l’ancien «Magasin Pittoresque»: la barre à Grand-Bassam. Paysage tout en longueur. Une mer couleur thé, où traînent de longs rubans jaunâtres de vieille écume. Et, bien que la mer soit à peu près calme, une houle puissante vient, sur le sable du bord, étaler largement sa mousse. Puis un décor d’arbres très découpés, très simples, et comme dessinés par un enfant. Ciel nuageux.
Sur le wharf, un fourmillement de noirs poussent des wagonnets. À la racine du wharf, des hangars; puis, de droite et de gauche, coupant la ligne d’arbres, des maisons basses, aplaties, aux couvertures de tuiles rouges. La ville est écrasée entre la lagune et la mer. Comment imaginer, tout près, sitôt derrière la lagune, l’immense forêt vierge, la vraie…
Pour gagner le wharf, nous prenons place à cinq ou six dans une sorte de balancelle qu’on suspend par un crochet à une élingue, et qu’une grue soulève et dirige à travers les airs, au-dessus des flots, vers une vaste barque, où le treuil la laisse lourdement choir.
On imagine des joujous requins, des joujous épaves, pour des naufrages de poupées. Les nègres nus crient, rient et se querellent en montrant des dents de cannibales. Les embarcations flottent sur le thé, que griffent et bêchent de petites pagaies en forme de pattes de canard, rouges et vertes, comme on en voit aux fêtes nautiques des cirques. Des plongeurs happent et emboursent dans leurs joues les piécettes qu’on leur jette du pont de l’Asie. On attend que les barques soient pleines; on attend que le médecin de Grand-Bassam soit venu donner je ne sais quels certificats; on attend si longtemps que les premiers passagers, descendus trop tôt dans les nacelles, et que les fonctionnaires de Bassam, trop empressés à les accueillir, balancés, secoués, chahutés, tombent malades. On les voit se pencher de droite et de gauche, pour vomir.
Grand-Bassam. – Une large avenue, cimentée en son milieu; bordée de maisons espacées, de maisons basses. Quantité de gros lézards gris fuient devant nos pas et regagnent le tronc de l’arbre le plus proche, comme à un jeu des quatre coins. Diverses sortes d’arbres inconnus, à larges feuilles, étonnement du voyageur. Une race de chèvres très petite et basse sur jambes; des boucs à peine un peu plus grands que des chiens terriers; on dirait des chevreaux, mais déjà cornus et qui dardent par saccade un très long aiguillon violâtre.
Transversales, les rues vont de la mer à la lagune; celle-ci, peu large en cet endroit, est coupée d’un pont qu’on dirait japonais. Une abondante végétation nous attire vers l’autre rive; mais le temps manque. L’autre extrémité de la rue se perd dans le sable d’une sorte de dune; un groupe de palmiers à huile; puis la mer, qu’on ne voit pas, mais que dénonce la mâture d’un grand navire.
Lomé (2 août).
Au réveil, un ciel de pluie battante. Mais non; le soleil monte; tout ce gris pâlit jusqu’à n’être plus qu’une buée laiteuse, azurée; et rien ne dira la douceur de cette profusion d’argent. L’immense lumière de ce ciel voilé, comparable au pianissimo d’un abondant orchestre.
Cotonou (2 août).
Combat d’un lézard et d’un serpent d’un mètre de long, noir lamé de blanc, très mince et agile, mais si occupé par la lutte que nous pouvons l’observer de très près. Le lézard se débat, parvient à échapper, mais abandonnant sa queue, qui continue longtemps de frétiller à l’aveuglette.
Conversations entre passagers.
Je voudrais comme dans le Quotidien ouvrir une rubrique, dans ce carnet: «Est-il vrai que…» Est-il vrai qu’une société américaine, installée à Grand-Bassam, y achète l’acajou qu’elle nous revend ensuite comme «mahogany» du Honduras?
Est-il vrai que le maïs que l’on paie 35 sous en France ne coûte que… etc.
Libreville (6 août), Port-Gentil (7 août).
À Libreville, dans ce pays enchanteur,
où la nature donneDes arbres singuliers et des fruits savoureux,
l’on meurt de faim. L’on ne sait comment faire face à la disette. Elle règne, nous dit-on, plus terrible encore à l’intérieur du pays.
La grue de l’Asie va cueillir à fond de cale les caisses qu’elle enlève dans un filet à larges mailles, puis déverse dans le chaland transbordeur. Des indigènes les reçoivent et s’activent avec de grands cris. Coincée, heurtée, précipitée, c’est merveille si la caisse arrive entière. On en voit qui éclatent comme des gousses, et répandent comme des graines leur contenu de boîtes de conserve. J’en saisis une. F., agent principal d’une entreprise d’alimentation, à qui je la montre, reconnaît la marque et m’affirme que c’est un lot de produits avariés qui n’a pu trouver acheteur sur le marché de Bordeaux.
8 août.
Mayoumba. – Lyrisme des pagayeurs, au dangereux franchissement de la barre. Les couplets et les refrains de leur chant rythmé se chevauchent1. À chaque enfoncement dans le flot, la tige de la pagaie prend appui sur la cuisse nue. Beauté sauvage de ce chant semi-triste; allégresse musculaire; enthousiasme farouche. À trois reprises la chaloupe se cabre, à demi dressée hors du flot; et lorsqu’elle retombe un énorme paquet d’eau vous inonde, que vont sécher bientôt le soleil et le vent.
Nous partons à pied, tous deux, vers la forêt. Une allée ombreuse y pénètre. Étrangeté. Clairières semées de quelques huttes de roseaux. L’administrateur vient à nous en tipoye2, et en met aimablement deux autres à notre disposition. Il nous emmène, alors que nous étions déjà sur le chemin du retour; et nous rentrons de nouveau dans la forêt. À vingt ans je n’aurais pas eu joie plus vive. Cris et bondissements des porteurs. Nous revenons par le bord de la mer. Sur la plage, fuite éperdue des troupeaux de crabes, hauts sur pattes et semblables à de monstrueuses araignées.
9 août, 7 heures du matin.
Pointe Noire3. – Ville à l’état larvaire, qui semble encore dans le sous-sol.
9 août, 5 heures du soir.
Nous entrons dans les eaux du Congo. Gagnons Banane dans la vedette du commandant. Chaque occasion de descendre à terre nous trouve prêts. Retour à la nuit tombante.
La joie est peut-être aussi vive; mais elle entre en moi moins avant; elle éveille un écho moins retentissant dans mon cœur. Ah! pouvoir ignorer que la vie rétrécit devant moi sa promesse… Mon cœur ne bat pas moins fort qu’à vingt ans.
Lente remontée du fleuve dans la nuit. Sur la rive gauche, au loin, quelques lumières; un feu de brousse, à l’horizon; à nos pieds l’effrayante épaisseur des eaux.
(10 août).
Un absurde contretemps m’empêche, en passant à Bôma (Congo belge), d’aller présenter mes respects au Gouverneur. Je n’ai pas encore bien compris que, chargé de mission, je représente, et suis dès à présent un personnage officiel. Le plus grand mal à me gonfler jusqu’à remplir ce rôle.
Matadi4(10 août), 6 heures du soir
Partis le 12, à 6 heures du matin – arrivés à Thysville à 6 h. 1/2 du soir.
Nous repartons vers 7 heures du matin, pour n’arriver à Kinshassa qu’à la nuit close.
Le lendemain traversée du Stanley-Pool. Arrivée vendredi 14 à 9 heures du matin à Brazzaville5.
Brazzaville.
Étrange pays, où l’on n’a pas si chaud que l’on transpire.
À chasser les insectes inconnus, je retrouve des joies d’enfant. Je ne me suis pas encore consolé d’avoir laissé échapper un beau longicorne vert pré, aux élytres damasquinés, zébrés, couverts de vermiculures plus foncées ou plus pâles; de la dimension d’un bupreste, la tête très large, armée de mandibules-tenailles. Je le rapportais d’assez loin, le tenant par le corselet, entre pouce et index; sur le point d’entrer dans le flacon de cyanure, il m’échappe et s’envole aussitôt.
Je m’empare de quelques beaux papillons porte-queue, jaune soufré maculés de noir, très communs; et d’un autre un peu moins fréquent, semblable au machaon, mais plus grand, jaune zébré de noir (que j’avais vu au Jardin d’Essai de Dakar).
Ce matin, nous sommes retournés au confluent du Congo et du Djoué, à six kilomètres environ de Brazzaville. (Nous y avions été hier au coucher du soleil.) Petit village de pêcheurs. Bizarre lit de rivière à sec, tracé par une incompréhensible accumulation de «boulders» presque noirs; on dirait la morène d’un glacier. Nous bondissons de l’une à l’autre de ces roches arrondies, jusqu’aux bords du Congo. Petit sentier, presque au bord du fleuve; crique ombragée, où une grande pirogue est amarrée. Papillons en grand nombre et très variés; mais je n’ai qu’un filet sans manche et laisse partir les plus beaux. Nous gagnons une partie plus boisée, tout au bord de l’affluent, dont les eaux sont sensiblement plus limpides. Un fromager énorme, au monstrueux empattement, que l’on contourne; de dessous le tronc, jaillit une source. Près du fromager, un amorphophallus violet pourpré, sur une tige épineuse de plus d’un mètre. Je déchire la fleur et trouve, à la base du pistil, un grouillement de petits asticots. Quelques arbres, auxquels les indigènes ont mis le feu, se consument lentement par la base.
J’écris ceci dans le petit jardin de la très agréable case que M.Alfassa, le Gouverneur général intérimaire, a mis à notre disposition. La nuit est tiède; pas un souffle. Un incessant concert de grillons et, formant fond, de grenouilles.
23 août.
Troisième visite aux rapides du Congo. Mais cette fois, nous nous y prenons mieux, et du reste guidés avec quelques autres par M.et MmeChaumel, nous traversons un bras du Djoué en pirogue et gagnons le bord même du fleuve, où la hauteur des vagues et l’impétuosité du courant sont particulièrement sensibles. Un ciel radieux impose sa sérénité à ce spectacle, plus majestueux que romantique. Par instants, un remous creuse un sillon profond; une gerbe d’écume bondit. Aucun rythme; et je m’explique mal ces inégalités du courant.
–«Et croiriez-vous qu’un pareil spectacle attend encore son peintre!» s’écrie un des invités, en me regardant. C’est une invite à laquelle je ne répondrai point. L’art comporte une tempérance et répugne à l’énormité. Une description ne devient pas plus émouvante pour avoir mis dix au lieu d’un. On a blâmé Conrad, dans le Typhon, d’avoir escamoté le plus fort de la tempête. Je l’admire au contraire d’arrêter son récit précisément au seuil de l’affreux, et de laisser à l’imagination du lecteur libre jeu, après l’avoir mené, dans l’horrible, jusqu’à tel point qui ne parût pas dépassable. Mais c’est une commune erreur, de croire que la sublimité de la peinture tient à l’énormité du sujet. Je lis dans le bulletin de la Société des recherches Congolaises (n°2):
«Ces tornades, dont la violence est extrême, sont, à mon avis, la plus belle scène de la nature intertropicale. Et je terminerai en exprimant le regret qu’il ne se soit pas trouvé, parmi les coloniaux, un musicien né pour les traduire en musique.» Regret que nous ne partagerons point.
24 et 25 août.
Procès Sambry.
Moins le blanc est intelligent, plus le noir lui paraît bête.
L’on juge un malheureux administrateur, envoyé trop jeune et sans instructions suffisantes, dans un poste trop reculé. Il y eût fallu telle force de caractère, telle valeur morale et intellectuelle, qu’il n’avait pas. À défaut d’elles, pour imposer aux indigènes, on recourt à une force précaire, spasmodique et dévergondée. On prend peur; on s’affole; par manque d’autorité naturelle, on cherche à régner par la terreur. On perd prise, et bientôt plus rien ne suffit à dompter le mécontentement grandissant des indigènes, souvent parfaitement doux, mais que révoltent et poussent à bout les injustices, les sévices, les cruautés6.
Ce qui paraît ressortir du procès, c’est surtout l’insuffisance de surveillance. Il faudrait pouvoir n’envoyer dans les postes reculés de la brousse, que des agents de valeur déjà reconnue. Tant qu’il n’aura pas fait ses preuves, un administrateur encore jeune demande à être très étroitement encadré.
L’avocat défenseur profite de cette affaire, pour faire le procès de l’administration en général, avec de faciles effets d’éloquence et des gestes à la Daumier, que j’espérais hors d’usage depuis longtemps. Prévenu de l’attaque, et pour y faire face, M.Prouteaux, chef de cabinet du Gouverneur, avait courageusement pris place aux côtés du ministère public; ce que certains ne manquèrent pas de trouver «déplacé».
À noter l’effarante insuffisance des deux interprètes; parfaitement incapables de comprendre les questions posées par le juge, mais que toujours ils traduisent quand même, très vite et n’importe comment, ce qui donne lieu à des confusions ridicules. Invités à prêter serment, ils répètent stupidement: «Dis: je le jure», aux grands rires de l’auditoire. Et lorsqu’ils transmettent les dépositions des témoins, on patauge dans l’à-peu-près.
L’accusé s’en tire avec un an de prison et le bénéfice de la loi Bérenger.
Je ne parviens pas à me faire une opinion sur celle des nombreux indigènes qui assistent aux débats et qui entendent le verdict. La condamnation de Sambry satisfait-elle leur idée de justice?…
Durant la troisième et dernière séance de ce triste procès, un très beau papillon est venu voler dans la salle d’audience, dont toutes les fenêtres sont ouvertes. Après de nombreux tours, il s’est inespérément posé sur le pupitre devant lequel j’étais assis, où je parviens à le saisir sans l’abîmer.
Le lendemain, je reçois la visite de M.X, l’un des juges assesseurs.
–«Voulez-vous le secret de tout ceci? me dit-il; Sambry couchait avec les femmes de tous les miliciens à ses ordres. Il n’y a pas pire imprudence. Dès qu’on ne les tient plus en main, ces gardes indigènes deviennent terribles. Presque toutes les cruautés qu’on reproche à Sambry sont leur fait. Mais tous ont déposé contre lui, vous l’avez vu.»
Je prends ces notes trop «pour moi»; je m’aperçois que je n’ai pas décrit Brazzaville. Tout m’y charmait d’abord: la nouveauté du climat, de la lumière, des feuillages, des parfums, du chant des oiseaux, et de moi-même aussi parmi cela, de sorte que par excès d’étonnement, je ne trouvais plus rien à dire. Je ne savais le nom de rien. J’admirais indistinctement. On n’écrit pas bien dans l’ivresse. J’étais grisé.
Puis, passé la première surprise, je ne trouve plus aucun plaisir à parler de ce que déjà je voudrais quitter. Cette ville, énormément distendue, n’a de charmant que ce qu’elle doit au climat et à sa position allongée près du fleuve. En face d’elle Kinshassa paraît hideuse. Mais Kinshassa vit d’une vie intense; et Brazzaville semble dormir. Elle est trop vaste pour le peu d’activité qui s’y déploie. Son charme est dans son indolence. Surtout je m’aperçois qu’on ne peut y prendre contact réel avec rien; non point que tout y soit factice; mais l’écran de la civilisation s’interpose, et rien n’y entre que tamisé.
Et je ne doute pas qu’il n’y aurait beaucoup à apprendre sur le fonctionnement des rouages de l’administration en particulier; mais pour le bien comprendre, il faudrait connaître déjà le pays. Ce qui pourtant commence à m’apparaître, c’est l’extraordinaire complication, l’enchevêtrement de tous les problèmes coloniaux. La question de chemin de fer de Brazzaville à Pointe-Noire serait particulièrement intéressante à étudier; mais je n’en puis connaître que ce que l’on m’en raconte, et tous les récits que j’entends se contredisent; ce qui m’amène à me méfier de tous et de chacun. On parle beaucoup de désordre, d’imprévoyance et d’incurie… Je ne veux tenir pour certain que ce que j’aurai pu voir moi-même, ou pu suffisamment contrôler. Sans interprète, comment interroger les «Saras» que je rencontre, ces grands et fort Saras que l’on fait venir de la région du Tchad pour les travaux de la voie ferrée? Et ceux-ci ne savent rien encore: ils arrivent. Ils sont là, devant la mairie, en troupeau, répondant à l’appel et attendant une distribution de manioc, que d’autres indigènes apportent dans de grands paniers. Comment savoir s’il est vrai que, parmi ceux qui les ont précédés sur les chantiers, la mortalité a été, comme on nous le dit, consternante?… Je suis trop neuf dans le pays7.
Nous engageons, au petit bonheur, deux boys et un cuisinier. Ce dernier, qui répond au nom ridicule de Zézé, est hideux. Il est de Fort-Crampel. Les deux boys, Adoum et Outhman, sont des Arabes du Oua-daï, que ce voyage vers le nord va rapprocher de leur patrie.
30 août.
Engourdissement, peut-être diminution. La vue baisse; l’oreille durcit; aussi bien portent-elles moins loin des désirs sans doute plus faibles. L’important, c’est que cette équation se maintienne entre l’impulsion de l’âme et l’obéissance du corps. Puissé-je, même alors et vieillissant, maintenir en moi l’harmonie. Je n’aime point l’orgueilleux raidissement du stoïque; mais l’horreur de la mort, de la vieillesse et de tout ce qui ne se peut éviter, me semble impie. Je voudrais rendre à Dieu quoi qu’il m’advienne, une âme reconnaissante et ravie.
2 septembre.
Congo-Belge. – Nous prenons une auto pour Léopoldville. Visite au Gouverneur Engels. Il nous conseille de pousser jusqu’à Coquillatville (Équateur-ville) et propose de mettre une baleinière à notre disposition, pour nous ramener à Liranga, que nous pensions d’abord gagner directement.
Notre véranda est encombrée de caisses et de colis. Le bagage doit être fractionné en charges de vingt à vingt-cinq kilos8. Quarante-trois caissettes, sacs ou cantines, contenant l’approvisionnement pour la seconde partie de notre voyage, seront expédiés directement à Fort Archambault, où nous avons promis à Marcel de Coppet d’arriver pour la Noël. Nous n’emporterons avec nous, pour le crochet en Congo belge, que le «strict nécessaire»; nous retrouverons le reste à Liranga, apporté par le Largeau, dans dix jours. Brazzaville ne nous offre plus rien de neuf; nous avons hâte d’aller plus loin.
CHAPITRE II – La lente remontée du fleuve
5 septembre
Ce matin, au lever du jour, départ de Brazzaville. Nous traversons le Pool pour gagner Kinshassa où nous devons nous embarquer sur le Brabant. La duchesse de Trévise, envoyée par l’Institut Pasteur[3], vient avec nous jusqu’à Bangui, où son service l’appelle.
Traversée du Stanley-Pool[4]. Ciel gris. S’il faisait du vent, on aurait froid. Le bras du pool est encombré d’îles, dont les rives se confondent avec celles du fleuve; certaines de ces îles sont couvertes de buissons et d’arbres bas; d’autres, sablonneuses et basses, inégalement revêtues d’un maigre hérissement de roseaux. Par places, de larges remous circulaires lustrent la grise surface de l’eau. Malgré la violence du courant, le cours de l’eau semble incertain. Il y a des contre-courants, d’étranges vortex, et des retours en arrière, qu’accusent les îlots d’herbe entraînés. Ces îlots sont parfois énormes; les colons s’amusent à les appeler des «concessions portugaises». On nous a dit et répété que cette remontée du Congo, interminable, était indiciblement monotone. Nous mettrons un point d’honneur à ne pas le reconnaître. Nous avons tout à apprendre et épelons le paysage lentement. Mais nous ne cessons pas de sentir que ce n’est là que le prologue d’un voyage qui ne commencera vraiment que lorsque nous pourrons prendre plus directement contact avec le pays. Tant que nous le contemplerons du bateau, il restera pour nous comme un décor distant et à peine réel[2q].
Nous longeons la rive belge d’assez près. À peine si l’on distingue, là-bas, tout au loin, la rive française. Énormes étendues plates, couvertes de roseaux, où mon regard cherche en vain des hippopotames. Sur le bord, par instants, la végétation s’épaissit; les arbrisseaux, les arbres remplacent les roseaux; mais toujours, arbre ou roseau, la végétation empiète sur le fleuve – ou le fleuve sur la végétation du bord, comme il advient en temps de crue (mais dans un mois les eaux seront beaucoup plus hautes, nous dit-on). Branches et feuilles baignent et flottent, et le remous du bateau, comme par une indirecte caresse, en passant les soulève doucement.
Sur le pont, une vingtaine de convives à la table commune. Une autre table, parallèle à la première, où l’on a mis nos trois couverts.
Une montagne assez haute ferme le fond du pool, devant laquelle le pool s’élargit. Les remous se font plus puissants et plus vastes; puis le Brabant s’engage dans le «couloir». Les rives deviennent berges et se resserrent. Le Congo coule alors entre une suite rompue d’assez hautes collines boisées. Le faîte des collines est dénudé, ou du moins semble couvert d’herbes rases, à la manière des «chaumes» vosgiens; pacages où l’on s’attend à voir des troupeaux.
Arrêt devant un poste à bois, vers deux heures (j’ai cassé ma montre hier soir). Aimables ombrages des manguiers. Peuple indolent, devant quelques huttes. Je vois pour la première fois des ananas en fleurs. Surprenants papillons, que je poursuis en vain avec un filet sans monture, car j’ai perdu le manche à Kinshassa. La lumière est glorieuse; il ne fait pas trop chaud.
Le navire s’arrête à la tombée du jour sur la rive française, devant un misérable village: vingt huttes clairsemées autour d’un poste à bois, où le Brabant se ravitaille. Chaque fois que le navire accoste, quatre énormes nègres, deux à l’avant, deux à l’arrière, plongent et gagnent la rive pour y fixer les amarres. La passerelle est rabattue; elle ne suffit pas, et de longues planches la prolongent. Nous gagnons le village, guidés par un petit vendeur de colliers qui fait avec nous le voyage; une bizarre résille bleue marbrée de blanc couvre son torse et retombe sur une culotte de nankin. Il ne comprend pas un mot de français mais sourit, lorsqu’on le regarde, d’une façon si exquise que je le regarde souvent. Nous parcourons le village, profitant des dernières lueurs. Les indigènes sont tous galeux ou teigneux, ou rogneux, je ne sais; pas un n’a la peau nette et saine. Vu pour la première fois l’extraordinaire fruit des «barbadines» (passiflores).
La lune encore presque pleine transparaît derrière la brume, exactement à l’avant du navire, qui s’avance tout droit dans la barre de son reflet. Un léger vent souffle continûment de l’arrière et rabat de la cheminée vers l’avant une merveilleuse averse d’étincelles: on dirait un essaim de lucioles. Après une contemplation prolongée, il faut me résigner à regagner ma cabine, à étouffer et suer sous la moustiquaire. Puis lentement l’air fraîchit, le sommeil vient… De curieux cris me réveillent: je me relève et descends sur le premier pont à peine éclairé par les lueurs du four où les cuisiniers préparent le pain avec de grands rires et des chants. Je ne sais comment les autres, étendus tout auprès, font pour dormir. À l’abri d’un amoncellement de caisses, éclairés par une lanterne-tempête, trois grands nègres autour d’une table jouent aux dés; clandestinement, car les jeux d’argent sont interdits.
5 et 6 septembre.
Je relis l’oraison funèbre d’Henriette de France. À part l’admirable portrait de Cromwell et certaine phrase du début sur les limites que Dieu impose au développement du schisme, je n’y trouve pas beaucoup d’excellent, du moins à mon goût. Je relève pourtant cette phrase: «… parmi les plus mortelles douleurs, on est encore capable de joie»; et: «… entreprise… dont le succès paraît infaillible, tant le concert en est juste». Abus de citations flasques.
L’oraison d’Henriette d’Angleterre, que je relis sitôt ensuite, me paraît beaucoup plus belle, et plus constamment. Ici je retrouve mon admiration la plus vive. Mais quel spécieux raisonnement! Imagine-t-on quelqu’un qui dirait à un voyageur: «Ne regardez donc pas le fuyant paysage, contemplez plutôt la paroi du wagon, qui elle, du moins, ne change pas.» Eh parbleu! lui répondrais-je, j’aurai tout le temps de contempler l’immuable, puisque vous m’affirmez que mon âme est immortelle; permettez-moi d’aimer bien vite ce qui disparaîtra dans un instant.
Après une seconde journée un peu monotone, nous avons passé la nuit devant la mission américaine de Tchoumbiri, où nous avions amarré dès six heures. (La nuit précédente le Brabant ne s’était pas arrêté.) Le soleil se couchait tandis que nous traversions le village; palmiers, bananiers abondants, les plus beaux que j’aie vus jusqu’ici, ananas, et ces grands arums à rhizomes comestibles (taros). L’aspect de la prospérité. Les missionnaires sont absents. Tout un peuple était sur la rive, attendant le débarquement du bateau; car avant d’accoster nous avions longé quantité d’assez importants villages.
Nous sommes redescendus à terre après le dîner, à la nuit close, escortés par un troupeau d’enfants provocants et gouailleurs. Sur les terres basses, au bord du fleuve, d’innombrables lucioles paillettent l’herbe, mais s’éteignent dès qu’on veut les saisir. Je remonte à bord et m’attarde sur le premier pont, parmi les noirs de l’équipage, assis sur une table auprès du petit vendeur de colliers qui somnole, la main dans ma main et la tête sur mon épaule.
Lundi matin, 7 septembre.
Au réveil, le spectacle le plus magnifique. Le soleil se lève tandis que nous entrons dans le pool de Bolobo. Sur l’immense élargissement de la nappe d’eau, pas une ride, pas même un froissement léger qui puisse en ternir un peu la surface; c’est une écaille intacte, où rit le très pur reflet du ciel pur. À l’orient quelques nuages longs que le soleil empourpre. Vers l’ouest, ciel et lac sont d’une même couleur de perle, un gris d’une délicatesse attendrie, nacre exquise où tous les tons mêlés dorment encore, mais où déjà frémit la promesse de la riche diaprure du jour. Au loin, quelques îlots très bas flottent impondérablement sur une matière fluide… L’enchantement de ce paysage mystique ne dure que quelques instants; bientôt les contours s’affirment, les lignes se précisent; on est sur terre de nouveau.
L’air parfois souffle si léger, si suave et voluptueusement doux, qu’on croit respirer du bien-être.