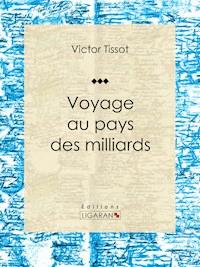
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Vous m'avez demandé, mon cher ami, pendant les deux ou trois mois que je vais passer en Allemagne, de vous envoyer quelques notes de voyage ; je n'ose donner le nom d'études à ces simples lettres, que je serai parfois obligé de vous écrire dans la salle d'attente d'une gare ou sur le pont d'un bateau à vapeur."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335043204
©Ligaran 2015
Qui n’a pas vu Berlin n’a pas vu l’Allemagne. – Le défaut de la cuirasse du colosse germanique. – Ulm. – Cathédrale et forteresse. – Le service militaire en Allemagne. – Vie de garnison.
Vous m’avez demandé, mon cher ami, pendant les deux ou trois mois que je vais passer en Allemagne, de vous envoyer quelques notes de voyage ; je n’ose donner le nom d’études à ces simples lettres, que je serai parfois obligé de vous écrire dans la salle d’attente d’une gare ou sur le pont d’un bateau à vapeur. Il faudrait un long séjour, des recherches patientes, et surtout le commerce des hommes spéciaux, pour approfondir des sujets que je n’aurai que le temps d’effleurer. Je laisse donc à d’autres le soin des grands tableaux historiques et politiques ; mes impressions et mes observations seront celles du voyageur et de l’artiste qui passe, armé de sa lorgnette et de son crayon, regardant tout, et écoutant même derrière les portes. Je voudrais, dans une suite de petits croquis, vous faire connaître d’une manière intime cette Allemagne nouvelle, telle qu’elle est sortie, l’épée à la main, du cerveau de M. de Bismarck.
Autrefois, avant nos malheurs et nos défaites, on répétait en France avec les vieux professeurs d’Université en perruque : Qui non vidit Coloniam non vidit Germaniam. Qui n’a pas vu Cologne n’a pas vu l’Allemagne. Aujourd’hui le proverbe est bien changé, et l’on peut dire que celui qui ne voit pas Berlin ne voit pas l’Allemagne. Dans ce vaste corps germanique, c’est Berlin qui a usurpé la place de la tête et du cœur : c’est lui qui pense, conçoit, médite, machine, commande, conduit, c’est lui qui ôte et qui donne, qui distribue la justice et la gloire ; c’est vers lui qu’affluent la vie et la chaleur de cette Allemagne qui n’est plus celle des légendes naïves, des douces ballades, des rêves gothiques, des saintes cathédrales, mais l’Allemagne du sang et du fer, des canons, de la mitraille et des batailles… Le chevalier Albert Dürer n’est plus arrêté dans la forêt enchantée de la poésie et de l’art, il chevauche sur les grands chemins de l’Europe, armé d’un fusil à aiguille et coiffé d’un casque à pointe.
Les bords du Rhin ne peuvent plus rien nous apprendre, sinon qu’on y élève des forteresses contre la France. Ces belles rives couvertes de pampres et couronnées de vieux châteaux ont encore conservé, il est vrai, l’attrait du pittoresque. Mais est-ce le moment pour nous d’avoir le cœur léger, et de nous livrer à des voyages de plaisir ? « Si nous avions su ! » disions-nous après la guerre, pour excuser nos fautes, notre paresse à rester chez nous et à ne nous pas inquiéter de ce qui se fait et se trame ailleurs. Notre ignorance de nos voisins, telle a été, on nous l’a dit assez, une des causes de nos désastres. « Nous nous sommes, selon la pittoresque expression d’un chroniqueur, trop longtemps complu, comme les fakirs de l’Inde, à nous regarder le nombril dans une muette extase.
« Si nous avions su ! » Eh bien ! à l’avenir, sachons ! Sachons que les Allemands fouillent nos contrées en tous sens ; qu’ils étudient notre langue, nos mœurs, nos institutions ; qu’ils nous suivent pas à pas, nous épiant partout ; qu’ils connaissent mieux la France que nous ne la connaissons nous-mêmes. Voilà trente ans qu’ils s’appliquent à promener leur loupe sur notre pays. C’est de l’espionnage, si l’on veut, mais de l’espionnage qui ressemble beaucoup à de l’étude. Sachons donc faire chez eux ce qu’ils font chez nous. Le défaut de la cuirasse du colosse germanique n’est pas si difficile à trouver.
Partie pour repousser l’invasion, l’Allemagne s’est laissée emporter par l’esprit de conquête et est revenue dans ses foyers avec une arrière-garde de vices qu’elle ne connaissait pas et un despotisme qu’elle avait brisé par des luttes séculaires. Une fois sortie de sa voie civilisatrice et humaine, elle est rentrée dans ses forêts barbares ; elle n’a plus de loisirs studieux, elle a perdu la tradition de ses anciennes vertus domestiques ; en proie à tous les appétits matériels, elle oublie Dieu, ou le renie, et ne croit plus qu’au triomphe suprême du canon. De peur d’être débordé par la Révolution, le nouvel empire a été forcé de contracter une alliance avec elle.
Voyez les socialistes suivre en Allemagne d’un œil attentif et réjoui la décomposition morale qui commence dans cette atmosphère de matérialisme et d’orgueil. Ils savent bien qu’un jour ils descendront dans l’arène avec leurs gourdins noueux, et que cette arme suffira pour mettre en fuite ceux qui enferment l’âme dans une cellule et le patriotisme dans un viscère.
Les catholiques s’agitent aussi avec passion, ils sont en lutte ouverte avec le pouvoir. Déjà le sang a coulé : qu’on se rappelle les troubles de Trêves.
À distance, on pourrait encore se tromper sur tant de symptômes alarmants ; mais là-bas, je sais qu’en appliquant l’oreille, on entend les pulsations d’une nation profondément travaillée et mal à l’aise. Serait-ce pour échapper au danger et préparer une habile diversion que les orateurs du Parlement et les journaux officieux de la Prusse entretiennent l’esprit du peuple dans une fièvre belliqueuse, et semblent regretter les milliards oubliés sur les bords du Rhône et de la Garonne ? Des esprits très sérieux le prétendent, car ce n’est plus que sur le champ de bataille que peut s’accomplir la réconciliation des catholiques avec leurs adversaires.
Nous commencerons notre voyage, si vous le voulez bien, par une pointe dans les États du Sud. Il me semble intéressant, avant de franchir les portes de la capitale impériale, d’interroger ces anciennes provinces qui ont sacrifié leur autonomie et leur liberté à une bouffée de gloire. Le plat de lentilles dure-t-il encore ? Est-on revenu de tant d’illusions et ne regrette-t-on pas un peu le bon vieux temps ?
La tâche me sera d’ailleurs rendue attrayante par les fêtes qui se préparent à Stuttgard, à l’occasion du mariage de la grande-duchesse Véra avec le prince Eugène de Wurtemberg. Il y aura grand bal à la Wihelma, palais d’été du roi ; représentation au Kœnigsbau, donnée par les dames de la cour ; bénédiction nuptiale, en présence du czar, dans la chapelle du château, et grande revue.
Il y a quelques heures, je suis arrivé à Ulm ; et j’en repars, après avoir vu la cathédrale et la citadelle.
La cathédrale d’Ulm, malgré l’abandon dans lequel on la laisse, et les réparations urgentes qu’elle réclame en vain depuis dix ans, n’en est pas moins un des plus beaux monuments de l’art religieux du quatorzième et du quinzième siècle. Après le Dôme de Cologne, c’est la plus grande cathédrale gothique d’Allemagne. On aborde ce chef-d’œuvre par une petite place qu’entourent encore des maisons aux pignons pointus, avec des lucarnes et des fenêtres à losanges, des portes ornées de merveilleuses serrureries. Le Moyen Âge vous sourirait partout, sans les militaires wurtembergeois, badois et bavarois qui passent d’un pas lourd, et sans les revendeurs de meubles d’occasion qui ont pris la place, dans ces anciennes boutiques à auvent, des marchands de chapelets, de cierges bénits, de médailles et de fleurs. Le soir, les lanternes, étoiles discrètes, ne s’allument plus derrière les étalages : c’est le gaz qui vous brûle les yeux ; et la mélodie des cantiques, se confondant avec la voix des orgues, est remplacée par les couplets obscènes de quelque sergent aviné.
Après avoir admiré et les fresques du portail, et les statues de saints qui veillent encore, sentinelles éternelles, dans leurs niches de pierre, et la grille de fer, plus fine et plus légère qu’une dentelle flamande, j’ai été frapper chez le bedeau, homme épanoui et bien portant, qui vit des étrangers visitant « sa » cathédrale. C’est par sa chambre qu’on pénètre dans l’église. On débouche sous une voûte latérale, et le merveilleux effet d’ensemble de cette forêt de colonnes, de colonnettes, de piliers qui semblent supporter le ciel même, est totalement perdu. En revanche, l’œil peut se promener à l’aise sur d’immenses murailles décorées de vieux trophées enlevés aux Turcs, à Belgrade, et sur d’énormes toiles d’araignées qu’on vous montre, avec un sourire ironique, comme les « étendards de la Prusse. » À gauche, on a découvert d’anciennes fresques : la légende de sainte Catherine ; on n’a rien fait pour les garantir contre l’humidité, et elles disparaissent insensiblement.
Mais je n’en finirais pas, si je voulais vous décrire dans tous leurs détails les trésors de cette cathédrale. Je vous dirai cependant deux mots des verrières qui ont conservé leur couleur éclatante, et donnent à la pauvre église délabrée, veuve de son Saint-Sacrement, de ses lampes d’or, de ses fleurs et de ses parfums, l’aspect d’une reine en haillons, qui n’a gardé de ses anciennes parures que son collier.
Voici d’abord la création : l’Éternel tire le monde du chaos, il crée les arbres, les prairies, les éléments, les animaux et l’homme. Puis c’est la tentation d’Adam et d’Ève dans le paradis terrestre. Le serpent porte une tête de femme. Le déluge submerge la terre ; Noé grimpe dans la cheminée de l’arche et sort une tête impatiente, pour consulter le ciel. Jésus est né : saint Joseph, avec des besicles sur le nez, lit à côté de la crèche, dans un beau livre à tranches dorées. Ces singularités n’ont rien de ridicule et de choquant, elles ajoutent au contraire au charme de ces peintures. Quand, sur une autre verrière, on voit Caïn qui tire en tremblant son chapeau à Dieu le Père apparaissant au milieu d’un nuage, on se dit que c’est là un garnement dont la conscience est bien mauvaise.
La perle artistique de la cathédrale d’Ulm est la chapelle du Saint-Sacrement. On ne peut rien imaginer de plus aérien, de plus hardi, de plus gracieux ; on dirait de la pierre fondue. Figurez-vous un mélange de dentelures, de ciselures, un fouillis d’ornements capricieux, des festons, des aiguilles qui se croisent et s’entrecroisent, des trèfles, des étoiles, des broderies ; une végétation de stalactites travaillée par le ciseau d’un Michel-Ange et guillochée par la main d’un Benvenuto. La description de cet autel, qui n’a son pareil au monde qu’à Nuremberg, à l’église de Saint-Laurence, ne se peut faire. Il faut que la gravure ou la photographie vienne à l’aide de la plume et de la parole. C’est une petite cathédrale dans la grande cathédrale ; c’est une ballade à la fois gaie et pieuse, qui sert d’épigraphe au majestueux poème gothique. À droite, sur la balustrade de l’escalier, sont couchés huit dormeurs, l’air heureux et tranquille : c’est le sommeil du juste. À gauche, des crocodiles, des lézards, des serpents s’agitent dans des contorsions douloureuses : c’est le sommeil du méchant. Fantaisie charmante qu’on ne se lasse pas d’admirer, tellement sont parlantes et vivantes ces têtes d’hommes et d’animaux ! D’autres statuettes, qui ressemblent bien plus à des gnomes qu’à des saints, sont perchées sur des arbres de pierre et vous souhaitent mille félicités. Le tabernacle est non seulement gardé par des anges, mais par des dragons, des chiens, des ours, au milieu desquels se tient un moine qui les guide et les surveille.
Au pied du tabernacle, un chevalier de grandeur naturelle est à genoux, les mains jointes. C’est le fondateur de la chapelle. On lit cette inscription sur la console :
La chronique rapporte que ce Ehinger Habvast donna, à sa mort, toute sa fortune à un fabricant de toile, avec obligation d’en employer les intérêts à la construction d’un tabernacle. Telle est l’origine de ce chef-d’œuvre.
Dans le chœur, des richesses à profusion. Les stalles sont ornées des têtes des sept sages de la Grèce, des sibylles de Delphes, de Tibur, de Cumes, etc., des figures des saints et des femmes de la Bible, de celles des apôtres et des vierges martyres ; Cicéron, avec une barbe à la Jules Favre, coiffé d’un bonnet pointu, a la physionomie d’un brigand des Abruzzes. Pythagore joue philosophiquement de la mandoline. Parmi les têtes de femmes, il y a celle de la sibylle de Tibur, qui a la mélancolie rêveuse des vierges allemandes. On la dirait à demi endormie et l’on marche doucement de peur de la réveiller. La tête de sainte Cécile est aussi un miracle de sculpture sur bois. Elle rappelle l’angélique création de Raphaël.
Une des furies qui ornent les stalles est, dit-on, le portrait de la femme du maître-sculpteur. Il se consola de la sorte de ses chagrins domestiques.
Je passe devant la chaire, autre merveille, autre bijou gothique ; je passe également sans m’arrêter devant des tableaux qu’envient les musées de Dresde et de Florence, et je monte sur la plate-forme du clocher, ou plutôt de la tour. L’ascension est longue, bien que la flèche, qui devait avoir le double de hauteur de celle de Strasbourg, n’ait pas été commencée. Je sonne pour avertir le veilleur. C’est un petit homme maigre, pâle, qui a des yeux de chauve-souris, qui parle par signes.
D’ici, le panorama est immense, les plaines de la Souabe se déroulent comme une vaste mer jusqu’à l’horizon brumeux. Le Danube, encore enfant, se berce entre ses deux rives vertes. Sur les collines voisines, des retranchements, des fortifications, des forts avancés. Ils datent de 1845 et ont été construits d’après le nouveau système par le général prussien de Prittwitz. Je compte, enveloppant la ville comme un véritable rempart, une quinzaine de casernes aux dimensions colossales : à droite, au bord du Danube, les casernes des Bavarois, toutes neuves, en grès rouge couleur de sang. La garnison actuelle d’Ulm se compose de 30 à 40 000 hommes. Conduit par une pensée douloureuse, mon regard se porte des casernes sur le cimetière, qu’ombragent là-bas quelques arbres au feuillage noir. Je vois d’ici le lambeau de champ mortuaire réservé aux prisonniers français. Combien sont morts dans les baraquements d’Ulm, sans consolations, au milieu des neiges ! Les mères seules le savent. Quelque chose doit cependant adoucir leur douleur : les chers morts n’ont pas été indignement jetés à la voirie ; des mains pieuses ont semé quelques fleurs sur leurs tombes, et la croix qui les orne fait de cette terre étrangère une terre française.
Le soir approche, redescendons de la tour et montons en hâte à la citadelle. Pourrons-nous y entrer ? Les personnes que j’ai interrogées m’ont répondu non ; mais c’est l’heure où les officiers se promènent sur le perron de la gare, attendant l’arrivée des trains pour passer les voyageuses en revue ; nous avons chance de trouver un caporal complaisant.
Je débouche d’un chemin que borde une haute haie, et me trouve en face du pont-levis. Je hèle la sentinelle. Elle s’approche. « Voulez-vous me permettre d’entrer ? – Passez au corps de garde ! » J’entre dans une salle qui sent mauvais ; quelques soldats sont couchés sur des paillasses crasseuses ; d’autres, attablés près de la fenêtre, boivent, fument et jouent aux cartes. Je répète ma demande. Un jeune sergent m’examine deux minutes, sans mot dire, puis, s’adressant à un de ses hommes : « Accompagnez monsieur. »
Nous visitons d’abord l’intérieur de la citadelle, nous parcourons de longs et sombres couloirs dont les murs n’ont pas moins de dix mètres d’épaisseur ; de distance en distance s’ouvre une meurtrière habilement ménagée pour mettre le tireur à l’abri. Les casemates ont des proportions babyloniennes. Nous traversons une vaste cour : des obus sont entassés en pyramides, des canons s’allongent paresseusement sur leurs affûts.
Mon guide, conscrit de l’année dernière, aime à causer.
– Si je n’avais pas été si pressé, je tirais un bon numéro et j’étais quitte…
– Comment ! la conscription par tirage au sort existe encore chez vous ? Voilà une chose dont on ne se doute pas en France.
– Mais, monsieur, elle a toujours existé en Prusse, depuis que Frédéric II remplaça l’armée de mercenaires par l’armée nationale. Ceux qui tirent un bon numéro ne peuvent être incorporés que dans la landsturm ; quant aux autres, ils doivent bon gré mal gré faire leurs cinq ans. Seulement, le rachat, tel que vous l’aviez en France, n’a jamais été admis.
– Les conscrits restent-ils trois ans en service actif ?
– Non ; cela coûterait trop cher. Il n’y a qu’un tiers du contingent annuel sous les drapeaux. Le contingent est fixé chaque année par le gouvernement, selon les ressources du budget, les besoins momentanés de l’État, et le nombre d’engagés volontaires. En général, on accorde un congé à ceux qui, au bout de la première année, ont montré du zèle et de la bonne conduite. Il suffit qu’on ait des cadres capables ; le reste va tout seul.
À ce moment, des hommes de corvée passèrent, chargés de grands sacs ; un de ces sacs s’ouvrit et une demi-douzaine de pains roulèrent à terre.
– C’est votre pain de forteresse ? dis-je.
– Ah ! oui, il est noir comme du charbon. En France, le pain du soldat est du bon pain ; nous ne sommes pas gâtés sous le rapport de la nourriture, et si nous ne pouvions pas de temps en temps nous payer une cruche de bière et un plat de choucroute, nous serions bien malheureux. Le matin, on nous donne une espèce d’eau grisâtre qu’on appelle du café ; à midi, une soupe, du bœuf ou du lard ; le soir une soupe à la farine. Et avec cela, levés à cinq heures et manœuvrant jusqu’à la nuit.
Nous étions arrivés près d’un échafaudage qui conduis sait sur le couronnement même de la citadelle, où s’exécutaient divers travaux. Mon conscrit voulut me faire monter, mais il comptait sans une sentinelle qui fit le geste de nous coucher en joue, si nous avancions d’un pas.
Ces arguments-là sont sans réplique. Nous revînmes à notre point de départ, en traversant encore des cours encombrées d’obus et de canons, comme à la veille d’une nouvelle guerre.
Les recrues d’Ulm sont particulièrement exercées au tir et à la gymnastique. Deux heures chaque jour on leur fait viser des mannequins qui ont une ressemblance frappante avec la silhouette des zouaves et des turcos. Les maîtres de tir sont tous, de même que les officiers supérieurs, d’origine prussienne ; ils sortent de l’école de tir de Spandau, près de Berlin.
Les exercices quotidiens de gymnastique et d’escrime se font sous la surveillance d’un officier qui a passé au moins un an à l’école centrale de gymnastique à Berlin.
On les exerce souvent aussi à des simulacres de guerre. Dernièrement, les conscrits bavarois s’emparaient par surprise de la gare d’Ulm, faisaient les employés prisonniers, tandis que les « bataillons de chemins de fer » confisquaient le matériel et organisaient le service comme en pays ennemi. Quelques jours auparavant, les mêmes soldats s’étaient « exercés » à réquisitionner un village comme des carabins s’exercent à amputer une jambe. Mais pendant qu’ils mettaient les paysans à la porte de leurs propres demeures, le corps ennemi, « les Français, » arrivait et les obligeait à déguerpir par le plus court.
– Nous ayons laissé aux Français l’honneur de nous battre ; il faut bien supposer que nous serons aussi une fois rossés, ajouta, – mais d’un air peu convaincu, je dois le dire, – le conscrit, en me souhaitant bon voyage.
Ulm était autrefois une forteresse fédérale de premier rang. Les tacticiens allemands prétendent qu’une armée de 200 000 hommes serait impuissante à l’assiéger. La citadelle ou le fort principal dont nous venons de sortir s’appelle le Wilhelmsburg. Il couronne le mont Michel, et commande, d’un côté, la plaine jusqu’au bord du lac de Constance, et de l’autre, il balaye le plateau qui conduit à Stuttgard. Six mille soldats manœuvrent à l’aise dans le Wilhelmsburg. Il est question de transférer à Ulm les établissements militaires, les fonderies, les fabriques de poudre de la Bavière, et de lancer en même temps sur les eaux du lac de Constance, à la barbe des fils de Guillaume Tell une flottille cuirassée dans le genre de celle qui manœuvre déjà sur le Rhin. Ulm, Rastadt, Ingolstadt, Germersheim forment la première ligne de défense de l’Allemagne, de ce côté. En déployant la nouvelle carte de l’empire, on remarque que les plus importantes gares de chemins de fer, l’embouchure des fleuves et les ports de mer sont tous protégés par des forteresses. Ulm défend l’entrée du Danube comme Strasbourg défend l’entrée du Rhin, Metz l’entrée de la Moselle. Ulm est une barrière contre l’Autriche, c’est aussi une barrière contre laquelle une armée française traversant la Suisse peut venir se briser.
La vie de garnison est passablement monotone à Ulm. Les officiers ne fréquentent que le restaurant de la gare, une ou deux brasseries, et leur cercle, où ils peuvent lire les revues militaires qui se publient dans le monde entier. Le cercle des officiers reçoit deux cent cinquante journaux, parmi lesquels se trouvent bon nombre de feuilles françaises, russes et italiennes. Ce ne sont pas les moins lues.
Avant la guerre, il était rare qu’un officier eût une maîtresse attitrée. La solde étant aujourd’hui meilleure, l’esprit de famille en décadence, l’élément féminin joue son rôle dans la vie des officiers et des chefs supérieurs ; l’antique vertu allemande se voile la face, mais un peu à la manière de ces femmes qui ne s’abritent derrière leur éventail que pour mieux voir à travers.
Il faut six mois de frottement aux conscrits qui arrivent de la campagne pour se dégrossir. Jusqu’alors ils sont d’une grossièreté sauvage. On a dû faire mettre deux boutons sur les manches de leurs capotes pour les empêcher de s’en servir au lieu et place de mouchoir ! il est rare aussi que, le dimanche, il n’y ait pas de rixes sanglantes. Ce jour-là, on défend aux soldats de porter leur sabre. Autrefois, Ulm était le théâtre de véritables batailles : trois, quatre cents Bavarois assaillaient dans la rue les conscrits wurtembergeois, qui étaient souvent obligés de se réfugier en toute hâte derrière les murs de leur forteresse. L’antagonisme existe encore, mais le caporal prussien est là, la cravache haute, comme Bidel dans sa cage.
Encore la forteresse. – L’alpe-Rude. – Vieilles ruines et vieilles chansons. – Le Wurtemberg. – La Vallée du Neckar. – Les chasseurs d’hommes.
En sortant d’Ulm, le chemin de fer passe sous la citadelle, élevée à l’endroit même où, le 20 octobre 1805, 30 000 Allemands se rendirent sans conditions au général Bernadotte, et furent emmenés prisonniers en France, – seul souvenir historique qui puisse adoucir pour nous la honte de la capitulation de Metz ! La voie ferrée traverse une série considérable de fossés et de retranchements. Comme Mayence, Strasbourg, Magdebourg, Ulm a pris un très grand développement militaire depuis quatre ans. Les fortifications, pour lesquelles on a déjà employé 4 millions de thalers de l’indemnité de guerre, ont été complétées et agrandies par la construction de six forts détachés, qui rendent la place presque imprenable.
Le ciel s’est rembruni depuis une heure ; quand nous arrivons, traînés par deux puissantes locomotives, au sommet de la Rauhe-Alp, l’Alpe-Rude, à 916 mètres au-dessus de la mer, nous sommes assaillis par une rafale de neige. Autour de nous s’ouvrent des précipices sans fond et se dressent des sapins gigantesques, enveloppés dans leur manteau blanc, comme les fils de l’hiver. Mais voici Geislingen, célèbre par ses filatures. Celle de M. Staub renferme aujourd’hui 28 000 broches et 550 métiers à tisser. C’est une véritable cité ouvrière, avec une église, des écoles pour les deux sexes, des salles de récréation, de lecture, une bibliothèque, un théâtre, une maison de bains, une caisse d’épargne, etc. Les ouvriers sont logés dans de confortables petites maisons, entourées d’un jardin planté d’arbres, où les enfants peuvent jouer sous l’œil maternel. Le jury de l’Exposition universelle de Paris a décerné à M. Staub un prix de 10 000 francs et la grande médaille d’or.
Après Geislingen, c’est Gœppingen, berceau de la maison de Hohenstauffen. On continue de descendre ; le paysage est sévère, encadré de hautes montagnes couvertes de neiges. À Esslingen, des lions de pierre gardent l’entrée de la ville, dont les remparts, encore intacts, datent de 1216 ; M. de Thou, qui s’y arrêta en 1579, écrivait que c’est « un lieu renommé pour la fabrique de l’artillerie et l’abondance de ses vins. » On ne fabrique plus de canons dans la vieille cité guerrière, mais on y fabrique une espèce de champagne qui continue avantageusement l’œuvre destructive de l’ancienne artillerie.
Le pays qui nous entoure est des plus pittoresques. Partout des parois de roches d’où jaillissent des cascades ; sur la crête des montagnes, à l’entrée des vallées, l’œil découvre des châteaux en ruines, des pans de murs que le lierre protège contre l’assaut du temps. Primitivement, ces châteaux furent la demeure de chevaliers pillards et brigands du genre de ceux qui rançonnaient les voyageurs sur le Rhin. Le plus sauvage d’entre eux, Eberard de Wurtemberg, prit cette devise : « Ami de Dieu, ennemi de tous. »
Ces petits seigneurs affectaient de se donner des noms d’animaux, soit pour se faire mieux redouter, soit par amour des forêts, des montagnes, et des fauves qu’ils y chassaient. Ainsi nous trouvons dans l’histoire, à cette époque, Albert l’Ours, Henri le Lion, Erhard le Loup, etc.
Sous le règne de Frédéric II le Glorieux, un de ces chevaliers, surnommé à bon droit le chevalier Mange-Pays, fut mis au ban de l’empire. Il quitta son château des bords du Neckar à la faveur des ténèbres, et l’on n’entendit plus parler de lui.
Un jour, après une bataille livrée aux musulmans, Frédéric, frappé des prodiges de valeur d’un de ses cavaliers portant une armure noire et tenant toujours sa visière baissée, le fit appeler et le pria de se découvrir pour recevoir la récompense qu’il méritait. Le mystérieux guerrier obéit et montra en souriant, aux seigneurs allemands assemblés, la redoutable figure du chevalier Mange-Pays. Frédéric, touché de sa belle conduite et de son repentir, lui pardonna.
Autres traits de ces seigneurs souabes, qui ont joué un si grand rôle sur la scène que nous parcourons :
Le baron de Krenking, à Teng, sur le lac de Constance, simple chevalier et propriétaire d’une terre, reçut le grand empereur Barberousse comme son égal. Il resta assis et couvert devant cette majesté qui portait la boule du monde dans sa main. « Excusez-moi, dit-il, de ne pas me tenir debout : je suis ici dans mon aire, maître comme vous dans la vôtre ; je ne suis vassal de personne ; je ne dois mon alleu qu’à la bonté du Dieu éternel et du soleil allemand. Je vous honore, du reste, comme l’empereur de l’empire. »
Une autre fois c’est Henri le Lion qui fait le pari d’effrayer le terrible Thelde de Wallmode. Henri s’approche du géant par derrière et le mord au poignet. Mais celui-ci, sans s’émouvoir, se retourne et applique à Henri un soufflet qui l’étend à terre. Alors éclatant de rire, il s’écrie ; « Eh ! lion, tu n’es donc qu’un chien ? »
Aux sauvages cris de guerre, succédèrent bientôt dans ces orgueilleux manoirs les chants pieux et doux des Minnesænger. La Souabe est leur poétique berceau. Ce fut la colombe soupirant dans le nid de l’aigle. Ces cœurs de rudes chevaliers, qui ne battaient que dans la mêlée sanglante, s’attendrirent à la vue de la femme affranchie par le christianisme, et qui leur apparaissait avec la céleste auréole des vierges du Moyen Âge. L’amour devint pour ces hommes de fer et de sang un sentiment héroïque et religieux que les Minnesænger célèbrent dans des vers immortels. Cette poésie des troubadours souabes est encore fraîche et jeune comme le jour où elle naquit à l’ombre des tourelles gothiques. Son soleil n’a point pâli, ses fleurs ont conservé leur éclat et leur parfum, ses sources leur limpidité et leurs murmures, ses forêts leurs mystères, ses clairs de lune caressent encore des ombres de femmes blanches et vaporeuses comme des visions.
Y a-t-il dans la littérature du Moyen Âge beaucoup de noëls plus gracieux que celui de Jean Tauler ?
« Voyez, chante-t-il, arriver ce navire chargé jusqu’au bord ; il porte le fils de Dieu avec sa grâce et sa puissance ; il porte aussi le Verbe éternel de Dieu le Père. Le navire approche doucement. Sa voile, c’est l’amour ; son mât c’est le Saint-Esprit. Enfin le navire de Dieu jette l’ancre. Le Verbe de Dieu devient homme pour nous. Le Fils divin nous est envoyé… Et si, comme vassal de Dieu le Père, vous voulez participer à l’éternité, vous devez d’abord souffrir, vous crucifier, puis mourir. »
Tel était le langage de ces naïfs troubadours souabes que Uhland, Geibel et toute la pléiade romantique ont si maladroitement imités, à part Uhland peut-être, qui, dans certaines de ses ballades, a su retrouver cette grâce sans apprêt des Minnesænger, ses compatriotes. Uhland est mort il y a dix ans, à Tubingue, mais ce ne sont point les plus belles dames de la ville qui l’ont porté en terre, comme celles de Cologne portèrent le poète Frauenlob au treizième siècle. Sa tombe n’a pas été non plus, comme celle du Minnesænger, arrosée de vin parfumé ; il n’y est tombé que deux ou trois discours de professeurs d’Université, bien lourds et bien secs.
De toutes les provinces germaniques, la Souabe fut celle où la chevalerie poussa les racines les plus profondes. Au dix-septième et au dix-huitième siècle, il existait encore une quantité de villages et de domaines seigneuriaux, d’évêchés, d’abbayes, de bailliages. Le pays était uniquement gouverné par la noblesse. C’est à Napoléon que le peuple doit son affranchissement.
Nous avons quitté les régions désolées de l’Alpe-Rude pour descendre dans la vallée du Neckar. Ici tout est fertile et riant. De gentils moulins babillent avec l’onde claire des ruisseaux. Les arbres fruitiers couverts d’une neige de fleurs remplacent les sombres sapins ; la vigne, plantée par les légionnaires romains, tapisse les coteaux ; des villages s’encadrent dans le frais paysage, de blanches villas couronnent les hauteurs. Qui se douterait que, dans cette belle et riche vallée, il se forma, en 1619, pendant les guerres de religion, des associations d’anthropophages, qui donnaient la chasse à l’homme pour le tuer et le manger ?
Stuttgard. – Café des dames. – Le roi et la reine. – Le Château-Vieux. – Un menu wurtembergeois. – Le fils de Schiller.
C’est une ville à la physionomie heureuse et gaie que la capitale du Wurtemberg. Tout autour, des collines que le pampre décore ; un splendide horizon de verdure ; des jardins publics avec plus de fleurs que de militaires et de bonnes d’enfants ; de beaux édifices ; beaucoup d’écoles excellentes ; des rues larges, pleines d’air et de soleil ; un vieux château encore endormi dans le passé ; des maisons gothiques qui ne semblent pas se douter que les anciens fossés sont comblés et les remparts abattus ; une population ouverte, bruyante, peut-être un peu trop amie du plaisir et de la bonne chère ; un souverain qui règne et ne gouverne pas, voilà Stuttgard, et voilà ce qui rend le séjour de cette ville si agréable aux étrangers. Il y a en ce moment dans les nouveaux quartiers 3 000 Américains et 2 000 Anglais. C’est la retraite du sage. On y vit tranquille, loin de la politique, loin de l’arsenal et de la caserne. Tous les cultes y ont leur église ouverte ; si ce n’est pas encore le pays de la liberté, c’est celui de la tolérance.
Essentiellement conservateur, se défiant des innovations comme des révolutions, le peuple wurtembergeois s’est peint d’un trait en 1848. La populace, ameutée devant le château, demandait l’abdication du roi. Guillaume ne se fit pas prier ; il prit son chapeau, sa canne et son parapluie et descendit dans la cour. « Vous ne voulez plus de moi, dit-il au peuple ; eh bien ! pas tant de vacarme, je m’en vais de ce pas. » Il se rendit à Ludwisbourg, où les ambassadeurs, la noblesse et les étrangers ne tardèrent pas à le rejoindre.
Au bout de quinze jours, les bons Stuttgardois, qui avaient chassé leur souverain, lui envoyaient une députation pour le supplier de revenir, « attendu que la capitale était déserte, que le commerce n’allait plus, que tout le monde se trouvait dans la gêne ou la misère. » Guillaume rentra à son château au milieu de la joie universelle ; ceux qui avaient voulu le lapider lui élevèrent des arcs de triomphe.
– Que n’avons-nous quelques-uns de vos défauts ? me disait hier, en parlant de cette sagesse populaire, un Souabe, joufflu comme Éole et ventru comme Bacchus.
– Oui, la légèreté ! lui répondis-je en riant.
Le rêve de tout Wurtembergeois n’est pas de devenir caporal, mais aubergiste. Le roi actuel, propriétaire de deux restaurants et d’un café, est lui-même le premier restaurateur de son royaume.
Avoir un débit de vin ou de bière, un restaurant, une auberge ou un hôtel, un lieu où l’on donne à boire ou à manger, c’est, ici, avoir la considération et la fortune. Le maître d’hôtel chez qui je loge est conseiller d’État et décoré de plusieurs ordres. C’est l’homme le plus influent de la capitale : il fait crédit aux princes, il relève les ducs qui titubent et nourrit les généraux.
Si la valeur guerrière des Souabes ne brille plus aujourd’hui de son ancien éclat, leur réputation de premiers mangeurs de l’empire est restée intacte. Leur appétit n’est pas seulement remarquable, il est effrayant. Ils ne mangent pas, ils engouffrent. « Les Allemands, a déjà dit Montaigne, boivent et mangent quasi également de tout avec plaisir ; leur fin c’est l’avaler, plus que le gouster. »
Entrez dans un restaurant ou dans une brasserie à n’importe quelle heure de la journée, vous rencontrez des gens attablés devant des montagnes de purée, derrière des remparts de choucroute hérissés de saucisses longues comme de petits canons. Ils boivent la sauce des plats en se pourléchant voluptueusement les lèvres. Ils garnissent leur bœuf de confitures, et croiraient manquer à l’honneur s’ils ne mangeaient pas une galette et une crème à leur dessert. Après quoi ils prennent du café au lait avec des gâteaux, le pousse-café, kummel ou kirsch, puis trois ou quatre chopes de bière de Munich. Quatre heures sonnent, et il est de bon ton de demander de nouveau du café. Ils avaleraient la Jamaïque si elle était à leur portée.
Les dames ont droit de cité dans les établissements publics. Elles se donnent rendez-vous au café comme les hommes ; et, de même que ceux-ci y font leur correspondance, elles s’y livrent aux travaux de leur sexe, confectionnent des rideaux, des chemises et autres objets de toilette intime, tout en suçant une côtelette ou en savourant un bol de café au lait aux dimensions de chaudière. Dans la plupart des cafés de Stuttgard, vous lisez, en français, sur la porte d’une salle réservée :
CAFÉ DES DAMES.
Elles sont là, chaque après-midi, réunies au nombre de vingt, trente ou quarante. Un jour c’est la frau ministerialrathin K… (Mme la conseillère ministérielle K…) avec sa fille fraulein ministerialrathin Zenobie (Mlle la conseillère ministérielle Zénobie), qui fait les honneurs de la table ; une autre fois, c’est la frau hofapothekerin (Mme l’apothicaire de la cour) qui a lancé les invitations. Je vous laisse à penser tout ce qui se débite sur le dos du prochain dans ces réunions appelées couronnes, en allemand Krantz, probablement parce qu’on y tresse des guirlandes de cancans.
Pendant que les dames, la plupart du temps en grande toilette, mangent et boivent, les messieurs fument leur cigare dans une salle voisine en vidant forces chopes et carafons.
Le moyen, je vous le demande, à un peuple qui digère si bien d’être méchant ! Il a essayé de résister aux empiétements de la Prusse pendant un an ou deux ; mais aujourd’hui, fatigué de son effort, il est retourné à sa bière et à ses jambons, ne s’inquiétant pas plus de M. de Bismarck que du roi Charles.
Il n’existe peut-être pas de monarchie au monde où le souverain ait moins de prestige. Autant le feu roi Guillaume exerçait d’influence dans l’Allemagne du Sud, autant il savait faire respecter ses volontés, autant le roi actuel est sans force. Son esprit flottant, irrésolu, en a toujours fait un instrument docile dans les mains des courtisans. Il passe la plus grande partie de sa journée à croquer des bonbons et à tambouriner aux fenêtres. Il est féroce sur l’étiquette et règle lui-même la toilette des dames de la cour. Chaque matin, il descend pour voir si l’on cire bien les souliers et il met lui-même son vin en bouteilles. On l’a surnommé Charles le Téméraire, parce que, en 1866, on ne put jamais le décider à accompagner ses soldats contre les Prussiens. Quand il doit monter à cheval, on a soin de fatiguer toute la nuit le coursier destiné à le porter. Sa figure est vulgaire ; sa taille est petite. À voir la façon ennuyée dont il se promène avec son fidèle Spitzenberg, l’agent de confiance de la Prusse, on dirait qu’il n’attend que le bon plaisir de M. de Bismarck pour mettre une housse sur son trône et s’en aller pêcher à la ligne sur une rive inconnue. Tout ce qui touche à la politique ne l’intéresse pas. Il étudiera l’effet d’une cravate, d’un ruban, mais rarement une question de diplomatie. Un de ses plus grands passe-temps est de changer la coupe de sa barbe. Tantôt il la porte longue comme le législateur des Hébreux, tantôt courte ; quelquefois il se fait entièrement raser. Cette innocente manie ne manque pas d’être coûteuse à ses courtisans et aux fournisseurs de la cour, obligés d’avoir des portraits de rechange de Sa Majesté, selon l’aspect que présente sa figure.
La reine s’appelle Olga, et dans leurs moments de gaieté les Wurtembergeois appellent leur souverain Olgus. La reine, fille de l’empereur de Russie, a des qualités de race : elle est chevaleresque, distinguée, belle, spirituelle. Elle est « le roi. » Elle laisse son mari remplir consciencieusement son rôle de majordome du palais, surveiller la domesticité, passer en revue les provisions, décréter des toilettes, tandis qu’elle lit les rapports des ministres, donne des ordres, et essaye de maintenir sa barque loin du maelstrom prussien. Elle a fort à lutter ; le roi l’entrave plus qu’il ne l’aide dans cette pénible manœuvre.
C’est en Italie que Charles de Wurtemberg a fait la connaissance de la princesse Olga. Le mariage eut lieu à Palerme. On raconte que la colonie allemande de cette ville planta, en commémoration de cette union, deux orangers dont on envoie les fruits chaque année à la reine.
Le château royal, triste et morose sous ses rubans et ses guirlandes de pierre, reflète l’esprit de celui qui l’habite. Trois sentinelles se promènent en bâillant, et des laquais en livrée rouge et bleue sont paisiblement assoupis sur les bancs du péristyle. Le palais de la Belle au bois dormant n’était pas plus silencieux. Et cependant on est à la veille d’y célébrer un beau mariage, d’y contracter une grande alliance ; mais rien de cette joie ne transpire ; il n’y a pas une fleur au portail, un sourire aux fenêtres, un drapeau au toit. C’est une fête chez les ombres.
Ce château, si vivant naguère, si brillant et si joyeux alors que le souverain se sentait le seul maître de son royaume, que sa puissance était sans partage, qu’il n’était ni le vassal de la Prusse, ni le sous-préfet de M. de Bismarck, – ce château a été bâti en 1744, d’après les plans des architectes français Léger, Pierre-Louis-Philippe de la Guêpière et Thouret. Le duc Frédéric fut si heureux de recevoir de Napoléon le titre de roi, qu’il fit immédiatement coiffer le pavillon central d’une immense couronne dorée. On sait que ce monarque devint tellement gros, qu’on fut obligé de pratiquer une échancrure aux tables auxquelles il s’asseyait pour manger. « S.M. le roi de Wurtemberg, disait l’empereur, arrive toujours à Paris ventre à terre. »
En face du château, au milieu du jardin, où la musique militaire joue chaque jour à midi, s’élève une haute colonne de granit, surmontée d’une statue de la Victoire que l’ancien roi appelait la statue de la Concorde.
Nous passons, sans nous arrêter, devant le Kœnigsbau, dont la colonnade se déploie au bout de la place comme celle d’un temple grec. C’est là que se trouvent la Bourse et cette suite de magasins qui sont les plus clairs revenus du roi.
Entrons dans la cour du Château-Vieux, l’ancien Castellum Stuttgardten, la citadelle, l’aire de l’aigle. De là sont sortis ces comtes de Wurtemberg qui ont fait, à la pointe de leur épée, leur trouée au milieu de cette cohue de princes, de ducs, de seigneurs qui s’agitaient en Allemagne. Hommes énergiques et tenaces, descendants de la fière famille des Guelfes, ces comtes souabes avaient pour eux tout ce qui assure le succès. Ils s’agrandirent au moyen de l’or et du fer. Aux croisades, les chroniqueurs nous les montrent entourés de leurs soldats « qui ressemblaient à des géants. » Ce sont eux qui ouvrent la bataille par des provocations et des chants ; ils montent les premiers à l’assaut et réclament l’honneur de forcer les passages périlleux. Ils portaient, dit-on, empalés dans leur lance, une demi-douzaine de cadavres ennemis, et fendaient en deux, de haut en bas, les cavaliers arabes. De là ce proverbe : « Le Souabe fait deux Arabes d’un seul. »
Je ne vous décrirai ni la cour du Château-Vieux, formée de trois étages d’arcades finement découpées, ni la salle de tournois, ni l’escalier en colimaçon dans lequel on monte à cheval, ni la statue du comte Eberhard le Barbu, reléguée ici par le roi actuel, et qui ornait précédemment la place de la Résidence. En 1511, à l’occasion du mariage du duc Ulric avec une princesse bavaroise, sept mille invités trouvèrent place dans ce vaste édifice. On réquisitionna, pour servir tout ce monde, huit cents des plus beaux jeunes gens et des plus belles jeunes filles du pays, qu’on habilla de drap rouge et jaune. Le menu de ces noces de Gamache est enregistré par les historiens wurtembergeois eux-mêmes, avec l’orgueil d’un bulletin de victoire ; on mangea 136 bœufs, 1 800 veaux, 570 chapons, 1 200 poules, 2 759 grives. 11 tonnes de saumons, 90 tonnes de harengs, 120 livres de clous de girofle, 40 livres de safran, 200 000 œufs et 3 000 sacs de farine. Il fallut 15 000 tonneaux de vin pour étancher la soif de ces robustes buveurs.
Les cuisines royales se trouvent encore au rez-de-chaussée, à l’angle gauche de l’ancien manoir. Au coup de midi, on voit sortir, comme d’une trappe d’Opéra, un long convoi de laquais en culottes courtes et en souliers plats, portant d’énormes civières bleu de ciel, qui renferment, sous leur triple cadenas, le dîner de Leurs Majestés. Cette singulière procession, traverse la voie publique pour se rendre au palais du roi.
Il y a peu de pays qui aient fourni autant d’hommes distingués que la Souabe. Nous avons vu hier, en passant, la maison paternelle du grand Hégel, et le buste qui décore l’entrée de la rue d’Uhland. On sait que Schelling est de Leonberg, Kepler de Well-la-Ville, restée exclusivement catholique au milieu des communes protestantes ; Schawb, Morike, deux des poètes lyriques les plus célèbres de l’Allemagne, sont également Wurtembergeois. Haclænder, l’Alexandre Dumas allemand, est de Stuttgard.
En sortant de la cour du Château-Vieux, on a devant soi la cathédrale et la statue de Schiller, œuvre du célèbre sculpteur danois Thorwaldsen. Le poète de la Cloche a vu le jour dans un pauvre petit village, Marbach, à quelques lieues de la capitale. Sa maison est aujourd’hui un musée national. On a poussé les choses un peu loin, et certainement cette collection de vieilles culottes rapiécées, de bas de laines troués, de sandales racornies, n’ajoute rien à la gloire de l’auteur de Don Carlos. C’est abaisser le génie que de nous le montrer sous ses côtés vulgaires. Le propre fils de Schiller vivait encore il y a quelques années ; il était simple garde forestier. On montre, sur les hauteurs qui avoisinent Stuttgard, le chêne sous lequel le poète, âgé de vingt ans, lut à un groupe d’amis son drame des Brigands, dont la représentation le fit exiler par le duc Charles. Thorwaldsen a donné à l’émule de Gœthe cette expression triste et pensive qui est si bien le résumé de sa vie, si pleine d’agitations et de tourments.
Mais nous sommes attendus au Burger Museum ; l’heure s’avance : les petits garçons de sept à douze ans reviennent déjà de l’école, avec leurs sacs militaires et leurs casques à pointe dorée ; ils passent à côté de nous en courant et en conjuguant en français, s’il vous plaît, le verbe courir, joignant la démonstration à la règle. Rendons aux Allemands cette justice : leur premier soin est d’apprendre les langues. Il est rare de rencontrer ici un jeune homme qui ne sache pas le français, l’anglais et l’italien. Dans les gares, à la poste, dans les bureaux d’administration, partout l’on parle français. Il se donne chaque hiver, à Stuttgard, des cours publics de littérature française, fréquentés par trois à quatre cents personnes. J’ai entendu, à table d’hôte, des officiers converser de préférence en français ; il est vrai qu’ils buvaient du champagne. À la cour, bien que le roi pense maintenant en prussien, on parle français, et les grandes faiseuses de Paris y ont conservé leur clientèle.
Le Burger Museum. – Son jardin d’été. – Comment on se marie dans l’Allemagne du Sud. – M. Karl Mayer. – Le Sud lors de la déclaration de guerre. – Les écoles. – Villages français.
Le Burger Museum (Musée des Bourgeois) est au centre de la ville. C’est un beau bâtiment, confortable, bâti d’après un plan qui correspond parfaitement au but de l’édifice. Il y a de grands salons pour les bals et les réunions artistiques et littéraires, de vastes salles de lecture, une salle de billard, des salles plus petites pour la causerie. En Allemagne, Museum est synonyme de club, de cercle. On y trouve tous les monuments de la littérature française et étrangère, la collection complète des grands journaux, et la plupart des revues qui se publient sur les deux continents. En entrant au Museum, le Parisien sait ce qui se passe sur le boulevard et dans les coulisses de l’Opéra, l’Anglais est au courant des évènements de la Cité, le Russe se retrouve à Saint-Pétersbourg sans quitter son fauteuil, l’Américain traverse les mers avec la rapidité de la pensée. On fait le tour du monde en quatre-vingts minutes. Et tout ce qui peut faciliter le voyage, le rendre utile, intéressant, est à votre portée : cartes générales et spéciales, atlas, mappemondes, dictionnaires, livres de « références, » etc. Comme organisation pratique, c’est admirable. Une salle est réservée aux publications nouvelles ; dès le lendemain de son apparition, on trouve là le roman ou la brochure qu’on lit à Berlin, à Paris ou à Londres.
La cotisation annuelle du Burger Museum est de cent francs. Chacun a la faculté de devenir membre propriétaire. Les étrangers y sont admis gratuitement pendant un mois, sur la simple présentation d’un des membres.
Le Museum possède une villa d’été, aux portes de la ville, où l’on conduit sa famille et ses amis.
Nous y sommes allés cette après-midi, entre deux rayons de soleil. Partout des bosquets, des berceaux de verdure, des cascades, des ponts rustiques : une véritable Suisse de couvercle de tabatière. Des enfants jouaient dans les allées fleuries ; leurs mères, assises devant la traditionnelle tasse de café au lait, travaillaient à des tapisseries à ou des tricots. Chaque dimanche, il y a concert sur la grande terrasse, et le soir, on danse dans le salon, sans apprêts, en toilette simple, comme l’on est venu. Ces réunions sont charmantes et deviennent un bureau de placement pour les mères embarrassées de trop de filles. Un minois vous plaît-il ? Vous vous en approchez et lui proposez une valse. Cela sans présentation, à la bonne franquette. On se revoit les dimanches suivants, on valse de nouveau, on se lie avec les frères, les sœurs, les parents, et un beau jour Dorothée déclare qu’elle aime Hermann, et le roman finit comme les romans du Musée des familles. Le mariage est resté ici une affaire de cœur. Les parents ne sont consultés qu’en dernier ressort. En général, les jeunes filles n’ont pas de dot. Aussi, elles réclament dans le ménage leur part de travail ; elles sont une associée. Leur éducation est dirigée dans ce sens : on m’a cité des jeunes filles de parents fort riches, qui passent une ou deux heures par jour dans la cuisine d’un hôtel, pour apprendre à cuire. Une ou deux fois par semaine, ces mêmes jeunes filles vont travailler dans une école de couture. Leur toilette et celle des enfants se confectionnent par leurs soins, à la maison. La machine à coudre tient souvent la place d’honneur dans les salons.
En nous promenant dans le jardin d’été du Burger Museum nous avons rencontré sous une tonnelle, que le lilas décorait de ses grappes aristocratiques, le célèbre chef du parti radical wurtembergeois, M. Karl Mayer ; il lisait paisiblement un livre de poésies entre sa femme et ses deux filles. M. Karl Mayer, bien qu’il se tienne à l’écart depuis quelques années, n’en est pas moins resté la bête noire des adeptes de toutes nuances de la prussification de l’Allemagne du Sud. Il a mérité cette haine, qui l’honore. Exilé en 1849, il est rentré dans son pays en 1864, et, dès son retour, il a pris la direction de l’organe du parti démocratique, le Beobachter. Chaque jour sur la brèche, c’est lui qui a le plus vigoureusement combattu les empiétements du parti bismarckien. Au Nationalverein, qui demandait l’unification par un coup d’État prussien, il opposa, avec ses amis, le fameux Volhsverein, encore si puissant à la veille de la dernière guerre.
La conversation roula naturellement sur cette époque de triste souvenir. Aussitôt qu’on sut que la lutte allait s’engager, l’angoisse et la perplexité furent extrêmes dans le Sud. On se demanda, comme en 1866 : « Que devons-nous faire ? Faut-il rester neutres ? » M. de Bismarck et son parti profitèrent habilement de cette indécision. Ils soufflèrent la peur, et l’on vit déjà les rives du Rhin occupées, la Forêt-Noire envahie, Stuttgard aux mains des zouaves et des turcos. Le roi Charles, qui se trouvait en Suisse, était revenu en hâte et s’était écrié, à moitié hors de lui, en débarquant à Friedrichshafen : « J’ai toujours été bien avec Napoléon. Rassurez-vous. Il nous ménagera ! » Et, dès son arrivée à Stuttgard, ce souverain timide et prudent avait envoyé son argenterie dans les casemates de la forteresse d’Ulm, et s’était mis au lit.
« J’ai vu, nous dit Karl Mayer, mes voisins qui enfouissaient, la nuit, des objets précieux dans leur jardin. Voilà où nous en étions ! Dans les campagnes, on était aussi affolé que dans les villes. On se jeta donc dans les bras de la Prusse par peur, uniquement par peur, je ne saurais trop vous le répéter. Le nom prussien haï, exécré, devint quelque chose de si sacré, que nous fûmes, nous autres libéraux, assaillis à coups de pierres dans la rue, pour avoir osé mal parlé de M. de Bismarck dans notre journal. La peur redoubla quand on apprit la marche de Bourbaki sur Belfort ; beaucoup d’habitants de la Forêt-Noire abandonnèrent leurs villages. Comment voulez-vous maintenant que tous ces gens, qui voyaient déjà leurs foyers pillés et incendiés, n’aient pas de la reconnaissance envers la Prusse ? Ils ne portent sans doute pas M. de Bismarck dans leur cœur, mais ils vous répondent que, s’ils ne sont pas Prussiens, ils sont toutefois les alliés de la Prusse. Aussi, dans le Sud, l’opposition ne sera jamais bien sérieuse.
« Le fondateur de l’unité allemande, M. de Bismarck, obtiendra ce qu’il voudra d’une multitude de paysans et de bourgeois qui tremblent au mot de guerre. Le fantôme de la revanche fera longtemps encore son effet ; comme le cor merveilleux de la légende, ce mot a le pouvoir de dissiper l’ennemi. Il est même dans l’intérêt de la Prusse le faire accroire que nous sommes au plus mal avec la France. Voyez la loi militaire : elle n’a été votée que par la peur. »
En rentrant en ville, la personne qui me faisait les honneurs de Stuttgard me montra un atelier de tailleurs dont les ouvriers ont menacé dernièrement de se mettre en grève, parce que leur patron voulait les empêcher d’avoir leur lecteur. Ce lecteur, un fruit sec d’Université, fait du matin au soir, moyennant un kreutzer par auditeur, lecture à l’atelier des journaux et des brochures socialistes.
Le Wurtemberg possède sans conteste les meilleures écoles de l’Allemagne. L’instruction, comme en Suisse, est répandue dans toutes les classes. Causez avec un ouvrier, avec un paysan, l’un et l’autre connaissent la géographie et l’histoire. Chaque hameau de trente familles possède une école. Les parents sont tenus d’y envoyer leurs enfants, de six jusqu’à quatorze ans, sous peine de la prison. Les jeunes gens pauvres qui veulent continuer leurs études jusqu’à dix-huit ou vingt ans fréquentent les écoles du soir et du dimanche.
L’École polytechnique de Stuttgard est citée au nombre des meilleures de l’Europe. Des Américains, des Anglais, des Français, des Italiens et des Russes viennent y suivre les leçons d’esthétique de MM. Fischer et Lubke, auteurs d’ouvrages traduits dans toutes les langues. On donne également à l’École polytechnique un cours de littérature française fréquenté par 200 auditeurs.
Moyennant la rétribution de 1 florin 1/2 par trimestre, chacun est admis à suivre les cours qui lui conviennent.
Une particularité peu connue dans cet intéressant pays de Wurtemberg, c’est l’existence de treize villages entièrement français, formés par les émigrés protestants de l’édit de Nantes. Jusqu’en 1830, tous ces villages ont eu des pasteurs et des instituteurs français. Un de mes amis, écrivain de talent, M. Ladevèze, qui a eu l’occasion de visiter le village de Neu-Hengstett, au centre de la Forêt-Noire, a été frappé de voir combien le type français s’est conservé au travers des âges dans sa pureté primitive. La physionomie ouverte, le regard vif et franc, l’œil généralement noir, ainsi que les cheveux, le teint coloré, révélant une population qui boit du vin et a peu de goût pour la bière ; enfin, notre langue encore parlée par les vieillards octogénaires, avec un gentil accent méridional et des expressions du temps : tels sont les traits qui caractérisent encore aujourd’hui ces bonnes gens.
La jeune génération ne parle malheureusement plus français. « Dix-huit de nos jeunes gars, disait à M. Ladevèze un vieillard du nom de Monod, ont fait le siège de Paris : cinq ont été tués à Champigny ; tous les autres sont revenus parlant le français, qu’ils ont presque compris de suite à leur arrivée en France. » Ajoutez qu’en cette qualité, ils ont été constamment envoyés les premiers au feu.
En 1825, ces treize villages, qui tenaient beaucoup à conserver leurs titres et leurs privilèges de Français au milieu des Wurtembergeois de la Forêt-Noire, envoyèrent au vieux roi Guillaume une députation des anciens de leurs communes, pour lui demander de ne pas donner suite à son projet de remplacer leurs pasteurs et leurs instituteurs français par des pasteurs et des instituteurs allemands. Après qu’ils eurent exposé leur requête, le vieux roi, qui n’entendait pas très bien leur langue, leur répondit : « Mais vous voyez bien que je ne vous comprends pas ; vous avez oublié le français ; vous avez besoin d’instituteurs allemands. »
Le village de Neu-Hengstett est le seul qui porte un nom germanique ; les douze autres villages s’appellent Pinage, Valmont, Peyrouse, Luze, etc.
Parmi les noms de ces réfugiés, arrivés au nombre de 600 familles, en 1698 et 1699, on remarque ceux de Colloumbet, Claparadède, Concourde, d’Haisig, d’Artois, d’Indot, d’Estampe, de la Fontaine-Fourmayron, de la Gouille, de l’Abadice, de la Plume, Montesquio, Perdrix, Pis-Vache, Tirebouche, Tourn-Boncœur, Vive-l’Âme, etc.
Nos compatriotes sont estimés dans le pays ; ils sont travailleurs, sobres, économes, mais très chatouilleux sut le point d’honneur, ce qui les distingue essentiellement du paysan allemand.
Les fêtes de Stuttgard. – Un palais des Mille et une nuits. – Le bal de la Wilhelma. – La revue.
Depuis deux jours, les journaux ne parlent que des fêtes de Stuttgard. En lisant leurs récits, vous vous imaginez sans doute que nous sommes ici dans une ville en galant appareil, aux rues décorées d’arcs de triomphe, aux fenêtres ornées de guirlandes, aux toits hérissés de drapeaux. Illusion, mon cher ami ! Nous vivons dans la capitale la plus calme, la plus tranquille, la moins pavoisée du continent. On ne cause cependant, dans les salons, dans les cafés et aux tables d’hôte, que du mariage de la grande-duchesse Véra avec le prince Eugène de Wurtemberg. L’indifférence n’est qu’apparente. Ce qui explique l’absence de festons et d’astragales, c’est le caractère intime de ces fêtes de famille. Le public n’est pas censé y prendre part. D’ailleurs, tout se passe simplement et économiquement dans cette petite cour, qui se souvient des conseils du feu roi Guillaume ; « Faisons d’abord ce qui est utile, et seulement après ce qui est agréable. » Or, à voir Stuttgard aujourd’hui, l’étranger pourrait supposer qu’il y a énormément de choses utiles à faire ; mais pour peu qu’il interroge et qu’il observe, il ne tardera pas à être convaincu que le Wurtemberg est un des pays les plus heureux et les plus prospères de l’Allemagne. Tandis que partout ailleurs on se querelle à propos de dogmes, de religion, ici on ne parle ni de protestants, ni de catholiques, ni d’infaillibilité, ni de prêtres en prison. La liberté, comme le soleil, luit pour tout le monde.
Je ne veux pas vous décrire en détail les fêtes auxquelles je viens d’assister. Les fêtes se ressemblent à peu près toutes, et celles de Paris sont restées sans rivales. Mais ce qui ne se peut voir à Paris, c’est un bal comme celui de la Wilhelma. La Wilhelma est un château féerique, un jardin enchanté comme ceux d’Armide.





























