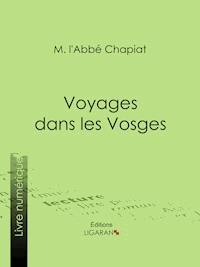
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Nous allons, aux premiers pas de notre route, pénétrer dans cet antique sanctuaire dédié à la Reine des anges et des hommes, dans cette chapelle dont les nefs sont du XVe siècle, l'avant-chœur du XIIIe et dont l'abside a été par nous construite dans le style des nefs."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les Vosges sont situées dans la partie sud-est de la France, entre le 47° 52’ et 48° 32’ de latitude nord, le 3° 6’ et 4° 52’ de longitude est, du méridien de Paris. La température en est généralement plus froide que ne semblerait indiquer cette position : les montagnes, les forêts et les eaux vives y prolongent ou ramènent fréquemment la froidure, et l’air, qui du reste est salubre, y subit une extrême variabilité. Les beaux printemps chez nous font l’exception ; la végétation n’y devient belle qu’à partir du mois d’avril ou de mai, et les gelées tardives viennent trop souvent la contrarier, la suspendre ou même l’anéantir. L’été nous donne des chaleurs, parfois excessives, dans les mois de juillet et d’août : le thermomètre s’y élève alors pendant le jour, à 27, 28 et 29° Réaumur. L’automne est généralement beau ; mais nous quittons à peine le mois d’octobre, que les brouillards, les neiges et les frimas nous arrivent ; de novembre à mars l’hiver, à part quelques beaux jours, nous fait sentir ses rigueurs : le thermomètre descend, en certaines années, à 18, 19 et même 20° ; mais, pour le froid comme pour la chaleur, ce sont heureusement des exceptions.
La longueur moyenne du département, de l’est à l’ouest, par Épinal, qui en est à peu près le centre, est d’environ 100 kilomètres, et la largeur, du sud au nord, par le même point, est d’environ 53. La contenance territoriale approche de 600 000 hectares. Ce département se divise en trois régions bien caractérisées : la plaine, la Vosge, et la montagne. Ce qu’on nomme la plaine est cependant loin d’offrir un terrain plat, il est, au contraire, fort accidenté ; la Vosge l’est à peine davantage ; la région granitique étale de vraies montagnes, dont le sommet varie de 500 à 1 400 métros. Les principales de ces montagnes sont, du sud au nord, les Ballons, le Gresson, le Drumont, le Rotabach, le Bonhomme, le Bressoir, le Cumbert, l’Ormont, le Climont et le Donon. Les principales vallées sont celles de la Meurthe, de la Mortagne, de la Vologne, de la Moselle, du Madon, du Vair, du Mouzon et de la Meuse, dont les eaux coulent vers la mer du Nord ; et celles du Combeauté, de l’Augrone, de la Sémouze, du Côney et de la Saône, qui portent leurs eaux vers la Méditerranée. Les eaux de la région granitique et de la région arénacée sont fraîches, limpides et pures ; celles de la région calcaire, surchargées de diverses substances, sont rarement de bonne qualité : la pluie les trouble et les rend souvent impotables, à l’exception toutefois de celles qui jaillissent des profondeurs du sol.
La région montagneuse est composée de roches de granit ou de roches de grès rouge et de terrains détritiques. Dans les terrains provenant des débris de roches granitiques, l’alumine sert de base, et dans ceux qui sont formés de grès rouge, c’est la silice ; les meilleurs proviennent du mélange des deux. Les terrains des vallées sont fertiles ; les autres ne conviennent qu’aux forêts de pins et de sapins. Le grès domine dans l’arrondissement de Saint-Dié ; le granit dans celui de Remiremont.
Le sol de la Vosge vient du grès bigarré, et se compose de sable siliceux : propre à porter des forêts de chêne et de hêtre, il est peu favorable à l’agriculture et il exige beaucoup d’engrais ; cependant les vallées y offrent de belles prairies. Ce sol, fort accidenté, se trouve affleuré, ici et là, en partie, par des bancs d’argile et de marne, par des bancs de grès rouge ou par des bancs calcaires. Il comprend les cantons de Bains, Xertigny et Plombières, et partie de Monthureux et Darney… Dans la plaine, les terres peuvent se réduire à deux divisions de terrains stratifiés, les calcaires marneux et les calcaires oolithiques et liasiques ; ces derniers sont de beaucoup les plus fertiles ; moins avides d’engrais, ils sont féconds en blés et la luzerne y prospère. Aux premiers appartient presque tout l’arrondissement de Neufchâteau ; aux seconds presque tout celui de Mirecourt, et en outre les cantons de Châtel et de Rambervilliers.
Les substances minérales, qu’on trouve en ces diverses espèces de terrains, sont la chaux, la silice, l’alumine, la potasse, la magnésie et la soude ; on y rencontre, en petite quantité, de l’or, de l’argent, du cuivre, du plomb, du zinc, du manganèse, et en quantité plus grande, du fer ; on y trouve aussi de la houille et de la tourbe.
Les forêts, malgré les déboisements, inopportuns et nuisibles, opérés sous le règne de la bourgeoisie, de 1830 à 1818, surtout dans la plaine, occupent encore la trente-cinquième partie de la surface territoriale ; la proportion est devenue plus grande par le reboisement des montagnes en maints endroits, depuis 1850.
Les essences varient singulièrement de la plaine à la montagne : celle-ci est couverte de pins, de sapins et de pesses ; celle-là de chênes, de hêtres et de charmes ; toutes les deux nourrissent encore, au moins dans les vallées, l’aune, le saule, le peuplier, le tremble, le bouleau, le frêne et l’érable.
Les vergers, dans toute l’étendue des Vosges, voient croître, plus ou moins heureusement, le poirier, le pommier, le prunier, le cerisier, le noisetier, le noyer, l’abricotier et le pêcher. La région arénacée se couvre de merisiers, qui donnent d’excellent kirsch. La vigne tapisse les coteaux de la plaine, où elle produit un vin léger, excellent dans les bonnes années. Le sol argilo-calcaire de la plaine peut nourrir le houblon et le tabac.
Le sol des Vosges nourrit aussi une quantité considérable d’arbrisseaux et d’arbustes : la plaine nous étale l’épine-vinette, le prunellier, l’aubépine, le nerprun, la viorne, le troène, la renouée, la clématite ; la montagne nous offre le genêt, le houx, la bourdaine, la myrtille, la couleuvrée, la cuscute ; et par tout le pays on trouve le groseillier, le framboisier, la ronce, le rosier, le sureau, le lierre, le chèvrefeuille, le fusain, le genévrier, la bruyère, la pervenche, le grateron et les liserons.
Les bois de la plaine sont remplis des plantes les plus diverses, qui les parent d’une quantité innombrable de fleurs dans toutes les saisons, tandis que ceux du sol granitique, où croissent les pins et les sapins, en sont presque totalement dépourvus. Il n’en est pas de même des haies et des bosquets, lesquels, dans la montagne comme dans la plaine, en offrent des variétés considérables, qu’il nous est impossible d’énumérer en détail.
Les prairies, dont l’étendue s’élève à plus de 100 000 hectares, offrent, parmi les graminées qui en sont l’essence, une multitude d’autres plantes, dont les fleurs en émaillent successivement la verdure, dès le retour du printemps : ce sont les corolles dorées du souci, des pissenlits et des primevères ; puis celles des salsifis, des liondents et des renoncules ; les fleurs des jacées rouges ou violettes, du trèfle incarnat, du sainfoin, des luzernes, se mélangent avec les corolles bleues de la sauge et les ombelles blanchâtres des cerfeuils. La gesse, le mélilot, la lupuline, les marguerites et une foule d’autres, décorent les prairies de la plaine. Le narcisse et la scorsonère, dans celles des montagnes, forment, en leur saison, un tapis jaune si serré qu’il couvre toutes les autres plantes : c’est comme le sénevé sur les avoines de la région calcaire.
Les moissons de blé dont se couvre la plaine sont diaprées par le rouge ardent des coquelicots, le bleu foncé des bluets, le jaune de la vesce, les jolies fleurs du mouron, des gesses, des petits liserons, et malheureusement de la nielle et de l’ivraie.
Le botaniste, en parcourant nos vallées, nos plaines et nos montagnes, peut s’enrichir d’une foule incalculable de plantes, dont il ne peut entrer dans notre plan d’énumérer les espèces. Pour en avoir une connaissance détaillée, on n’a qu’à consulter le savant mémoire qu’en a inséré le docteur Mougeot dans la statistique du département.
La zoologie des Vosges n’est pas moins intéressante que la botanique : on y rencontre des animaux de mille espèces, vertébrés, mollusques et articulés.
Chez les vertébrés, parmi les solipèdes, nous avons le cheval et l’âne : parmi les ruminants, le bœuf, le mouton, la chèvre et le cerf ; parmi les pachydermes, le porc et le sanglier ; parmi les rongeurs, le lapin, le lièvre, l’écureuil, mais aussi les loirs et les rats ; parmi les carnassiers, le chien, le chat, mais aussi le loup, le renard, la martre, la belette et la loutre ; parmi les plantigrades, le hérisson et la taupe ; parmi les chéiroptères, la chauve-souris.
Chez les oiseaux, nous trouvons, parmi les rapaces, l’épervier, le milan, la buse et le busard ; parmi les passereaux, la grive, le merle, la fauvette, le rossignol, la linotte, le pinson, le chardonneret, le loriot, la mésange, la bergeronnette, l’hirondelle, le rouge-gorge, le roitelet, le bouvreuil, la verdière, le moineau, l’alouette, le geai, la pie, le corbeau, la huppe, l’étourneau et l’alcyon ; parmi les grimpeurs, les pics, le torcol et le coucou ; parmi les gallinacés, la poule, le dindon, la perdrix, la caille, le faisan, le paon et les pigeons ; parmi les échassiers, le vanneau, le pluvier, le héron, la cigogne, la bécasse et la poule d’eau ; parmi les palmipèdes, l’oie, le canard, le cygne, le cormoran, la mouette et le plongeon.
Chez les reptiles, se rencontrent, parmi les sauriens, le lézard ; parmi les ophidiens, l’orvet, la couleuvre, la vipère ; parmi les batraciens, la grenouille, la raine, le crapaud et la salamandre.
Chez les poissons, l’on remarque la perche, la carpe, la tanche, le goujon, le barbeau, la truite, le brochet, la lotte, l’anguille, l’ombre, la loche, l’ablette, l’esturgeon et la lamproie.
La seconde classe d’animaux, les mollusques, ainsi nommés à cause de leur corps entièrement mou, le plus souvent recouvert d’un têt, ou coquille, univalve ou bivalve, est très nombreuse dans nos terres et surtout dans nos rivières et nos ruisseaux.
Parmi les mollusques nus, nous rencontrons les limaces et limaçons, et parmi les mollusques testacés, les hélices ou escargots, dont les espèces sont multiples. Les mollusques aquatiques nous offrent des espèces innombrables. Les mollusques des Vosges en comprennent environ 150, dont 95 terrestres et 55 fluviatiles : 11 espèces terrestres sont dépourvues de têt ; 40 espèces fluviales sont pourvues de coquille univalve, et 15 de coquilles bivalves.
La troisième classe d’animaux, les articulés, fourmille dans les terres vosgiennes, surtout les insectes, parmi lesquels se distinguent les coléoptères et les lépidoptères, dont plusieurs amateurs ont fait de superbes collections.
Parmi les coléoptères, ou animaux dont les ailes sont couvertes d’un étui corné, on remarque les carabes, les cicindèles, dont la plupart sont si brillants ; les tourniquets que l’on voit sans cesse nager ou tournoyer sur les eaux ; les staphylins, qui aiment les fumiers ; les richards aux couleurs si vives ; les lampyres, qui luisent de nuit ; les vrillettes et les limebois, dont les larves rongent le chêne et le sapin, qu’elles réduisent en poussière ; les scarabées ; les hannetons qui fournissent de superbes couleurs pour la peinture à l’aquarelle ; les cantharides, qui ont la propriété de scarifier l’épi – derme ; le charançon, ennemi de nos blés, et les jolies coccinelles.
Les lépidoptères ou papillons, aux ailes triomphales, peuplent nos campagnes et nos prairies. Les papillons de jour resplendissent comme des fleurs volantes, qui émaillent l’azur des airs ; malheureusement leurs larves ou chenilles qui sont une nourriture pour les oiseaux, deviennent un véritable fléau pour nos arbres fruitiers et pour nos légumes. Les papillons de nuit sont de couleur tout à fait sombre, et leurs larves sont encore plus nuisibles.
Les autres insectes ont aussi parmi nous leurs tribus : les névroptères nous offrent la libellule ou demoiselle, si svelte, aux ailes de gaze, qui voltige avec tant de rapidité dans sa chasse aux moucherons ; les orthoptères fournissent les sauterelles et les grillons, au chant aigre et monotone ; les hyménoptères donnent la fourmi travailleuse, l’abeille économe et la guêpe vorace ; les hémiptères, les cigales et malheureusement aussi les punaises et les pucerons ; les diptères peuplent les airs de mouches, de taons et de moucherons, et les aptères, qui infestent de leurs puces et de leurs poux, ne sont pas tout à fait inconnus, pas plus que les araignées, les mites et les scorpions ; enfin les crustacés nous fournissent les écrevisses, et les annélides les sangsues et les vers.
Imitons l’ordre du Créateur ; après avoir décrit le pays, peuplé les terres, les airs et les eaux, de plantes et d’animaux de toutes les espèces, amenons-y l’homme, parlons de ses habitants.
Ce pays fut anciennement habité par la tribu des Celtes appelés Leuci, qui avait pour chef-lieu Tullum Leucorum, Toul. La plaine, – peut-être même quelques vallées des montagnes, – paraît avoir été assez peuplée, lors de l’invasion des Romains, qui assignèrent le pays à la Gaule-Belgique. Les Belges étaient regardés comme le peuple le plus vaillant des Gaules, et certes les Lorrains n’ont pas dégénéré de leurs ancêtres sous ce rapport. On se souvient d’un mot de Napoléon, du grand capitaine : « Tu es donc Lorrain, » dit-il un jour à un intrépide soldat. « Sire, je suis des Vosges, » repart le héros. « C’est ce que je voulais dire, » ajoute l’Empereur. Ces peuples n’avaient pas de villes ni de villages : leurs demeures, fermées d’un enclos, s’élevaient au milieu des campagnes, près d’une source ou d’un ruisseau ; les terres n’étaient point partagées ; la chasse et la guerre étaient la grande occupation des nobles et des guerriers, qui gouvernaient la nation et qui menaient les gens aux combats. Le peuple, comme dans toute société païenne, était leur chose.
La principale divinité des Celtes était Teutath ou le Père, évidemment le Dieu suprême défiguré, ainsi qu’il en fut dans tout le paganisme. Ils adoraient ensuite Bélen ou le Soleil ; Néhalen ou la Lune ; Camoul, dieu de la guerre, et Esus, le dieu du chêne. Leurs prêtres étaient les Druides ou prêtres du chêne : dépositaires de traditions mystérieuses, ils habitaient le sein des forêts, où ils présidaient aux sacrifices, immolant jusqu’à des victimes humaines ; ils jugeaient les procès, instruisaient la jeunesse, et assistaient à toutes les délibérations publiques. Ils ont laissé des traces de leur culte dans les dolmens et les menhirs.
Les Romains occupèrent surtout la plaine, où ils ont laissé de nombreux vestiges de leur domination, vestiges que nous rencontrerons dans nos voyages ; ils pénétrèrent même dans les montagnes, et ils formèrent quelques établissements au val d’Avend, – Remiremont – et au Val qui porte aujourd’hui le nom de Saint-Dié. Pour obtenir l’alliance des Leuques, et trouver dans leur courage un rempart contre les invasions germaniques, Rome leur avait laissé leurs usages et une sorte d’indépendance. L’urbanité romaine adoucit la férocité de ces peuplades à demi-sauvages ; leur langue se fondit avec la langue latine ; ils adoptèrent peu à peu les coutumes et les lois de leurs vainqueurs, et ils avaient fini par s’unir à eux.
Un grand nombre de voies avaient sillonné le sol et avaient formé les réseaux de l’occupation, que protégeaient des camps placés sur les hauteurs, et qui servaient de stationnement pour les légions. Des vici s’élevèrent, qu’on entoura de murailles flanquées de tours, et de petits forts défendirent les passages des rivières et les sinuosités des vallées.
C’est alors que le Christianisme s’introduisit dans la contrée ; les idoles tombèrent ; le sang des martyrs fit germer une moisson de chrétiens, et la capitale des Leuques, Toul, devint une métropole chrétienne.
Les invasions des Barbares ravagèrent le pays à peine civilisé ; presque tout y était détruit, quand les Francs y établirent leur domination. Au partage des enfants de Clovis, les Vosges firent partie de l’Austrasie, qui eut Metz pour capitale, et, après Charlemagne, elles firent partie du royaume de Lotharingie, qui se divisa plus tard en plusieurs principautés, dont la Lorraine proprement dite eut des ducs héréditaires, de 1048 à 1737.
La période austrasienne a laissé peu de traces dans les Vosges, mais, en revanche, cette époque fut féconde en établissements religieux : nos montagnes devinrent la Thébaïde des Gaules. Saint Colomban fonda Luxeuil ; saint Amé et saint Romaric fondèrent Remiremont ; saint Goéric, Épinal ; saint Déodat, Saint-Dié ; saint Hidulphe, Moyenmoutier ; saint Gondelbert, Senones ; saint Bodon, Étival.
La jeune dynastie lorraine vit s’épanouir dans les Vosges l’ordre de Saint-Norbert et celui des Chanoines réguliers. Le premier fonda les monastères de Flabémont, de Bonfaïs et de Mureau ; le second, ceux de Chaumousey et d’Autrey.
Un siècle plus tard, sous le duc Ferry III, s’opéra un mouvement prodigieux vers la liberté par l’affranchissement des serfs : ce fut, en Lorraine, une révolution toute pacifique, accomplie par le souverain lui-même et par les seigneurs ; aussi les résultats en furent-ils féconds et heureux. Les populations formèrent des communautés ayant leurs bans ou finages, leurs bois, leurs eaux, leurs pâturages, administrés par un maire, aidé d’un conseil élu par le peuple ; tous les individus purent aspirer à la propriété ; les terres, mal cultivées ou demeurées incultes, devinrent fertiles, et les seigneurs y gagnèrent par l’accroissement de la population.
Au XVe siècle, les Vosges furent envahies par le duc de Bourgogne dit le Téméraire : presque toutes les villes se virent forcées d’ouvrir leurs portes au vainqueur ; mais partout les populations déployèrent une valeur héroïque et une noble fidélité à leur duc René II, et lorsque Charles tomba sous les murs de Nancy, presque toutes ses conquêtes lui avaient été successivement enlevées par les habitants. Le pays était ruiné.
Au XVIIe siècle, les guerres de Charles IV contre la France furent encore plus funestes : tous les fléaux vinrent successivement accabler le pays. Les affreux Suédois, alliés de Richelieu, portèrent le ravage et la désolation partout et rappelèrent les fureurs des Huns et des Vandales ; la peste et la famine achevèrent l’œuvre de destruction : la France, en s’annexant la Lorraine, put régner sur un désert, et quand notre infortunée patrie, après un siècle de misères de toute sorte, recouvra son indépendance, pour un moment, sous le sceptre de son duc Léopold, elle n’était plus qu’un pauvre oiseau blessé par les terribles serres d’un vautour, qui ne lâchait un instant sa proie que pour revenir à elle et la dévorer.
Aussi, quand le bruit de la Révolution vint réveiller les Lorrains, à peine soumis à un joug de conquête, on les entendit répondre avec énergie aux cris de liberté. Cependant, aimons à le dire, les Vosges furent moins souillées d’abominables excès que d’autres points de la France : le fameux Richelieu et ses successeurs avaient fait d’avance en Lorraine une partie de l’œuvre révolutionnaire, en abattant nos châteaux et en ruinant notre noblesse. Les Vosgiens ne surent guère se signaler que par leur héroïsme, sur les champs de bataille, en faveur d’un pays qui, pendant deux siècles, n’avait cessé de les opprimer.
Enfin la France est devenue pour nous une patrie ; une ère nouvelle s’est levée sur cette terre que la nature semble s’être plu à embellir. L’agriculture et l’industrie se sont emparées d’elle, et il n’est presque plus un coin du sol qui ne leur appartienne : ces deux reines du monde matériel répandent, à pleines mains, leurs dons, en jetant, l’une sur la plaine, l’autre dans les montagnes, une semence d’incomparables richesses. Puissent ces progrès matériels ne pas trop nuire au développement de l’intelligence et de la santé, et surtout au progrès moral !
La population de notre beau département, malgré les causes de dépopulation, qui ont pesé sur la Lorraine, pendant près de trois siècles, dépasse encore aujourd’hui 400 000 âmes, parmi lesquelles on compte quelques milliers de protestants et d’Israélites : tout le reste appartient au catholicisme.
Les Vosgiens, en général, ont des mœurs douces et polies ; ils sont intelligents ; ils aiment les arts ; actifs et laborieux, charitables et hospitaliers, courageux et braves, ils se distinguent surtout par une franchise qui exclut de chez eux la politique et la sournoiserie. Le patois est encore en usage dans les campagnes et même dans les faubourgs des villes ; mais on y parle au besoin, et l’on y comprend la langue française : nos écoles primaires tiennent un des premiers rangs.
Parcourir ce beau pays des Vosges, l’histoire à la main, en archéologue et en artiste, avec des yeux pour voir, un esprit pour comprendre, un cœur pour sentir, une âme idolâtre des splendeurs de la nature, n’est-ce pas la plus pure des jouissances, le plus doux des plaisirs, le premier des bonheurs ? Nous avons donc entrepris et accompli ces voyages, lecteurs, avec un entrain que nous vous souhaitons à les lire, et même que nous vous souhaitons à les entreprendre après nous. La route vous est ouverte ; vous compléterez ce que nous n’avons qu’ébauché, vous ajouterez ce que nous aurons omis, vous corrigerez ce en quoi nous aurons pu faillir : Non omnia possumus omnes.
En tout cas, si nous avons réussi à vous faire aimer un peu notre beau pays, si nous avons pu inspirer à nos concitoyens la pensée de se rendre dignes de nos bons, de nos pieux, de nos glorieux ancêtres, ce sera pour nous la meilleure des récompenses.
Vitel, juillet 1879.
Avant de quitter notre Vitel, n’est-il pas juste d’en donner une esquisse à nos lecteurs ?
Vitel, – non Vittel : barbarisme tout moderne, – est situé à la tête d’une vallée dont le bassin pourrait lui permettre de s’étendre à souhait et de prendre des développements considérables. Abrité contre les vents froids du nord par la longue montagnette de l’Orima, dont l’élévation est de 454 mètres, et dont les pentes, au sud, sont tapissées de vignes et de forêts ; contre les vents orageux de l’ouest par celle de Châtillon, qui a 409 mètres d’altitude, et dont la tôle est couronnée de bois de chênes et de hêtres, ce bourg repose tranquille et paisible au sein de coteaux ornés de jardins, de plaines où pendant l’été s’étalent de riches moissons, et de vastes prairies émaillées de l’éclat et embaumées du parfum des fleurs.
Vitel, ayant été un vicus gallo-romain, semble avoir tiré son nom de deux mots de la langue primitive du pays. Comme la vallée recevait une grande voie, qui lui a laissé le nom de Vau-Via, Vallis-Via, ne serait-ce pas les deux mots Weg-Thal – Weï-Thal – voie de la vallée, qui auraient formé celui de Vitellum, Vitelle, puis Vitel ? Une pensée humoristique a inspiré à un buveur de ses eaux minérales si bienfaisantes l’étymologie de Vitæ tellus.
En tout cas, Vitel a eu du temps des Gaulois, des Romains et des Francs, une existence incontestable, écrite sur le sol même, en caractères qui ne nous paraissent point permettre le doute. Sur la petite éminence qui domine les sources minérales on a découvert, en creusant les caves de l’hôtel de l’établissement, des traces évidentes du culte des Druides. Un réseau de voies antiques, venant de Sugena, d’Esculanum, de Darneïum, de Grandesina, de Solimariaca, et se reliant sur plusieurs points à la grande voie d’Andomaturum, – Langres, – à Argentoratum, – Strasbourg, – aboutissait à Vitellum, et prouve évidemment que ce bourg avait une certaine importance. D’ailleurs une foule d’objets, recueillis dans un sol puissamment recouvert par les alluvions et non sérieusement fouillé, en sont des témoins irréfragables.
Un fait considérable vient à l’appui : lors de la formation des chrétientés diverses, Vitel eut l’insigne honneur, – qu’il conserva jusqu’à notre grande révolution, – de devenir le siège de l’un des plus vastes archidiaconés de l’immense diocèse de Toul. On trouve la signature, au XIIe siècle, de l’un de ses archidiacres. L’archidiaconé renfermait les cinq grands doyennés de Vitel, de Bourmont, de Neufchâteau, de Châtenois et du Xaintois, – Saintois. Il comprenait cent cinquante cures, trente succursales, cinq abbayes, un grand nombre de couvents, de prieurés et d’ermitages.
Il reste encore aujourd’hui à Vitel, pour gage d’antiquité, ses deux vieilles églises. Leurs parties romanes, qui remontaient fort haut dans les temps, étaient restées debout comme de vieux témoins. – Au XVe siècle, les nefs, trop étroites, avaient disparu pour faire place à de plus vastes, de style ogival ; les chœurs seuls étaient conservés ; encore ont-ils à peu près disparu dans une restauration toute récente, qui les a raccordés avec les nefs. La tour seule de la grande église est demeurée romane, avec le portail. De temps immémorial, Vitel était partagé en deux communes et en deux paroisses, ayant chacune leurs intérêts à part : le grand Ban et le petit Ban. Le grand Ban dépendait de l’insigne Chapitre des Dames de Remiremont, dont une abbesse, Jeanne d’Anglure, l’avait doté d’un hôpital, qui fut malheureusement, au dernier siècle, réuni à celui de Remiremont : il n’en reste que le nom de la rue.
Vitel, en 1790, devint chef-lieu de canton, et il absorba, en l’an IX, ceux de Lignéville et de Valfroicourt, à l’exception de quelques villages.
Ce lieu a vu sortir de ses murs plusieurs personnages de distinction, dont le plus remarquable est l’abbé François-Florentin Brunet, né en 1731, d’une famille bourgeoise des plus honorables. Il fut confié pour ses études aux Récollets de Bulgnéville, pays de sa mère, et les bons pères aidèrent avec un grand soin au développement de ses heureuses dispositions et de ses vertus naissantes. Au sortir de leurs mains, il entra dans la congrégation de Saint-Lazare, où ses rares talents furent bientôt appréciés, et il s’y engagea en 1749. Professeur de philosophie au séminaire de Toul, de théologie à celui de Châlons-sur-Marne, puis supérieur de ce dernier en 1775, et de celui de Poitiers en 1787, il fut, l’année suivante, choisi pour second assistant de la congrégation, et il dut retourner près du général, à Paris, où l’attendaient de rudes épreuves.
La Révolution allait éclater. La scélératesse des meneurs inventait et répandait dans le peuple les choses les plus calomnieuses contre la noblesse et le clergé. Une disette eut lieu : on les accusa d’en être la cause, en accaparant les grains, pour affamer les populations et s’en rendre plus aisément les maîtres. Cette absurde imputation trouva créance, et l’on put ameuter le peuple de Paris contre les fils de Saint-Vincent-de-Paul. Le 13 juillet 1789, les émeutiers tombèrent sur la maison des Lazaristes et y causèrent le plus affreux désastre. Saisi par la populace en furie, l’abbé Brunet fut traîné à la halle aux blés, menacé d’y être pendu ; il dut son salut à un officier de garde, qui le fit secrètement évader. L’intrépide religieux rentra dans sa maison dévastée, et il y demeura jusqu’à la suppression de son ordre, en 1792.
Quittant Paris alors, le P. Brunet erra, comme un pauvre proscrit, en divers lieux, rejoignit son général, du Cayla, en 1794, à Manheim et le suivit à Rome. Avant de mourir, en 1800, ce général le désigna comme supérieur de la congrégation. En 1804, par l’influence du cardinal Fesch, oncle de Bonaparte, il put rétablir son ordre en France : le premier Consul avait cédé devant le nom de Vincent de Paul.
Le nouveau supérieur général vainquit avec une rare prudence les immenses difficultés d’un temps de recomposition sociale et religieuse, et, en gouvernant son ordre, il s’attira l’estime et la vénération de tous les membres, des religieuses comme des religieux. Autorisé par le souverain Pontife à désigner son successeur, il nomma le P. Placiard, un peu avant de mourir, en 1806.
Le savant P. Brunet a composé des ouvrages remarquables, dont le principal est intitulé : Parallèle des Religions, en 5 vol. in-4°. Ce grand ouvrage, publié en 1792, est écrit avec une grande lucidité, une rare pureté de style, et présente un vrai modèle de méthode et de modération. Il n’existe rien de plus utile et d’aussi complet sur la matière ; on l’a beaucoup copié, sans même daigner citer son nom.
Le P. Brunet a aussi publié des Elementa Theologiæ, en 5 vol., Rome, 1804. C’est encore un grand ouvrage, très estimé à Rome et en Italie.
Vitel a vu naître, en 1770, un autre homme, qui s’est distingué sur les champs de bataille de la première république. Au sortir du séminaire de Toul, voyant la carrière sacerdotale fermée, Louis Barjonnet s’engagea dans les volontaires en 1792, et se vit élever au grade de capitaine. Incorporé dans l’armée de Sambre-et-Meuse, il monta rapidement et parvint au grade de colonel. Engagé dans l’expédition de Saint-Domingue, à la suite du général Humbert, le colonel Barjonnet périt au moment où il recevait le titre d’intendant général. C’était un soldat remarquable par la hauteur de sa taille, sa bonne mine et sa bravoure.
Le docteur Latraye, médecin des ducs Léopold et Stanislas, était né aussi à Vitel.
Un honneur, insigne assurément, pour ce bourg est d’avoir donné le jour à l’une des marraines de Jeanne d’Arc, de l’héroïque libératrice de la France.
Vitel a subi une célébrité d’un autre genre. À la faveur des troubles révolutionnaires, quand nul ordre ne régnait plus en France, une famille scélérate, – étrangère d’origine à la localité, – s’acquit par ses vols et ses assassinats, une odieuse et horrible renommée. Cette abominable famille, du nom d’Arnoul, commit, dans les ténèbres, une longue série de forfaits. Composée d’une mère, veuve, de trois fils et d’une fille, elle avait reçu le sobriquet de Cardinaux, parce que, dit-on, ils portaient des calottes rouges. En 1805, ces misérables furent arrêtés, traduits à la cour d’assises d’Épinal et condamnés à mort. Les trois fils et la mère périrent sur l’échafaud, le 29 fructidor an XIII-1806. La fille alla aux travaux forcés. Le pays et les environs restèrent longtemps sous une impression d’effroi au seul nom de ces Cardinaux.
Touchons à une chose plus gracieuse pour Vitel, à l’exploitation de ses eaux minérales. Les sources, qui possèdent des propriétés diverses, dont la bienfaisance est éprouvée, jaillissent un peu au-dessous du bourg, au flanc d’une vaste prairie, dans un espace de quelques hectares de terrain, au sein d’une ample vallée, ouverte au sud et à l’est, abritée au nord et à l’ouest par les montagnettes de l’Orima et de Châtillon. Un tel site fait chérir ces sources, près desquelles on respire à pleins poumons un air pur et bienfaisant. « Vraiment, nous a dit une famille de Tours, ce site nous ferait oublier notre Touraine. »
L’établissement, formé depuis une vingtaine d’années, offre ce que peut réclamer une exigence même difficile : bosquets charmants, ombrages délicieux, air pur, eaux toujours limpides, agréables à boire, faciles à digérer ; vues pittoresques, paysage à souhait. Aussi, les eaux sont-elles d’année en année plus connues et plus fréquentées : une source éminemment purgative, remplaçant celle de Niederbronn, que nous a enlevée la Prusse, vient d’être acquise et unie à l’établissement.
Mardi 8 juin 1869.
Nous allons, aux premiers pas de notre route, pénétrer dans cet antique sanctuaire dédié à la Reine des anges et des hommes, dans cette chapelle dont les nefs sont du XVe siècle, l’avant-chœur du XIIIe et dont l’abside a été par nous construite dans le style des nefs. Là, devant ce frais autel gothique, dont le gracieux clocheton voile à demi une rose dans laquelle s’épanouit une Vierge couronnée, tenant sur son bras l’Enfant divin orné du diadème, nous implorons le secours nécessaire à notre patriotique entreprise, et, le cœur joyeux, le bâton de voyage à la main, nous entreprenons notre vaste pèlerinage.
Nous prenons une vieille rue de ce vieux Vitel ; nous passons de la droite à la gauche du petit Vair, par un pont nouvellement construit ; nous laissons de côté la rue d’antique souvenir qui porte le nom de Pharamond et qui monte au Brahaut – camp de Brunehaut, – sur lequel aboutissait la voie d’Esculanum – Escles, – et nous prenons le chemin qui nous conduit à Lignéville.
Lignéville, ou mieux Ligniville, est un village antique, dont le nom fut noblement et héroïquement porté par une grande famille, alliée de la famille ducale, et qui était l’une des quatre de la haute chevalerie appelées Grands-Chevaux de Lorraine. Elle portait losange d’or et de sable. Les membres en furent mêlés à presque tous les grands évènements du pays, de la façon la plus glorieuse. L’un d’eux, Philippe-Emmanuel, né au château d’Houécourt, s’illustra par sa vaillance dans la guerre franco-suédoise. Le château fort et ses donjons ont été démolis, et il n’en reste plus que la place, avec les fermes, qui ont été vendues. La famille de Ligniville subsiste cependant toujours, seule survivante des quatre maisons de notre grande chevalerie ; elle semble avoir été providentiellement conservée, pour qu’une goutte du sang de cette vieille noblesse de l’héroïque nation catholique allât couler encore, pour la cause de l’Église et de la France, sous les murs de Sébastopol.
La seule chose qui rappelle un peu cette antique gloire, c’est l’église du lieu, véritable crypte, dont le chœur est roman et les nefs du XVe siècle. Cette église a été parfaitement restaurée par les soins de son digne curé, Paul ROUHIER.
Lignéville a vu naître, en 1744, d’un intendant de la maison seigneuriale, Joseph-Clément Poulain, dit de GRANDPRÉ. Devenu avocat, il fut pourvu, en 1770, de l’office de conseiller du Roi au bailliage de Mirecourt. En 1790, il embrassa les principes de la Révolution, fut nommé procureur-général-syndic du département des Vosges, et envoyé, deux ans plus tard, à la Convention. Lors du jugement de Louis XVI, il vota la peine de mort, avec sursis, il est vrai, mais la mort immédiate, en cas d’invasion. Cependant Poulain n’était pas un méchant homme : la terreur lui fit voter cette peine ; sa conscience lui inspira une échappatoire. Chargé d’aller apaiser les troubles du Midi, Poulain s’acquitta de cette mission avec zèle et humanité. En l’an V, il devint secrétaire, puis président du Conseil des Anciens ; il en sortit par la voie du sort, et il entra au Conseil des Cinq-Cents. Exclu de cette assemblée au 18 brumaire, il fut interné dans la Charente, où il se retira chez le célèbre Montgolfier, son ami. En l’an VIII, sur la recommandation de Bernadotte, il fut nommé président du tribunal de Neufchâteau, et en 1811 président de chambre à la cour d’appel de Trêves. Député des Vosges, pendant les Cent-Jours, il fut exilé à la rentrée des Bourbons, et trouva un refuge à Trêves, dont les habitants lui avaient conservé bon souvenir et lui accordèrent le droit de bourgeoisie. Autorisé à rentrer en France, en 1818, il s’occupa uniquement d’agriculture, jusqu’à sa mort, qui arriva en 1826, au château de Graux, canton de Coussey.
En allant de Lignéville à Saint-Baslemont, nous traversons la grande voie romaine de Langres à Strasbourg. Parvenu sur les hauteurs, nous voyons se dérouler sous nos yeux un des plus vastes et des plus beaux panoramas qu’on puisse rencontrer : d’immenses étendues de forêts, dans une plaine accentuée de monticules, entrecoupée de villages avec leurs champs cultivés, limitée au loin par les monts de la Vosge, s’étalent aux regards du voyageur émerveillé.
Sur le versant sud-est du plateau, nous trouvons, près l’un de l’autre, un antique castel et une antique église : signe de l’union intime qui régna toujours en Lorraine entre la religion, la noblesse et le peuple. L’église, de style ogival, n’a besoin que d’une restauration bien comprise, pour être un charmant édifice. Le château, d’origine très ancienne, est placé à souhait pour le plaisir des yeux.
Ce château, fort jadis, mais dont il ne reste que quelques tours délabrées, fut assiégé, en 1635, par les Suédois, qui ne purent s’en rendre maîtres, et qui, pour se venger, incendièrent le village, où cinq maisons seulement restèrent debout. La châtelaine, Alberte d’Ernecourt, née en 1607, au château de Neuville, en Verdunois, devenue épouse de Jacques d’Haraucourt, seigneur de Saint-Baslemont, se rendit fameuse dans cette guerre franco-suédoise. Son mari étant au service de son prince, le duc Charles IV, cette femme héroïque prit à cœur de défendre elle-même ses domaines. Elle s’habilla en guerrière, monta son cheval, l’épée au côté et les pistolets à l’arçon de la selle, et veilla au danger. Un jour, elle attaqua, seule, trois cavaliers qui dételaient sa charrue et leur fit lâcher prise. Un autre jour, elle lutta contre dix-sept, en un poste où elle s’était jetée dans le péril. « Elle tua ou prit à l’ennemi, dit Tallemant des Réaux, plus de quatre cents hommes. »
Une fois un officier la provoqua en duel ; l’amazone accepta et se rendit à pied sur le terrain, où l’attendait son adversaire, monté sur un cheval superbement caparaçonné. Alberte salue poliment le cavalier descendu à terre, saute sur le cheval, prend congé, en disant : « Une honnête femme ne se bat pas ainsi, » donne de l’éperon, et plante son officier, tout honteux et tout ébahi, au milieu des témoins de la scène.
Cette dame, aussi religieuse que brave, ayant perdu son unique fils, en 1644, et son mari, tué dans une bataille, au Luxembourg, voulut entrer chez les Clarisses, en 1659, à Bar-le-Duc. Sa santé, ruinée par les fatigues et les peines, ne put en soutenir le régime trop austère. Elle se retira forcément au château de Neuville, et y mourut, en 1660, dans les plus beaux sentiments de piété.
Nous descendons à Bonneval, joli vallon, encadré dans les forêts, où s’élevait autrefois un prieuré d’Augustins, fondé, au milieu du XIe siècle, par un moine du Saint-Mont, nommé Vichard, sous la dépendance de celui d’Hérival, près de Remiremont, et détruit à la Révolution de 93. Il n’y reste qu’un coin du chœur de sa belle église, détruite seulement dans notre siècle. Il reste aussi le moulin des moines et les terres qu’ils ont défrichées et fertilisées. La famille de Bonneval y a fait récemment élever une petite chapelle de style roman.
Après nous être un instant reposé dans ce nid solitaire, nous allons, à quelques pas, visiter la Belle-Roche, ainsi nommée de ce qu’un simple maçon de Relanges, Dominique PLANCOLÈNE, y sculpta pieusement, quoique assez grotesquement, au siècle dernier, les diverses scènes de la Passion.
Nous retournons vers l’ancien prieuré, et non loin de là, sur l’extrémité septentrionale d’un vaste plateau, couronné de bois de hêtres et de chênes, nous trouvons les ruines du vieux château de Bonneval. Ces ruines occupent un angle escarpé de cet immense plateau, où aboutissaient deux anciennes voies, dont l’une allait de Vitellum à Darneium, deux stations gallo-romaines. Les fouilles faites en cet endroit donnent à supposer l’existence d’un camp fortifié : des tumuli de formes diverses, des médailles gauloises, divers objets antiques, sont venus appuyer cette conjecture. Deux pierres brutes, posées parallèlement, séparées par un intervalle d’environ trois mètres, supportaient une pierre transversale dont les morceaux gisent brisés : c’était évidemment un dolmen ou table de sacrifice à l’usage des Druides. On a conclu de tout cela que le château avait été bâti sur les ruines d’une redoute gauloise.
D’ici nos vieux souvenirs nous entraînent vers le village de Relanges, où nos jeunes années s’imprégnèrent du levain des études classiques, par les soins d’un prêtre, alors chéri de tous ses paroissiens, auxquels il se prodiguait, et dont plusieurs, par la suite, devaient l’abreuver d’amertumes. Ce digne curé, M. Martin, de Darney, quitta cette paroisse, malgré lui, pour celle de Suriauville, d’où le chassa la révolution de 1848. Il se retira dans ses foyers, à Darney, et il alla mourir à Martigny.
Relanges est veuf de son prieuré de Bénédictins, fondé en 1049, par Ricuin, de Darney, et Lancède, sa femme. Défricheurs du sol, ses bons moines devaient donner aux pauvres l’aumône et aux voyageurs l’hospitalité. Ce prieuré n’attendit pas la Révolution pour périr : il avait été, sous le duc Léopold, uni, pour ses revenus, à la collégiale de Darney. Mais les Bénédictins ont laissé là un magnifique souvenir, c’est la belle église paroissiale, le plus beau monument religieux de la contrée.
Cette église a trois vastes nefs ogivales, un magnifique transept et un chœur romans à trois absides. La tour, solidement bâtie sur la croix du transept, ne se laisse deviner, à l’intérieur, que par la grosseur des piliers qui la supportent : tant le monument est dégagé ! Les nefs latérales sont larges et bien voûtées ; les fenêtres, qui manquaient au sud, à cause des bâtiments du prieuré, ont été créées récemment, et celles du nord agrandies, dans le style de cette partie de l’édifice, XVe siècle, et toutes sont vitrées en belle mosaïque. La nef principale, quoique privée de baies supérieures, a cependant une élévation assez considérable. Le chœur, qui est du XIe siècle ainsi que le vaste transept, forme un carré, terminé par un hémicycle percé de trois baies à plein cintre. Deux petites absides du même genre existent sur les côtés, et ce qui est remarquable, sans correspondre aux nefs latérales, qui se perdent dans le transept, mais vers les extrémités de celui-ci. Malheureusement, quand on a restauré, d’une manière cependant intelligente, cet édifice sacré, on a négligé de rouvrir ces deux chœurs, murés depuis longtemps et devant lesquels on a placé, vis-à-vis des basses nefs, deux autels romans avec leurs retables : ces autels sont très beaux, mais ils ne peuvent empêcher de regretter les petites absides. Le chevet de cette église, vu de la hauteur du village, à l’est, a un aspect grandiose : la construction romane en est solide ; la tour, évidemment rehaussée, au moment de la bâtisse des nefs, a quatre fenêtres ogivales. Le monument, du côté de l’ouest, ne dit rien à l’œil, parce que son portail est enterré : il serait facile pourtant de creuser le sol et d’arriver au seuil de l’édifice par un superbe escalier d’un bon nombre de degrés.
Deux jolies routes conduisent maintenant de Relanges à Darney ; nous prenons celle qui longe la prairie, comme étant la plus pittoresque, et parce que nous pouvons encore y retrouver quelque empreinte des pas de nos jeunes années, quand de Belmont à Relanges nous suivions ce chemin pour aller prendre nos leçons.
Darney, voici Darney, la ville de nos premiers ans, des années de l’enfance ; la ville qui, la première, ait frappé nos regards, encore ignorants de toutes choses ; la ville qui nous apparut si belle au sortir du village. D’elle nous aurions dit alors, comme Virgile de Mantoue :
Darney, – du celte Daren, entrée, et Haye, forêt, selon M. Mangin, à cause de sa situation à l’entrée d’une vaste forêt, – Darney remonte jusqu’au temps des Gaulois : ce fut un castellum gallo-romain. Ce castel devint une place forte, défendue par une citadelle, protégée par une muraille flanquée de tours au nombre de trente, par de profonds et larges fossés, remplis par les eaux de la Saône, qui communiquait par une coupure avec le ruisseau de Relanges. La base de son château ou citadelle était romane ; le corps en était ogival ; des constructions modernes s’y étaient posées comme superfétation. Après avoir ainsi traversé les âges, il fut détruit sous le règne du duc Charles IV, dans cette affreuse invasion franco-suédoise, qui accumula tant de ruines sur le sol de notre infortuné pays. Il reste à peine de ce château fort quelques pans de murailles, du côté du sud-est ; la dernière des portes de la ville a été récemment détruite, parce qu’elle obstruait la rue.
Ce château avait été consacré par la religion : une superbe chapelle y avait été construite par le duc Thibaut II, en 1308, et formée en collégiale, sous le vocable de saint Nicolas, patron de la Lorraine. Vendue en 1790, cette belle église a été détruite, il n’en reste pas une seule pierre. Le chapitre de cette collégiale était composé de douze chanoines et d’un prévôt, qui faisait les fonctions de curé de la paroisse. Réduit à cinq, par suite des ravages de la guerre qui avait ruiné la Lorraine, il fut relevé à dix, en 1725, par la réunion du prieuré de Relanges, et transféré dans l’église actuelle, qui ne fut entièrement achevée qu’en 1789, à la veille de la suppression de ceux qui l’avaient bâtie.
Cette église, reste insigne de la munificence du chapitre, est une belle et vaste basilique de style moderne, un peu lourde, à piliers carrés, et dont le chœur – chose étonnante de la part des plus intéressés – manque de profondeur. L’ossature en est très solide ; les voûtes en sont très simples ; une frise dentelée, portée sur des chapiteaux d’ordre ionique, en fait tout l’ornement. Le chœur est orné d’une magnifique boiserie en chêne, avec des stalles destinées aux chanoines ; la nef possède une chaire superbe de même nature : le tout sculpté par Gerdol, fils de celui qui avait taillé dans le roc, sur le chemin de la forêt, un calvaire assez remarquable, que des mains impies dégradèrent à la Révolution.
La ville de Darney eut, au Moyen Âge, une importance assez considérable : elle fut un apanage princier. Le duc Ferry IV la donna, en 1316, à son frère le prince Mathieu. Le duc René, fait prisonnier à la bataille de Bulgnéville, la céda au duc de Bourgogne, pour garantie de sa rançon. Le roi de France, Charles VII, la reprit aux Bourguignons : les Français voulaient la livrer au pillage, mais le roi s’y opposa, disant que « la ville appartenait au roi René, son cousin, et qu’il ne souffrirait pas qu’on lui causât déplaisir ni dommage. » Charles le Téméraire s’empara de Darney, en 1476, mais cette ville revint au duc de Lorraine après la fameuse bataille de Nancy.
Les armoiries de Darney étaient d’azur, à trois glands montants, feuilles et tiges d’or. Elle fut le siège d’une prévôté, puis d’un bailliage. En 1790, elle eut l’honneur de devenir le chef-lieu d’un district ; mais en l’an IX, elle ne fut plus qu’un chef-lieu de canton.
Cette ville avait vu les Récollets fonder, en 1735, dans un de ses faubourgs, un superbe couvent, qui subsista jusqu’aux jours désastreux de la Révolution. Une partie de leur maison est encore debout, changée en habitation particulière ; mais leur église et leurs beaux cloîtres ont complètement disparu. Les vertus et les travaux de ces bons moines, racontés par nos mères, à nous enfants d’un nouveau siècle, semblaient être de la bien vieille histoire, et cependant c’était l’histoire de la veille !… Tout, hélas ! était si changé, que nos jeunes esprits n’y pouvaient rien comprendre. Et qu’a donc gagné le pays, qu’a gagné le peuple, qu’ont gagné les pauvres, à la suppression de ce monastère, asile de piété, centre d’action religieuse et morale ?
Les bons pères avaient soigné l’adolescence d’un homme qui devait être la gloire de la religion et de sa patrie : tous les hommes marquants de l’ancienne France avaient été élevés par des religieux. Les cités sont fières des artistes distingués, des orateurs éloquents, des guerriers fameux, qu’elles ont vus naître dans leurs murailles ; mais quel artiste, quel poète, quel héros, est comparable à un savant de premier ordre, qui a usé sa vie et ses forces à la défense de la vérité ? Il n’a point, celui-ci, cherché la gloire ni la fortune, qui avaient déserté le camp où il combattait ; il ne comprit qu’une grande chose, demeurer fidèle à son Dieu qu’on reniait, à l’Église qu’on renversait, à la vertu que l’on conspuait ; et cet homme, si digne d’honneur ! il n’a pas même, dans sa patrie, un buste qui rappelle son souvenir. Il est vrai qu’il a sa place dans le monde catholique, au sanctuaire de tous les cœurs qui s’intéressent à la cause de la Religion, qu’il a si glorieusement défendue.
Nicolas-Silvestre BERGIER naquit le 31 décembre 1718, au sein d’une religieuse famille qui tenait un rang distingué dans sa petite ville. Doué de talents peu communs, il fut, comme le jeune Brunet de Vitel, confié pour ses premières études aux soins des Récollets, et il y fit des progrès rapides. Darney appartenait alors au diocèse de Besançon, et ce fut là que le jeune Bergier alla continuer ses études classiques, faire sa philosophie et sa théologie ; ce fut là qu’il reçut les ordres sacrés ; – mais, avide d’une science sérieuse et complète, devenu prêtre, il partit pour Paris, afin d’y achever et d’y fortifier ses études.
Au retour il fut pourvu de la modeste cure de Flangebouche, au sein des montagnes du Doubs, et y il exerça, pendant seize ans, le ministère pastoral. Le savant mais modeste prêtre ne s’y crut point déplacé, et, au milieu des soins du ministère pastoral, il employa ses loisirs et ses veilles à se rendre digne de la grande lutte qu’il allait soutenir contre les ennemis de l’Église et de la Société. Ce ne sont pas les places qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les places.
Du fond de ses montagnes un mérite éminent le mit en lumière : il fut nommé principal du collège de Besançon. Il se consacra dès lors tout entier à la défense de la foi. Le philosophisme avait levé hautement l’étendard de l’impiété ; l’abbé Bergier entra résolument dans l’arène pour en repousser les attaques sacrilèges. Il publia plusieurs ouvrages, qui révélèrent un vaillant champion de la vérité, indignement trahie, et qui portèrent son nom à tous les coins de l’Europe.
Devenu chanoine de Paris, en 1769, il mit la main à son grand ouvrage du Traité de la vraie Religion, qui parut, au bout de onze ans, en 1780 – 8 vol. in-4° ; – il y confondit, avec une science profonde et sûre, les impies, prétendus philosophes, qui s’acharnaient à en saper les fondements. Ce traité, riche d’érudition, fort de raisonnement, d’une clarté limpide, est une réponse solide à tous les sophismes de l’incrédulité. Il n’a manqué à ce grand ouvrage, pour être un chef-d’œuvre hors ligne, que la magie du style et les mouvements de l’éloquence : deux choses qui, malheureusement, se trouvaient alors au service de l’erreur. Ce traité n’en restera pas moins, par la force et l’enchaînement de ses preuves, une défense sans réplique du christianisme, une œuvre théologique de premier ordre, qui a placé son auteur à la tête des apologistes du XVIIIe siècle.
Dans son Dictionnaire de théologie, publié en 1788 – 8 vol. in-4° – on retrouve la clarté, la force et l’abondance de ses autres ouvrages. Il y attaque, dans les plus petits détails, les sophismes des ennemis de la Religion, et il en montre la faiblesse avec une précision et une lucidité qui ne laissent subsister aucun nuage. Cette grande œuvre est malheureusement empreinte des idées de ce Gallicanisme, qui était alors le triste apanage de presque tout le clergé de France.
Choisi pour confesseur par les princesses royales, Bergier vécut à Versailles comme à Flangebouche, en homme de cabinet, sans aucune prétention et loin de toute intrigue. Il lui eût été facile de parvenir ; mais il ne voulait rien des choses de ce monde. À l’offre qui lui fut faite d’une abbaye en commende, il répondit qu’il était assez riche, et il refusa. Cet homme admirable, par ses vertus et ses talents, au comble de la réputation, mourut en 1790 : Dieu lui épargna ainsi la douleur d’être le témoin des maux horribles qui allaient fondre sur la religion et sur la patrie.
Darney a aussi donné le jour à quelques autres célébrités :
1° Au jésuite DELESGUILLE, né en 1748, professeur, à Brienne, du jeune Napoléon Bonaparte, dont il écrivit ces mots prophétiques : « Ce jeune homme ira loin, si les circonstances le favorisent. » Et l’on sait comme les circonstances l’ont favorisé : sans les circonstances favorables le génie s’étiole et meurt. Piètre humble et modeste, l’abbé Delesguille refusa plus tard un emploi élevé que lui offrit son élève, devenu premier consul.
2° Au conventionnel BRESSON, né en 1760, qui montra un noble cœur et un grand courage, en se prononçant avec énergie lors de la mise en accusation de l’infortuné Louis XVI : « Je ne suis pas juge, osa-t-il dire, et ma conscience me défend d’en remplir les fonctions… Non, citoyens, nous ne sommes pas juges, car les juges ont un bandeau glacé sur le front, et la haine de Louis nous brûle et nous dévore… Notre aversion poursuit Louis jusque sous la hache du bourreau… Homme d’État, de sérieuses méditations m’ont convaincu que son existence sera moins funeste à ma patrie que son supplice… Je demande que Louis soit détenu jusqu’à l’époque ou la tranquillité publique permettra de le bannir. » Bresson, décrété d’accusation plus tard, fut obligé de fuir ; il échappa au sort qui attendait tous les modérés, et il laissa à sa famille un nom honorable et honoré, qui l’oblige devant la société et devant Dieu, si quelque chose oblige encore.
3° À Stanislas BRESSON, neveu du précédent, né en 1794 ; député en 1831 ; intendant civil de l’Algérie en 1836 ; enfin, directeur général des eaux et forêts : il aima de rendre service à tous.
4° Au lieutenant-colonel LEGROS, né en 1760 ; ce héros soutint, à la bataille navale d’Aboukir, avec 400 hommes, qu’il commandait, sur le Spartiate, une lutte acharnée de quatorze heures contre les Anglais ; plus tard, au retour de sa captivité, il se distingua de la façon la plus brillante à la bataille de Friedland ; les circonstances seules manquèrent à cet intrépide officier pour arriver au grade de général et peut-être de maréchal de France. – Nous avons connu, jeune étudiant, ce brave colonel, aux mœurs si sympathiques et si douces ; il aimait la promenade, seul, à pas lents, sa canne à la main ou sous le bras. Il aimait à s’arrêter près de nous, et toujours il nous adressait la parole en latin ; nous l’aimions : il est si aisé, par une caresse, de gagner le cœur des enfants !
5° À Louis-Gabriel Le PAIGE, savant entomologiste, surtout excellent et digne homme, qui représenta loyalement les Vosges, sous la Restauration, à la Chambre des députés.
Il est singulièrement à regretter que ses collections de lépidoptères et de coléoptères, à l’un desquels on a donné son nom, ainsi que celle de ses médailles, aient été dispersées.
6° Au notaire MANGIN, savant archéologue.
7° Au colonel d’artillerie HAMART.
On ne peut quitter Darney sans parler de ses forêts immenses, autrefois si célèbres par leurs belles verreries. De tout temps les ducs de Lorraine favorisèrent dans leurs états cette industrie, qui répandait ses produits au loin dans les nations voisines, en France, en Italie, en Allemagne. Ils dressèrent des chartes en faveur des maîtres ouvriers, qui l’établirent et l’exploitèrent : ces industriels furent traités comme gentilshommes, et ils eurent tous les privilèges des gens extraits de noble lignée. On leur donna le nom de gentilshommes verriers, et l’on fit sur eux une pasquinade, qui n’ôtait rien à leur mérite :
En 1690, on trouvait en activité, dans ces forêts, les verreries suivantes : Henezel, Thiétry, Henricel, Biseval, le Torchon, la Bataille, le Tollois, la Pile, Leppenoux, le Hattré, la Planchotte, Claudon, Senenne, Frison, Clairey, Clairefontaine, Belrupt, Couchaumont, le Hubert, la Sébille, la Houdrie et la Rochère. Il n’existe plus aujourd’hui que la Rochère, la Planchotte et Clairefontaine où l’on coule des verres blancs qui rivalisent avec le cristal. Les forges de la Hutte et de Droiteval complètent l’industrie de ces vastes forêts.
Ces verreries nous rappellent nos ancêtres du côté maternel, les de Massey, les de Finance, les de Bonnay, les du Houx, les d’Hennezel ; aussi que de fois, dans notre jeunesse, nous les parcourûmes, en recevant, dans ces nobles et chrétiennes familles, l’accueil le plus franchement cordial, reste charmant de ces mœurs antiques et à jamais perdues, où le sang reconnaissait le sang, où la parenté s’étendait aux dernières limites des vieux souvenirs.
La communauté des Verreries et Granges, répandues dans les forêts de Darney, n’avait pas de chef-lieu fixe ; elle n’était d’aucune paroisse ; elle était reçue dans les églises de Belrupt, d’Attigny et de Martinvelle, mais seulement à titre de composition avec le chapitre de Darney, auquel appartenaient les droits de la desserte. Ce ne fut qu’en 1763, sous le règne du duc viager Stanislas, qu’eut lieu l’érection de deux vicairies perpétuelles, à Hennezel et à Claudon. On bâtit les églises et les presbytères aux frais de ce prince, mais dans le style de ce siècle, qui avait complètement perdu le sens de l’architecture chrétienne.
Nous terminons cette première journée de notre voyage au sein de l’amitié. Plus d’une maison se serait ouverte pour nous offrir l’hospitalité ; mais un vieil ami est là qui réclame la préférence ; nous allons donc nous reposer chez le digne curé de la paroisse, l’abbé Michel PETITNICOLAS, prêtre éminent, dont le cœur est aussi franc et le caractère aussi bon que l’esprit élevé. Avec quel plaisir on s’embrasse ! Quelle délicieuse soirée on passe à deviser, à cœur ouvert, des choses du passé, à causer de celles du présent, à s’interroger sur les chances de l’avenir ! Comme elle rafraîchit l’âme, cette coupe que remplit la main généreuse d’un vieux camarade ! Que nous étions loin, hélas ! de prévoir les affreux malheurs qui devaient tomber bientôt sur notre infortuné pays ! Qui nous eût dit que cette vénérable tête du curé de Darney serait traînée comme otage, dans un corps de garde prussien, pendant deux nuits d’hiver ?
Mercredi 9 juin.
Nous sommes levés de grand matin : un soleil splendide nous annonce un beau jour, et nous voulons en prévenir les chaleurs, torrides au mois de juin. Nous offrons l’auguste sacrifice dans la belle église, tant admirée de notre enfance ; nous serrons, avant le départ, la main de notre hôte, et nous prenons la route de Bonvillet. Nous jetons un souvenir de regret aux âmes des vieux Récollets, en passant devant leur antique demeure ; nous traversons la vallée étroite que baigne la Saône, et nous allons nous jeter dans les bras d’un excellent et vieil ami et parent, Adolphe de BONNAY, qui nous offre un déjeuner du matin, de la façon la plus cordiale. Nous visitons ensuite un compatriote et contemporain de séminaire, l’abbé TISSIER, de Monthureux, ancien curé de Bouzemont et d’Esley, qui devait, en mourant, quelques années plus tard, consacrer sa modeste fortune à fonder une maison pour l’éducation des jeunes filles. Plusieurs endroits des environs portent des noms qui supposent, selon l’antiquaire Mangin, l’existence de monuments druidiques : la pierre Du Las ou des douleurs, du côté de Darney, et la Pierre-Percée, du côté d’Escles.
Nous traversons la Saône faible encore, comme un colosse à son enfance, et à travers les forêts qui bordent des deux côtés la route, nous montons à Jésonville, petit village de trois à quatre cents âmes, qui ne nous offre rien de remarquable, sinon une église neuve, bâtie malheureusement avant la renaissance de l’architecture chrétienne en notre siècle.





























