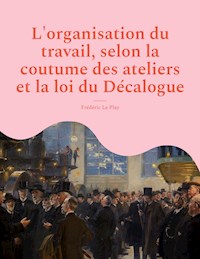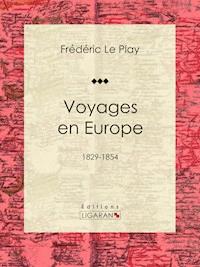
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Ma chère maman, avant de relater ce que j'ai fait jusqu'ici, je veux te donner une idée de notre mission. Notre voyage a pour but des recherches sur la géologie et la minéralogie et ce travail se fait dans les routes, les montagnes, les vallons, etc..., que nous traversons comme le Juif-Errant."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335041583
©Ligaran 2015
Les extraits de lettres de mon père que je publie aujourd’hui sont choisis dans une volumineuse correspondance qu’il adressait à sa mère pendant ses premiers voyages et à sa femme à partir de 1836.
La majeure partie de cette correspondance, qui a trait à des sujets intimes et personnels, n’offrirait aucun intérêt pour le public.
Les résultats scientifiques de ses voyages (1829-1853) à travers les différentes contrées de l’Europe, entrepris avec l’appui des pouvoirs publics ou qui ont été l’objet de missions spéciales, ont été publiés dans les Annales des mines ou dans diverses publications scientifiques.
Mais l’État de l’Europe a tellement changé depuis un demi-siècle que ces extraits, qui sont surtout anecdotiques, qui décrivent certaines régions peu connues, les mœurs et les usages d’une époque déjà si différente de la nôtre, peuvent encore présenter quelque intérêt.
C’est surtout pour ses compatriotes, pour ceux qui ont connu F. Le Play, qui l’ont aimé et apprécié, que je publie ces pages.
A.L.P.
Par M. LEFÈBVRE DE FOURCY, Inspecteur général des Mines
À une lieue au levant de Honfleur, sur la rive gauche de la basse Seine, s’étend le gros village de la Rivière-Saint-Sauveur. C’est là que, le 11 avril 1806, naquit Pierre-Guillaume-Frédéric LE PLAY, fils de Pierre-Antoine Le Play et de Marie-Louise-Rosalie Auxilion. Son père occupait un modeste emploi dans l’administration des douanes.
De 1818 à 1822, Le Play suivit comme externe les classes d’humanités au collège du Havre. L’année 1823 fut l’époque décisive de sa vie. Il avait de bonne heure compris qu’il devait tenir son avenir de lui seul et, comme diversion à ses études, il avait puisé dans quelques livres des notions d’arithmétique et de géométrie. Un ami de collège, qui se préparait à l’École polytechnique, l’engageait vivement à suivre la même direction. Ce conseil lui souriait ; mais ses aptitudes répondaient-elles aux difficultés de l’entreprise ? Pour lever ses doutes, il se rendit auprès d’un ancien ami de la famille, M. Dan de la Vauterie, alors ingénieur des ponts et chaussées à Saint-Lô. Après un mois d’épreuve, son juge lui garantit le succès. M. Dan de la Vauterie était célibataire. La présence du jeune Le Play égayait son austère solitude. Il le prit pour commensal et devint son professeur. Dans cette communauté d’existence, le maître, travailleur infatigable, au travail dès quatre heures du matin, fortifia et fixa définitivement chez l’élève les habitudes laborieuses que celui-ci avait contractées dès sa plus tendre enfance. Dans les premiers jours de 1824, Le Play fut envoyé à Paris pour faire ses mathématiques spéciales au lycée Saint-Louis, qui venait d’être fondé sur l’emplacement du vieux collège d’Harcourt et où l’enseignement des sciences avait été très solidement établi. Mon père, alors professeur à ce lycée, n’eut pas de disciple plus studieux ni plus intelligent. Le Play entra, en octobre 1825, à l’École polytechnique où il fut sergent la première année et sergent-major la seconde. Il en sortit, en octobre 1827, le quatrième de la liste générale et le premier de la promotion des mines.
L’élève des mines fut aussi brillant que le polytechnicien. Logé avec quelques élèves des ponts et chaussées à l’hôtel du Luxembourg, prenant ses repas chez Rousseau l’aquatique de légendaire mémoire dans le quartier latin, Le Play ne quittait sa petite chambre d’étudiant que pour le laboratoire de chimie ou la salle d’étude de l’École, apportant à ses manipulations et à ses dessins une rigueur et une adresse sans rivales. Cinq ans après, lors de mon séjour à l’École, on y gardait encore le souvenir d’une analyse de tourmaline qui avait duré deux mois et dont le procès-verbal était souvent consulté dans les registres du laboratoire.
Le Play ne fit que deux années à l’École. À la suite des examens qui terminèrent l’année scolaire 1828 – 1829, M. Becquey, directeur général des ponts et chaussées et des mines, lui écrivait. « Le conseil de l’École m’a donné connaissance des très remarquables succès que vous avez obtenus dans le dernier concours. Bien que vous n’ayez que deux années d’études, vous vous trouvez en tête de la liste des élèves et vous avez acquis 5 767 points de mérite, nombre auquel, depuis la fondation de l’École, n’a jamais atteint aucun élève, même de quatrième année. Je me plais à vous en féliciter et à vous en exprimer toute ma satisfaction. » Nous verrons bientôt que M. Becquey ne s’en tint point à cette lettre d’éloges.
Le Play s’était lié d’une solide amitié avec Jean Reynaud, dont le caractère quelque peu dominateur s’accommodait avec la déférence du conscrit, déférence rendue d’ailleurs facile par l’admiration que ce dernier éprouvait, suivant la bizarre loi des contrastes, pour l’imagination enthousiaste et les aspirations mystiques de son ancien. Jean Reynaud, qui devait finir par un volume de philosophie religieuse, Terre et ciel, avait commencé par le journal le Globe et le saint-simonisme. Il voyait la grandeur de la patrie dans une transformation sociale, découlant pacifiquement des dogmes de 1789 qui lui avaient été inculqués dès l’enfance. Le Play opposait à cette platonique théorie les solides arguments qu’il avait appris à tirer des faits de l’histoire. Sans s’attacher autant que son contradicteur à la méthode d’observation, Jean Reynaud ne repoussait point le projet de soumettre leur controverse à l’épreuve d’un voyage fait en commun dans cette Allemagne du Nord qu’on vantait comme la patrie de la sagesse. Le Play fit donc agréer à son ami un projet qui devait leur faire visiter en deux cents jours, pendant la belle saison de 1829, les mines, les usines et les forêts des Provinces rhénanes, du Hanovre, du Brunswick, de la Prusse et de la Saxe. L’entreprise des deux amis devait entraîner une dépense supérieure à l’allocation que l’École accordait à ses élèves. Ils se procurèrent à l’avance, par quelques travaux littéraires et scientifiques, le supplément de ressources qui leur était nécessaire, et M. Becquey, après avoir souri de la confiance avec laquelle Le Play prétendait allier l’étude des questions sociales à l’apprentissage de son métier, accueillit avec intérêt ses plans de voyage et accorda aux jeunes ingénieurs une indemnité de campagne exceptionnelle.
Nul, je crois, n’a su voyager comme Le Play. De petite stature, mais de taille dégagée, doué de jarrets d’acier, passé maître dans l’équipement du piéton, bravant les ardeurs du soleil comme les intempéries du ciel, résigné aux mauvais repas et aux mauvais gîtes, il accomplissait sans fatigue des étapes énormes, aussi dispos à l’arrivée qu’au départ. Nul aussi n’excellait comme lui à tirer des hommes et des choses jusqu’au dernier des renseignements utiles à l’objet qu’il avait en vue. Industriels et ouvriers, propriétaires et paysans, professeurs et étudiants, aubergistes et passants, tous étaient ses tributaires. Que de portes, fermées à d’autres curieux moins habiles, se sont ouvertes devant son irrésistible entregent ! Que de secrets n’ont point tenu devant sa finesse cachée sous la plus engageante parole.
Les voyageurs s’étaient proposé, dans chaque contrée, trois buts principaux : « 1° visiter les établissements spéciaux offrant au mineur des modèles à suivre ; 2° se mettre en rapport intime avec les populations et les lieux, pour établir une distinction nette entre les faits entièrement locaux et ceux qui ont un caractère d’intérêt général ; 3° rechercher avec sollicitude les autorités sociales de chaque localité, observer leur pratique, recueillir les jugements qu’ils portent sur les hommes et sur les choses. » Dans ce voyage, où ils parcoururent 6 800 kilomètres À pied, Le Play et Reynaud se mirent d’accord à l’égard de certaines thèses économiques reposant sur l’évidence des faits. C’est ainsi, par exemple, qu’ils reconnurent l’excellence des grandes corporations instituées dans les États allemands pour l’exploitation des mines métalliques. Ils ne réussirent pas à s’entendre sur la question sociale, point de départ de leur entreprise ; ils comprirent seulement qu’elle présentait une complication dont ils ne s’étaient point tout d’abord rendu compte. Le Play s’affermit dans la pensée que la solution se trouvait en grande partie dans les coutumes du passé. Reynaud conserva ses convictions sur la doctrine du progrès continu et, en général, sur le concours que pouvait prêter, en cette circonstance comme en toute autre, l’esprit de nouveauté. En résumé, « ils revinrent à la fois plus divisés d’opinion et meilleurs amis que jamais ».
De retour à Paris, Le Play se mit activement, dans l’hiver de 1830, à la rédaction de son journal de voyage ; mais un terrible accident vint interrompre son travail. Dans une préparation de potassium, une violente projection de cette dangereuse substance l’atteignit aux : avant-bras. Accourus à ses cris, les élèves du laboratoire eurent à peine le temps de lui arracher ses vêtements en flammes. Les deux mains étaient horriblement dépouillées et calcinées. On le transporta dans le cabinet chinois attenant à la salle du Conseil, aujourd’hui englobé dans la nouvelle bibliothèque ; on y installa un lit provisoire à l’aide de matelas empruntés au personnel de l’École, et, en attendant l’arrivée de sa mère et de sa sœur mandées du Havre en toute hâte, ses camarades se relayèrent tour à tour pour entretenir sur ses mains un courant d’eau froide, seul adoucissement à ses souffrances. Longtemps mal soignée par le médecin de l’École, l’affreuse brûlure ne céda qu’à une habile médication du célèbre Dupuytren. Au bout de dix-huit mois, Le Play retrouva l’usage de ses mains, déformées pour la vie, mais ayant conservé toute leur adresse pour l’écriture, le dessin et les manipulations chimiques.
Dès sa guérison, le blessé reprit et termina son journal de voyage. Ce travail fit époque à l’École et fut pour les élèves le meilleur des modèles. Édifiée sur les services qu’elle pouvait attendre de son auteur, l’Administration s’attacha ce dernier en lui confiant la direction du laboratoire de l’École sous les ordres de Berthier, et la publication des Annales des mines en collaboration avec Dufrenoy.
Le séjour de Le Play au laboratoire fut de très courte durée. Berthier, que d’importants travaux avaient justement placé à la tête de la docimasie française, n’était point disposé à partager cet honneur avec qui que ce fût. Il craignit bientôt de rencontrer un rival dans son collaborateur, et l’association scientifique entre le professeur et l’élève se rompit d’un commun accord.
Il n’en fut point de même aux Annales. Une nouvelle série, la troisième, fut inaugurée en 1832. De notables additions furent apportées aux matières courantes ; la gravure des planches fut plus soignée ; d’importants emprunts furent faits aux publications anglaises et allemandes, que le nouveau secrétaire traduisait sans difficulté. Devenu d’adjoint secrétaire en titre, le 7 janvier 1837, Le Play n’en continua pas moins aux Annales son active collaboration. Il les abandonna en 1840, quand il fut chargé du cours de métallurgie.
La publication des Annales valut au jeune ingénieur une notoriété dont il ne tarda point à recueillir le fruit. À cette époque, la prospérité des mines de plomb rouvertes dans les Sierras de Gador et de Lujar avait attiré sur l’Espagne l’attention du monde industriel, et l’on racontait que de non moins riches filons se montraient aux limites communes de l’Estramadure et de l’Andalousie. Le Play fut chargé de vérifier l’exactitude de ces récifs et de donner, chemin faisant, un aperçu géologique et statistique des richesses minérales de la péninsule. Nous avons de sa mission un très intéressant rapport dans les Annales des mines (3e série, tomes V et VI, 1834).
Le voyage dura quatre mois. La fièvre vint subitement y mettre fin et il rentra en France par la voie de mer.
En 1832, avant son départ pour l’Espagne, Le Play avait donné aux Annales (3e série, tome II) un travail statistique intitula : « Observations sur le mouvement commercial des principales substances minérales entre la France et les puissances étrangères, pendant les douze dernières années, et particulièrement pendant les années 1829-1830-1831. »
Pour le fond comme pour la forme, le travail statistique de Le Play fut très remarqué, et il eut sa grande part dans le projet de loi que le ministre fit sanctionner par la Chambre, le 23 avril 1833. Aux termes de l’article 5 de cette loi, il devait être publié, à l’ouverture de chaque session, un compte rendu des travaux métallurgiques, minéralogiques et géologiques que les ingénieurs des mines auraient exécutés, dirigés ou surveillés. Le ministre des travaux publics institua immédiatement une Commission permanente de Statistique de l’industrie minérale. Le Play fut nommé membre de cette commission par arrêté du 31 janvier 1834, et, en réalité, chargé seul du travail qu’elle devait annuellement présenter. Le premier compte rendu avait trait à l’année 1833 ; il fut distribué aux Chambres de 1834, Thiers étant ministre. Chaque année, les ingénieurs eurent dès lors à dresser (quelques-uns en les maudissant) sept tableaux de dimensions uniformes, dont les têtes de colonne avaient été libellées par Le Play, après les études les plus approfondies au point de vue de la statistique comme à celui de l’art des mines. C’est ainsi que 602 tableaux venaient, vers la fin de l’année, couvrir les tables de la mansarde donnée comme cabinet de travail au secrétaire de la Commission de Statistique, dans les bâtiments affectés aujourd’hui à l’École des ponts et chaussées. En quatre ou cinq mois, ces tableaux, soigneusement dépouillés, se résumaient en un in-4, de format, de caractère, de disposition toujours les mêmes, et contenant, en outre, pour relever l’intérêt de cette monotone publication, d’instructives notices sur les houilles, sur les fers, sur les métaux. Adjoint à Le Play comme collaborateur, j’ai vu chaque année grandir, sous sa féconde impulsion, la publication destinée à tenir le pays au courant des progrès de notre industrie minérale. Entre temps, il donnait à l’Encyclopédie nouvelle (1848) un grand article, intitulé : « Vues générales sur la statistique, suivies d’un aperçu d’une statistique générale de la France. »
L’œuvre anonyme à laquelle Le Play vouait toute son activité, et dont l’administration avait tout l’honneur officiel, fut religieusement maintenue, de 1834 à 1848, dans la voie où il l’avait dirigée. La République de 1848 avait à faire des économies dans ses budgets : la loi de 1833 fut rapportée par une loi de 1848, et le Compte rendu condamné à ne paraître que tous les cinq ans, et plus tard tous les trois ans. Appelé le 20 juillet 1848 aux fonctions d’inspecteur des études à l’École des mines, Le Play quitta la Commission de Statistique. Le volume qui suivit son départ parut en 1853 ; il comprenait les années 1847 à 1852, et perdait l’uniformité de composition si précieuse pour les recherches dans ce genre de publications périodiques.
Le repos n’était pas fait pour Le Play. Après avoir donné les mauvais mois de l’année à la publication du Compte rendu, il demandait et obtenait sans peine des missions à l’étranger. La Belgique, l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande furent tour à tour parcourues en 1835 et 1836 ; chaque mission donna lieu à un important travail concernant la production de la houille et du fer dans ces régions privilégiées. En 1837, il saisit avec empressement l’occasion d’étendre ses études aux confins orientaux de l’Europe. Un des plus riches propriétaires de la Russie, M. Anatole Demidoff, avait conçu le projet de faire à ses frais une reconnaissance scientifique des terrains carbonifères du Donetz sur la rive droite du Don, entre la mer Caspienne et la mer d’Azof. Chargé d’organiser l’expédition, Le Play s’adjoignit un personnel comprenant un ingénieur des ponts et chaussées, un géologue, un naturaliste, un dessinateur, qui l’accompagnèrent par terre jusqu’au lieu de destination, et il expédia par mer un attirail complet d’outils de mine et d’engins de sondage avec quelques maîtres-ouvriers destinés à former et à diriger les manœuvres pris dans le pays. Après avoir traversé l’Autriche et les Provinces danubiennes, l’expédition s’engageait avec admiration, en juin 1837, dans les steppes de la mer Noire, « où les herbes, écrit Le Play, s’élevaient parfois assez haut pour engloutir les chevaux ». Chacun se mit à l’œuvre suivant sa spécialité et, de retour en France, fournit son contingent, texte et dessins, à la publication de luxe qui compléta, en 1842, la libérale entreprise de M. Demidoff. La description des terrains carbonifères fut la part de Le Play dans cette œuvre commune. Mais, dès 1838, il avait adressé au ministre du commerce d’intéressantes lettres sur l’organisation économique et commerciale de la Russie méridionale. Ces lettres doivent se trouver dans les archives du ministère.
La campagne scientifique du Donetz eut pour Le Play des conséquences tout à fait inattendues. M. Demidoff possédait dans l’Oural de riches mines d’or, de platine, d’argent, de cuivre et de fer. Ces mines, livrées à d’inhabiles directeurs, étaient exploitées suivant de routinières méthodes, aussi dispendieuses que peu productives, M. Demidoff, qui avait été à même d’apprécier la puissance organisatrice de son collaborateur, soumit ces méthodes à son examen. Un premier voyage dans l’Oural, fait en 1844, démontra sans peine à Le Play toute leur imperfection, et, après avoir étudié, soit sur place, soit à Paris, les améliorations dont elles étaient susceptibles, il conclut avec M. Demidoff une association dans laquelle l’un apportait ses domaines et ses capitaux, l’autre sa science et son talent. L’extraction des minerais, leur préparation mécanique, leur traitement métallurgique, tout fut renouvelé et approprié aux enseignements de la théorie et de la pratique les plus rationnelles. De son cabinet, Le Play gouvernait jusqu’à 45 000 ouvriers travaillant dans l’Oural sous son invisible direction. Un second voyage, fait en 1853, lui permit de vérifier par ses propres yeux les résultats de la nouvelle organisation. Ces résultats se traduisaient par une plus-value considérable sur le rendement des mines.
J’ai dit, plus haut, comment Le Play employait en voyages les loisirs que lui laissait, entre les sessions des Chambres, la Statistique de l’industrie minérale. L’Angleterre fut visitée en 1842 ; l’Allemagne du Nord et la Russie en 1844 ; le Hartz, le Danemark, la Suède et la Norvège en 1845 ; la Belgique, l’Autriche, la Hongrie et l’Italie du Nord en 1846 ; la Suisse, les Provinces danubiennes et la Turquie centrale en 1848 ; l’Auvergne en 1850 ; l’Angleterre, les Provinces rhénanes, la Westphalie, l’Erzgebirge en 1851 ; l’Autriche et la Russie en 1853. Dans ses nombreux voyages, Le Play se proposait un double but. Il dirigeait ses observations et recueillait ses notes au point de vue technique et au point de vue social, comme ingénieur et comme économiste. D’une part, en effet, il se mettait de longue main en état de remplacer Guényveau dans la chaire de métallurgie qui devait vaquer en 1840. D’autre part il préparait, comme emploi de ses dernières années, une prédication écrite des doctrines propres à enrayer la décadence des populations européennes en général et de la nation française en particulier. Nous aurons plus tard à le suivre sur ce dernier terrain. Je n’ai, pour le moment, à m’occuper que du professeur. Les ingénieurs de ma génération sourient encore au souvenir du cours de métallurgie qui leur était enseigné à l’École, toujours le même depuis plusieurs années. Il était donné à Le Play de le rajeunir dès son début et, plus tard, de le tenir au courant des progrès faits par la science, tant en France qu’à l’étranger. J’ai sous les yeux, au moment où je trace ces lignes, les trois volumineux cartons où ont pris place une centaine de leçons rédigées suivant le plan le plus méthodique, illustrées de croquis dessinés et cotés de la main du maître. Je puis suivre dans chacune les modifications subies d’année en année par la rédaction, à la suite d’observations ou de théories nouvelles et, arrivé au dernier cahier, j’éprouve un véritable sentiment de tristesse à la pensée que ces feuilles, fruit de tant de labeur, fruit de tant de fatigues vont, après cette suprême revue, s’ensevelir dans des archives de famille sous la poussière de l’oubli. Nos Annales auront du moins conservé quelques pages de ce vaste et beau manuscrit.
Nous voici parvenus à l’ère de ces grands tournois auxquels l’Angleterre et la France convoquèrent tour à tour, à Londres et à Paris, les industriels, les commerçants, les artistes de la terre entière. L’Angleterre donna le signal et inaugura, en 1851, dans son féerique Cristal-Palace la première Exposition universelle. Le Play y fut membre du 21e jury et remit à la commission française un rapport sur la coutellerie et les outils d’acier, qui a été imprimé à part en 1854 à l’imprimerie impériale, et qui forme à lui seul comme un traité sur cette intéressante matière.
La France eut à son tour son Exposition qui, décrétée le 8 mars 1853, devait s’ouvrir le 1er mai 1855. La Commission chargée de la diriger avait été placée sous la présidence du prince Napoléon. Le Play, l’un des commissaires, eut tout d’abord à préparer un système de classification des produits. Dans cette aride mission, il déploya des qualités spéciales, qui devinrent des plus précieuses en présence des mille difficultés de détail que soulevait l’entreprise. Le 11 août 1854, le Comité d’exécution, trop lent dans ses allures, fut remplacé par un commissaire général, le général Morin, qui lui-même céda ses fonctions à Le Play, le 23 mai 1855. L’on sait que l’Exposition de 1855 s’ouvrit officiellement le 15 mai, aux Champs-Élysées, dans le Palais de l’industrie, auquel fut annexée une longue galerie provisoire s’étendant sur le quai de Billy, depuis la place de la Concorde jusqu’au pont de l’Alma. Ce qu’on connaît moins, ce sont les obstacles que Le Play, tardivement chargé du commissariat général, rencontra dans l’accomplissement de son mandat. Insuffisance des bâtiments, lenteur des décisions, retard des constructions, inexactitude des envois, rivalité des emplacements, tout conjurait contre ses efforts. Le succès n’en fut pas moins assuré. Le nombre des visiteurs dépassa 5 000 000, et l’Exposition, qui devait fermer le 31 octobre, fut, à la demande du public, prolongée jusqu’au 15 novembre. La liste des récompenses fut insérée au Moniteur officiel le 8 décembre et, quelques jours après, Le Play était nommé conseiller d’État. Il dut, en conséquence, abandonner ses fonctions d’inspecteur des études à l’École des mines et descendre de sa chaire de métallurgie, renonçant ainsi, non sans regrets, aux études qui avaient si bien rempli vingt-six années de sa vie.
Le Play apporta au conseil d’État ses habitudes de travail et prit une part active à la solution d’une question qui passionna en son temps l’opinion parisienne, celle de la boulangerie. La question de la boulangerie n’en est plus une aujourd’hui. Avec la promptitude des communications par mer et la multiplicité des chemins de fer sillonnant l’Amérique et l’Europe, les populations ne sauraient plus craindre la disette. Il n’en allait point tout à fait de même il y a une vingtaine d’années. À cette époque, le nombre des boulangeries était limité, et le pain taxé officiellement suivant le cours des céréales. Fallait-il maintenir une industrie, qui intéresse à un si haut degré le repos public, sous la tutelle de l’administration, en réglant son monopole ? Convenait-il de lui donner la liberté, en lui laissant pour seul frein la concurrence ? La question divisait les meilleurs esprits. Après une enquête restée célèbre, qu’il étendit jusqu’au commerce des grains, Le Play conclut en faveur de la liberté. Son avis fut adopté par le gouvernement.
La troisième Exposition universelle eut lieu à Londres en 1862. Le Play y dirigea la section française en qualité de commissaire général.
En 1867, l’honneur de la quatrième Exposition revint à la France. Elle fut, comme celle de 1855, confiée à une Commission placée sous la présidence du prince Napoléon qui donna peu après sa démission, et Le Play, commissaire général, fut en réalité l’organisateur tout puissant de cette grande œuvre. Par une combinaison aussi hardie que nouvelle, l’État, la Ville de Paris et le public furent associés au succès financier de l’entreprise. L’État devait fournir 6 millions, la Ville 6 millions, et le public 8 millions. Ces 8 millions ne constituaient qu’un fonds de garantie. Les souscripteurs n’étaient tenus à versement qu’en cas d’excès des dépenses sur les recettes. Dans le cas d’excès des recettes sur les dépenses, le bénéfice devait être partagé par tiers entre l’État, la Ville et l’association de garantie. Le capital de 8 millions fut divisé en 8 000 actions de 1 000 francs, dont la souscription n’était accompagnée que d’un dépôt provisoire de 20 francs par action. Les demandes affluèrent et constituèrent, le 20 juillet 1865, date de la clôture des listes, un capital de 10 347 000 francs. La plupart des souscripteurs, uniquement soucieux de l’honneur du pays, étaient résolus à y coopérer au besoin par des sacrifices. Ces sacrifices leur furent épargnés. Les promesses faites dans l’appel au public furent non seulement tenues, mais dépassées. La balance des opérations financières, depuis l’origine jusqu’au 4 février 1872, date de la clôture des comptes, donna :
Le dépôt de 20 francs par action avait été antérieurement restitué avec intérêt annuel de 5 p 100. Chaque actionnaire reçut donc près de go francs par action, en échange de sa confiance en l’œuvre et, l’on peut presque dire, de son patriotique désintéressement. Ce résultat constituait un heureux précédent dont le public ne devait point perdre le souvenir et qui aurait pu faciliter la tâche aux organisateurs des expositions futures. Les errements de 1867 ne furent point suivis, et de larges emprunts au budget ont payé l’éclat des dernières Expositions.
Il fallait arrêter le plan du palais. Instruit par l’expérience | de 1855, Le Play fit prévaloir un projet longuement étudié, qui avait pour point de départ une double classification des produits, par nature d’objets et par nationalité. La surface de l’espace à couvrir fut portée à 150 000 mètres carrés. La forme adoptée pour le palais fut celle de deux demi-cercles de 190 mètres de rayon, reliés par un rectangle de 380 mètres sur 110 mètres. Intérieurement, deux systèmes de division répondirent à la double classification des produits. Le premier était formé de zones concentriques recevant les groupes des produits similaires de tous les pays ; le second, de secteurs rayonnant du centre du palais et consacrés chacun à une même nation. Par cette disposition, les voies de circulation concentriques facilitaient l’étude comparative d’une même industrie dans le monde entier ; les voies rayonnantes permettaient de passer en revue toutes les industries d’un même pays. La division en zones et en secteurs fut étendue au parc qui environnait le palais, dans la mesure toutefois que permettaient les convenances de la décoration.
L’Exposition, ouverte le 1er mai, fut close le 3 novembre. Le nombre d’entrées par les tourniquets avait été de 12 millions. Ce chiffre dispense de tout commentaire. Le commissaire général, à qui revenait pour une si grande part le succès de la quatrième Exposition universelle, fut nommé sénateur. Le 12 août 1868, il reçut le titre d’inspecteur général des mines honoraire.
Nous avons suivi Le Play dans sa carrière d’ingénieur des mines, de conseiller d’État, de sénateur, d’organisateur de deux Expositions universelles. Il nous faut maintenant revenir de quelques années sur nos pas pour considérer en lui l’économiste. Nous l’avons vu, dès sa mission d’élève mineur, défendant contre Jean Reynaud la prééminence de la méthode d’observation sur les théories préconçues, pour résoudre les grands problèmes de la science sociale. Nous l’avons vu plus tard, dans ses nombreux voyages à travers l’Europe et jusqu’aux versants asiatiques de l’Oural, faire dans ses carnets deux parts, l’une consacrée aux comptes rendus de la statistique minérale et aux leçons de son cours de métallurgie ; l’autre destinée à un grand ouvrage où il se proposait d’établir par les faits les conditions dans lesquelles une nation prospère et grandit, ou souffre et déchoit. Les matériaux qu’il avait accumulés et révisés sans cesse, pendant dix-huit années d’observations, furent publiés pour la première fois, en 1855, sous le titre : les Ouvriers européens. Le 28 janvier 1856, l’Académie des sciences décernait à l’ouvrage le prix de statistique fondé par Monthyon, et, le 11 avril suivant, la Société d’Économie sociale se fondait pour appliquer à ses études la méthode inaugurée dans les Ouvriers européens.
En 1864, Le Play publia la première édition de la Réforme sociale en France, déduite de l’observation des peuples européens. Depuis, 1789, dix formes de souveraineté ont régi la France. Chacune d’elles a été instituée, puis renversée par la violence. Bien des hommes d’État, bien des écrivains ont cherché, le remède à cette instabilité sans exemple. Quoique étranger aux lettres et à la politique, Le Play a voulu découvrir le secret d’un gouvernement qui n’aurait point l’effusion du sang pour début ou pour terme. Après avoir établi que les fausses théories de l’histoire font généralement prendre le change sur les conditions de la Réforme, l’auteur démontre que l’observation des faits sociaux constitue la seule méthode propre à donner la solution de ce grand problème. Dans les quatre volumes qui composent son ouvrage, il traite successivement de la religion, de la propriété, de la famille, du travail, de l’association, des rapports privés, du gouvernement. C’est là que pour la première fois il a revendiqué en faveur de la France la liberté testamentaire qui existe en Angleterre et en Amérique. Dans sa session de 1865, une proposition tendant à accroître l’autorité du père de famille fut présentée au Corps législatif par cinquante et un députés. Elle ne fut pas prise en considération.
L’Organisation du travail (1870-1871), l’Organisation de la famille (1870-1875) dérivent de la Réforme sociale et forment comme des parties détachées et agrandies de ce vaste cadre ; la Constitution essentielle de l’humanité (1880) en est, au contraire, comme une réduction à très petite échelle.
Dans la Constitution de l’Angleterre (1875), Le Play a résumé les documents que lui avaient fournis ses nombreux voyages dans la Grande-Bretagne, et surtout ceux qu’il avait recueillis pendant son long séjour à Londres, lors de l’Exposition de 1862 ; car, suivant le mot heureux d’un de ses plus affectionnés disciples, tout était pour Le Play motif ou moyen.
Les amis de Le Play l’avaient longtemps pressé de fonder une revue périodique, destinée à répandre sa doctrine. Le livre et la parole n’ont qu’une portée restreinte ; le journal, s’il réussit, pénètre partout et impose sa propagande. Il céda à leur désir, et l’année 1881 a vu naître, sous son patronage, la Réforme sociale, revue paraissant tous les quinze jours. Dans le numéro du 15 février 1882, Le Play écrivait, et ces lignes sont presque les dernières que sa main ait tracées : « Au terme d’une journée de marche, le voyageur aime à se recueillir dans le calme du soir ; il jette un regard sur le chemin parcouru, avant que les ombres de la nuit ne descendent cacher la terre pour ne laisser voir que le ciel aux mystérieuses clartés. Par une faveur de la Providence, après une carrière qui n’a pas été sans labeur, je jouis de ce repos. J’ai vu grandir peu à peu l’École de la paix sociale et, me portant par la pensée vers l’état des esprits au début de mes travaux, je me plais à croire qu’elle n’a pas été sans quelque utilité. J’ai confiance dans son avenir. Sans doute, il ne faudra pas épargner notre peine, et la route paraîtra longue encore, même à ceux qui viendront après moi. Mais, avec l’aide de Dieu, ils accompliront la tâche commencée, parce qu’ils garderont toujours comme règle de servir la cause de la vérité pour assurer le règne de la paix. »
Pendant les dernières années de sa vie, Le Play habitait le premier étage d’une ancienne et belle maison située sur la place Saint-Sulpice, qui avait appartenu à Thénard et que possède encore la famille du célèbre chimiste. C’est là que, dans l’embrasure de la fenêtre éclairant son vaste cabinet, debout devant un bureau-pupitre, il rédigeait ou réimprimait ses traités d’économie sociale et subvenait à la plus active des correspondances, heureux de toute nouvelle adhésion à ses doctrines, venue de Paris, de la province ou de l’étranger. En octobre 1880, se déclara la première crise de l’affection du cœur qui devait l’emporter. Il s’en releva promptement, mais il dut se condamner dès lors à la plus rigoureuse retraite. Après le travail du jour, son salon recevait, toujours ouvert, les amis de la maison ou les étrangers de passage. Une lecture à haute voix, une partie de whist, la préparation de la Revue, et surtout une causerie sérieuse ou gaie, suivant les visiteurs, remplissaient tour à tour ces réunions du soir, auxquelles présidait avec une grâce incomparable la dévouée compagne qui, depuis quarante années, donnait à Le Play le bonheur intime du foyer. À neuf heures apparaissait le samovar, souvenir des voyages de Russie. La sonnerie de dix heures donnait le signal de la retraite. Tel était l’invariable train de vie qu’interrompirent seules quelques crises, toujours très courtes, de la maladie. La soirée du 4 avril dernier s’était écoulée pareille à toutes les autres. Le lendemain, vers midi, Le Play perdit subitement connaissance, et finit sans un cri, sans une souffrance. Il laisse un fils, qu’il avait été heureux d’unir à la fille d’un camarade illustre, Michel Chevalier, et dont il a pu voir grandir la jeune postérité.
Pierre-Guillaume-Frédéric Le Play a voulu dormir son suprême sommeil au milieu des champs qu’il a tant aimés. Il possédait près de Limoges, dans la commune du Vigen, le domaine de Ligoure. C’est dans l’humble cimetière de ce village que repose aujourd’hui celui qui fut : Inspecteur général des Mines, Conseiller d’État, Sénateur, Commissaire général des Expositions universelles de 1855, 1862 et 1867, Fondateur de la Société d’Économie sociale, Grand-Officier de la Légion d’honneur et grand dignitaire de tous les ordres étrangers connus.
Paris, juin 1882.
(1829)
Mercredi 10 juin 1829, de H ***, près Thionville. – Ma chère maman, avant de relater ce que j’ai fait jusqu’ici, je veux te donner une idée de notre mission. Notre voyage a pour but des recherches sur la géologie et la minéralogie et ce travail se fait dans les routes, les montagnes, les vallons, etc., que nous traversons comme le Juif-Errant. Le travail le plus important se compose de la visite d’un très grand nombre d’usines de toute espèce, et comme en général ces usines appartiennent à des particuliers, qui par conséquent sont maîtres chez eux, la possibilité de faire ce travail dépend complètement de leur bonne volonté. Nous sommes plus ou moins bien reçus, suivant les différents cas, et c’est alors que nous avons à déployer toutes nos ressources de séduction ; c’est aussi la partie de notre travail qui présente les incidents les plus variés.
Nous sommes partis en voiture de Paris, vendredi 5 juin, à 8 h. du matin, en suivant la route de Meaux. Nous avions à voir aux environs de Saint-Dizier une usine à fer. Nous avons été parfaitement bien reçus par le propriétaire de l’usine, qui en est en même temps le directeur. C’est un homme excessivement riche qui fait de l’industrie en amateur, aussi son logement est un véritable palais. Sa femme fort aimable nous a fait les honneurs de sa maison avec la meilleure grâce.
Les environs de l’usine sont tous dessinés en jardins anglais et on peut dire que les forges ainsi que les cascades qui font mouvoir les roues ne sont que des agréments. Les jardins sont à cheval sur la Marne, il y a en divers points des digues qui forment des petits lacs charmants bordés de saules et de peupliers ; ce dernier est l’arbre du pays, ainsi que l’acacia dont M. B…, cultive de petites forêts, dont le produit est transformé en charbon pour ses fourneaux qui en consomment par jour 10 000 kilog. Tu peux te faire par là une idée de l’importance de cette forge ; c’est un spectacle excessivement curieux et Mme B…, ne manque jamais d’aller se promener dans l’usine, le soir, après son dîner. Il est beau de voir ces grands fourneaux de 40 pieds de hauteur et de 8 à 10 pieds de largeur qui sont remplis de charbon embrasé d’où le fer sort aussi liquide que de l’eau, au point qu’on peut le prendre avec de grandes cuillères pour aller le porter au loin dans des moules. J’ai oublié de te dire que, joignant l’utile à l’agréable, M. B…, a un magnifique jardin potager, où il y a à peu près de tout, depuis l’humble navet jusqu’au magnifique ananas.
Nous avons été forcés d’accepter le dîner, le coucher et le déjeuner le lendemain ; mais comme tout cela était offert avec cordialité, la violence a été douce. Nous sommes enfin partis le dimanche par des chemins difficiles au travers de belles forêts pour Bar-le-Duc, où nous sommes arrivés le soir. Nous y avons, outre un bon dîner, mangé des confitures et bu un vin qui méritent leur réputation. La journée du 9 a été consacrée à faire des courses géologiques aux environs de Metz, à voir les fortifications qui sont des plus remarquables. J’étais seul alors, car Reynaud m’avait quitté le matin pour aller voir sa mère qui habite un petit vignoble aux environs de Thionville. Metz est une ville éminemment militaire et où tout cède à l’aristocratie du sabre. C’est à Metz que se trouve la plus grande partie de la promotion de l’École polytechnique. Elle compte environ 60 élèves à l’École d’application militaire. Dès que mon arrivée a été connue j’ai eu nombreuse société et j’ai été immédiatement invité à partager l’ordinaire de la brigade composée pour la majeure partie de mon ancienne salle d’étude de l’École polytechnique.
J’ai passé une soirée très agréable en me trouvant réuni avec tous les camarades dans un café qui leur est exclusivement réservé et où il est bien rare qu’on voie se glisser quelque pékin.
Le lendemain 10 juin, à 4 h. du matin, je me suis mis pédestrement en route pour H ***.
H *** est un assez joli village qui doit son existence aux forges magnifiques qui sont établies en cet endroit.
Elles appartiennent à Mme de X… et sont dirigées par M. de Y…, ingénieur des mines, qui est le gendre de cette dame. Nous avons trouvé dans cette maison un accueil complètement différent à celui que nous avait fait M. B… Toutefois, comme membre de notre corps, M. de Y… n’a pu s’empêcher d’être poli, mais il l’a été sans la moindre nuance de cordialité. Je n’ai pu toutefois me dispenser d’y dîner avec Reynaud, qui était venu me rejoindre. Cette maison n’est si désagréable que parce que tout le monde est lancé dans un excès de dévotion qui passe toutes les bornes. Pour t’en donner une idée, voici la circonstance qui a amené le mariage de M. de Y… avec Mlle de X… Dans une mission qui eut lieu à Metz, il y a 4 ou 5 ans, on ne put trouver une personne pour porter les croix. Enfin on déterra un homme de la plus basse extraction qui porta l’une et M. de Y… qui s’offrit pour porter l’autre. Tous les élèves de l’École polytechnique de Metz furent, comme tu dois le penser, peu flattés de cette association d’un de leurs camarades avec ce rebut de la ville ; mais Mlle de X…, qui assistait à la Mission, prenant pour un acte d’héroïsme ce qui n’était qu’un acte intéressé, signifia à sa mère qu’il n’y avait qu’avec un pareil homme qu’elle pourrait faire son salut. M. de Y… pressa les choses, vu que Mme de X… est excessivement riche. Il se remaria quoique sa dernière femme fût morte seulement 6 mois auparavant. – Ce qu’il y a de curieux, c’est que l’ingénieur de Strasbourg qui est son chef, étant resté absent de chez lui pendant 6 mois, a trouvé à son retour les deux avis de décès et de mariage. M. de Y…, ne nous trouvant probablement pas l’air assez mystique, ne nous a pas adressé une seule fois la parole pendant le dîner. Quant au fils de Mme de X…, c’est un jeune homme charmant qui, malgré les précautions de sa mère, est entré complètement dans les idées du siècle, et n’a pas conservé la moindre trace de jésuitisme. Il a travaillé pour entrer à l’École polytechnique, il a même été reçu avec distinction, mais sa mère n’a jamais voulu lui permettre d’entrer dans ce lieu de perdition, et l’a gardé auprès d’elle, malgré le désir bien naturel qu’il avait d’aller jouir du fruit de ses travaux.
18 juin, de Sarrelouis. – Nous sommes partis le 11 de H *** et après une course à travers bois, ravins, etc., nous sommes enfin arrivés chez Reynaud, où sa mère nous a reçus de son mieux. Le lendemain 12 nous avons été coucher à Bouzonville après une journée de 69 k. ou d’un peu plus de 17 lieues. Le 13, j’ai traversé la frontière de Prusse et quitté la France pour la première fois de ma vie.
À 3 h. de l’après-dîner nous avons fait notre entrée à Sarrebruck.
Le 14, qui était un dimanche, nous avons été voir Oberbergrath qui est le directeur des mines et qui nous a donné des lettres de passe pour visiter toutes les mines et usines du pays exploitées par le gouvernement. On peut déjà observer un changement notable dans les mœurs, surtout dans celles des aubergistes qui sont plus honnêtes gens que ceux de France et d’ailleurs et en général de bien meilleur ton. Celui chez lequel nous sommes, à Sarrebruck, où nous devons encore retourner, est le type de l’aubergiste allemand. Il est très riche et n’exerce plus qu’en amateur ; il n’a pas d’enseigne, en sorte qu’il ne loge que ceux qui lui conviennent et nous avons eu le bonheur d’être de ceux-là. Le dîner chez M. Hilt est toujours présidé par lui, c’est lui qui sert à table avec beaucoup de gravité, en sorte qu’on peut se considérer comme invité pour son argent. On voit là quelques habitués assez drôles et quelques voyageurs, mais l’ensemble n’en a pas moins l’air d’un dîner de famille. Mme et Mlle Hilt ne viennent à table que quand il n’y a que les habitués et, la preuve que nous avons fait de grands progrès dans les faveurs de M. Hilt, c’est que notre présence n’empêche plus l’arrivée de ces dames. Les domestiques ont aussi une nuance bourgeoise, il y a une bonne bien drôle, qui ne sait pas un mot de français et qui fait notre éducation pour l’allemand. Depuis 3 ou 4 jours j’ai déjà fait des progrès bien sensibles. Le pays de Sarrebruck est couvert d’usines et de mines de houille qui nous donnent beaucoup de besogne. Hier 17, nous avons commencé une tournée de 3 jours vers le nord et nous sommes venus coucher à Sarrelouis.
La garnison prussienne, en allant faire les exercices militaires, nous a régalés d’une marche avec des instruments de cuivre nouveaux très remarquables pour la partie harmonique. Déjà l’on sent l’approche de l’Allemagne pour la musique. J’ai déjà entendu plusieurs chanteurs vagabonds des rues toujours chanter avec la plus grande justesse. Nos pauvres joueurs d’orgue de Barbarie, qui n’ont jamais eu de leur vie une instruction musicale, ne gagnent pas à la comparaison. Je me rappelle avoir entendu avec mon camarade une femme qui chantait des chansons allemandes avec un enfant de 8 ans en s’accompagnant sur la guitare ; ils avaient l’un et l’autre une voix désagréable, mais ils chantaient avec tant de précision, qu’avec de pauvres moyens ils faisaient l’effet le plus agréable. Quand nous serons décidément dans le cœur de l’Allemagne nous entendrons tous les dimanches au soir des concerts d’amateurs en plein vent qui ne le cèdent en rien à ceux d’Italie.
Nous allons passer par les vallées de Dateveiler vers le N.-E., dans le duché des Deux-Ponts qui appartient à la Bavière, puis nous nous dirigerons par le Mont Tonnerre sur Mayence ; nous redescendrons ensuite le Rhin jusqu’à Bona en suivant la rive gauche ; nous remonterons ensuite sur la rive droite jusqu’à Coblentz.
Kusel (Bavière), 24 juin 1829. – De Sarrelouis nous sommes remontés jusqu’à Wardern pour revenir à Sarrebruck ; nous faisions ce voyage surtout pour voir des usines et divers travaux de mines excessivement intéressants pour nous. Le pays est en général pittoresque, surtout aux environs de Wardern, où nous sommes arrivés après une journée de 16 lieues 1/2. Le 22 nous étions revenus chez le bon M. Hilt, à Sarrebruck. Ce brave homme, qui nous regardait déjà comme faisant partie de la maison, nous a fait part du prochain mariage de sa fille à qui il donne 120 000 fr. de dot, ce qui n’est pas mal pour un aubergiste.
La métallurgie et la visite des mines ne sont guère favorables aux aventures, toute notre journée dans le pays de Sarrebruck est employée à descendre dans des houillères, et rien n’est plus triste que la visite d’une mine. Après être descendu à une grande profondeur, on pénètre dans des galeries basses et étroites où le sol est toujours boueux, on est couvert d’eau qui tombe par infiltration, et pour toute distraction on voit passer de temps en temps un homme qui trie le minerai placé sur un chariot, ou bien on entend les explosions des mines des travailleurs qui vous saluent toujours avec le gluckauf de rigueur. Ce mot est consacré par toute l’Allemagne, il a quelque chose de mélancolique, il signifie bonheur au-dessus et semble dire que le bonheur n’est pas fait pour les pauvres mineurs.
De Sarrebruck nous sommes partis le 23 pour Neunkirchen, j’ai vu ce jour-là dans une mine que j’ai visitée une couche de houille qui est embrasée depuis un temps considérable et on voit sortir de dessus la montagne une fumée épaisse comme celle qu’exhalent les volcans. La montagne est excessivement aride, elle est très chaude dans quelques points, et toutes les roches sont calcinées comme si elles avaient été mises dans un fourneau. On exploite dans une mine qui est sous la montagne même des couches de houille voisines de celles-là. J’ai pénétré dans un endroit très proche de la couche embrasée où l’on a une chaleur de plus de 35 degrés ; les mineurs y ont tellement chaud que, même étant complètement nus, leur corps est toujours baigné de sueur. C’est, je t’assure, un triste spectacle que celui de ces malheureux quoique le mot soit peut-être impropre, puisqu’en général les mineurs aiment leur état. Nous avons entrepris aujourd’hui une course assez longue, celle de Neunkirchen à Kusel.
À cela près de l’excessive chaleur, tout alla bien jusqu’à 3 lieues de Kusel, mais, à peine entrés sur le territoire de la Bavière, dans un pays qui était devenu très montagneux, nous aperçûmes un orage que le vent nous amenait avec une grande vitesse. Nous commençâmes à hâter le pas, mais dix minutes après il était sur notre dos et nous le reçûmes avec la gravité la plus imperturbable jusqu’à un village situé à 2 lieues de Kusel. Nous n’avions pas été complètement traversés, aussi je manifestai l’intention d’attendre un peu dans une grange pour voir ce que l’orage deviendrait. Reynaud, voulant faire le brave, me dit qu’il allait néanmoins aller en avant et le voilà parti toujours par la même petite pluie. Dix à douze minutes après, voilà l’orage qui se déclare avec une fureur inconcevable. Le village fut en peu de temps coupé en deux par un torrent impossible à traverser et l’on entendait au moins dix détonations par minutes.
Pendant ce temps j’avais retiré ma redingote que je brossais sur le foin avec un soin minutieux. J’avais étendu ma cravate mouillée pour ne pas lui faire prendre de mauvais plis. Tout absorbé par ce travail d’économie domestique, je ne m’étais pas aperçu que dix ou douze indigènes étaient entrés dans la grange et me considéraient avec des regards de stupéfaction, comme si j’avais été un sorcier occupé d’opérations magiques. Il est de fait que mes habits, mes paquets étendus çà et là donnaient à ma situation une apparence équivoque. Je ne suis pas encore fort dans l’art de parler la langue, je l’entends avec beaucoup de difficulté et je ne la comprends absolument pas quand elle est parlée par des paysans qui parlent allemand à peu près comme les Bretons parlent français. Tu peux concevoir combien je fus peu flatté quand l’un d’eux, plus intrépide que les autres, se mit à me faire quelques questions. Comme je présumais qu’il me demandait qui j’étais au nom de l’honorable compagnie je lui répondis, en aussi bon allemand que je pus, que j’étais un voyageur français et que j’attendais la fin de l’orage. Je me serais aussi facilement fait comprendre en lui parlant Russe. Je vis bien qu’il n’avait compris autre chose que le mot : français, qui circula aussitôt dans toutes les bouches de mes sauvages des deux sexes, et que j’entendis bientôt répéter dans une grange voisine tant la chose semblait extraordinaire à ces espèces de Hurons. Cependant le même sauvage qui m’avait adressé déjà la parole continua à me parler comme si j’avais pu l’entendre et je crus apercevoir, à la chaleur croissante de son discours, qu’en général l’assemblée n’était pas contente de moi. Les sauvages femelles s’agitaient beaucoup. Dieu sait tout ce qu’elles disaient, mais par malheur je n’en savais rien ; ma situation commençait à devenir assez embarrassante, je commençai donc à rassembler mes habits que je remis sur mon dos et qui avaient bien séché dans l’intervalle, enfin d’un air menaçant j’armai ma main droite de mon gros marteau. Mais en général prudent, il fallait songera la retraite et la porte était barrée par l’armée de sauvages dont le nombre s’était augmenté ; nous étions au 1er étage, c’est-à-dire environ 15 pieds au-dessus de terre et je vis, par la fenêtre qui était ouverte, que rien n’était plus facile que de me sauver par là ; mais ne voulant pas en venir à cette extrémité avant le commencement des hostilités, je m’assis tranquillement sur la fenêtre en gardant mon air résolu et en faisant aussi bonne contenance que possible contre le caquetage et les cris des femmes et des enfants qui dans cette classe forment le véritable fléau du voyageur.
Les choses étaient en cet état quand un nouvel arrivant fit changer la face des affaires. Juge quelle fut ma joie quand j’entendis ce brave homme me demander, en bon français, quel hasard m’amenait dans cette grange. Pour me donner de suite de la considération, je lui dis que j’étais un officier français qui voyageait en Allemagne et que ma voiture s’étant brisée ce matin, sur la route de Neun-Kirchen à Kusel, j’avais pris le parti de continuer la route à pied avec mon domestique que j’avais envoyé en avant pour me chercher des chevaux et qu’enfin, en attendant les chevaux et la fin de l’orage, je m’étais reposé dans cette grange ; que j’avais lieu d’être fort étonné de la manière inhospitalière quelle on avait l’air de me recevoir. Le brave homme que la Providence m’avait envoyé avait fait avec les Français toutes les campagnes de l’Empire, pendant que tous les pays en deçà du Rhin appartenaient à la France. Juge donc quelle fut la colère de mon brave troupier quand il sut que ses sauvages compatriotes avaient manqué de respect à un officier français. Il se mit aussitôt à les traiter d’une belle façon, et me prenant par la main, il m’invita à entrer chez lui. Je m’aperçus en m’en allant que mes sauvages avaient considérablement changé de manière de voir à mon égard et que mon conte de la voiture brisée avait eu le plus grand succès. Arrivé chez mon brave homme, nous commençâmes par boire une bouteille de vin, il commença aussi par me demander dans quel corps je servais ; comme je savais qu’il avait été troupier, j’avais grande crainte dans le choix de mon corps de tomber sur un de ceux où il avait servi et par suite de me blouser quand nous en serions venus à causer des détails du métier. Je jugeai plus prudent de me donner pour un officier de marine et je lui dis que j’allais m’embarquer sur ma frégate qui m’attendait à Anvers pour aller faire un voyage autour du monde. Mon brave a cru tout cela comme l’évangile ; il a alors commencé le récit de ses guerres, ce qui nous a fait boire une seconde bouteille de vin, puis enfin je manifestai l’intention de partir pour Kusel, malgré les instances de mon brave troupier qui m’observait qu’il valait beaucoup mieux attendre mon domestique. Cette raison me touchait fort peu, comme tu peux le penser, et, malgré l’offre d’une troisième bouteille, je me mis en route, la pluie ayant alors complètement cessé. Avant de partir je demandai à mon homme pourquoi les sauvages avaient l’air si furieux, il me dit que les femmes avaient été fort scandalisées de ce que je ne faisais pas de signe de croix à chaque éclair. Elles craignaient que cette impiété n’attirât la foudre sur les granges et elles proposaient simplement de me faire un mauvais parti. Tu vois donc que, sans l’arrivée de mon troupier, j’aurais pu ajouter une page à l’histoire des dangers des superstitions humaines.
En arrivant à Kusel je trouvai le camarade Reynaud couché pour qu’on fît sécher ses habits. Il avait fait toute la route de Kusel avec le plus fort de l’orage ; une seconde après le commencement de la grande pluie il ne lui était pas resté un fil de sec sur le corps, il avait encore marché pendant quelque temps pour trouver un abri, mais, en réfléchissant qu’il ne pouvait pas être trempé plus qu’il ne l’était, il avait pris le parti de marcher pour arriver le plutôt possible. Il avait vu tomber à deux cents pas de lui un coup de tonnerre qui avait abattu un arbre. À ce moment la pluie était devenue si intense et le gênait tellement en le frappant à la figure qu’il s’était couché à plat ventre sur l’herbe pour la recevoir sur le dos, mais comme la montagne était pour ainsi dire couverte d’une nappe d’eau qui jaillissait autour de lui, comme lorsqu’un torrent rencontre une pierre, il dut bientôt renoncer à cette position qui n’était pas tenable, pour continuer sa route dans l’état le plus grotesque. Aussi en arrivant à Kusel tous les petits sauvages sortaient des maisons pour hurler après lui comme cela se voit chez nous pendant le carnaval. C’est avec cette brillante escorte qu’il se présenta à l’hôtel de la Poste.
Mon entrée au contraire fut des plus pompeuses, vu que j’étais parfaitement sec. Mais cependant j’étais crotté comme un barbet et harassé par la fatigue d’une journée dans laquelle nous avions fait environ dix-huit lieues, dont cinq le matin et treize l’après-midi. Aussi, par suite d’un système que nous pratiquons dans le voyage, nous terminâmes cette journée par un souper des plus copieux dans lequel nous bûmes trois bouteilles de vin de Bavière et après lequel nous dormîmes d’un sommeil qu’on ne connaît que dans pareilles circonstances. Voici en quoi consiste le système dont je te parlais. La partie la plus délicate de notre individu pendant le voyage est sans contredit la plante des pieds que nous nous appliquons à maintenir dans le meilleur état possible, car, avec la moindre anicroche, il est impossible de marcher et de faire des journées telles que les nôtres. Nous avons remarqué qu’après une marche forcée la peau de la plante des pieds est très sensiblement unie. C’est ce que nous appelons dans notre argot une perte de cuir, nous avons trouvé un remède infaillible à cette perte, c’est de beaucoup manger. Nous reconnaissons constamment que la nuit qui suit un bon souper suffit complètement pour reposer le cuir le plus endommagé ; à cet égard, le souper d’hier ne nous a rien laissé à désirer pour les résultats.
Obentein (duché d’Oldembourg), 27 juin. – Notre excursion d’avant-hier s’est encore terminée par un orage encore plus fort que celui que j’ai décrit précédemment. Après diverses péripéties, rentrant à Kusel, je trouvai le camarade dans la même situation que la veille, vu qu’il avait été absolument traversé. Je vis ce jour-là une chose qui peut donner une idée de la violence de ces orages : un champ de pommes de terre qui était sur la pente d’une montagne avait été complètement entraîné, pommes de terres et fond de terre, tout était dans le torrent, il ne restait plus qu’une roche nue.