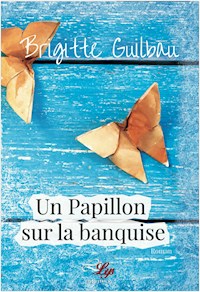Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LiLys Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Malade, Charles Depreez refuse l’acharnement thérapeutique et fera tout pour que ses dernières volontés soient respectées.
102.670, c’est la clé du secret que cet homme s’apprête à révéler à Florence, une auxiliaire de vie qu’il considère comme sa fille. Une révélation difficile à accepter pour cette jeune femme en proie à la violence conjugale.
Peut-on rendre justice soi-même ? Avons-nous le droit de vie ou de mort sur les autres ? Œil pour œil, Florence sera entraînée dans la spirale d’une Loi vieille comme le monde: celle du Talion.
L'auteure nous entraîne dans une spirale de haine et de vengeance, où une seule loi règne : celle du Talion.
EXTRAIT
— Flo, vous voulez bien venir dans monbureau, s’il vous plaît !
Il ne s’agissait pas d’une question, Florence le savait. Et encore moins d’une expression formulée avec politesse car le « s’il vous plaît » venait de claquer dans le couloir du bureau comme le fouet sur la croupe d’une bourrique têtue. Son chef de service n’était pas enclin aux égards ou à la courtoisie, encore moins à la compassion. Il faisait partie de cette catégorie de supérieurs hiérarchiques qui considère que les échelons de la bureaucratie sont suprêmes.
Et qui se servent de cette soi-disant supériorité pour asseoir un appétit de puissance sans imaginer un seul instant que la plus élémentaire amabilité serait au service d’un rendement accru de leurs employés. Son savoir-vivre se limitait aux formules toutes
faites et usuelles. Sa galanterie était urbaine. C’était un chef de service, simplement. Ni plus, ni moins. Il n’était donc pas question de tergiverser. Florence
À PROPOS DE L'AUTEUR
Petite fille, née en hiver d’un père d’origine bretonne et d’une mère ardennaise, j’ai affiché très rapidement un caractère trempé.
Aujourd’hui, je suis professeur de cours philosophiques. Active et engagée, mes objectifs pédagogiques et mes travaux d’écriture sont tous tournés vers la réflexion humaniste, certains avec force et désespoir, d’autres avec l’ironie propre aux vrais sensibles, mais toujours avec le même dénominateur commun : la condition de l’Homme, ses espoirs et ses doutes.
Cet engagement citoyen m’a valu la reconnaissance de mes pairs avec le prix de la Fondation Reine Paola pour l’enseignement, le prix de la CommunautéFrançaise de Belgique et le prix Condorcet-Aron. En 2003, j’ai été Namuroise de l’Année et reconnue « Enseignant Entreprenant ». Certaine que les actes prévalent sur les paroles, j’affiche une attitude résolument anti-tartuffe en disant qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une face de Carême pour défendre la vie car défendre la vie c’est l’aimer. J’apprécie cette réflexion de Zola qui dit qu’il faut savoir où on veut aller, que c’est bien... mais que c’est encore mieux de montrer qu’on y va et il m’arrive d’ajouter « Tu veux du bonheur? Donne du bonheur...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
S’il a brisé un os, on lui brisera un os
Code de Hammourabi, Mésopotamie, 17 siècles avant J.-C.
Wakangli yewaye.Père, rejoins (aide)-moi.Ate hiyu ye.Quelqu’un m’a fait tomber.Tuwa aiyahpemaye.Mère, rejoins (aide)-moi.Ina hiyu ye.Quelqu’un m’a fait tomber.Tuwa aiyahpemaye.Alors j’envoie l‘éclair
« Cette cérémonie se déroula pendant la nuit. Les guerriers Lakotas étaient assis en ligne, leurs chevaux derrière eux. Aucun participant n’avait le droit de parler. Seuls, les loups, proches, hurlaient car leurs cris envoyaient « une voix » et les mots reçus furent chantés, lors d’une vision, par l’Homme Sacré qui exhortait à la vengeance.
C’étaient les loups qui lui envoyaient leurs instructions. Les loups et les hommes sont les seuls à connaître le sentiment des représailles et du talion. »
William K.Powers, La langue sacrée, discours surnaturel chez les Sioux Lakotas, éd.
Du Rocher, 2003
Mars
— Flo, vous voulez bien venir dans mon bureau, s’il vous plaît !
Il ne s’agissait pas d’une question, Florence le savait. Et encore moins d’une expression formulée avec politesse car le « s’il vous plaît » venait de claquer dans le couloir du bureau comme le fouet sur la croupe d’une bourrique têtue. Son chef de service n’était pas enclin aux égards ou à la courtoisie, encore moins à la compassion. Il faisait partie de cette catégorie de supérieurs hiérarchiques qui considère que les échelons de la bureaucratie sont suprêmes. Et qui se servent de cette soi-disant supériorité pour asseoir un appétit de puissance sans imaginer un seul instant que la plus élémentaire amabilité serait au service d’un rendement accru de leurs employés. Son savoir-vivre se limitait aux formules toutes faites et usuelles. Sa galanterie était urbaine. C’était un chef de service, simplement. Ni plus, ni moins. Il n’était donc pas question de tergiverser. Florence traversa le couloir, ouvrit la porte de verre et, toujours la main sur la clenche dorée, attendit.
Les bâtiments du centre-ville qui regroupaient l’entreprise de services aux personnes étaient austères.
Probablement fallait-il montrer aux clients que leur argent n’était pas dépensé en futiles articles de bureau ou superficielle décoration. Tout respirait, ici, le travail sévère, la besogne utile, le fonctionnement réfléchi, la fatigue salutaire et l’ennui rémunérateur. Etait-ce le chef de service qui avait déteint sur l’environnement ou l’inverse, Florence se posait souvent la question.
Il n’y avait que deux…non, trois digressions à cette morosité ambiante…un, la cravate du chef de service ; deux, la réceptionniste qui ne comprenait toujours rien au fonctionnement de la centrale d’appel téléphonique et riait à tous bouts de champs en se trompant dans la distribution des communications et trois, cette habitude qu’il avait d’appeler tout le personnel par un diminutif. C’était des Flo par-ci, des Steph par-là, des Domi, des Nath et des Jo ! Comme s’ils étaient intimes ! Comme si son statut lui permettait cette condescendance qu’il jugeait familière, courtoise et de bon aloi et que tout le monde trouvait effrontée et ordinaire. La seule qui y échappait était la Galloise Connie et tout le monde comprenait pourquoi !
Après cinq années passées dans cette boîte, Florence ne savait toujours pas dire lequel de ces trois écarts à l’austérité ambiante l’énervait le plus.
Ceci était pourtant un moindre mal comparé aux cravates de l’intéressé qui choquaient sur le personnage autant que des palmes à un oiseau, des ailes à un éléphant, un sourire serviable chez la concierge ou une tenue à paillettes de vedette des eighties sur un croque-mort.
Ces cravates étaient toutes plus ridicules les unes que les autres, se disait-elle. D’autant que ce chef, à l’allure qu’il pensait classique mais restait quelconque, poussait la balourdise à afficher ce qu’il appelait ses « cravates tendances » à toutes occasions ! Une horreur ! Les quatre saisons et autres jours festifs défilaient sur ces satanés bouts de tissus ! Le personnel avait droit, de janvier à décembre, aux motifs adaptés à la saison : verdure au printemps, feuilles mortes en automne, fleurs jaunes, roses ou rouges en été sans oublier, bien entendu, le bonhomme de neige en décembre, le Père Noël et le feu d’artifice pour présenter ses bons vœux au patron qui offrait alors son fameux mousseux à vous flanquer une migraine jusqu’à l’Epiphanie. En juin, il était apparu avec un palmier et un parasol, en mars avec Titi et Gros Minet et tous avaient pu découvrir Betty Boop pour la fête des secrétaires ! A l’anniversaire de la mort d’ Hergé, son geste mémoriel avait été de nouer autour du col de sa chemise un capitaine Haddock qui jurait son bien connu Mille sabords ! Il ne manquait plus à sa collection qu’un poilu en cuissardes pour la Gay Pride, un cercueil à la Toussaint et une paire de seins à la Lolo Ferrari pour la journée de la mammographie !
Hubert, c’était son prénom, portait une alliance mais personne n’avait jamais vu sa femme. Peut-être faisait-il semblant d’être marié finalement, logique ! C’était bien le genre d’homme à considérer que ça lui donnait un statut d’équilibré social. Et puis, qui oserait se promener au bras d’un homme qui exhibe de telles cravates ou le détester à ce point pour les offrir ?
Florence avait passé les débuts de son stage à passer l’attitude de son supérieur à la loupe, ne pensant rien de valorisant, arrivant parfois à le mépriser.
Puis elle avait changé d’avis. A bien le regarder, à le fréquenter, à le cerner, ce n’était pas ses cravates qui dérangeaient… Non, ce n’était pas elles le problème. Parce que les mêmes accessoires portées par quelqu’un d’autre auraient été bien sympathiques ! Les mêmes compléments qualificatifs auraient été des clins-d’œil humoristiques, comme un calendrier de l’Avant réparti sur trois cent soixante-cinq jours. Elles n’avaient aucune responsabilité sur l’image qui était renvoyée. Parce que c’était lui, le problème. Oui. Le problème venait de la contradiction entre les cravates colorées et comiques et le reste de la personne, autoritaire, arrogante, sévère, refoulée et terne.
En souriant, elle se disait simplement : « Pauvres cravates ».
On devrait faire comme pour les chiens, pensait elle, en le regardant trifouiller dans ses papiers à la recherche d’elle ne savait quoi à son intention. N’importe quel éleveur vous dirait que c’est le chien qui doit choisir son maître et non l’inverse. Et bien, ce devrait être identique pour les cravates ! Elles devraient avoir le choix. C’est de la non-assistance à cravate en danger !
Florence souriait toujours, perdue dans ses pensées. Elle attendait qu’il lui propose de s’asseoir.
Elle ne s’était jamais rendue compte qu’elle dénotait, elle aussi, dans ce bureau par sa fraîcheur et sa spontanéité.
Elle était jolie, dans cette position de nonchalance, accoudée au chambranle de porte. Petite mais bien proportionnée, elle portait merveilleusement le Slim et le petit pull rose échancré. Ses longs cheveux bruns soyeux étaient retenus par une barrette dans le dos. Ses yeux en amande étaient d’un brun profond que son teint mat rehaussait. Elle était le type même de la jeune femme qui donne l’impression d’être encore lycéenne, ce qui entraînait un manque de confiance de la part de ses collègues, encore trop nombreux à la penser inexpérimentée. Pourtant, tout qui se serait arrêté sur ses yeux, qui les aurait vraiment regardés, aurait constaté qu’ils étaient traversés d’un chagrin subtil, amer et mélancolique mais en même temps d’un amène appétit pour la vie pourtant contradictoire. Ils étaient capables de vous fusiller, de vous envoyer mille éclats réjouissants et dans la même seconde de se voiler et d’aller se perdre dans un monde où plus rien n’existait.
Quelques année auparavant, la jeune femme avait, avec mention, terminé ses études classiques.
Passionnée par les us et coutumes des civilisations passées, animée d’une volonté d’analyser et de contextualiser les témoignages matériels des croyances parfois oubliées, Florence, jeune femme curieuse, dotée d’une rigueur et d’un esprit d’analyse pointu, avait donc décidé d’entamer un cycle de Bachelier en Histoire de l’Art et Archéologie, seule voie susceptible d’étancher sa soif de savoir ancien.
La disparition brutale de sa mère laissa son père dans une prostration affective dont il ne sortit que pour aller la rejoindre au cimetière trois mois plus tard. La jeune femme ne trouva jamais la force, l’abnégation ou l’amour nécessaire pour l’aider à sortir de la dépendance alcoolique où il s’était laissé sombrer. Peut-être parce qu’elle avait compris que c’était sa volonté et que l’alcool ne l’avait pas pris en traitre mais que c’était bien lui qui se l’était annexé des années auparavant, lorsqu’il avait perdu son travail et que les agences pour l’emploi ne pouvaient lui venir en aide.
Il avait alors poussé la porte de l’établissement voisin, un bistrot qui accueillait les personnes en mal de vie. C’était alors installée une routine : métro, crédo, bistrot, dodo.
La mort de sa femme, la seule qui donnait un sens à sa vie, lui fit perdre tous ses repères. Et comme il n’eut pas le goût d’en chercher d’autres parce qu’il se disait trop vieux, ou trop seul ou trop inutile, ou trop imbibé, ou qu’il utilisait ces excuses pour ne pas en trouver, il lâcha les rames. Florence s’en voulait depuis lors de ne pas l’avoir aidé, de ne pas avoir vu les rames qui flottaient de plus en plus loin de la barque qui s’éloignait ou, pire, de les avoir vues sans broncher parce qu’elle l’avait jugé, elle aussi, trop vieux, trop seul ou trop inutile ou trop imbibé mais il était trop tard. Elle savait qu’elle n’était pas coupable mais se sentait responsable. Parce qu’il ne suffit pas d’être coupable pour être responsable ! Elle n’avait pas de remords, elle avait des regrets comme on en a toujours quand on n’a pas tendu la main à ceux qu’on aimait. Elle ne savait pas non plus si elle s’en voulait de ne pas l’avoir soutenu parce qu’elle le jugeait insoutenable dans sa déchéance qu’elle condamnait ou si elle s’en voulait de l’avoir laissé dépérir parce qu’elle lui en voulait de ne pas l’avoir choisie pour donner un sens nouveau à sa vie.
Toujours est-il que cette double disparition la laissa sans ressources et donc dans l’impossibilité de poursuivre ses études. Après avoir galéré, elle aussi, d’agence en agence en évitant de passer par la case « bistrot », elle atterrit dans cette entreprise d’aides multiples aux personnes qui travaillant avec des assureurs proposant les services d’auxiliaires de vie aux personnes dépendantes. Comme elle n’avait aucune spécialité dans ce domaine, elle remplissait les fonctions de préposée au nettoyage, dame de compagnie et assistante aux menus travaux tels que les emplettes.
— Prenez place, dit enfin son chef de service qui venait de retrouver le document qu’il cherchait.
Tiens, se dit-elle, il me demande de m’asseoir. Il a donc un service à me demander. Elle sourit discrètement, se déplaça prestement, tendit la main, tira le dossier du siège et s’assit.
Polie, elle attendit. Tout, dans sa manière, était retenu. Même sa façon de s’asseoir sans ostentation. Elle ne croisa pas les jambes et ne prit aucune pose. Elle resta droite, les mains sur les genoux, bien à plat.
Son chef, engoncé dans ses papiers et son costume, avec cette cravate où Obélix soulevait un menhir, affichait la mine de celui à qui on ne la fait pas. Le masque était bien entraîné. Florence ne savait toujours pas ce qu’on ne pouvait pas lui faire, ni lui dire, mais le message fonctionnait : tout le monde se tenait à carreau !
En cachette, tout le personnel s’amusait à imaginer ce chef obscur d’une agence provinciale sans envergure en train d’obéir à son épouse que chacun fantasmait et c’était très amusant. Pour sa part, Florence l’imaginait aisément en tablier, les fesses à l’air, en train de faire la vaisselle dans son appartement décoré de meubles sans âme, soumis à sa maîtresse-épouse.
Pendant qu’il parcourait le document d’un air concentré, elle laissa vagabonder son imagination.
Certains hommes, se dit-elle, sont unis à des squaws, ce sont des femmes guerrières qui traversent la ville comme elles iraient à la chasse, elles sont nomades et l’horizon les chatouille. Ils ont peur de les voir filer avec les papooses et le produit de la chasse alors ils sont aimables, courtisans et mortifiés.
Certains ont des épouses, des compagnes, des doudous, elles affichent régulièrement des petits sourires légèrement désabusés qui en disent long, parce qu’elles ont enterré la hache avec la squaw qu’elles étaient il y a longtemps et préfèrent le calumet de la paix aux espaces sans fin pour la satisfaction de leur sédentaire de mari que ça ne rend de toute façon pas heureux et qui rêve dès lors d’espaces et de femmes guerrières en regardant la leur qui sourit mais ne rit plus. En tout cas, plus avec eux.
D’autres sont des filles d’Eve, ce qu’on appelle des femelles. En général, elles ne trouvent pas de mari car elles n’attirent que les croqueurs de pommes. La majorité des maris rangés les désirent mais durcissent le regard pour que ça ne se voie pas ! Surtout devant leur femme ! Evidemment ! Comment expliquer à sa doudou casée, semblant satisfaite en société mais ne riant plus qu’il rêve de la voir transformer leurs soirées spartiates en banquets de plaisirs où elle évoluerait en femelle hétaïre cultivée et lubrique ?
Quelques répliques du Royaume Introuvable qu’elle avait lu il y a plusieurs années lui traversèrent l’esprit :
« — J’aimerais…
— Quoi donc, mon garçon, demanda Dickson en voyant rougir son élève.
— Voir danser les moukères dans l’un ou l’autre café arabe ! confessa le jeune homme un peu confus » 1
Florence eut envie de rire. Mais pourquoi donc pensait-elle à cet extrait ?
Elle se pinça les lèvres et se concentra sur l’homme qui était en face d’elle. Oui, se dit-elle, celui-là doit être marié à une greluche, une péronnelle qu’il suit dans la rue en caniche porteur. Il paie, il se plie, il ouvre les portes et les écrins pour bijoux, il fait la vaisselle en tablier. La jeune femme l’imaginait très bien dans ce rôle. Et pourquoi pas aussi en soumis masochiste, pieds et poings liés, suppliant son amazone juchée sur ses talons aiguilles de recevoir une correction…Cet homme jouait avec trop d’application son rôle de chef besogneux jusque dans le détail de la défiance disciplinée pour ne pas cacher une docile soumission qui le rendait subordonné intramuros et donc par voie de conséquence omnipotent et insidieux avec ceux qu’il jugeait subalternes.
C’était son oxygène !
Elle se secoua et sortit de ses pensées se disant qu’il était beau de rêvasser, mais qu’elle n’avait toujours aucune idée de ce qu’il lui voulait.
Il lui fallut quelques secondes pour se ressaisir et se rendre compte qu’il avait ouvert un dossier client.
— Je voudrais que vous remplaciez Justine. C’est important, le client est mécontent.
— C’est qui ?
Florence saisit le dossier. L’adresse n’était pas éloignée de chez elle. Elle lut : « Charles Depreez, soixante-deux ans ».
— Pourquoi a-t-il besoin d’une aide familiale ?
Le caniche-courtier, laveur de vaisselle, redevint un chef de service. Et un chef de service, ça ne répond pas aux questions, ça ordonne ! Surtout quand ça ne connaît pas les réponses aux questions posées par des subalternes.
— On s’en fout. Il en a besoin, c’est tout.
Florence leva les yeux et rencontra son regard. Il y lut de la désapprobation, parut légèrement décontenancé et n’ajouta qu’un mot :
— Cancer.
— Je ne suis pas médecin.
— Non, ça je sais mais vous avez le savoir-faire pour ce job.
— C’est vrai que pour un vieux, l’archéologie ça aide, dit-elle en souriant.
— On n’est pas vieux à soixante-deux ans, répondit-il avec emphase.
— Je blaguais !
— Trêve de balivernes.
Il eut un geste impatient de la main, un geste qui voulait encore dire « on s’en fout » et continua :
— Il refuse d’être hospitalisé, il lui faut donc de l’aide.
— Pourquoi moi ?
— Parce que Madame est une intello et que ce vieux fou a déjà rendu folles deux idiotes, ça devrait être dans vos cordes !
— Ah bon !
— Si t’as rien d’autre à dire, je considère que c’est okay.
— Je devrai faire quoi ?
— Ménage, causette, courses, tea-time…
— Quels horaires ?
— On ne sait pas encore mais si tu conviens, ça pourrait être full time !
Florence était dubitative. D’un côté le plaisir d’un seul client au lieu de courir de maisons en maisons pour nettoyer, faire les vaisselles sans échange de paroles, mais de l’autre, la maladie et le danger de ne pas se plaire si l’homme était désagréable. Que ferait-elle s’il s’agissait d’un malotru ?
Son hésitation la desservit. Hubert, ne voyant aucune réaction de la part de son employée conclut à un accord. Il se leva pour notifier la fin de l’entretien. Il était midi : un chef est toujours à cheval sur les horaires, surtout lorsqu’ il a faim.
La jeune femme l’imita mais ne peut s’empêcher de demander :
— Mais pourquoi aurait-il massacré les autres ?
— Ça, j’en sais rien fifille, paraît qu’il est foldingue !
La moutarde lui piqua les narines. Fifille, fifille ! Imbécile, se dit-elle, je t’en ficherai, moi, des fifilles ! Elle repoussa la chaise. L’entretien était terminé. Affaire classée.
— Je commence quand ?
— Vas-y après-midi, comme ça tu verras ce qu’il veut !
Florence quitta le bureau, prit son sac, sa veste de daim et sortit. L’air frais de mars lui piqua les joues. Elle se dirigea vers un bistrot et commanda un café. L’idée de s’occuper d’un moribond ne lui plaisait pas du tout. Elle n’aimait pas l’odeur de la maladie qui se transforme lentement, insidieusement mais inexorablement en odeur de mort. Elle n’aimait pas les couronnes mortuaires, les têtes de circonstance, les familles qui se déchirent sur l’héritage, les rancœurs, les adieux et évidemment les regrets.
La mort était mortelle. Elle n’était pas une femme de mort, elle était une squaw. Oui, une squaw. Elle l’avait toujours su. Ou voulu…
Elle fit la moue et pouffa. On ne pouvait pas dire qu’elle voyait l’horizon dans l’appartement minable de son quartier pitoyable avec son colocataire de tipi alcoolique et coléreux. Pourquoi avait-elle souffert du comportement de son père si c’était pour, aujourd’hui, accepter les mêmes travers adoptés par son compagnon ? La vie nous ramène toujours aux mêmes dilemmes, aux mêmes choix ou alors est-ce nous qui reproduisons sans cesse le même schéma ? Elle ne le savait pas mais n’arrivait pas à se résoudre à quitter Josh. En fait, elle réagissait exactement comme elle avait vu faire sa propre mère : elle attendait qu’il arrête de boire. Elle voulait qu’il la choisisse, elle ! Elle ne voulait voir que les moments où il était gentil et refusait de regarder en face, ceux, de plus en plus nombreux, où il était odieux. Elle avait peur de se sentir coupable plus que de ses colères. Elle avait peur de reprendre sa route. Florence voyait très bien les rames flotter derrière la barque mais lorsqu’elle essayait de les rendre à sa moitié, il les lui jetait au visage !
Il faut être deux pour s’en sortir à deux…Si tu rames seul, la barque tourne en rond, si tu rames pour lui, tu n’avances pas et s’il refuse les rames et se laisse dériver, faut-il rester dans la barque ? Elle comprenait aujourd’hui ce que sa mère avait vécu. Elle comprenait pourquoi, parfois, on sourit mais ne rit plus.
Elle quitta définitivement ses pensées pour se concentrer. Elle n’avait toujours aucune idée de ce qu’on lui voulait.
Sans parler de ce métier si valorisant qu’il… vous envoie panser les blessures, écouter les souffrances et nettoyer les cuvettes de toilettes d’étrangers. Elle se voyait déjà en garde-malade, « suant et souffrant les poisons » de la mort, la supportant, la regardant arriver. Non ! Elle n’aimait pas ça ! La mort, ça ne s’apprivoise pas, ça ne se reçoit pas, ça n’adoucit rien, ce n’est pas un cadeau. C’est une puanteur, une souffrance, une désolation, une caisse sans horizon, fermée de l’extérieur pour bien montrer au cadavre raidi dedans, qu’il n’a plus voix au chapitre. Il est devenu un objet, partie prenante de sa boîte à poignées.
La mort, ce n’est pas vivable ! Quelle galère, Florence avait déjà la tête d’enterrement.
Elle prit le bus pour se rendre à l’adresse et marchait dans la rue comme on se traine derrière un corbillard. Normal, la jeune femme croyait encore : que seule la vie offre un espoir ; que lorsqu’on a plus vingt ans on est automatiquement vieux ; qu’après la taille « S » on est gros ; qu’avec des lunettes on voit tout ; qu’il suffit d’écouter pour entendre ; que la seule façon de marcher c’est en regardant uniquement devant soi ou encore que toutes les certitudes sont des vérités.
Florence n’avait pas encore rencontré Charles Depreez.
1Harry Dickinson, Tome 4, Le Royaume Introuvable, Dargaud, juin 1996
Charles
« Une vraie rencontre, une rencontre décisive, c’est quelque chose qui ressemble au destin. »
Tahar Ben Jelloun.
Le quartier où se trouvait la maison de Charles Depreez était quelconque. Après être descendue du bus, Florence se dirigea vers un carrefour et obliqua dans la rue adéquate qu’elle remonta. Elle chercha le numéro en regardant distraitement les façades. Les interdictions de stationner flanquées sur les portes de garages succédaient aux volets clos ou non.
37, 39…41. La demeure de Charles Depreez était la dernière de la rue, sur le coin. Florence se recula pour l’observer et découvrit une maison à un étage, probablement construite dans les années soixante, qu’elle devina agrémentée d’un jardin duquel on ne pouvait distinguer que les arbres au fond de la propriété, à quinze ou vingt mètres du pignon car celui-ci était ceint d’un mur de pierre atteignant donc probablement le mètre quatre-vingt.
Elle revint vers la porte d’entrée. Les châssis, récents, en polychlorure de vinyle gris clair tranchaient peu sur la façade blanche mais lui donnaient une sérénité agréable à l’œil. Toutes les fenêtres de la façade étaient en verre opaque. Florence eut le sentiment que le propriétaire de cette demeure refusait de voir et d’être vu. Elle décida que cette maison lui plaisait et sonna.
L’homme qui ouvrit la porte n’avait rien d’un moribond. Florence fut mal à l’aise une fraction de secondes, ses certitudes chavirèrent. Elle se raccrocha donc immédiatement à l’idée que cet homme-là ne pouvait être le malade. Il était trop vif, trop éveillé, trop vivant.
Grand et plutôt bien charpenté, habillé d’un pantalon de velours noir et d’un polo blanc, il avait le regard clair. Mais ce regard, malgré sa douceur, n’était pas celui d’un sentimental mou, malléable ou amoureux affectionnant, flexible ou délicatement nunuche. Non ! L’homme avait les yeux d’un sentimental dans la réceptivité et l’échange. On comprenait vite qu’il était doux par choix et non par faiblesse. Il lui tendit la main. Une main longue et fine mais nerveuse. Elle la serra. Ils se regardèrent. Elle ne cilla pas. Il sourit.
La jeune femme se présenta simplement en disant :
— Je viens pour l’emploi.
— Entrez, je vous prie. L’agence m’a téléphoné pour me prévenir.
Il s’effaça et fit un geste de la main pour l’inviter à entrer. Il n’y avait pas de hall, cette maison n’était pas traditionnelle. On entrait directement dans une belle pièce très lumineuse aux tons de gris. Les murs étaient clairs, recouverts de plâtre-chaux teinté brut. Leur effet gris brume avait manifestement été obtenu après qu’ils aient été cirés. Quelques tapis dans les tons gris taupe rehaussaient la beauté des meubles où le gris béton s’harmonisait avec des objets métalliques. Ce n’était pas la maison d’un monsieur de soixante-deux ans qui allait mourir, se dit-elle, mais elle se reprit immédiatement devant l’absurdité de cette réflexion et ajouta :
— Bonjour Monsieur, Florence Hartoix. L’agence m’a demandé de venir rapidement.
— Quelle agence ? Mortuaire, matrimoniale, immobilière, casting, voyages ? dit-il avec le sourire de celui qui teste son interlocuteur.
Florence sourit. Elle pensa à ses deux collègues sacrifiées sur l’autel des intérimaires candides.
— Agence fédérale de contrôle nucléaire, Monsieur.
— Quel plaisir, Madame. Voulez-vous être présentée immédiatement au placard à balais radioactifs ou acceptez-vous une boisson ?
— Une boisson sera du meilleur effet, Monsieur.
— Parfait, suivez-moi.
Elle lui emboîta le pas et traversa la pièce principale pour se rendre dans un patio blanc aux meubles de bois du même ton. Il lui désigna un fauteuil Chesterfield blanc placé face à un Club en vieux cuir brun roux craquelé qui dénotait avec la majorité de gris de la maison depuis la façade jusqu’au jardin. Elle prit place. Il s’éloigna.
— Thé ? Café ? Alcool ? Limonade ? énuméra-t-il en quittant la pièce.
— Café, je veux bien, si vous en avez, répondit-elle à voix haute.
— Parfait !
Il fut absent quelques minutes pendant lesquelles elle put à discrétion regarder autour d’elle.
La pièce où se trouvait ce salon donnait directement et de plain-pied sur un jardin délimité par le mur de pierres qu’elle avait vu de l’extérieur. Pas très grand, mais spacieux pour une maison urbaine, il était conçu sur le modèle des jardins japonais qu’on appelle plutôt chez nous, en Occident, jardin sec ou zen. Les jardins japonais sont magiques car ils ne se révèlent jamais complètement à la vue, souvent pour des raisons esthétiques. Dissimuler certains éléments selon le point de vue rend le jardin plus intéressant et le fait paraître plus grand qu’il ne l’est réellement. Le miegakure2 de cette maison, chargé de bambous, utilisait la végétation et des éléments de décor en pierre pour cacher ou montrer différentes parties du jardin selon la perspective du spectateur en l’incitant à parcourir du regard tous les détails d’un point intéressant à l’autre, sans se lasser….