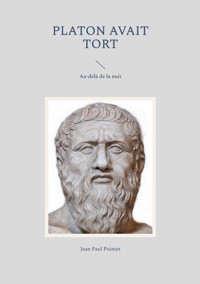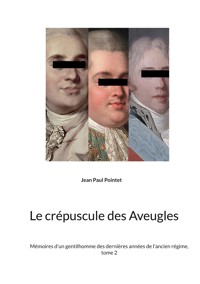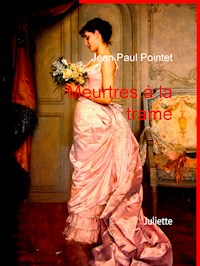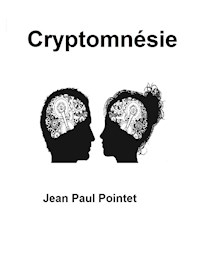Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Mémoires d'un gentilhomme des dernières années de l'ancien régime est une tétralogie qui s'adresse avant tout aux lecteurs exigeants, passionnés d'histoire, soucieux d'authenticité et qui aiment s'instruire, tout en lisant un bon roman. Elle s'adresse aussi à ceux qui aiment qu'une histoire se termine bien et qui souhaitent découvrir un poète exceptionnel, André Chénier, son frère moins connu mais courageux, Marie-Joseph Chénier, et surtout la femme la plus extraordinaire de cette fin du XVIIIe, à mes yeux aux moins, Olympe de Gouges. Sont aussi présents, et c'était inévitable, d'authentiques monstres sanguinocrates, imbéciles ou hypocrites, chacun se fera son opinion. Mais ce roman est aussi l'histoire d'un homme passionnément épris de son épouse, qu'il fera tout pour arracher à la guillotine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 711
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Je remercie mon épouse et mes deux filles, ainsi que tous ceux de mes anciens collègues qui m'ont dit de si jolies choses sur ma prose. Je remercie également Jean Laurent Poitevin pour sa courtoisie et sa confiance. Je remercie enfin mon fidèle ordinateur, que j'ai si souvent martyrisé pour gérer efficacement des milliers de pages de documentation. Enfin je remercie les éditions BOD qui permettent à tant d'auteurs et de lecteurs de partager leur passion.
Pour ma maman
Sommaire
Prolégomène
La difficile survie
L'ami des lois
Soulagement et désespoir des autres
Les derniers mois d'une année charnière.
L'infamie d'un meurtre "officiel"
Rester ou rentrer ?
Un dangereux cénacle
Madame de Paris
Châtiment
Capitole et Roche tarpéienne
L'abbaye de Monte-à-Regret
Robespierre
Melpomène à l'honneur
Melpomène en prison
Bellot
La mort d'une reine
La mort d'une amie
Monsieur de la Mort
La déesse Raison
La bascule à Charlot s'emballe
Un moulin à silence de plus en plus bruyant1
De Saint-Lazare à l'atelier d'un claveciniste réputé
Timoléon
Coups de tonnerre en cascade
La guillotine voyage
Prairial
Place du Trône-Renversé
Maison Egalité, ci-devant Collège du Plessis.
Thermidor
Excipit
Prolégomène
Un de mes amis, côtoyé en prison, utilisait souvent ce terme en préambule de ses miscellanées1. « Un prolégomène, c'est ce qu'il faut savoir avant de commencer me disait-il. Imagine le désarroi de ceux qui te liront s'ils ne savent pas pourquoi ton premier chapitre s'intitule "La difficile survie". Et que dire de ce titre étrange, À l'ombre de la guillotine ! Faut-il comprendre que tu as vécu à côté de cet engin de mort répugnant ? » Les quelques mots qui suivent ambitionnent de satisfaire cette légitime curiosité, ils serviront de lien avec ce qui précède dans le récit de ma vie2.
Le hasard d'un mariage d'amour et d'une ascension sociale inespérée avait fait de moi le responsable en second du Garde-meuble royal. À ce titre, je côtoyais souvent Leurs Majestés, surtout la reine qui appréciait la compagnie de mon épouse. En effet, après les terribles journées d'octobre 1789 ayant provoqué le retour de la monarchie aux Tuileries, le cercle des courtisans s'était prodigieusement restreint. Marie-Antoinette en souffrait et ses enfants avaient peur. C'est tout naturellement qu'elle avait demandé à Bérénice de venir les distraire en amenant notre fille, petite poupée vivante qui faisait la joie de Madame de France, l'orgueilleuse Marie-Thérèse Charlotte, et de son fragile petit frère, le dauphin. Les évènements s'étaient précipités, tragiques, à la fois pour la monarchie, mais aussi pour ma propre famille. Bérénice était malade depuis longtemps, elle refusait d'en parler et même Vicq-d'Azyr3, le propre médecin de la reine, avait reçu des consignes de silence. S'affaiblissant sans cesse, elle n'avait plus eu la force d'accompagner notre fille aux Tuileries, de ce fait, c'était Éléonore, la marraine, qui la remplaçait ce 10 août 1792, jour atroce où un roi incapable, accablé d'infirmités psychologiques, avait laissé massacrer ses gardes Suisses et arrêter tous les membres de la maigre cour qui lui restait.
J'avais été conduit à la prison de l'Abbaye. Les massacres avaient commencé presque aussitôt, alimentés par la peur de l'armée austro-prussienne qui marchait sur Paris. Celui qui faisait office de juge, un bien grand mot, s'appelait Maillard. Le procès durait à peine deux minutes, juste le temps d'identifier celui qui comparaissait, il était ensuite massacré à coups de sabre. J'avais vu mourir tous mes amis et attendais mon tour, quand un hasard me sauva la vie. Bien que haut fonctionnaire disposant d'une charge importante, je n'avais pas oublié mon enfance de pauvre. Je parlais suffisamment bien le patois saintongeais pour comprendre vite que mes gardes appartenaient à ma province natale. Nous avions échangé quelques mots. Celui qui parle la langue du peuple ne peut pas être son ennemi, Maillard s'était intéressé à mon cas. Je lui avais expliqué mon long combat contre les privilégiés, et notamment trois ducs qui avaient mis ma tête à prix4. Cela m'avait sauvé la vie.
Il me reste à expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre pour le 4ème volume de mes Mémoires. La réponse est simple, par haine. Après avoir connu Versailles, Trianon, Rambouillet et tant d'autres demeures royales dont j'assurais l'entretien, j'étais mieux placé qu'un autre pour savoir que notre roi était bon, animé de bonnes intentions, et que notre pauvre reine était injustement calomniée. La chute de la famille royale et son long calvaire provoqua en moi un dégoût pour tous ceux qui en étaient coupables. Je suis allé les voir mourir un par un, à commencer par les Girondins, ces faux modérés qui les premiers ont provoqué la perte du roi.
Je suis allé voir mourir Manon Roland, aussi entière et acharnée dans ses haines que dans ses affections. Celle qui n'avait pas de mots trop durs contre la reine, dont elle souhaitait ardemment qu'elle soit jugée et punie pour ses crimes, fut exécutée le 8 novembre 1793, soit 23 jours après celle qu'elle avait tant détestée.
J'étais avec Sanson à la Conciergerie lorsqu'on est allé chercher Camille Desmoulins, le bégayeur du Palais-Royal, l'homme qui s'autoproclamait procureur général de la lanterne et encourageait les exécutions sommaires d'aristocrates. Je l'ai vu se débattre avec désespoir, et ce jusqu'à l'échafaud où il fut lamentable au point d'excéder les autres condamnés à mort.
Guillotiné Fabre d'Églantine qui se moquait de la reine dans son "il pleut bergère". Guillotiné Philippe d'Orléans qui votait la mort du roi son cousin pour ne lui survivre que 289 jours, payant ainsi une longue vie de lâcheté et de trahison. Guillotiné, Dumas, Hébert, Herman, Hanriot, Coffinhal, Fouquier, Villate, tous ces sanguinocrates zélés qui ont rendu les places publiques impraticables, tant le pavé n'avait plus soif au point qu'il a fallu déplacer six fois la guillotine. Pour tous ces monstres j'étais au premier rang, dans l'ombre de celle que le peuple appelait avec dérision La Monte-à-regret. Je bénéficiais de l'amitié de Sanson qui me réservait la bonne place, et j'affirme sans remords avoir pris plaisir à voir ces baveurs de haine se faire raccourcir. J'ai vu Robespierre tuer un par un tous ses rivaux, à commencer par Danton qu'il qualifiait "d'idole pourrie", Hébert qui hurlait de peur dans sa cellule, Roux, l'ancien prêtre. J'ai vu ce même Robespierre subir à son tour les crachats de la foule, des dizaines de ses partisans l'ont suivi. J'ai vu tomber la tête de mythomanes croyant à leurs mensonges, celles de doctrinaires d'un bonheur placé sur le piédestal de la théorie, ou de brillants orateurs, mettant leur talent au service d'une démesure utopique. Je suis allé les voir mourir l'un après l'autre, et je m'en suis réjoui, je me suis repu de leur désespoir car enfin, Dieu, s'il existe, n'a-t-il pas émis le premier cette théorie fondamentale qui veut que : "Qui a vécu par la guillotine périsse par la guillotine5".
Au terme de ma vie, avec une épouse que j'aime comme au premier jour, et une descendance dont je suis fier, je reprends la plume, un peu contre mon gré. Je ne pensais pas terminer le cycle des Mémoires d'un gentilhomme des dernières années de l'ancien régime. Pourquoi ai-je survécu alors que tant sont morts ? Écrire devenait difficile, trop de crimes, trop de mensonges, trop de haine y compris chez Robespierre, l'incorruptible, qui m'honorait d'un semblant d'amitié. Mais j'aime finir ce que j'entreprends. Je livre donc mon récit à l'hypothétique curieux qui voudra découvrir comment j'ai traversé ces années d'horreur, et je reprends le fil de mon récit, là où je l'ai interrompu à la fin de mon troisième tome.
1 Il s'agit de Louis Sébastien Mercier, auteur d'un extraordinaire et savoureux Tableau de Paris avant la Révolution, et de sa suite, moins connue, Paris pendant la Révolution, ou, le nouveau Paris. Dans les deux cas il s'agit de miscellanées, c’est-à-dire de textes et portraits divers mélangés avec une unité plus ou moins manifeste, ce qui en fait un texte hybride, morcelé, une sorte de mosaïque littéraire qui peut désorienter.
2Mémoires d'un gentilhomme des dernières années de l'ancien régime est une tétralogie, dont À l'ombre de la guillotine est le dernier tome.
3 Il bénéficiait d'une si grande réputation qu'on le surnommait le "Buffon de la médecine".
4 Il s'agit des ducs d'Aumont, de Praslin et de Montmorency, voir le tome 2 de ces Mémoires.
5"Qui a vécu par l'épée périra par l'épée" Mathieu, 26,52
1 La difficile survie
Je revenais de l'enfer. J'en avais réchappé. Maillard m'avait même accordé une garde d'honneur et un certificat de civisme rédigé en ces termes.
"Nous, commissaires nommés par le peuple pour faire justice des traîtres détenus dans la prison de l’Abbaye, avons fait comparaître, le 4 septembre, le citoyen Edmond-Alfé Des Gonds, lequel a prouvé que les accusations portées contre lui étaient fausses, et n’être jamais entré dans aucun complot contre les patriotes. Nous l’avons fait proclamer innocent en présence du peuple, qui a applaudi à la liberté que nous lui avons donnée. En foi de quoi nous lui avons délivré le présent certificat, à sa demande. Nous invitons tous les citoyens à lui accorder aide et secours. Signé : Maillard. À l’Abbaye, an 4e de la liberté, et le 1er de l'égalité."
Il était deux heures du matin, les rues n'en étaient pas plus vides pour autant. Une foule joyeuse attendait la sortie des cadavres pour les détrousser. Perruques, gilets mêmes tachées de sang, culottes, chaussures, tout était bon. Ce sont des corps presque nus qui gisaient sur le pavé. On m'avait placé au milieu de quatre torches. Maillard m'avait embrassé sous les ovations des spectateurs qui criaient des Vive la Nation à s'en casser la voix. « Ces honneurs civiques te placent sous la protection du peuple citoyen, je le charge de t'escorter jusque chez toi » m'avait-il dit.
De la rue Saint-Benoît, nous montâmes dans un fiacre qui nous porta rue des Fontaines dans le quartier du Temple. Mon escorte me demanda une attestation prouvant qu’ils m'avaient bien reconduit sans accident. Je la leur donnai et les embrassai de bon cœur, puis frappai à mon huis. Personne ne répondit. J'insistai. Une fenêtre finit par s'ouvrir. Voyant un homme seul, une femme me demanda qui j'étais et ce que je voulais. Je reconnus la voix de la femme de chambre de mon épouse.
⎯ Viens ouvrir, Louise, c'est moi.
⎯ Ah, Mon Dieu !
Elle ne fut pas longue. Je découvris un visage ravagé de larmes et crus stupidement que c'était pour moi.
⎯ Tu vois, je suis vivant, même si je reviens de l'Enfer.
⎯ C'est le mot monsieur, mais sauf votre respect, pas seulement pour vous.
Entre deux sanglots elle m'apprit que Bérénice n'avait pas supporté le spectacle affreux de la tête de la princesse de Lamballe portée au bout d'une pique pour narguer la reine. Ma pauvre épouse avait pensé que c'était le sort qui m'attendait. Épuisée par la maladie, rongée d'angoisse, n'ayant plus aucun espoir, elle s'était écroulée sans un mot. Bérénice reposait désormais au cimetière de la Madeleine, un ami était venu jouer du violon sur sa tombe. Mes enfants avaient disparu. Éléonore, me croyant mort, les avait emmenés. Louise se justifia.
⎯ On massacre partout monsieur, et pas seulement à l'Abbaye. Ils ont tué aux Carmes, à la Conciergerie, au grand-Châtelet, à la Force, à Saint-Firmin, à Bicêtre, à la Salpêtrière. Comment aurait-elle pu savoir !
Ma femme était morte, j'étais vivant. J'avais vu tant de cadavres que je ne le réalisais pas encore. J'errais dans la maison, incapable de mettre en ordre mes pensées. Par la fenêtre ouverte, je voyais le donjon où croupissait un roi que je ne pouvais plus me retenir de mépriser. Des abîmes de colère et de douleur m'empêchaient de faire mon deuil. Au-delà des pénombres de la nuit, je regardais cette tour sinistre dans laquelle une jeune fille et son petit frère essayaient de refouler leur peur. Le roi avait été incapable de protéger même sa propre famille.
De Marie-Thérèse Charlotte de France et son petit frère, mes pensées glissèrent naturellement à mes propres enfants. Où Éléonore les avait-elle emmené ? En avait-elle le droit ? Bien sûr que oui, n'était-elle pas la marraine ! Piranesi était en prison, peut-être même massacré comme tant d'autres. La mort avait saisi Bérénice par surprise. Éléonore était seule avec mes petits, elle avait agi avec sa détermination habituelle, sans tergiverser. Étaient-ils tous les trois en Saintonge ? Quand on est l'amie de Marie-Joseph Chénier, un homme qui siégeait à la Commune insurrectionnelle, c'était facile d'obtenir un passeport. J'étais donc prisonnier dans Paris sans espoir de revoir mes enfants. Louise m'apporta un médicament pour dormir, c'étaient les pilules d'opium de Bérénice. La drogue fit effet.
Le réveil fut cruel. L'absence des enfants, et surtout de Bérénice, était un silence effroyable. Il fallait que j'aille la voir, tout de suite, ne fut-ce que pour me recueillir sur sa tombe. Je choisis de faire le trajet à pied et quittais ce quartier du Temple où j'avais installé les miens afin qu'ils soient plus en sécurité, sans savoir qu'une foule stupide accélérerait la mort de mon épouse en brandissant leur glorieux trophée sous les fenêtres de Marie-Antoinette.
La marche est une activité qui libère l'esprit. Sous l'influence d'un égoïsme confus, je jouissais en profondeur d'être encore en vie. Les boutiques étaient ouvertes, les femmes causaient entre voisines, les affiches des spectacles étaient placardées comme de coutume, les carrefours ne désemplissaient pas, on dansait dans les guinguettes. Certes, il y avait des moments de silence lorsque passaient les charrettes remplies de chairs sanguinolentes, mais dès qu'elles s'éloignaient, la vie reprenait son cours.
Je descendis à pas lents la rue Saint-Jacques, saisi du contraste entre l'horreur de ce qui s'était passé et l'apparente apathie de ce peuple qui avait laissé faire. Mes pas me portèrent rue des Arts, puis rue de Bussy. Insensiblement je me rapprochais de l'Abbaye, foulant ce pavé où aurait dû se trouver mon cadavre. Deux charrettes attendaient devant la prison. Leurs conducteurs fumaient la pipe, tranquilles, avant de partir pour les profondes carrières de la plaine de Montrouge. Une pièce de forte toile imperméabilisée cachait les corps. Un pied nu dépassait, les massacres continuaient. Loin d'éprouver de la culpabilité, l'ivresse d'être en vie gagnait toutes les fibres de mon corps. L'envie folle de voir mon épouse s'accéléra. Je hélai un fiacre et me fit conduire à la Madeleine.
Les cimetières sont des jolis lieux pour un citadin qui recherche le calme, celui-ci n'était pas encore devenu ce qu'il serait quelques mois plus tard : le lieu où toutes les victimes de la Terreur reposeraient côte à côte sous la chaux, dans des fosses communes. Je trouvai sans peine la tombe de Bérénice. J'avais l'impression qu'elle n'était pas partie, qu'elle attendait ma venue. J'étais incapable de prier. Prier qui ? Dieu, s'il existait, ne le méritait pas. Quand on est omnipotent on ne laisse pas mourir les gens. Ma Bérénice était là. Sa belle âme flottait dans l'air. Je devinais son petit air inquiet, réfléchissant au meilleur conseil à me donner. La paix m'envahit. Je devais quitter le quartier du Temple et me réinstaller chez moi. Ma maison était à quelques minutes, je pourrais venir tous les jours, j'en avais besoin.
Adelet, mon secrétaire et ami, était à l'image de Probus, l'intendant de mes terres là-bas très loin en Saintonge, un homme discret et plein de retenue, ce ne fut pas le cas.
⎯ Je savais que vous étiez en vie, monsieur, je l'ai lu dans la Gazette de Louis Marie Prudhomme. Oserais-je vous féliciter ? S'il vous débaptise légèrement, réunissant votre nom à sa particule6, il fait de vous un très bel éloge, soulignant que dès avant la révolution vous étiez déjà un ardent patriote, pourfendant la noblesse et les privilégiés sous le nom de Jus Sapientia. Il va jusqu'à citer votre célèbre épigramme, "D'Aumont rime avec Couillon, Praslin avec Coquin, Montmorency avec celui qui trahit. Trois ducs, trois fainéants, peuple de France révolte-toi."
⎯ Prudhomme a légèrement modifié le texte.
⎯ Qu'importe puisque vous devez la vie à ce placard ! Ah monsieur, je ne devrais pas m'énerver, mais qu'ont fait Robespierre avec son autorité morale et Danton avec son énergie ? Rien. Ni l'un ni l'autre ne se sont risqués à prendre une quelconque initiative. Ils ont laissé massacrer des innocents et peut-être même s'en sont réjoui. Pétion est resté passif. Roland s'est contenté de dire qu'il fallait jeter un voile sur toutes ces horreurs. Tous ont laissé Marat se glorifier du carnage. L'appel de cette bête répugnante a été entendu à Meaux, Lyon, Gisors, Reims, Sens, Marseille. Toutes ces villes ont imité la capitale et massacré les prisonniers. Le monde est devenu fou. Collot d'Herbois, cet auteur médiocre toujours pris d'eau-de-vie, a osé proclamer que le peuple était un juge infaillible ! Quel peuple ? Celui des avinés, des fanatiques, des excentriques mélangés aux sadiques, des furies de la guillotine ? Il se dit qu'il y en avait partout et qu'elles encourageaient les massacreurs et riaient. Le pire, c'est que ces "honnêtes républicains" ont été payés vingt-quatre livres pour chacune de leur journée d'assassinat, le tout en trouvant normal qu'ils dépouillent les cadavres de leur montre, cravate, chemise, bourse et même chaussures !
Puis Adelet me fit pudiquement remarquer que je devais m'enquérir du sort de mon beau-père. Si Piranesi avait subi le sort commun, mes enfants devenaient ses uniques héritiers, donc ce serait à moi de gérer son immense fortune. Il avait raison mais comment savoir si mon beau-père était en vie ou non ? La solution vint de Louis Marie Prudhomme. Ce même homme, qui avait travesti mes propos pour les mettre aux goûts du jour, vint me voir dès le surlendemain de ma libération et me proposa tout de go de travailler avec lui. « Les Révolutions de Paris en sont déjà à deux cent mille lecteurs, et ce n'est qu'un début » insista-t-il. Avoir devant soi un individu qui avait collaboré avec Rousseau m'impressionna. Il avait la tête d'un honnête homme, un visage sérieux, grave, cependant, l'idée de côtoyer des Loustalot, Maréchal, Chaumette, Sonthonax et Fabre d'Églantine me dérangeait. Voyant que j'hésitais, il souligna ce qui n'était pas un détail.
⎯ Avoir été gracié par Maillard équivaut à tous les certificats de civisme.
⎯ Je n'ai pas besoin de travailler.
⎯ Je sais. Il se dit que vous étiez baron, et que vous êtes même cousu d'or.
⎯ Vous avez besoin d'argent pour faire tourner vos presses ?
⎯ Pas d'ironie. Nous avons tous commis des erreurs. La naissance en est une, pas la richesse. Aujourd'hui il n'y a plus de roi, de marquis, de titre de noblesse, de droits seigneuriaux, de privilèges. Nous sommes tous égaux. Orléans est devenu Philippe-Égalité. Vous avez été le "Pourfendeur de ducs", je veux que vous redeveniez Jus Sapientia.
⎯ Et en échange, ferez-vous libérer mon beau-père s'il est encore en vie ?
⎯ Oui.
Prudhomme tint parole, Piranesi fut libéré quelques jours plus tard. L'épreuve l'avait vieilli prématurément. Il s'enferma chez lui, demandant à Adelet de venir le voir régulièrement car il n'avait plus goût à diriger ses affaires.
L'ancien Jus Sapientia travaillait dans l'anonymat, faisant coller ses placards à la sauvette. Le nouveau eut droit à plusieurs colonnes dans ce qui était l'un des plus gros quotidiens de la capitale. Je n'étais pas bien sûr de mériter les compliments de Prudhomme et ce pour plusieurs raisons. Art du pamphlet ? Olympe7 écrivait bien mieux que moi. Polémiste ? J'avais plus que jamais la politique en horreur, pour rédiger de tels articles il fallait s'intéresser à l'actualité, en étais-je capable ? Enfin, Prudhomme se réservait le droit de censurer mes articles, idée insupportable quoique … Malgré son titre, "Les Révolutions de Paris" avait un lectorat composé de gens modérés, ce journal n'avait rien à voir avec "L'ami du Peuple", ou encore pire, "Le Père Duchesne". J'y avais donc ma place, si tant est que je le souhaite. Adelet m'encouragea à accepter en me faisant remarquer que nous n'avions plus rien à faire, il n'y avait plus de Garde-Meuble, Ville d'Avray avait été massacré comme tant d'autres, lui-même aidait mon beau-père à mettre ses affaires en ordre. Il avait raison. Mon hôtel de la rue Saint-Florentin était près des Tuileries où tant de souvenirs m'attachaient encore, et encore plus près de la Salle du Manège où les députés de l'Assemblée législative vivaient les dernières heures d'un mandat qu'ils avaient tant contribué à raccourcir. Ce fut le sujet de mon premier article, qui se révéla être polémique, malgré moi.
Je ne suis pas allé voter. Voter pour qui ? La nouvelle Assemblée portera le joli nom de Convention. Ce mot devrait signifier contrat, engagement, entente. Comment pourrait-ce être le cas alors que les femmes, les domestiques et les vagabonds n'ont pas eu le droit de choisir leurs représentants ? Peut-on légitimement appeler "démocratie représentative" un suffrage à deux degrés où des assemblées primaires désignent un délégué pour cent habitants, ces délégués choisissant eux-mêmes les députés en public, et à haute voix, le tout dans un climat d'épouvante qui a découragé quatre citoyens sur cinq de se déplacer.
Le retour de Jus Sapientia connut un certain succès. Outre que Prudhomme m'encouragea à continuer dans ce style tout en ne me rétribuant pas, ce dont je n'avais cure, étant fortuné, elle me permit de revoir mon ami Deleyrant, dont je devins le porte-parole officieux, tant nos idées étaient proches. Il accepta de reprendre le rôle d'Olympe, c’est-à-dire corriger mon travail, me souffler des idées, bref, écrire à quatre mains.
⎯ J'ai lu votre article, me dit-il avec un regard bienveillant, je lui ai trouvé une modération suffisante. Vous avez bien fait de ne pas écrire qu'un tel mode de scrutin explique la facile victoire des extrémistes de la Commune et de leurs amis.
⎯ Tous ceux que je méprise ont été élus, Desmoulins, Marat, Philippe-Égalité, Fabre d’Eglantine, David, Collot d’Herbois, Manuel, Robespierre, et bien sûr Danton. Et dire que je vais devoir les fréquenter !
⎯ En ces temps troublés, hurler avec les loups tout en gardant son intégrité est nécessaire. Prenez modèle sur votre beau-père, je suis sûr qu'il va rebondir. Voulez-vous savoir comment s'est passée mon élection ?
⎯ Je vous en prie.
⎯ La province n'est pas Paris, surtout celles assez reculées comme la nôtre, où les solidarités locales jouent un grand rôle. Prêtre jureur, la partie était acquise, mes origines modestes ainsi que ma générosité envers les indigents ont fait le reste. Notez que bon nombre d'hommes modérés figurent parmi les 749 députés de la future assemblée, et que s'ils réussissent à se fédérer, et si un chef émerge, ils représenteront une force considérable.
⎯ Puissiez-vous avoir raison. La mission de représenter le pays dans sa diversité et ses profondeurs est une lourde charge, surtout dans les circonstances présentes où il faudra construire un véritable régime républicain, ce dans un pays profondément divisé.
⎯ Nous allons être appelés à en parler souvent. À propos, mon cher Edmond, savez-vous que je me suis marié ?
⎯ Vous, un abbé !
⎯ La loi m'y autorise, la nature et la compassion me l'imposent.
⎯ Vous avez épousé une pauvresse ?
⎯ Que non, elle est riche, mais la timide enfant est orpheline, je l'ai prise sous ma protection.
⎯ Elle est laide ?
⎯ Oui, mais ce sont ses vertus qui m'ont attiré.
Deleyrant me fit alors une prière à laquelle j'accédai sans hésiter. Selon lui, il n'était pas bon que je sois seul, il me proposa donc de venir s'installer chez moi avec sa femme. Nous pourrions ainsi travailler plus facilement, et sa petite et fragile épouse, Coralie-Gersende, remplacerait Bérénice pour diriger nos domestiques.
⎯ Coralie-Gersende ?
⎯ Son nom complet est Coralie-Gersende de Talour de la Cartrie. Elle est extrêmement jeune et de vieille noblesse charentaise. C'est une riche héritière, terrorisée par les violences qui ont eu lieu dans l'Ouest.
⎯ Pourquoi vous a-t-elle épousé ?
⎯ J'étais son confesseur.
⎯ Éloïse et Abélard ?
⎯ Ne riez pas, en ces temps de violences, avoir un protecteur n'est pas à négliger.
⎯ Et puis elle est orpheline, vous ne risquez rien ! Je croyais que vous aviez de tendres pensées pour la belle Manon Roland.
⎯ Elle est son sosie parfait, la faconde en moins et … quelques années, ce qui me la rend plus chère.
⎯ Donc vous avez menti, elle n'est pas laide, elle est même très jolie.
⎯ Peut-être, je ne me rends pas compte.
Deleyrant et sa jeune épouse s'installèrent donc chez moi pour mon plus grand plaisir, Coralie-Gersende apportant à mon foyer cette touche de douceur féminine et d'efficacité domestique qui lui faisait cruellement défaut, le départ de Julie n'ayant pu être remplacé par mon épouse, que la maladie affaiblissait sans cesse. Député, financièrement à l'aise grâce à son abbaye et aux biens de son épouse, Deleyrant pouvait se consacrer entièrement à sa passion : la politique.
⎯ Vous avez bien fait d'accepter la proposition de Prudhomme.
⎯ Je me le demande. Je ne suis pas journaliste, je n'aime pas la politique, je n'ai aucune idée, c'est Bérénice qui les avait pour moi. Je suis incapable d'écrire une seule ligne.
⎯ Vos affichettes sur Orléans étaient très spirituelles, vous êtes donc capable d'en faire d'autres. Il y a trois cents journaux publiés chaque jour dans Paris. La plupart ne sont que des feuilles de circonstances, éphémères et sans grands lecteurs, ce n'est pas le cas de celui de Prudhomme.
⎯ Il n'est pas assez neutre pour moi.
⎯ Mais si, laissez tomber la première page et intéressez-vous aux autres.
⎯ Je l'ai fait. La politique est partout, y compris dans l'actualité littéraire. Les auteurs se bousculent, tous veulent célébrer la naissance de la République en imitant les antiques. Après son Charles IX et la Saint-Barthélemy, Chénier va nous pondre un grand drame sur les massacres des prisons. J'en vois déjà le titre : Les Septembriseurs, sauveurs de la Liberté. Ou encore les faits divers sur les personnages en vue, Roland, ministre de l'Intérieur, époux de la furie qui rêve de voir guillotiner la reine, a été assiégé dans sa propre maison par un troupeau de tape-durs voulant l'empêcher d'intervenir pour faire cesser les massacres.
⎯ Et les informations pratiques telles que les prévisions météorologiques ou la hauteur de la Seine, ironiserez-vous aussi ?
⎯ Bien sûr : A-t-elle enflé ? Y a-t-on jeté les corps des victimes, comme le 25 août 1572 au matin ?
⎯ Les résultats de la loterie ?
⎯ Plus de roi, plus de loterie royale. Indigent cherche projet de remplacement pour fournir d'autres rêves aux pauvres.
⎯ Les nouvelles des personnes dont la santé intéresse le public ?
⎯ Robespierre ne peut plus s'asseoir. Croyant qu'il se tient debout pour prendre la parole, les patriotes de l'Assemblée retiennent leur souffle. En fait il s'agit d'une douloureuse crise d'hémorroïde. On s'interroge. À l'instar du nez de Cléopâtre, le cul du grand-homme peut-il changer la face du monde ? Notre Sans-culotte national est-il devenu un Sang-culotte ?
⎯ Méfiez-vous Edmond, il n'a aucun sens de l'humour et est très rancunier.
Si je sortais de prison, ce n'était pas le cas de Deleyrant qui m'en apprit un peu plus sur la passivité et le laisser-faire des gens les plus en vue. Alors qu'on massacrait des innocents dans les prisons, Danton, théoriquement ministre de la justice, avait été interpellé sur son attitude expectante, voire équivoque. Pétion avait réuni les présidents des sections chez lui, on y avait beaucoup discouru et rien fait. Robespierre, parlant toujours à mi-mot sur son thème favori du complot, avait très sérieusement évoqué l'existence d'une conspiration pour donner le trône au duc de Brunswick. Billaud-Varenne avait applaudi et encouragé les septembriseurs. On était passé d'un roi faible, mais bon, à d'autres tyrans, autrement plus sanguinaires. Seules deux personnes avaient osé condamner les massacres, Brissot et Olympe de Gouges. Cette femme sublime avait osé écrire que « Le sang, même celui des coupables, versé avec cruauté et profusion, souille éternellement les révolutions. » J'avais manifesté mon indignation concernant le pseudo pacifisme d'un Brissot.
⎯ C'est ridicule. Cela fait des années qu'il prêche la violence !
⎯ Et maintenant il commence à s'en inquiéter. Pour en revenir à Olympe, cette femme vaut, à elle seule, tous les Robespierre, Danton et Marat de la création. Elle propose de proclamer que le 2 septembre soit déclaré "Fête des martyrs de Paris." Elle a raison. Que vaut une démocratie qui se construit sur le silence ? Mais elle prend trop de risques.
⎯ J'admire un courage que je n'aurais jamais, surtout après ce que j'ai vu. Les septembriseurs se moquaient de leurs victimes en les appelant "Ces Messieurs de la Peaufine".
⎯ C'est pour cela qu'il faut se battre, Edmond, pour construire une société telle que la rêvait Montesquieu, Diderot et autres Voltaire. Vous en avez le talent et la force.
⎯ Talent, peut-être, mais pas la force.
⎯ Que puis-je faire ?
⎯ Rendez-moi ma femme.
Deleyrant poussa un profond soupir.
6 À l'instar de La Fayette, devenu Lafayette, j'étais désormais Alfé Desgonds.
7 Olympe de Gouges.
2 L'ami des lois
Ce fut l'époque la plus sombre de ma vie. Je ne supportais pas l'idée d'être veuf, d'avoir perdu mes enfants. J'étais convaincu qu'Éléonore avait réussi à se faire octroyer un passeport, qu'elle était en Saintonge et me croyait mort. J'écrivis à Probus en ce sens et ne reçut aucune réponse. Je ne savais pas qu'Émilie et Louis-Anne étaient là, tout proche, et plus encore que je les côtoierais plusieurs fois sans le savoir.
De son côté, Éléonore entendait chaque soir dans le salon de la rue Chantereine les plus horribles récits. On n'y parlait que des prisonniers massacrés. On citait des noms. Il y en avait eu tant qu'il avait était impossible de les compter. On avait tué à la Force, aux Madelonnettes, aux Carmes, à Saint-Lazare, sans distinction, les jeunes, les vieux, les prêtres, les civils, et même les enfants. Les tueurs étaient pour la plupart totalement ivres. La mort était l'objet d'une mise en scène, une affaire de plaisir, un spectacle. À l'Abbaye, on avait entassé des hardes au milieu de la cour, comme une sorte de matelas. La victime, lancée de la porte dans cette arène, passait de sabre en sabre, de piques en pique, et venait, après quelques tours, tomber sur ce matelas trempé de sang. Les assassins commentaient la manière dont chacun courait, criait, tombait. Ils jugeaient le courage, la lâcheté, la résignation et les tentatives pour se défendre, mais que peut faire un bras nu contre un sabre ? Une poitrine contre une pique acérée ?
Éléonore apprit qu'il y avait aussi des femmes. Les massacreurs, ravis de l’intérêt qu’elles y prenaient, avaient installé des bancs éclairés de lampions. Quand la pile des corps devenait trop haute, c'est elles qui les évacuaient dans la rue où les détrousseurs de cadavres se disputaient chaussures, bagues, montres, culottes, au point que c'étaient des corps presque nus qu'on portait aux carrières de Montrouge. Elle était convaincue que j'avais connu un tel sort. Elle ne retournerait jamais rue Saint-Valentin, ne lirait jamais aucun de ces horribles journaux comme les Révolution de Paris, et fuirait cette ville dès qu'elle aurait un passeport. André avait accepté, à contrecœur, d'en parler à son frère, ce n'était qu'une question de jours, si l'invasion était stoppée. En attendant, elle préféra rentrer chez elle rue des Fossés Saint-Germain. Julie Careau fut désolée de perdre son amie, et lui fit promettre de revenir souvent.
Traverser les rues de Paris fut une épreuve. Épreuve aussi la joie des enfants, convaincus qu'ils rentraient à la maison. Affronter leur déception fut difficile, elle ne savait que répondre à des questions telles que : « Où est ma maman ? Pourquoi papa n'est pas venu nous chercher ? » La petite voix inquiète d'Émilie la torturait. Comment gérer la peur d'une petite fille ? Comment gérer sa propre douleur ? Louis-Anne se taisait, laissant sa sœur poser et reposer sans cesse la terrible question. Comment les empêcher de souffrir ? Bien sûr, Émilie avait vu que sa maman était malade, un mot qui n'avait pas beaucoup de sens à cinq ans et demi, et encore moins le mot "mourir". Émilie avait l'idée confuse que sa maman l'attendait quelque part, une maman, ça ne quitte jamais sa petite fille. Il fallait leur dire. Elle n'en avait pas le courage.
Une bonne fée vint à son secours. Il y avait un logement libre à côté de celui qu'elle avait loué, Rosalie hésitait, Éléonore proposa de lui avancer l'argent. « Tu me rembourseras quand des temps meilleurs reviendront. » Rosalie avait connu Éléonore quand elle était encore marquise, un peu lointaine, le regard triste, fréquemment accompagnée d'André Chénier, généreuse sans commentaire, sans fierté, soutenant Thomas Bellot, le trésorier de la troupe, chaque fois que c'était nécessaire. Elle hésitait à accepter et préféra changer de sujet.
⎯ Nous répétons une nouvelle pièce, une œuvre de Jean-Louis Laya, "L'Ami des lois". Laya a conquis la célébrité deux ans plus tôt avec Les Dangers de l'opinion. Chénier ne l'aime pas car Laya est un révolutionnaire très-très modéré, tout le contraire de l'autre, ardent jacobin, fréquentant les Cordeliers, siégeant à la Convention aux côtés de Marat et Robespierre, membre actif de la Commune et capable de signer l'acte d'arrestation de ses meilleurs amis.
⎯ Moi qui espérais confusément que tu m'aiderais à m'occuper des enfants !
⎯ Mais je le ferai, quand je ne serai pas au théâtre, à moins que … On pourrait les emmener, ça les distrairait. Ils resteraient dans les coulisses, joueraient avec les accessoires, rencontreraient d'autres enfants.
⎯ C'est interdit.
⎯ Penses-tu, la plupart d'entre nous ont commencé comme ça.
⎯ Tu veux faire de mes enfants des comédiens ? demanda Éléonore, amusée malgré elle.
⎯ Bien sûr que non, c'est juste que, c'est amusant de se déguiser. Quand on est malheureux, ça change les idées.
⎯ En Saintonge, je montais à cheval tous les jours. Ici, je m'ennuie. Je n'ai jamais coiffé personne, à part Émilie bien sûr, mais l'art des postiches s'apprend. Je ne sais pas coudre, mais je brode un peu, ça ne doit pas être très différent.
⎯ Où veux-tu en venir ?
⎯ Ce qui est valable pour Émilie et Louis-Anne l'est aussi pour moi.
⎯ Je ne comprends pas.
⎯ J'ai suffisamment fréquenté les loges, maintenant qu'il n'y a plus de marquise, j'aimerais découvrir l'envers du décor.
⎯ Coiffer, broder, coudre, tu veux devenir …
⎯ Ton habilleuse.
⎯ C'est impossible, tout le monde te connaît.
⎯ Ils imagineront que je suis ruinée et que j'ai besoin de gagner ma vie.
⎯ Bellot ?
⎯ C'est mon ami, il gardera le secret. Vous autres comédiens, vous êtes souvent très instruits. Presque toutes les actrices lisent la musique, jouent d'un instrument et chantent à merveille. Votre mémoire est un outil. Vous connaissez les classiques, les grands personnages, les beaux textes. Au contraire je suis très ignorante, je ne veux pas que l'éducation des enfants soit négligée.
⎯ Ça me ferait drôle.
⎯ Tu es mon dernier lien avec la vie d'avant. Oui, c'est vrai, j'ai un château, j'en ai même trois grâce à ce brave Piranesi, mais je suis seule, sans époux et avec des enfants à charge qui ne sont même pas les miens. Avec toi, j'ai l'impression qu'il reste quelque chose de ce que j'ai connu. Molière n'est pas encore interdit que je sache.
⎯ Il ferait beau voir.
⎯ Alors je veux être avec vous, discrètement, au pays du bon goût et de l'élégance.
Rosalie avait déjà une habilleuse, Léonie. Elle n’était ni très jeune ni très jolie, mais avenante, avec un visage rond aux pommettes saillantes, un petit air espiègle, un corps robuste, une poitrine gonflée de tendresse qui soulevait le fichu croisé à la mode de l’année. Léonie admirait profondément Rosalie Dugazon, l'actrice qui avait bravé les Tape-durs en proclamant devant toute une salle son célèbre : « Ah, comme j'aime ma maîtresse. » Elle plaignait le sort de la famille royale. Léonie n'était pas que l'habilleuse de la jolie actrice, elle était aussi sa cuisinière et sa femme de chambre, en un mot, sa domestique. Elle accepta de bon cœur de céder une partie de sa charge et expliqua en quoi elle consistait. Comme tous ses camarades, Rosalie était propriétaire de ses costumes, soit une gestion assez lourde dont elle lui expliqua les secrets. Devant tant de gentillesse, Éléonore se sentit fondre. Elle lui expliqua à mi-mot son histoire, sans citer de nom : le jeune voisin dont elle était amoureuse, les fiançailles rompues, la solitude, puis son amitié improbable avec sa rivale dont elle avait recueilli les deux enfants. Émilie, Madame Royale, Versailles, Trianon, Saint-Cloud, ça fit rêver la grisette. Éléonore eut beau lui répéter que ces temps étaient finis, qu'il n'y avait plus de reine, plus de noblesse, qu'elle n'était plus marquise, qu'on était tous égaux, Léonie lui répondit que les hommes étaient fous, que ces temps reviendraient et qu'alors elle serait fière d'avoir été mise dans le secret.
Entre deux répétitions la vie prit un tour tranquille. Éléonore louait souvent un curricle8 pour emmener les enfants en promenade. D'autres fois elle se rendait dans les jardins du Luxembourg où des vendeurs de sirop promenaient parmi les groupes leur hotte de verre. La promenade préférée d'Émilie et Louis-Anne restait les jardins des Tuileries, c'était tout près de la rue Saint-Florentin, ils y allaient avec leur maman, s'en souvenaient-ils, ou était-ce le chanteur public dont le petit singe et ses pitreries amusaient la foule ?
Malgré la douceur de ces promenades, les enfants restaient tourmentés. Louis-Anne demandait souvent, « Où est maman ? » Émilie la regardait, attendant la réponse, la peur dans les yeux. Rosalie savait que répondre c'était tuer l'espoir, la jeune comédienne racontait quelque chose de drôle, faisait le pitre et couchait elle-même les enfants.
Éléonore l'aidait à apprendre son nouveau rôle, s'étonnant du ton de la pièce. "L'Ami des lois", personnage principal de cette comédie écrite à la manière de Molière, était un ancien aristocrate qui soutenait les idées de la Révolution tout en en condamnant les excès. Laya allait plus loin. La pièce ridiculisait deux modernes Tartuffes dénués de scrupules et assoiffés de pouvoir. Le premier s'appelait "Nomophage", il portait toujours le même habit bleu à revers, des petites lunettes cerclées de fer, et s'exprimait très lentement et à voix basse. Il fallait être idiot pour ne pas reconnaître Robespierre. Le second était couvert de haillon, sale des pieds à la tête, ne parlait pas mais hurlait et voulait tuer tout le monde. Laya l'avait baptisé "Duricrane", autrement dit l'idiot, c'était bien sûr Marat.
⎯ … « Cette chose verte d’habit, ces yeux gris-jaune si saillants, mais c’est au genre batracien qu’elle appartient à coup sûr, plutôt qu’à l’espèce humaine. De quel marais nous arrive cette choquante créature ? » Marat ne va pas apprécier.
⎯ Ne sommes-nous pas en Liberté ? Serait-il donc le seul à parler et dire ce qu'il pense ?
⎯ … « Un prophète de carrefour, vaniteux, crédule, croyant tout et surtout ses propres mensonges auxquels le porte sans cesse son esprit d’exagération. »
⎯ C'est parfaitement exact. Note que Robespierre n'est pas mal non plus. … « Ses yeux sont plutôt doux. Leur transparence, l’étrange façon dont ils regardent sans regarder ferait croire qu’il y a là un visionnaire. »
⎯ Mais il ajoute … « à la fois charlatan et dupe, s’attribuant la seconde vue. » Crois-tu vraiment que Jacobins et Cordeliers laisseront faire ? Chénier sautera sur l'occasion pour faire interdire la pièce, il est membre de la Commune, qui a tendance à se croire la municipalité de la France.
⎯ Nous demanderons l'arbitrage de l'Assemblée.
La première de "l'Ami des lois" fut un succès. Bellot enregistra dès le premier soir deux mille entrées payantes, et idem les jours qui suivirent. Avec l'argent qui rentrait, le moral remonta pour les anciens comédiens du roi, mais les passions s'exacerbaient, provoquées, entre autres, par la peur de l'invasion. Personne ne savait ce qui se passerait si la coalition austro-prussienne rentrait en vainqueur dans Paris. Louis Marie Prudhomme, qu'on n'appelait pas encore la "girouette de la Révolution", cherchait d'où venait le vent, or il n'était pas encore interdit d'afficher des convictions royalistes. Tous les soirs les plus exaltés se réunissaient devant le théâtre de la Nation, satirisant les "faux monnayeurs du patriotisme, les profiteurs de la révolution, les criminels de la licence et de l’anarchie, les sectaires". Jean Louis Laya, qui n'en demandait pas tant et croyait dans la liberté d'expression, devint malgré lui le représentant de la conscience nationale. "Tyran royaliste ou Tyrans républicains, quelle est la différence ?" De telles tirades soulevaient l'enthousiasme, on l'appelait le nouveau Beaumarchais, l'homme qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas.
Prudhomme hésitait à prendre parti pour ou contre une pièce que je n'étais pas encore allé voir. À chaque nouvelle représentation les applaudissements se faisaient plus nourris. On se répétait les harangues contre les "prêcheurs d'égalité, les buveurs de sang, les théoriciens aveugles, les fanatiques des mots, hiératiques, fiévreux". On cherchait des ressemblances. Qui était cet homme à la prunelle flamboyante, aux lèvres minces, aux cheveux bouclés ? Saint-Just bien sûr, l'homme au cou si fortement serré d'une cravate empesée qu'il ne se tournait qu’en entier et tout à la fois. Quand il jouait le rôle, Sainval exagérait ce trait, faisant crouler de rire la salle.
Le succès allait grandissant au point que, dès trois heures de l’après-midi, les rues proches du Théâtre étaient noires de monde. Cela ne pouvait pas durer. Chaumette et Santerre dénoncèrent la pièce à la Commune, elle fut interdite une première fois. Laya et ses comédiens allèrent se plaindre à la Convention, criant à la tyrannie. Ils en ramenèrent un décret précisant qu'aucune loi n’autorisait les corps municipaux à violer la liberté des théâtres. Les représentations reprirent. Chénier et ses amis contre-attaquèrent, les demandes d'interdiction plurent sur le bureau du président de l'Assemblée sous le prétexte que la pièce favorisait l'esprit de parti, comme en attestait la présence au parterre d'un "rassemblement d'émigrés et de contre-révolutionnaires".
Prud'homme ne pouvait pas laisser passer une occasion de vendre son journal, il me demanda d'écrire un article à la façon de Jus Sapientia, c'est ainsi que j'allais enfin voir la pièce, sans me douter une seconde que mes enfants étaient en coulisses, à quelques pas de moi.
Le lendemain j'écrivais mon article. Je commençais par rappeler l'intrigue de la pièce, la qualité du jeu des comédiens et concluais en ces mots.
La Liberté exigerait que l’on pût s’exprimer sur le théâtre au moyen de ce genre de comédie politique, sans que cela offusquât outre mesure ceux qui ne sont pas du même avis. Le théâtre deviendrait alors la plus utile des tribunes, celle où l’on aurait le loisir d’exposer ses idées d’une manière attrayante, sans se faire taxer de contre-révolutionnaire.
J'y soulignais aussi que le mot "rassemblement d'émigrés" était inapproprié, géographiquement absurde, et surtout antinomique compte tenu du sujet de l'œuvre. Dans la floraison malodorante de la presse d'alors, mon article passa inaperçu. Prudhomme, mécontent, me demanda d'être plus agressif la prochaine fois.
Les choses s'envenimèrent. Chaumette, procureur syndic de la Commune de Paris, décida de braver la Convention en interdisant la pièce. Un arrêté fut placardé dans tout le faubourg Saint-Germain où l'on se pressait déjà dans la salle et aux guichets. Fleury se présenta sur scène, entouré de ses camarades, et lut l'arrêté interdisant la représentation. Ce fut aussitôt un vacarme épouvantable. « Déchirez cet arrêt ! Il est contraire aux Droits de l’homme. » … « L'Ami des lois ! L'Ami des lois ! » Santerre fit son entrée, vêtu en grand uniforme de général de la garde-nationale. Il était entouré d’une vingtaine de ses sbires, réclama le silence et répéta que la pièce ne serait pas jouée. Il se fit huer. Santerre les menaça. Deux bataillons de la garde-nationale cernaient le théâtre, les canons étaient déjà en place, braqués, prêts à faire feu. Le public refusa de quitter la salle, réclamant l'arbitrage des députés. Ce fut le brave Bellot qui dut traverser Paris en compagnie de trois émissaires. Il mit deux heures pour revenir. Santerre ne décolérait pas. Ce fut pire quand Fleury lut à voix haute la décision, rendue par la Convention, de casser l’arrêt de la Commune en lui déniant tout droit d’interdire la représentation. Il était vingt et une heures quand la pièce fut enfin jouée au milieu des cris de joie. J'étais là, au milieu des deux mille spectateurs heureux de leur victoire. Mon second article fut plus incisif. Il rappelait les faits et concluait ainsi.
Une fois le général mousseux9sorti rejoindre ses troupes, la victoire de la vraie Liberté, celle de penser et de le dire, fut totale. Jamais Fleury ne fut plus convaincant, jamais Larochelle, Dazincourt et les autres ne mirent plus de talent dans leur interprétation, quant à Sainval, il fut sublime. La pièce se termina vers une heure et demie du matin, sous les vivats du public.
Éléonore ignorait que j'étais Jus Sapientia, quand j'avais créé ce personnage elle vivait en Saintonge, et ne s'intéressait pas à la politique. Depuis, elle la détestait, pour rien au monde elle n'aurait lu les Révolutions de Paris.
Incapable d'interdire les représentations, Jacobins, factieux et fanatiques à courte vue changèrent de stratégie. Fleury reçut des menaces de mort, Laya fut agressé, des calomnies se répandirent ; quant au public, tous les soirs la salle était cernée de gardes nationaux qui le laissait passer en le narguant, « vous voulez une pièce, en voilà deux », et de désigner les canons braqués sur la salle. Les plus courageux répondaient, « la pièce ou la mort. » Santerre revenait régulièrement intimider les comédiens. Laya avait raison, c'était l'anarchie. La municipalité, forte de ses 80 000 gardes nationaux, tous issus des sections, et dont les officiers avaient été désignés dans des assemblées quasi désertes, entendait imposer ses décisions aux représentants de la nation, trop fraîchement rassemblés pour avoir eu le temps de rédiger une constitution républicaine. Gouvernement et ministres n'étaient que provisoires, sans moyen, sans assise populaire, dans un pays menacé par la marche victorieuse de l'armée austro-prussienne.
Fleury et ses amis commençaient à prendre peur. Chaque arrivée de Santerre, entouré comme à son habitude d’un groupe d’hommes armés au visage peu avenant, était accueilli de quolibets et d'injures, « A bas les gueux du 2 septembre ! Brigands ! Assassins ! » Ce à quoi il répondait invariablement que la pièce causait du désordre et que c'est pour ça qu'elle était interdite. Bellot finit par suspendre la vente des billets. De jeunes turbulents envahirent le théâtre et prétendirent s'improviser comédiens, le texte de la pièce à la main. Santerre fit donner les baïonnettes. Il n'y eut pas de bain de sang, on ne compta qu'une seule victime : la Liberté.
Le succès remporté par Laya avait excité la jalousie d'Olympe, sa fièvre littéraire s'était ranimée, et elle cherchait un sujet de pièce héroïque, à la façon du Cid. Il lui fallait un personnage, elle choisit Dumouriez. Elle se mit au travail, et, en professionnel, commença par se documenter sur le général, c'est ainsi qu'elle découvrit une intrigue romanesque avec dénouement heureux. Quand il n'était encore qu'un tout jeune officier, le beau Charles-François était tombé amoureux de sa non moins jolie cousine, mademoiselle de Broissy. Les deux familles s'étaient opposées à ce mariage. Lui avait été expédié en Corse, elle au couvent. De bataille en bataille, Charles-François s'était couvert de gloire : campagne de Westphalie durant laquelle il avait reçu vingt-deux blessures, Lanckoron, Ponte-Novo, mission en Prusse, en Suède, bref, c'est un tout autre homme qui s'était présenté un jour à la porte du couvent de la Visitation d'où il avait extrait sa cousine manu militari. La belle n'avait pas prononcé ses vœux, le mariage avait été célébré en l'église Saint-Ouen de Pont-Audemer.
Tous les ingrédients étaient réunis, restait à écrire la pièce, c'était plus facile en distribuant les rôles à l'avance. Molé serait parfait en Dumouriez, il en avait la silhouette, la même tête, fort spirituelle, où brillaient des yeux pleins de feu, la fougue. Pour mademoiselle de Broissy c'était plus difficile. Si Rouges et Noirs ne s'étaient pas séparés, Isabelle Vestris aurait été parfaite. Écrire un rôle devient aisé quand on imagine la personne la plus à même de l'interpréter. Mademoiselle Contât avait été charmante en comtesse de Boulogne. Mademoiselle Joly portait bien son nom, mais elle était inégale. La beauté sculpturale de mademoiselle Raucourt dans Pygmalion, portait Olympe à construire le rôle pour elle, serait-elle capable d'y mettre l'émotion suffisante. « Ah ! comme j'aime ma maîtresse. » Olympe avait assisté à la représentation des Evénements imprévus. Rosalie Dugazon avait non seulement été sublime de jeunesse et de beauté, mais elle avait mis tant de sentiment dans cette réplique que tous les doutes furent levés. Olympe se précipita au théâtre, entra dans la loge de Rosalie sans avoir frappé, et se trouva nez à nez avec Éléonore. Les deux femmes ne se connaissaient pratiquement pas, néanmoins Olympe avait la mémoire des visages.
⎯ Qui êtes-vous ?
⎯ L'habilleuse de Rosalie, et son amie.
Olympe détailla la jeune femme.
⎯ Vous n'avez rien d'une habilleuse, d'ailleurs je vous connais, je vous ai déjà vue, mais je ne parviens pas à me souvenir. C'est sans importance, je dois voir madame Dugazon, c'est capital.
⎯ Elle doit être en scène. Elle répète La Matinée d'une jolie femme, de Vigée. Le rôle aurait dû être tenu par Bérénice Montgautier, mais elle est malade. Attendez un peu, elle ne sera pas longue.
⎯ Vous ne me demandez pas mon nom ?
⎯ Pourquoi faire !
⎯ Je suis Olympe de Gouges, la grande, la talentueuse Olympe de Gouges, celle dont le talent a fait trembler Beaumarchais lui-même. Ah, je vois que vous êtes impressionnée. J'ai l'habitude.
Éléonore venait de comprendre qu'elle avait devant elle la femme avec laquelle j'avais trahi Bérénice, adultère dont elle m'aurait cru incapable. Ma trahison conjugale l'avait affectée au point qu'elle cesse de se nourrir. Elle avait tant dépéri que Probus avait écrit à Bérénice pour solliciter son aide. Ma merveilleuse épouse avait compris qu'elle n'avait pas le choix. Expédié en Saintonge, j'avais rendu le goût de vivre à ma petite marquise. Tirant un trait sur ce qui ne serait jamais, Éléonore avait épousé Ange Josnet de la Doussetière. Son amitié avec Bérénice s'était resserrée.
⎯ Olympe de Gouges !
⎯ Ne tremblez pas, je ne suis pas méchante. Quel nom avez-vous dit, je parle de celui de la comédienne que Rosalie Dugazon va remplacer ? Ne me dites pas que vous l'avez déjà oublié. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais asseyez-vous, vous allez tomber ! Ah oui, Bérénice quelque chose …
Éléonore s'écroula.
Rosalie connaissait très bien Olympe, la dramaturge harcelait les comédiens pour faire jouer ses pièces, faisait intervenir ses relations, menaçait, cajolait, fanfaronnait, lançait des défis. Quand elle la vit penchée sur Éléonore et tentant de la ranimer, Rosalie garda tout son sang-froid, il suffisait d'attendre, de lui parler doucement. Éléonore avait une solide constitution, ce ne serait pas grave. Quand Olympe lui raconta ce qui s'était passé, la jolie comédienne n'eut plus aucun doute.
⎯ C'est le prénom, Éléonore était très liée avec Bérénice Des Gonds. Quand cette dernière est morte récemment, elle a recueilli ses enfants.
⎯ Mais qui est-elle exactement ? Je sais que je l'ai déjà rencontrée.
⎯ La marquise de Fierville.
⎯ La femme pour laquelle ce cher Edmond s'est coupé le cœur en deux, en trois devrais-je dire puisque j'en ai eu un petit morceau. Je commence à comprendre. Racontez-moi tout.
⎯ Vous flairez un bon sujet de comédie ?
⎯ Oui.
⎯ Alors vous écrirez plutôt un drame, car c'en est un. Éléonore est tombée amoureuse de son jeune voisin alors qu'elle n'avait que quatorze ans. Ils ont fini par être fiancés, mais inexplicablement, il s'est enfui le jour des noces, l'humiliant devant toute la province. Le pire, c'est qu'il était amoureux d'elle, il l'a réalisé trop tard, il était marié à la plus adorable des petites bonnes femmes qui lui avait donné deux enfants. Ce grand imbécile aimait deux femmes à la fois. C'est Bérénice qui a tranché. Elle l'a entouré de tant d'amour qu'Edmond n'aurait voulu la blesser pour rien au monde. Il a sacrifié Éléonore une seconde fois.
⎯ La pauvre.
⎯ Madame de Fierville est une nature haute, elle ne transige pas. Elle aurait pu coucher avec lui plus d'une fois. Tous deux ont résisté, mais voilà, il y a eu plusieurs brouilles entre Edmond et Bérénice, toujours de son fait à lui. Pendant l'une d'elles, particulièrement grave et longue, Edmond a noué une relation avec vous. Éléonore ne l'a pas supporté. Elle était prête à se sacrifier pour une épouse, une mère, pas pour une …
⎯ Courtisane ? L'expression est très exagérée et les mots n'ont que la valeur qu'on leur attribue, ne craignez rien, je ne m'en blesse pas, on m'a suffisamment agressé verbalement pour que la cuirasse soit solide. Si je comprends bien, plus rien ne s'oppose à ce qu'ils se marient. Bérénice est trépassée, elles n'étaient pas vraiment rivales, cette jeune femme a recueilli les enfants et apparemment les aime. Une fin heureuse, en somme. Qu'attendent-ils ?
⎯ Edmond est mort. Il fait partie des victimes de septembre. Il a été massacré à la prison de l'Abbaye, comme tant d'autres.
⎯ Mais pas du tout. Il se porte comme un charme. Lisez les Révolution de Paris, vous y verrez des articles signés Jus Sapientia, c'est lui. Son dernier en date parle justement de L'Ami des lois. Quand j'ai vu qu'il reprenait le licol, j'ai été un peu blessée de ne pas refaire équipe, mais notre liaison était finie. J'ai d'ailleurs bien connu son épouse, nous avons travaillé ensemble sur un grand projet qui n'a pas abouti.
Olympe raconta le merveilleux dessein dont Bérénice avait été l'initiatrice : réunir en un seul témoignage les doléances des femmes des trois Ordres, puis le présenter à la reine.
⎯ Quand je rédige, on me reproche de mettre trop de flammes. Bérénice a nuancé ma prose. C'était l'époque heureuse de la préparation des états généraux, je vivais sous leur toit, à Versailles, au pavillon de Sigoll. Il n'y avait plus d'intimité physique entre Edmond et moi, je devais ce petit sacrifice à Bérénice, une femme exceptionnelle. Mais enfin, puisqu'elle n'est plus et que lui est vivant, il faut réunir ces deux-là. Ah, j'adore cette histoire, Dumouriez attendra, je change de sujet.
Olympe partit en tourbillonnant, laissant Rosalie seule avec Éléonore.
8 Le curricle est un petit cabriolet.
9 Santerre avait été brasseur de bière avant d'entrer en politique.
3 Soulagement et désespoir des autres
Les mésaventures des ex-comédiens du roi m'intéressaient peu, d'ailleurs j'avais trouvé la pièce mauvaise, honnête mais assez plate. Il n'en est pas moins vrai que depuis qu'on arrêtait tous ceux qui brandissait le texte dans les rues, Laya se cachait. J'allais voir Piranesi rue des Fontaines et le trouvais vieilli et désabusé. Ayant perdu sa fille unique, son épouse, côtoyé la mort de près et privé de ses petits-enfants, dont lui non plus n'avait pas de nouvelles, il n'attendait plus grand-chose de la vie. Même le grand souffle des affaires ne l'intéressait plus, il avait réduit son personnel, renvoyé la moitié de ses clercs et voulait se retirer. Il me demanda si j'allais rentrer en Saintonge. Je lui répondis que c'était impossible pour l'instant, mais que oui, j'en rêvais, j'étais convaincu qu'Éléonore avait réussi à se procurer le précieux passeport et que mes enfants m'y attendaient. Il me remercia de lui avoir envoyé Adelet, lequel s'entendait bien avec Claude Poltron, son premier clerc.
J'avais beaucoup de chances d'avoir rencontré Adelet Prothade, le jeune homme était à la fois courageux, travailleur, instruit et d'une probité sans faille. Il me fut d'une grande aide, notamment en me faisant remarquer que la solitude était mauvaise conseillère. Je le pris fort mal.
⎯ Mon épouse est à peine froide et tu voudrais que je me remarie ? Tu es complètement fou. Plus tard, peut-être, avec je ne sais qui.
⎯ Madame de Fierville ?
⎯ Adelet, c'est un double coup bas, mêle-toi de tes affaires. Et puisque tu en parles, la remarque est aussi valable pour toi, prend modèle sur l'abbé, épouse une ci-devante ruinée par la révolution. Si tu le veux je te doterai.
Adelet se mordit la lèvre, il avait autre chose à dire et craignait ma réaction. Je le brusquai, il me livra le fond de sa pensée.
⎯ Votre beau-père est très malheureux, vous pourriez l'accueillir ici, la maison est immense.
⎯ Et tu n'aurais plus à traverser tout Paris pour l'aider à mettre en ordre ses affaires.
⎯ À votre ton, je sens qu'il est mal venu de vous faire une autre prière.
⎯ Au point où j'en suis !
⎯ Restout a renvoyé Catherin Chaponnet. Il est quasiment à la rue, sans ressources. Il est allé trouver la veuve de Ville d'Avray, mais la pauvre femme se débat dans des difficultés sans fin et l'a mal reçu.
Je ne pouvais pas laisser dans la misère un homme qui me rappelait tant de bons souvenirs. Chaponnet m'avait formé à l'expertise des objets d'art, Bérénice l'appréciait beaucoup, j'acceptai.
⎯ Encore un protégé ?
⎯ Madame Deleyrant est timide, tout l'impressionne, y compris de prendre la place de votre épouse, en tant que maîtresse de maison, s'entend.
⎯ C'est vrai que la pauvre Coralie-Gersende n'a personne avec qui papoter quand nous sommes à table. Et tu verrais qui ?
⎯ Madame de Gouges ?
⎯ Non, j'ajoute qu'elle a un grand cœur et refuserait. Dis à Piranesi qu'il est le bienvenu.
⎯ Ça ne fait encore qu'une femme pour cinq hommes, monsieur.
⎯ Tu veux que je prenne une maîtresse, madame de Ville d'Avray peut-être !
⎯ Vous avez raison, je suis stupide.
Catherin Chaponnet ne se fit pas prier et voulut se rendre utile, Adelet l'associa à ses travaux d'écriture et de gestion de mes biens, qui avaient connu une croissance exponentielle depuis la vente des biens nationaux. C'est par cet homme que j'appris le sort atroce de celui qui avait été mon second père. Ville d'Avray avait d'abord été emprisonné à l'Abbaye, puis transféré à la Force. "Peuple, en immolant tes ennemis tu ne fais que ton devoir", cette phrase, prononcée par Billaud-Varenne, avait scellé son destin. Entraîné dans la cour, broyé de coups, sanglant, à peine conscient, il avait trébuché sur le cadavre de Montmorin et reçu une pique dans le corps, ce qui ne l’avait pas empêché, dans un dernier sursaut, de crier : « Vive le roi. » Pour le faire taire, un des hommes qui éclairaient les lieux du meurtre lui avait enfoncé dans la gorge une torche enflammée. Son corps avait été traîné jusqu'au ruisseau né de l’écoulement du sang de ceux que l’on avait déjà égorgés, puis il avait été perdu ! De ce fait, le décès n'ayant pu être officiellement admis, Ville d'Avray fut déclaré émigré et ses biens confisqués "au profit de la nation". Sa veuve dut faire la preuve que son mari avait bel et bien été assassiné. Elle y parvint en suscitant les témoignages du concierge de la prison et des personnes affirmant avoir vu son corps. La présomption d’émigration fut annulée et les scellés levés10.