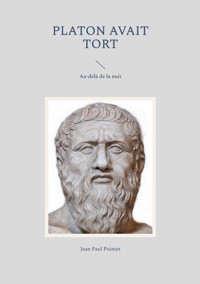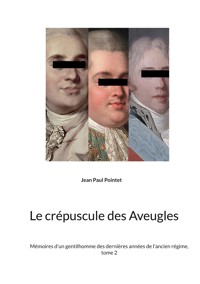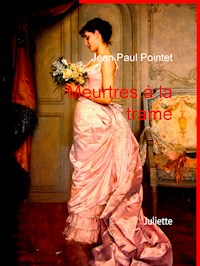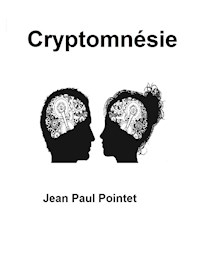Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Rajeunir, retrouver ses vingt ans, son amour de jeunesse tel qu’on l’a quitté quarante ans plus tôt, tout le monde en rêve... Paul l’a vécu, mais pas comme il aurait pu l’imaginer.
Il se réveille à l’hôpital, dans le corps d’un petit voyou sans envergure. La visite d’un officier de police lui apprend qu’on a tenté de l’assassiner et qu’on recommencera. Comment se défendre ? Comment aider la police quand on ne sait rien ? De plus, sa façon de parler et sa culture sont sans commune mesure avec celles de l’individu qui est réellement mort. Solder le passé de ce dernier se révélera difficile, tout comme ses retrouvailles avec une jeune fille qu’il n’a jamais oubliée.
À PROPOS DE L'AUTEUR
À la suite de plusieurs romans historiques publiés,
Jean-Paul Pointet propose
L’esthétique inhabituelle du point d’interrogation. Avec cet ouvrage, il cherche à satisfaire un vieux fantasme : retrouver un amour de jeunesse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Paul Pointet
L’esthétique inhabituelle
du point d’interrogation
Roman
© Lys Bleu Éditions – Jean-Paul Pointet
ISBN : 979-10-377-6304-4
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Le pari
Lisa se réveilla avec une forte migraine et une sensation de brûlure entre les cuisses. Paul était debout, son iPhone à la main, il parlait avec un copain.
— T’as reçu mon message ?
— Oui, t’es un beau salaud.
— Un salaud à qui tu dois cinq cents euros.
— Seulement quand tu auras mis les photos en ligne, j’ai encore rien vu.
— Le pognon d’abord, les photos ensuite.
— T’as pas confiance ?
— Non.
— J’ai pas le fric, faut que je m’fasse une billetterie.
— J’t’attends au Blockhaus, magne. Tu verras, sa petite moule est splendide.
— Elle était pucelle ?
— Bien sûr.
Lisa se souleva sur un coude et le dévisagea. Paul rigolait doucement. Elle réalisa qu’elle était nue. Ses yeux descendirent sur ses cuisses, les traces de sang ne laissaient aucun doute.
— Qu’est-ce que tu m’as fait ?
Il s’approcha, l’agrippa par les cheveux et lui mit l’iPhone sous le nez.
— Tu veux voir comme tu es belle ? Dans une heure, dès que ce con de Romain aura craché son fric, tout le lycée pourra admirer ta chatte, avant et après que tu sois devenue une femme. Maintenant, tu te rhabilles et tu dégages.
Elle poussa un cri de désespoir.
***
Paul enfourcha sa puissante moto, franchit le portail de la propriété et accéléra à fond sans remarquer la voiture banalisée garée en face. Immédiatement, un téléphone sonna au commissariat du second arrondissement.
— Il vient de partir, à vous de jouer.
***
Paul roulait sur les quais de Saône, à fond comme d’habitude. Il savait où était le radar fixe et accéléra encore. Sa plaque était illisible, un truc de Romain, un simple voile de vernis, il en rigolait déjà, quand il vit le barrage qui se formait pour l’intercepter. Son bolide était puissant, il calcula qu’il avait le temps de passer. Cela se joua à trois secondes, déjà il était loin. Les flics le prirent en chasse. Il s’engouffra dans Choulans dont il avala les courbes à 140 à l’heure, les semant facilement, mais l’idée de les narguer lui fit faire demi-tour. Arrivé au carrefour de Sainte-Foy, il s’engagea dans la descente. Les flics l’avaient vu, la poursuite dura peu. Au premier virage, Paul voulut freiner, mais sa moto alla tout droit, il percuta violemment le muret central et s’écrasa contre la maçonnerie soutenant la colline. Son iPhone explosa dans le choc.
***
Lisa avait fini de se rhabiller, elle voulait mourir. Elle prit le bus, descendit en centre-ville, s’engagea sur le pont de l’université, très encombré de piétons, enjamba le parapet et se jeta dans le vide, dans l’indifférence générale. Quand les pompiers la repêchèrent, ils réussirent à expulser l’eau qui engorgeait ses poumons, mais le cœur avait cessé de battre. Un vigoureux massage cardiaque réussit à le faire repartir, très faiblement. Toutes sirènes hurlantes, le SAMU l’emporta, inconsciente, vers le grand hôpital Lyon-Sud. C’est ainsi que les deux jeunes gens se retrouvèrent à quelques mètres l’un de l’autre, chacun agonisant dans sa chambre.
Réveil
Plusieurs semaines s’écoulèrent. Paul restait dans une sorte de coma, semi-conscient, incapable de réagir. Il souffrait de multiples fractures, y compris crâniennes. Une femme venait le voir chaque jour, elle lui tenait la main pendant des heures, pleurant silencieusement. Il était aveugle et ne pouvait pas parler.
Puis son corps émergea de sa léthargie, il bougea lentement la main droite, plia le bras, voulut appeler, mais sa bouche, ses lèvres, sa langue refusaient de lui obéir. Il y eut un petit cri, quelqu’un se leva, ouvrit la porte et se précipita dans le couloir.
— Docteur Mugnier, venez vite.
Une personne entra, puis une voix masculine tenta de le stimuler.
— Est-ce que vous m’entendez ?
Paul leva les doigts en signe de réponse.
— Pouvez-vous parler ?
Il fit signe que non.
— Est-ce que vous me voyez ?
Il ne voyait rien.
— Vous avez eu un très grave accident, maintenant vous êtes réparé, vos fractures sont réduites, vos organes fonctionnent, rien ne s’oppose à ce que vous retrouviez la vue et l’usage de la parole, c’est une question de volonté, essayez de parler.
Paul en était incapable, sa bouche était pâteuse, sa langue inerte, sa mâchoire refusait de bouger. Qui était ce type, son chirurgien, le psychiatre de l’hôpital ? En tout cas, il avait une voix rassurante.
— Docteur, il vous entend.
— Je vois bien, c’est un miracle. Vous êtes Paul Duval, vous avez vingt ans, avec toute la vie devant vous. Il faut que votre esprit réintègre votre corps. Puis il s’adressa à la vieille dame, qui ne pleurait plus, mais respirait fortement. Son cerveau réagit, il est conscient, il ne demande qu’à se libérer, vous seul pouvez l’aider. Il connaît votre voix, parlez-lui sans arrêt, racontez-lui sa vie.
Hélas, l’effort avait été trop dur, Paul sombra à nouveau dans l’inconscience.
***
Il devait faire nuit quand son corps réagit à nouveau. Les bruits de l’hôpital avaient cessé, il n’entendait rien, la vieille dame était partie, il était seul. Il réussit à bouger les deux bras en même temps, puis remua un pied. Sa mâchoire s’articulait normalement. Il essaya d’émettre un son, ce fut une longue plainte. Où était-il ? Qui était-il ? Pendant une heure, il s’exerça à parler, il avait la bouche sèche, c’était douloureux. Pourquoi n’y avait-il pas d’infirmière de garde ? Soudain, il réalisa qu’il voyait, faiblement certes, mais il distinguait les lumières des réverbères, la veilleuse de sa chambre. Il devait y avoir un bouton à presser, une sonnette. Il essaya de se lever, mais ses muscles avaient fondu, il ne fallait pas tomber. Il trouva, appuya. Quelques minutes plus tard entra l’infirmière de nuit.
— Boire.
Elle remplit un verre qu’elle lui tendit, accompagnant ce geste, quasi maternel, de mots affectueux. C’était une Africaine d’une cinquantaine d’années. Elle était belle avec ses gestes emplis de douceur. Elle le recoucha et lui expliqua qu’elle allait chercher l’interne. Ce dernier examina Paul et prononça lui aussi des paroles encourageantes. Il allait s’en sortir, il en était sûr désormais. Un quart d’heure plus tard, la police était prévenue.
***
Son cas passionnait tout le monde : c’est rare, dans une carrière de scientifique, d’assister à un miracle. Le docteur Mugnier lui expliqua qu’il était mort, puis que son cœur s’était remis à battre et son cerveau à réagir, c’était incompréhensible, inconcevable du point de vue scientifique, mais le fait était là, il était vivant et lui était là pour l’aider à retrouver toutes ses facultés, y compris sa mémoire, car Paul se taisait obstinément, comme s’il ne se souvenait de rien.
***
Dans les jours qui suivirent, tout alla très vite, il se levait, faisait quelques pas dans sa chambre, puis dans le couloir. Tout le monde était gentil. La vieille dame revenait tous les jours. Elle lui racontait sa vie, lui expliquant qu’il s’appelait Paul Duval, qu’il était orphelin et qu’il habitait avec elle, 48 rue Pasteur à Oullins. Elle était son ancienne nourrice, la bonne de ses parents. C’est elle qui l’avait élevé. Paul souriait sans répondre.
Mugnier était informé de cette étrange attitude. Un amnésique ordinaire souffre d’avoir perdu son passé, ses souvenirs, ses repères. Il n’en était rien. Paul n’évoquait jamais sa vie d’avant l’accident. Était-ce parce qu’il avait échappé de peu à la mort ? Autre chose curieuse, sa rééducation avait été extrêmement facile, brûlant les étapes. Au début, il marchait autour de sa chambre, s’appuyant sur les murs, puis sur ceux du couloir. Mugnier n’avait jamais vu ça. Puis il avait commencé à faire sa toilette seul, sous la surveillance d’une infirmière. Le jeune homme s’était regardé longuement dans le miroir de sa salle de bain, fixant son visage. « Lazare sortant du tombeau », avait-elle dit à Mugnier, qui avait hoché la tête gravement. Il était encore traumatisé par son accident, l’évidence était là. Cela s’arrangerait avec le temps.
***
Le moment de le faire sortir de l’hôpital finit par arriver. Mugnier s’était attaché au jeune homme, il lui fit promettre de donner de ses nouvelles.
— Tu dois être heureux à l’idée de retrouver ta maison, Émilie, ta copine ?
— Oui, répondit Paul pour couper court.
— Tu étais salement amoché quand tu es arrivé, mais on a bien travaillé. Pour tes jambes, je dois te prévenir, les cicatrices ne partiront pas.
— Ça ne fait rien. Et ça, ça peut s’enlever ?
Mugnier observa longuement le tatouage. Le poignard rappelait ceux des officiers SS, le célèbre Ehrendolch. Il n’y manquait rien, pas même l’inscription sur la lame, mais Paul avait demandé au tatoueur de remplacer la devise Alles für Deutschland par Alles für Vergnügen1.
— C’est un très beau travail ! Et qui a dû coûter une fortune. Tu es sûr ?
— Oui.
— Il y a plusieurs techniques, les deux meilleures sont le laser Q Switch et la picoseconde, dans les deux cas c’est long et douloureux.
— Je n’ai pas le choix. Neues Leben ? Nein Herr Doktor, meines echt2.
— J’ignorais que tu parlais allemand.
— Simple coquetterie. J’ai dû lire ça quelque part. À propos de copine, qu’est devenue la fille de la chambre trente, celle qui est morte le même jour que moi ?
— Comment sais-tu qu’une jeune fille morte reposait dans la chambre 30 ?
— Je l’ai vue en rêve.
Mugnier changea de visage, il se souvenait bien car la pauvre môme avait exactement l’âge de sa propre fille. Personne ne savait pourquoi elle avait tenté de se suicider. Tenté ? En fait, elle avait réussi, puis contre toute attente, son cœur s’était remis à battre, exactement comme celui de Paul Duval.
— Elle a quitté l’hôpital depuis longtemps.
Les ennuis
Paul ne ressentait aucune impatience à faire de même. Sortir de l’hôpital ? Pourquoi ? Il se posait suffisamment de questions, surtout le matin quand il se regardait dans la glace de sa salle de bain. Pourtant, ses journées n’étaient pas drôles. Émilie le saoulait en lui racontant une vie qui n’était pas la sienne. On stimulait sans cesse son cerveau. Scanners et tomographies n’avaient rien révélé, il fonctionnait parfaitement. Jusqu’à présent, le bien-être de se sentir en vie lui suffisait largement, les questions existentielles pouvaient attendre.
Puis tout vola en éclats. Un jour, une femme d’une beauté impressionnante pénétra dans sa chambre. Paul était étendu sur son lit, il attendait son kiné. Elle tira une chaise et s’installa en face de lui, le contemplant longuement.
— Survivre à un tel accident, il faut d’abord que je vous félicite, monsieur Duval, c’est miraculeux.
Paul lui donna la quarantaine, une quarantaine radieuse. Elle était grande, brune, bien faite, les cheveux légèrement ondulés, et surtout une voix basse, sombre, veloutée. Il était fasciné.
— Vous me reconnaissez ?
— Non.
— Ça m’étonne, vous avez passé suffisamment de temps dans mon bureau… avant l’accident.
— Qui êtes-vous ?
— La commissaire Marie-Ange Leflère.
— Et qu’est-ce que je faisais dans votre bureau ?
— Vous rendiez des comptes à la justice. Ça vous fait rire !
— Non. C’est juste que ça me rappelle mes cours d’éducation civique : ne pas confondre divorce et cambriolage, justice civile et justice pénale. Quels sont les huit grands types de tribunaux ? Les principaux acteurs de la justice ? Où commence une procédure juridique, au tribunal où au commissariat ? Avouez, commissaire, qu’on n’y est pas toujours en présence d’une femme extrêmement jolie.
La commissaire Leflère était habituée à provoquer ce genre de réaction3, elle ne réagit pas au compliment, mais aux propos eux-mêmes. Elle en avait vu défiler des petits délinquants, tous se ressemblaient : violences en réunion, propos discriminatoires, petits trafics, insultes aux agents de la force publique, refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d’autrui, délit de fuite. Or, le Paul Duval qu’elle avait devant elle était très différent de ce qu’il avait été. L’ancien était quasiment illettré, incapable de retenir quoi que ce soit, même le code de sa carte bancaire, et voilà qu’il citait des bribes de son cours d’éducation civique !
De son côté, Paul la trouvait absolument magnifique. De façon assez simpliste, il se disait qu’une aussi jolie femme ne pouvait être une garce, et qu’au contraire, elle lui voulait du bien.
— Je suis venue pour…
— Pour me faire la morale. C’est normal. J’ignore quand, comment et pourquoi, mais tout le monde me répète que j’ai échappé de peu à la mort en tentant d’échapper à la police. Vous êtes commissaire. Attendu que police et justice marchent main dans la main, avec comme première préoccupation, non la répression, mais de faire réfléchir et d’éduquer, vous allez utiliser l’argument du bâton, « argumentum baculinum ». Je vous rassure. Je ne conduirai plus jamais de moto, ne tenterai plus jamais d’échapper à la police, et je respecterai toujours les lois, ce qui est de mise dans un état civilisé où leur premier rôle est de nous protéger. Pour finir, je vous remercie d’être venue. Vous êtes le plus séduisant commissaire de France et de Navarre, comme on se plaît à le dire depuis l’année 1610.
Ce fut au tour de Marie-Ange d’être secouée par une franche rigolade, des compliments bidon, elle en avait entendu, mais pas dans la bouche d’un individu comme Paul Duval. Elle le contempla à nouveau longuement. Elle se souvenait d’un individu d’une ignorance crasse, s’exprimant par stéréotypes et avec un vocabulaire proche de celui d’un enfant de douze ans. Un mois de coma profond pouvait-il changer un être humain ?
— Pour quelqu’un à qui, « abréviations, onomatopées, injures et lieux communs » tenaient lieu de langage, vous avez beaucoup changé ! En attendant et en supposant que vous soyez sincère, quant à vos propos, et à cette prétendue perte de mémoire, je vais mettre les points sur les « i ». Non, je ne suis pas venue pour vous faire la morale, mais pour vous apprendre quelque chose.
— J’espère que ce ne sont pas les raisons pour lesquelles j’aurais tenté d’échapper à la police, ça ne m’intéresse pas. Pour tout autre sujet, je tenterai de vous aider, per fas et nefas4, mais ce sera modeste, j’en ai peur, je ne sais rien de Paul Duval ! Je sais juste que je suis vivant, que j’ai vingt ans, et c’est à la fois si effrayant et si merveilleux que plus rien ne m’intéresse.
— Même de savoir qu’on a tenté de vous tuer ?
De surprise en surprise
Paul était parfaitement guéri. Ses fractures étaient ressoudées, ses articulations fonctionnaient normalement, son crâne enfoncé lui faisait encore mal de temps en temps, mais ce n’était rien. Le seul problème apparent restait sa confusion mémorielle. Mugnier ne l’avait pas connu avant l’accident, il ne pouvait ni comparer ni s’étonner, ce qui n’était pas le cas de la commissaire. Marie-Ange le lui expliqua. Mugnier en parla à l’un de ses confrères qui fut vivement intéressé.
***
Le lendemain, Paul vit entrer dans sa chambre un homme d’une cinquantaine d’années, grand, avec un air doux. Mugnier le présenta.
— Le docteur Marsan est un spécialiste de la traumatologie crânienne et des cas d’amnésie. Je lui ai parlé de ce rêve sur la jeune fille de la chambre trente et d’autres petites choses. Ton cas l’intéresse.
Paul ricana, il s’y attendait. La visite de la commissaire l’avait pris par surprise. Elle s’était montrée gentille et puis elle était si belle qu’il avait baissé sa garde. À sa décharge, c’est vrai qu’il se déplaçait dans le brouillard. Il avait parfaitement reconnu la fille en question, mais c’était si vieux que c’en était presque irréel.
— J’imagine qu’il veut observer mes réactions quand je rentrerai chez moi.
— C’est exactement cela, répondit Mugnier, surpris d’une telle perspicacité, mais pas seulement. Tu as perdu la mémoire et cependant, tu as fait deux citations latines et une en allemand. C’est…
— … Très troublant pour un scientifique.
— Les troubles mémoriels sont fréquents après un choc violent. En l’occurrence, c’est plus qu’un choc violent, mais un très grave enfoncement de la boîte crânienne, théoriquement mortel. Que tu sois vivant est donc incompréhensible. Mais il y a plus. Tu as subi une longue phase d’agnosie.
— De quoi ?
— L’agnosie est l’incapacité de reconnaître ce qui est perçu alors que les organes sensoriels restent intacts. Tu étais aveugle alors que tu n’aurais pas dû l’être. Tu ne pouvais pas parler, alors que rien ne s’y opposait. Ta mémoire reste bloquée, alors que, selon la commissaire, tu es très différent du Paul Duval qu’elle a connu.
Paul préféra se taire.
***
Le taxi quitta Lyon-Sud pour Oullins, petite ville toute proche. Paul était conscient que Marsan guettait ses moindres réactions. Quand ils empruntèrent la rue du Perron et passèrent devant un beau portail de style renaissance, le taxi ralentit intentionnellement, il s’y attendait.
— Lisa Gauthier, la jeune fille de la chambre trente, est ici. Vous souvenez-vous d’elle ?
— Je devrais ? C’était elle, ma copine ?
— Je ne sais pas si on peut le dire ainsi, vous l’avez persécutée au point qu’elle a tenté de se suicider. Elle va mieux à présent.
Paul n’eut aucune réaction, cela viendrait en son temps, quand il serait seul.
Le taxi continua sa course et s’arrêta devant un grand portail peint en vert. Marsan appela par l’interphone, le portail s’ouvrit. Un parc apparut, avec à gauche un immense garage aux grandes portes en bois ornées de fers ouvragés, et juste à côté un jardin d’hiver et un petit bassin où flottaient des nénuphars. Le pavillon était au fond. Sur le porche attendait une vieille femme au sourire légèrement crispé. Émilie avait dû être briffée car elle resta muette, seuls ses yeux parlaient, ils disaient sa joie. Elle s’effaça pour laisser entrer les deux hommes.
Paul resta stupidement planté au milieu d’un hall gigantesque qui desservait des pièces étroitement fermées. Il ne savait où aller. Émilie interrogea Marsan du regard, il lui fit un signe. Elle ouvrit celle de droite. Elle donnait sur un salon austère. Il y avait un miroir, quelques tableaux, un ameublement cossu, mais vieillot. Les stucs au plafond évoquaient un confort bourgeois, désuet. Trois revues traînaient sur une table basse, des hebdomadaires financiers. Émilie était déçue.
— Tu ne reconnais rien ?
— Non.
Paul ne disait pas la vérité. Il avait parfaitement reconnu le portail et le charmant pavillon bourgeois du 19e, mais il n’en avait jamais poussé la porte, d’où son étonnement devant ces pièces à l’ameublement vieillot.
— Les amnésiques souffrent de leur perte d’identité, est-ce votre cas ?
— Non, je suis juste curieux. À propos, vous êtes psy, bien sûr.
— Oui.
— Vous voulez réparer ma tête ?
— Je ne le dirais pas comme ça, mais oui, sachant que rien ne peut se faire sans votre accord.
— Que vous n’aurez pas.
— Pourquoi ?
— Je n’aime pas les psychiatres, c’est comme SOS dépannage, on ne sait jamais ce que ça va coûter.
— Si vous dîtes cela, c’est que vous avez peur, murmura Marsan d’une voix douce, calme, impénétrable.
— Aquila non capit muscas5.
Marsan sursauta, on lui avait parlé de ces citations latines, d’où sortaient-elles, que se passait-il dans ce cerveau traumatisé ?
— Vous vous sous-estimez.
***
Marsan était bien placé pour savoir qu’il ne faut pas forcer la résistance d’un malade, il fit taire sa curiosité, donna des conseils en ce sens à Émilie et prit congé. Émilie et Paul se retrouvèrent face à face.
Énervé à l’avance, il comprit qu’il n’échapperait pas à la logorrhée habituelle. Elle lui expliqua, pour la nième fois, qu’elle connaissait tout son passé, qu’elle lui avait donné l’amour dont il avait été privé, soigné ses premières blessures, consolé ses échecs et tenté de le protéger quand était venu le temps des bêtises. Tout y passa, sa petite enfance, ses couches-culottes, ses premiers pas, ses caprices. Le fait qu’ils étaient toujours seuls tous les deux, que c’est elle qui lui avait servi de véritable maman pendant que sa mère voyageait d’un bout à l’autre du monde et que son père amassait de l’argent à la pelle. Elle savait tout de lui, au moins jusqu’à ce que commencent ses folies. Après, il lui avait tout caché.
Paul était incapable de répondre aux regards chargés d’amour, aux sollicitations muettes, pour la bonne et simple raison qu’il n’avait jamais perdu la mémoire, bien au contraire, mais les souvenirs qui l’envahissaient n’étaient pas ceux qu’attendait la vieille dame. Il avait vécu dans cette rue, marché sur ce trottoir. Il avait fait ses études secondaires dans le lycée où la jeune fille de la chambre trente avait repris les siennes.
Autant changer de sujet et en apprendre plus sur les propriétaires de cette maison.
— Pourquoi tous ces voyages ?
— Ton père était une sorte de collectionneur, il parcourait le monde pour racheter des voitures exceptionnelles. Lui-même roulait dans un coupé Mercédès qu’il venait de s’offrir. Il est à toi maintenant. Tu veux le voir, il est de toute beauté.
Paul la suivit jusqu’au garage. Une élégante voiture de sport, noire, racée, aux chromes discrets, mais qui ajoutaient une touche de noblesse, semblait l’attendre. C’était irrésistible. Il s’installa au volant. Contente de sa réaction, Émilie lui proposa de la suivre dans le bureau de son père.
***
C’était une pièce toute en longueur, remplie de classeurs à rideaux et d’une table de travail assez sobre. Une petite porte, dans un angle, donnait sur un minuscule w.c. décoré d’un tableau représentant un homme au visage lisse, sans l’ombre d’un sourire. « Ton père », lui dit-elle.
Paul se souvenait très bien de son vrai père, de ses yeux rieurs sous des sourcils en bataille, de sa gentillesse inépuisable, de sa fantaisie, de son goût immodéré des voyages lié à une incapacité pathologique à être heureux quelque part, infirmité qu’il lui avait transmise, avant que Paul ne se découvre une passion pour le jardinage.
— Pourquoi le tableau est-il dans les w.c. ?
— Il dissimule un coffre-fort mural.
— Qui contient ?
— Je ne sais pas. Ton père était très secret sur ses affaires, mais il était riche, très riche. Regarde.
Émilie lui désigna un premier classeur à rideau. Paul y découvrit une avalanche de dossiers. Il en choisit un au hasard : Espace quatre-vingt. C’était une résidence au nord de Lyon, sur une terrasse dominant le Rhône, Duval père y possédait deux appartements.
Il ouvrit un autre dossier. Les Moidons étaient une forêt de cinquante hectares dans le Jura. Suivaient les titres de propriété d’autres biens fonciers et immobiliers : trois étangs dans la Dombes loués à des sociétés de pêche, d’autres appartements, des garages. Visiblement, l’homme aimait diversifier ses placements.
— Les dossiers de l’entreprise ne sont pas là.
— Parce qu’il y a une entreprise !
— La Duval’s dreamcar. Ton père a fait fortune en rachetant, un peu partout, des voitures ayant appartenu à des célébrités. Il les faisait rapatrier dans son garage de Brignais, où une équipe de spécialistes les restaurait. Puis il les revendait dans son agence de la rue de la République.
— Bigre ! Et il a réussi de jolis coups ?
— Il a racheté la Cadillac Ville Estate Wagon d’Elvis Presley, et l’a revendue le double. Idem pour la Lamborghini Miura de Johnny Hallyday, elle lui a rapporté pas mal d’argent.
— Que les années soixante ?
— Non. Un hasard lui a permis d’acquérir la Delaunay-Belleville 1910 du tsar Nicolas II, il est allé la chercher directement à Moscou, c’est là qu’il a eu l’idée de racheter la Packard 12 de Staline, sa voiture préférée. Il paraît que c’est à son bord qu’il a observé les ruines du Reichstag dans Berlin en ruine.
— Incroyable ! Et toutes ces voitures ont été revendues ?
— La ZIL-114 de Brejnev est encore en magasin, ainsi que la Horch 853 Sport Cabriolet de Goering. Le grand regret de ton père est de ne pas avoir pu racheter la Lincoln Continental décapotable de John Kennedy, elle est au musée Henri Ford.
— Je peux ouvrir les tiroirs du bureau ?
— Tout est à toi maintenant.
Paul en doutait profondément. Vivait-il un rêve ou un cauchemar ? Allait-il se réveiller ? La gentillesse d’Émilie, sa tendresse, l’amour visible qu’elle lui portait lui fit du bien. Ça ne dura pas. Le tiroir central contenait un pistolet dans son holster. Il le sortit.
— Qu’est-ce que c’est que ce truc ?
— Un glock.
— Pour quoi faire ?
— Rester en vie.
Insomnie
Paul ne trouvait pas le sommeil. Qu’est-ce qu’il foutait là, avec pour compagnie une vieille dame qui lui avait expliqué qu’elle n’aimait pas le glock, qu’elle lui préférait « le 44 magnum en taille miniature, car il était plus léger et correspondait mieux à son âge » !
Émilie lui avait répété qu’on avait tenté de le tuer et qu’il devait apprendre à se défendre. Elle l’avait traîné dans le jardin pour qu’il s’entraîne, répétant inlassablement les mêmes conseils : « tendre le bras, bloquer sa respiration, abaisser lentement le canon et tirer sans hésiter. » Il avait aussi appris que si son pseudo-père préférait le glock, c’est parce que c’était une arme sans cran de sécurité, on tirait plus vite.
Une autre surprise l’attendait, la découverte de « sa » chambre. Tout était sale. Les placards débordaient de fringues débiles. Aucun livre, mais des jeux vidéo à en veux-tu-en-voilà, des murs couverts de posters psychédéliques, des bracelets cloutés, des bijoux douteux, des poignards à tête de mort, des symboles néonazis et un ordinateur verrouillé par un mot de passe.
C’était l’épreuve de trop. Le cerveau en ébullition, Paul s’efforça au calme. Cette nouvelle vie, il ne l’avait ni voulue ni choisie. Il aurait dû avoir peur mais s’en sentait incapable, pourtant, celui qui avait tenté de le tuer recommencerait. D’où viendrait le danger ? Allait-il devoir se méfier de tous ceux qui lui adresseraient la parole ? C’était ce que pensait Émilie, qui, hélas, n’avait pas pu l’aider. Elle ignorait qui il fréquentait avant l’accident. Il ne ramenait jamais personne à la maison, à part cette fille (celle de la chambre trente), et encore, n’était-elle venue que deux fois ! Profondément tourmentée à l’idée qu’il ne parvienne pas à retrouver ses souvenirs, Émilie lui avait soufflé qu’il devrait retourner au lycée, que ça l’aiderait peut-être, et que cette fille pourrait possiblement l’y aider.
La fille de la chambre trente
L’idée était intéressante, mais posait un problème. Vingt ans en terminale, cela signifiait trois ans de retard. De plus, Paul Duval avait visiblement été un sale con, serait-il capable de tenir le rôle ? Comment ça se comporte un imbécile ? Il en avait vu pas mal dans les couloirs de l’hôpital. Ils venaient visiter leur alter ego. Paul ignorait tout : les musiques, les jeux vidéo, la façon de s’habiller, les abréviations à la mode. Il détestait les raccourcis de langage, les idées toutes faites, la façon de parler avant d’avoir réfléchi, les multiples incivilités, les jugements à l’emporte-pièce, la prétention à tout savoir avant d’avoir appris, l’air niais devant un problème, les zygomatiques relâchés, la mâchoire pendante, le caleçon provocateur sous un ramasse-merde à la limite des fesses, tout cela il l’avait trop vu, il se savait incapable de donner le change.
Paradoxalement à présent, les yeux grands ouverts dans le noir, il se sentait comme aspiré à l’idée de retrouver l’ambiance d’une salle de classe, alors il pensa à cette fille. Que lui avait-il fait pour qu’elle tente de se suicider ? Croirait-elle qu’il était un autre ?
D’autres pensées plus farfelues lui traversèrent l’esprit. Être assis au milieu de lycéens qui auraient tous trois ans de moins que lui, voire quatre, était une pensée insupportable. Les profs se méfieraient de son retour et seraient sur leurs gardes. Il avait toujours eu horreur de l’anglais, cette langue stupide qui ne se prononce pas comme elle s’écrit. L’EPS ? Il serait dispensé à cause de ses nombreuses fractures. Les maths ? Il avait toujours adoré, mais de là à en refaire ! L’histoire-géo, là ça serait drôle. Puis il repensa à la fille, une onde de douceur l’envahit. Il s’endormit enfin.
***
Émilie l’attendait, elle avait préparé un copieux petit déjeuner.
— Déjà !
— J’aime prendre mon temps, donc je me le donne.
— Avant, tu aimais déjà prendre ton temps, mais sans te le donner.
Paul était nu, sortant de sa douche. Elle observa les nombreuses cicatrices de ses jambes, celle de son épaule, et poussa un douloureux soupir.
— J’ai réfléchi, ça ne me dit pas grand-chose, mais je crois que je vais faire un tour au lycée.
— Comme ça, sans les prévenir ! Il faut d’abord en parler au docteur Marsan, qu’il téléphone au directeur pour qu’on te fasse une place.
— Parce que je n’en avais pas !
— Ce n’est pas ce que je veux dire.
— On dirait que ça te fait peur, alors que c’est ton idée.
En fait, il n’y avait pas que la fille, il y avait aussi les anciens copains de Paul. Émilie ne les connaissait pas, mais imaginait sans peine de beaux pas grand-chose.
— C’est moi qui téléphonerais au directeur, lui dit-elle sur un ton catégorique.
— J’imagine qu’avant mon accident, vu que je ne foutais rien, j’allais au lycée sans cartable. Tu peux me trouver quelque chose ?
— Il y a le porte-document de ton père.
— Donne-moi aussi une de ses chemises et essaie de me trouver une cravate fantaisie.
— Tu veux mettre une cravate !
— Pourquoi pas ?
— Tu ne sais pas faire le nœud !
— Tu verras.
— Ils ne vont pas te reconnaître !
— J’ai cru comprendre que c’est peut-être mieux.
— Tu vas être déguisé.
— Moins que si je porte mes anciennes fringues. Téléphone au coiffeur du boulevard Émile Zola, et demande-lui s’il peut me prendre en urgence. Je ne veux pas continuer à ressembler à un hippie des années soixante.
— Tu seras en retard.
— Je leur fais déjà bien de l’honneur d’y retourner.
Émilie nota qu’il se souvenait de ce petit salon de coiffure, où elle-même allait faire ses brushings. Toute réjouie, elle s’exécuta.
***
Une heure plus tard, le splendide cabriolet décapotable SLK attendait son bon vouloir. Il n’y a pas à dire, on savait faire de belles voitures chez Mercedes, néanmoins celle-ci serait trop voyante, même garée sur le parking des professeurs. Il choisit de faire la route à pied, un porte-document en cuir noir sous le bras.
D’abord une forte montée, puis le franchissement d’une artère commerçante, et enfin la rue du Perron où il se retrouva devant le portail majestueux d’un lycée qu’il connaissait bien. Paul poussa la grille et pénétra dans la cour d’honneur. Elle précédait un escalier monumental menant à la terrasse, sur laquelle était bâti un château du XVIIe, ancienne résidence d’été des comtes évêques de Lyon, devenue un lycée secondaire.