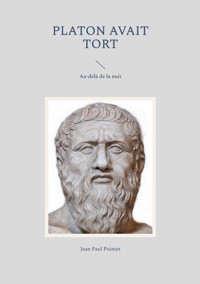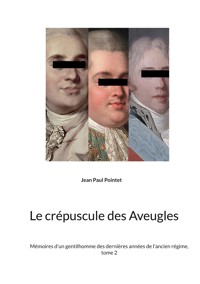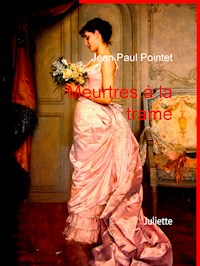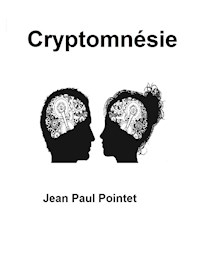5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Mémoires d'un gentilhomme des dernières années de l'ancien régime
- Sprache: Französisch
Edmond-Alfé, chevalier de Sémontré et baron Des Gonds, n'est qu'un petit nobliau de campagne désargenté lorsqu'il entame, par son mariage, une ascension sociale qui le conduira jusqu'au Garde-Meuble royal dont il deviendra responsable en second. À ce titre, il vivra tous les grands évènements de la Révolution et deviendra le secrétaire officieux du célèbre abbé Grégoire, l'un des rares hommes assez courageux pour tenir tête à Robespierre. Il sera l'ami d'Olympe de Gouges, dont il partagera les combats, puis de Rosalie Dugazon actrices phare de la Comédie-Française.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sommaire
Meurtre à Rouy-en-Bazois.
Le piège
Courriers
Corbinien
La nostalgie est un poison lent
Bérénice
Un repas de fiançailles
Coupable ?
Trianon
Maubuisson
Jean D'Osny
Deux duels, un enlèvement et une bataille.
Des ennuis en cascade.
Un journal intime
Sept jours de voyages
En Saintonge
En Auvergne
Libération
Karma
Julie
Ultimes combats
Conséquence d'un contrat de mariage
Enfin un emploi qui me convient
Mariage
Au Garde-Meuble Royal
Rejet familial
Encore un duel
1 Meurtre à Rouy-en-Bazois.
Deux hommes cheminaient de conserve sur la longue route qui mène de Saintonge en la lointaine Bourgogne. L'un était âgé, l'autre un adolescent d’une quinzaine d’années, c'était moi. Nous étions tous deux lourdement armés. Aucun chariot ne nous accompagnait, aucun valet, tout notre bagage tenait dans les fontes volumineuses de nos deux montures. Mon père était un homme de guerre, au cuir tanné par des années de campagne. Je sortais du collège, mes livres me manquaient. J'osai une question dont je savais déjà la réponse.
⎯ Pourquoi n'avons-nous pas pris la poste royale, père ?
⎯ Elle est réservée aux riches. Mais si notre voyage porte ses fruits, ce qui ne saurait manquer, car Bernard Chérin est un homme de bien, nous reconstruirons notre fortune aux dépens d'un forban qui mérite la corde.
⎯ Est-ce loin, où nous allons ?
⎯ Une centaine de lieues. Ne me dis pas que ça te fait peur.
⎯ Je n'ai pas l'habitude.
⎯ Tes curés ont fait de toi une mauviette. Ce soir nous coucherons à Cognac, puis à St Cybardeau, puis après, quand tes fesses seront bien tannées, ce sera Angoulême, puis La Rochefoucauld.
⎯ Pourquoi m'avez-vous emmené ?
⎯ Pour faire de toi un homme.
⎯ Et qui est ce forban que nous devons démasquer ?
⎯ Un faux noble qui essaie de s'emparer du château et des terres d'un digne gentilhomme. C'est un aigrefin habile, il n'en est pas à son coup d'essai. Une fois sur place, je solliciterai l'aide de monsieur de Rozières, l'intendant du Nivernais. Il nous fournira les soldats nécessaires.
⎯ Faudra-t-il se battre ?
⎯ Vous avez peur, mon fils ?
⎯ Non, mon père.
J'étais sincère. Ce n'est pas parce que je n'en avais pas le goût que je ne tirais pas très convenablement au sabre, au fleuret et à l'épée. Quant aux armes à feu, outre qu'elles étaient coûteuses, qu'on ne les utilisait guère que pour la chasse, et que je les trouvais bruyantes, grasses, donc très sales à utiliser, je n'ignorais rien de leur maniement.
⎯ Un chevalier de Sémontré n'a jamais peur, et quand il a cul-en-selle, il ne demande pas si la route va être encore longue. Quant à se battre, j'aurais honte de vous si vous restiez à l'écart. Auriez-vous préféré que j'emmène votre redoutable voisine, qui vous est supérieure en tout, y compris au pistolet.
Ah, ce vouvoiement, comme il était chargé de mépris ! Pourtant, mon père, le baron Antoine-Annet Des Gonds, avait tout pour être fier de moi. J'étais l'élève le plus brillant du collège, mon latin était digne d'un père Jésuite. À cela s'ajoutait une droiture morale bien supérieure à celle de beaucoup de mes camarades. N'eussè-je été fils unique et appelé à lui succéder à la tête de notre petite baronnie, une brillante carrière dans les ordres aurait pu s'ouvrir à moi. Le reproche m'avait atteint.
⎯ Éléonore est un garçon déguisé en jeune fille. Je ne sais que trop qu'elle me bat à plate couture dans tous les exercices où vous aimeriez me voir exceller. Elle fait mouche à trente pieds-de-roi1, et ce, même sur les cibles les plus petites.
⎯ Vous avez raison mon fils, elle vous est supérieure en tout. Elle monte mieux que vous, et sait débusquer n'importe quel gibier.
⎯ Mais elle ne pratique pas l'escrime, et encore moins les humanités.
⎯ Ce ne sont pas les livres qui vous sauveront la vie s'il y a bataille.
Mon fessier rendit l'âme en atteignant La Rochefoucauld. Le lendemain, à mi-chemin de Limoges, je ne savais plus comment tenir en selle. Je voulais le taire à mon père, mes grimaces parlaient pour moi. Sur la route de Guéret, je n'étais encore à cheval que par miracle. C'est entre Chambon et Luçon que mon père m'abandonna sans un mot chez le curé du village, les chausses souillées de sang. Il me donna l'ordre de le rejoindre à Rouy-en-Bazois, quand je serais à nouveau capable de tenir cul-en-selle comme un gentilhomme. Le rebouteux du village me soigna. Selon lui, il fallait une bonne dizaine de jours pour que mes plaies cicatrisent, mais à défaut de chevaucher, si je poursuivais à pied en tirant ma monture par la longe, mon père n'aurait pas tant d'avance que ça. Je suivis son conseil et allongeai les étapes, dormant très peu.
Mon père n'était plus à Rouy, il n'avait pas laissé de mots, l'aubergiste ne put me renseigner. J'ignorais tout, y compris le nom de l'homme qu'il traquait. Il n'y avait qu'une solution, me rendre à Nevers et y interroger monsieur de Rozières. Huit lieues ! Si mon fessier était en meilleur état, ce n'était pas le cas de mes finances. Alors que je m'arrêtais à Saint-Benain d'Azy et que je demandais à l'aubergiste si je pouvais coucher dans sa grange, il me jeta un regard narquois. « À supposer que vous n'ayez pas peur des morts, ça peut se faire. Il y a un cadavre. J'attends la maréchaussée. » J'étais tellement fatigué que j'aurais couché n'importe où. Un valet d'écurie s'occupa de mon cheval. J'avalai une soupe épaisse et me tassai près de l'âtre où je finis par m'assoupir. Le bruit bien reconnaissable d'un peloton de gendarmerie me tira du sommeil. La maréchaussée venait chercher le corps. Les gendarmes avaient amené une charrette, je les vis y déposer un homme de taille moyenne, enveloppé dans sa cape de voyage. C'est lorsque le cheval de l'inconnu y fut attaché que je reconnus la monture de mon père. Il avait été abattu d'un coup de pistolet, les brigands l'avaient dépouillé, il ne restait rien ni de sa bourse ni de l'épaisse chemise en cuir qui renfermait le dossier fourni par Bernard Chérin, le généalogiste royal. Je suivis le triste cortège jusqu'à Nevers, où monsieur de Rozières m'expliqua que mon père était effectivement venu quelques jours plus tôt, qu'il lui avait fourni les soldats nécessaires dans l'accomplissement de sa mission, laquelle avait été couronnée de succès. Hélas, la récompense promise avait disparu, volée par les bandits. Le corps de mon père fut enfermé dans un cercueil de plomb, elle-même dans une caisse en chêne. Je n'avais presque plus d'argent, monsieur de Rozières me donna le viatique nécessaire pour le voyage de retour.
1 Cent mètres.
2 Le piège
La mort de son époux laissa ma mère indifférente. La perte de la récompense espérée pour avoir démasqué un faux noble était plus cruelle. Dieu merci, elle avait un projet pour redorer le blason familial. J'en ignorais tout. Ma mère fit distribuer des billets d’enterrement, afin de prévenir tous ceux qui voulaient s’associer à notre deuil. Ce fut pour moi l'occasion de revoir Éléonore. Quand je signai l’acte de sépulture qui me faisait officiellement baron et chef de famille, elle se tenait au premier rang, étrangement belle dans sa robe noire. Elle priait de toutes ses forces, remerciant Dieu de ne pas être à ma place, tant elle aimait son père. Ce n'était pas mon cas. Mon géniteur voulait faire de moi un homme de guerre à son image. Je n'aimais que mes livres. Il m'avait enseigné l'usage de toutes les armes possibles, à grands coups d'étrivières. Cela faisait partie de l'éducation d'un jeune nobliau de campagne. Pour en revenir au jour de l'enterrement, notre voisin était là. C'était le père d'Éléonore, le marquis de Fierville, un homme déjà âgé. Il me serra de toutes ses forces dans ses bras, me supposant une émotion que je n'éprouvais pas.
Dans les jours qui suivirent, je vis plus souvent Éléonore. Elle était mal à l'aise et me regardait étrangement. De même, le carrosse des De Fierville venait plus souvent aux Gonds. De longs conciliabules se tenaient dans la modeste bibliothèque. Puis ma mère me pressa de choisir un état. Mon goût pour les études semblait indiquer une carrière dans l'administration royale.
Je retrouvai mon cher collège, mes livres et l'étude des physiocrates. Ils soutenaient que la terre et l’agriculture sont les sources essentielles de la richesse, ces notions arrivaient d'Angleterre, elles étaient à la mode, y compris à Versailles où notre reine élevait des moutons. Traditionnellement, les élèves ne quittaient jamais le collège, ma mère emprunta de plus en plus souvent la voiture du marquis pour venir me chercher, et ce sous les motifs les plus variés. Elle en profitait pour extraire Éléonore de son couvent. Nous faisions la route ensemble, aller et retour. Le vieux marquis savait jauger les êtres, non à l'aune de leurs titres ou de leur fortune, mais à celles des connaissances, de l'intelligence et des vertus. Il m'ouvrit généreusement sa bibliothèque, bien plus fourni que celle de feu mon père. Quand je reposais un ouvrage, il aimait en discuter avec moi et sonnait pour qu’on nous serve le chocolat. C’était un moment d’une grande douceur. Éléonore s'installait dans un fauteuil et regardait son père, qui, lui-même, tout en parlant, m'observait soigneusement. J'étais un être calme, très différent des fiers-à-bras qui pullulent dans la noblesse. Il appréciait mon instruction, me suggérait des lectures et acheta même l'intégrale de l'Encyclopédie de Diderot, dépense considérable qui m'attira encore plus chez les De Fierville, où on me considérait comme un fils.
Je ne flairais pas le piège. Ma mère s'y montra particulièrement habile, le vieux marquis complice, et Éléonore consentante. Il suffisait que j'évoque un livre pour que le père d'Éléonore l'achète. Madame de Genlis était alors un auteur à la mode. Le duc d'Orléans l'avait choisie comme préceptrice de ses enfants, c'était exceptionnel, cette tâche étant traditionnellement confiée aux hommes. Elle prenait modèle sur les préceptes de la Grèce antique, le jeune prince2 savait scier une planche, construire un mur de brique, lire Xénophon dans le texte et tant d'autres choses. Il en était tout autant pour l'éducation des princesses, "mens sana in corpore sano". Une telle lecture me passionnait et je m'étonnais, sans oser le dire, que l'éducation intellectuelle d'Éléonore soit assez négligée. Elle préférait l'équitation aux arts d'agrément, aurait été bien en peine de tirer la moindre mélodie de la harpe de sa mère ou du clavecin, ne lisait jamais, était incapable de citer un auteur, et, chose surprenante, n'était pas coquette. Rubans et dentelles la laissaient indifférente.
Si je me sentais bien à Fierville, je savais que je n'y étais pas à ma place. Éléonore était très courtisée. Outre sa beauté, qui s'affirmait de jour en jour, elle était l'une des six plus riches héritières de Saintonge. Quand je regardais avec envie les riches collections de son père, elle me disait d'un air malicieux que cette immense bibliothèque aux cinq mille volumes, les quarante tomes de l'Encyclopédie, le château et les terres qui l'entouraient, tout appartiendrait à son futur époux puisqu'elle était fille unique. Je ne me sentais pas concerné.
Trois années s'écoulèrent. Les De Fierville avaient de très belles écuries, Éléonore aimait les longues promenades dans nos deux domaines, son père me priait de l'escorter. C’était l’occasion de charmants apartés, hélas, nous n'avions pas grand-chose à nous dire. Éléonore n'aimait que sa carabine, son cheval, ses futaies, inspecter ses fermes, ses métairies et étudier les livres de compte de son père, dont la santé déclinait. « Ad astra per aspera », répétait l'un de mes vieux professeurs, « jusqu’aux étoiles par des sentiers ardus. » En guise d'étoiles, mon paradis portait un nom, la bibliothèque des De Fierville, c'était devenu mon second foyer. Je m'y réfugiais quand le vieux marquis avait des visites, et qu'Éléonore devait se tenir à ses côtés pour les recevoir. Tout se sait dans les petites provinces, y compris que la seigneurie des De Fierville allait sous peu tomber en quenouille. Ces visites étaient celles de prétendants. Le plus âgé avait quarante-huit ans. Marquis de la Coudraye, il était aussi riche, voire plus, que les De Fierville. Le plus jeune était comte, il s’appelait Perreau de la Franchère et était écuyer du roi. Monsieur De Fierville leur faisait bon accueil alors que sa décision était prise. De tous ceux qui gravitaient autour des jupes de sa fille, un seul avait retenu son attention. J'étais de plus en plus fréquemment au château, ma conversation était appréciée. Je me montrais intarissable dès qu'on me demandait mon avis, j'en avais un sur tout, comme c'est souvent le cas quand on a beaucoup lu. Éléonore appréciait ces moments. Installée dans une bergère, ses grands yeux noirs posés sur moi, elle m’écoutait discourir sur le grand commerce colonial, l’esclavage, le droit des femmes, la monarchie, l’Église, les inégalités. Son père ne refusait aucun sujet et s’amusait de mes emportements quand je citais Titus Manlius Torquatus en le comparant à Louis XVI, ils étaient rares les petits nobliaux de campagne aussi instruits que moi. Il voulait pour sa fille un époux exceptionnel, il l'avait trouvé, et en plus c'était un être parfaitement modeste et désintéressé.
J'étais sans doute le seul de toute la contrée à ne pas courtiser Éléonore. Outre la mésalliance, dont j'étais parfaitement conscient, je n'avais aucun état. Je pensais donc que les De Fierville ne voyaient en moi qu'un gentil voisin, agréable, un peu dilettante, dont la jeunesse et l'enthousiasme réchauffaient leurs vieux jours.
Le manège d'Éléonore écartant ses prétendants était intéressant à observer. Avec eux, elle était réservée, froide, et taisait toujours ce qu'elle pensait. Quand on la pressait de s'exprimer, elle était d'un grand pragmatisme, réaliste, logique, choisissait ses mots et ne s’exprimait qu’après avoir beaucoup réfléchi. Avec moi elle était plus spontanée, surtout quand nous étions seuls pour nos promenades à cheval quasi quotidiennes. Ces propos devenaient répétitifs. « Comment trouvez-vous notre étang, Edmond ? » Il était grandiose, c'était presque un lac. « Mon père en est très fier. Avez-vous remarqué qu’il jouxte vos terres ? Ce sera ma dot, ainsi que les bois qui le bordent. Puis à la mort de mes chers parents, que je souhaite le plus tard possible, tout reviendra à mon époux. » Pourquoi parlait-elle tout le temps de son mariage alors que les prétendants se bousculaient, et qu'elle les repoussait tous !
Éléonore avait désormais dix-sept ans. Sa beauté s’était affirmée, soulignée par son absence totale de coquetterie. Elle était fraîche, naturelle. J'appréciais son air grave, réservé, les regards prudents qu'elle posait sur l'aréopage en perruque poudrée qui lui tournait autour. Dès qu'elle pouvait se libérer, elle sautait sur son cheval et galopait jusqu'aux Gonds. Elle s’entendait à merveille avec toute la maisonnée. Des phrases telles que, « j’en ai discuté avec votre mère, elle m’approuve », revenaient très souvent. Elle s'intéressait même à la gestion de ma petite seigneurie, discutait avec mon régisseur, Probus Lemoine, et m'admonestait sans complaisance. « On vous vole. Probus a constaté des coupes sauvages dans vos forêts, des traces de pâturage et même de braconnage. Il faudra mieux surveiller vos terres. » Pourquoi ce futur, là où un conditionnel était attendu ? Cela ressemblait à une injonction, un ordre. Étions-nous devenus intimes à ce point ! Il faut croire que oui, car les reproches s'accumulaient sur ma tête. « Mon bien est mieux surveillé que le vôtre. Je m’y emploie puisque mon père n’a pas d’héritier mâle et qu’il est valétudinaire. Vous devriez passer moins de temps dans notre bibliothèque et avoir plus souvent cul-en-selle. Ce ne sont pas les livres qui nourrissent le seigneur, mais bonnes terres et bons troupeaux. » Quand je lui répliquais qu’elle ferait mieux de penser à son mariage, elle me répondait qu'elle y pensait, et même beaucoup.
J'atteignais mes dix-neuf ans quand ma mère décréta qu'il était temps de renouveler entièrement ma garde-robe, dépense considérable dont je m'étonnai. Elle me répondit qu'Éléonore serait particulièrement élégante le jour de son mariage. Je ne vis pas le rapport. L'explication me laissa sans voix.
⎯ La santé de monsieur de Fierville décline, il veut établir sa fille au plus vite. Éléonore apporte en dot deux belles prairies, une forêt, un étang à carpes, et trois pièces à labours. Elle vous connaît depuis toujours et vous apprécie. J’ajoute qu’elle n’est ni laide ni sotte et qu’elle possède le caractère qui vous manque. Vous allez l’épouser.
⎯ Nous sommes en tout inférieurs aux Fierville, comment pourraient-ils souhaiter une telle union !
⎯ Ils la souhaitent.
⎯ Même l'orgueilleuse Éléonore ?
⎯ J'en ai parlé avec elle. Elle souscrit pleinement à ce projet. Elle vous aime et vous l’aimez.
Comment pouvait-elle l'affirmer ? Éléonore était splendide, certes, mais je n’avais aucune envie d’être inférieur à ma femme. S'il n'y avait que ça ! Ma walkyrie vendéenne me donnait sans cesse des ordres. « Edmond, je vais me promener, accompagnez-moi. » Quoi que je fasse elle m'accablait de reproches. « Edmond, ôtez cette dentelle, vous ressemblez à un coq de basse-cour. »
⎯ Éléonore n’est pas que riche, elle est intelligente et belle. Elle a les hanches larges des femmes fécondes. Elle vous donnera de beaux enfants qui perpétueront notre lignage. Ce mariage est inespéré.
⎯ Elle ne m'aime pas. Elle choisit la facilité.
⎯ Oh que si, elle vous aime, mais vous êtes trop niais pour l'avoir compris. Éléonore est l’épouse qu’il vous faut. C’est une femme de tête, vous qui en manquez tant !
Trois jours plus tard nous étions agenouillés devant l’autel. Toute la province était là. Éléonore me jetait de petits regards possessifs. Je n'arrivais pas à croire qu'on puisse ainsi disposer de ma vie. Si j'épousais cette femme, dont la beauté ne faisait aucun doute, s’en serait finie de la liberté. Éléonore avait elle-même négocié sa dot, arpents, forêts, métairie, étangs, rien n'avait été omis, elle s’achetait un mari comme d’autre un habit, et ce mari, c’était moi. Tout était allé trop vite. J'asphyxiais. L’échange des consentements approchait. Je voyais fuir ma jeunesse, cette merveilleuse vacuité du corps et des sens. Éléonore deviendrait la geôlière d’une prison dorée. Je ne voulais pas vivre en cage. L'évidence franchit malgré moi le rempart de mes lèvres. « Je ne veux pas vous épouser. » Ce n'était qu'un murmure. Éléonore répondit sur le même ton. « Il est trop tard. Ne faites pas l'enfant. » Toute l’assemblée priait pour notre bonheur, la moitié de la noblesse de Saintonge était là. Jamais la petite chapelle n’avait été aussi remplie. Dehors, tous nos paysans, ensabotés de neuf, endimanchés et enrubannés, se préparaient à nous acclamer. Un mai3 avait été planté devant l’église, il était ébranché à l'exception de sa cime d'où pendait une couronne de fleurs. Probus avait fait construire un pont fait d'une simple planche, il symbolisait le ruisseau que nous allions franchir pour commencer une nouvelle vie. Le vielleux attendait. Même les fusils étaient là. Plus nombreux seraient les coups tirés, plus abondant serait le lait de la mariée quand elle deviendrait mère. Éléonore était vêtue d'une ample robe blanche laissant apparaître un jupon finement brodé. Un châle en dentelle couvrait ses épaules. Son corsage, décoré de perles, mettait en valeur sa poitrine. Je la trouvais désirable, le piège se refermait. Le prêtre avait appelé l’assistance à se recueillir. Le petit orgue jouait en sourdine. Personne ne nous regardait. Je pensai à Plutarque, à ces hommes illustres par leur courage et leur détermination. Je murmurai. « Je vais partir. » Éléonore eut une parole malheureuse.
« Vous n'oserez jamais, pensez à ce que dirait votre mère. » Elle n'eut pas le temps de réagir.
2 C'est madame de Genlis qui éleva le futur roi Louis-Philippe. Cette éducation, très proche du peuple, lui rendit les plus grands services, non seulement pendant la révolution, mais lorsque les évènements de 1830 lui permirent de s'emparer du trône.
3 Arbre de la mariée.
3 Courriers
Le scandale fut d'autant plus immense que personne ne comprit rien à ce qui s'était passé. Je fus traité de fou, ma famille devint la risée de la province et le vieux marquis tomba gravement malade. On loua la conduite d'Éléonore, on la plaignit, on admira sa réaction quand elle s'était retournée devant toute l'assemblée et n'avait prononcé que trois mots, « rentrez chez vous. » Personne ne savait où j'étais, sauf peut-être ma fiancée, mais elle était trop fière pour m'envoyer chercher. Sautant sur le premier cheval venu, j'avais galopé d'une traite jusqu'à Saintes et m'étais réfugié dans mon ancien collège. Le principal m'avait longuement écouté et blâmé. J'avais trahi tout le monde, à commencer par les de Fierville qui me traitaient en fils, ma mère, que j'avais elle aussi abandonnée alors que c’était une femme âgée, et surtout Éléonore, une jeune fille admirable. Il n'y avait qu'une solution, je devais m'éloigner, partir très loin. Il y avait moult collèges jésuites dans le royaume, avec mon niveau d'étude, je trouverais sans peine un poste de régent4, mais il me déconseilla Nantes et Bordeaux, trop proches, et me proposa Paris. Il poussa la gentillesse jusqu'à me donner une lettre de recommandation, et avança la somme nécessaire pour le voyage. L'idée de devenir régent ne me disait rien, pourtant il fallait vivre, me loger, manger, et réfléchir à un avenir bien compromis par ce qui m'apparaissait de plus en plus comme un coup de folie.
Paris me déplut au premier regard. La saleté y était omniprésente. Un large ruisseau coupait chaque rue en deux. À la moindre averse, les Parisiens dressaient des sortes de ponts minuscules de manière à rétablir la communication entre les deux côtés. On voyait des bourgeois en perruque à trois marteaux5 sauter ce ruisseau fangeux et courir sur la pointe du pied de peur de souiller leurs escarpins, puis regarder à droite et à gauche à la recherche d’un décrotteur qui œuvrerait pour un sol, et ne laisserait que quelques mouches sur leurs bas blancs. À cela s’ajoutaient les encombrements. Les voitures légères dépassaient chariots, fourgons, voitures de place et berlines, à grands coups de fouet. Acculé contre le mur, je les regardais passer en trombe, chaque cocher criant « gare, gare » sans se soucier d'être entendu. À toute heure et pour les situations les plus diverses, on voyait passer de lourdes turgotines6, des maîtres en fait d’armes dans un diable7 attelé d’un cheval fougueux, de grands seigneurs courant à six chevaux comme s'ils étaient en rase campagne. Les humbles vinaigrettes8 se glissaient entre les carrosses. Des cavaliers impatients gagnaient les remparts9, manifestant leur mauvaise humeur quand la foule, qu'ils éclaboussaient, retardait un peu leur marche précipitée. J'eus toutes les peines à rejoindre la rue Saint-Jacques au milieu d'un tel tohu-bohu.
Le principal du collège de Clermont portait le nom amusant d'abbé Poignard. Il testa mes connaissances, mais ne put rien me promettre, si ce n'est le gîte et le couvert pour quelques jours, et me confia au père préfet qui me donna un groupe de dix élèves. Je les aurai sur les bras du matin au soir, dortoir, chapelle, études, réfectoire, promenades. Bien sûr je connaissais ce genre de vie, mais comment ne pas comparer avec la douce Saintonge ! Je m'aperçus avec surprise qu'Éléonore me manquait. Que devenait-elle ? Le principal du collège de Saintes tiendrait-il sa promesse d'aller voir ma mère ? Comment reconstruire une vie que je m'étais employé à briser ?
Je dormis mal, et pas seulement par le sentiment de la faute que j'avais commise. Éléonore me semblait moins redoutable et mon attitude puérile. Les jours suivants furent un cauchemar. La nuit, c'était les charrois, au petit matin, les milliers de coqs de la capitale, puis les porteurs d'eau, la crieuse de vieux chapeaux, le marchand de ferraille, de peaux de lapin, la vendeuse de marée. Tous chantaient leur marchandise sur un mode haut et déchirant. Leurs cris discordants étaient totalement inintelligibles pour un provincial, mais pas pour la pratique, capable de distinguer du quatrième étage et à l’autre bout de la rue, si l’on criait des maquereaux ou des harengs frais, des laitues ou des betteraves. Comment s’y retrouvaient-ils dans cette cacophonie de voix aigres et perçantes, surtout que leur gosier surmontait le bruit et le tapage des carrefours ! J'étais installé dans mon collège depuis une dizaine de jours quand deux lettres arrivèrent. La première n'était pas celle d’une fiancée trahie, mais une analyse lucide de la situation, assortie d’un pardon conditionnel.
Fierville, ce 16 avril 1785
Edmond
Pourquoi avez-vous fui ? Joindre votre existence a la mienne est-il si terrible ? Suis-je effrayante ? Pouvez-vous me reprocher d’être lucide, réaliste, d’avoir le sens du devoir, une absence totale de coquetterie ? M’auriez-vous préférée légère, minaudante, superficielle ? M’en voulez-vous parce que c’est moi qui vous aie choisi ? Est-ce humiliant ? Placez-vous votre honneur au-dessus du désir d’une femme d’être heureuse avec vous ? Aurais-je dû prendre l’initiative de vous courtiser alors que c’est le rôle de l’homme ? À toutes ces questions, je n’ai pas de réponses si ce n’est que je vous aime réellement, ce que ma pudeur m’a empêché de vous dire, et que je suis profondément malheureuse.
Au-delà de cette épreuve, j’ai essayé de vous comprendre et mené une réflexion solitaire. Vous n’appartenez pas à la catégorie méprisable des jeunes gens qui jettent leur gourme avant de se couvrir des chaînes du mariage. Vous êtes sensible et profond, l’homme que je souhaite pour époux. Vous voyez Edmond, je vous ouvre mon âme, je vous écris les mots que j’aurais dû vous dire plus tôt, mais était-ce à moi de le faire ?
Nous sommes très jeunes tous les deux, je peux attendre. Mais je ne suis pas Pénélope, filant et tissant pendant vingt ans. Je vous offre une année de réflexion. Je prendrai soin de votre mère, de votre bien, et si enfin vous revenez prendre votre place, vous ferez de moi la plus heureuse des femmes.
Éléonore
Curieuse lettre, que je relus plusieurs fois avec des sentiments divers. D'abord le soulagement qu'on m'accorde un pardon immérité, puis une forte admiration. Éléonore était prête à affronter le regard de toute une province par amour pour moi. Dieu qu'elle était forte, et comme je lui étais inférieur ! C'était insupportable. Je voulais être un prince pour celle que j'épouserais, celui qui la protégerait et la guiderait sur le périlleux chemin de la vie à deux, pas un prince consort. De même, l'espèce de mise en garde contenue dans le dernier paragraphe m'agaça. J'ouvris la seconde, elle était brève et contenait une information précieuse.
En votre château des Gonds, ce 16 avril 1785
Mon fils,
Vous êtes un fou. Vous vous êtes déshonoré. Vous avez humilié la plus douce, la plus innocente des créatures, mais je n'ai que vous et il me faut faire avec. Je viens d'avoir une longue conversation avec celle qui se considère encore comme votre fiancée. Nos deux courriers partiront ensemble. Voici ce dont nous avons convenu. Éléonore vous offre une année de réflexion, elle a tort, c'est trop, mais enfin je respecte sa décision. Vous avez fui sans un sou, allez vous passer cette année de rédemption à donner des cours de latin ? Probus me conseille de vous envoyer de quoi vivre dignement. Cela se fera par l'intermédiaire d'un notaire. Vous vous présenterez rue des Fontaines chez maître Piranesi, il vous donnera une avance sur le montant de vos fermages. Pour moi, je vais fermer le château et aller vivre chez votre sœur aînée, en attendant que votre cervelle rejoigne son nid.
Votre mère.
PS : Vous ne vous étonnerez pas, Éléonore souhaite participer elle aussi à l'amélioration de votre quotidien. Vous recevrez donc plus d'argent que vous n'en méritez. Faites-en bon usage, et remerciez Dieu de vous avoir fait rencontrer une femme exceptionnelle pour future épouse.
Ainsi, on achetait mon retour, avec le cortège d'humiliation que cela supposait. Avais-je le choix ? Le coût de la vie était beaucoup plus élevé ici qu'en Saintonge. Ma mère avait raison sur un point, je n'étais plus un enfant, être régent de collège m'insupportait. Puisque j'étais condamné à lier ma vie à une femme qui m'aimait, certes, mais à la façon d'une mante religieuse, autant m'offrir les plaisirs de la capitale avant d'entrer en religion conjugale. Je pris la plume en ces termes.
Paris, ce 29 avril 1785
Chère Éléonore,
Je ne cherche pas d'excuse à mon comportement et vous dois la plus extrême sincérité, elle tient en peu de mots, je suis indigne de vous, et je l'étais bien avant l'affront que vous avez subi par ma faute. Que nous ayons grandi ensemble n’efface pas les différences. Un petit baron ne lève pas les yeux sur la fille d'un marquis cinq fois plus riche que lui. Quand vous évoquiez votre dot, les espérances de celui qui deviendrait votre époux, je ne me suis jamais senti concerné. Les mariages sont des alliances entre deux familles de même rang, ce n'est pas le cas. Je n'ai rien à vous offrir, pas même mon amour, car je me suis toujours interdit de lever les yeux sur vous. Tout a été trop rapide. Je ne sais à qui en revient la faute, néanmoins mon devoir est de rentrer en Saintonge. Quand j'aurai réussi à redresser ma conscience pour qu'elle soit aussi droite que mes jambes, je reviendrai, et puisque vous m'accordez votre pardon, je serai l'époux que vous appelez de vos vœux. On en rira. Je ferai front, au besoin l’épée à la main.
Edmond.
Redresser ma conscience et m'offrir les plaisirs de la capitale n'étaient pas antinomique. Je n'étais pas un libertin, j'avais des goûts simples, à l'image de mes lectures. La première volupté que je m'offris fut un logement confortable. Je choisis la rue Courtau-Vilain, car son éloignement du centre faisait baisser les prix. Une jeune et jolie veuve, prénommée Isabelle Martinot, m'offrit pour une somme raisonnable un appartement de trois pièces en enfilade donnant sur la rue. N’aimant en rien le désordre, je les tenais propres et bien rangées. Elle m’en complimentait avec des sourires aguicheurs, et montait sous le moindre prétexte pour s’enquérir de mon bien-être, tout en multipliant les œillades assassines.
Logé, disposant d'un revenu modeste mais donnant accès à l'oisiveté, mon premier réflexe fut de visiter toutes les bibliothèques de la capitale. Puis je musardai dans les beaux quartiers, admirai les hôtels de la noblesse, et me présentai, à tout hasard, dans celui de monsieur de Ponthièvre. À ma grande surprise, le marquis se souvenait très bien de mon père, son ancien aide de camp pendant les campagnes en Bavière sous feu Louis XV. Il me garda à souper, écouta le récit du voyage en Bazois, et offrit de m'ouvrir des portes. C'est ainsi que je commençai à fréquenter le salon de Madame de Vez, jolie personne qui trouvait son bonheur dans la musique. Elle venait d’acquérir un piano-forte, instrument dont la sonorité changeait agréablement du clavecin. Madame de Vez jouait Mozart, les autres invités apportaient flûtes et violons, je barytonnais volontiers, mon éducation me permettant de lire la musique.
4 Surveillant.
5 Trois rouleaux latéraux.
6 Diligence chargée des messageries royales.
7 Espèce de calèche étroite à deux roues que l’on conduit debout.
8 Sorte de chaise à porteurs équipée de deux roues.
9 Nom impropre donné par les Parisiens au mur des Fermiers généraux. Il n’était pas destiné à la défense, mais à la perception de l'octroi. Cinquante-sept portes, gardées, permettaient d’entrer et sortir de Paris. Il fut détruit en 1860.
4 Corbinien
Aimant la musique, il m'était impossible de ne pas aller au moins une fois à l'opéra. Il y en avait plusieurs, je choisis celui de la Montansier. Ce fut un enchantement. Je guettais les œillades, le froufrou des soieries, admirais de ravissantes déesses qui semblaient tout droit descendues de l’Olympe et me regardaient en souriant, supputant le poids de ma bourse, et m'éconduisant de rires joyeux. En bon provincial, je ne compris pas tout de suite que j'arrivais à la fin d'une répétition. Le public clairsemé n'était composé que d'admirateurs, d'amants, et de petits maîtres à la recherche d'une aventure. Vrais ou faux, les gilets endiamantés attiraient les regards. En réponse, les jolies soubrettes gonflaient leurs jeunes poitrines. Soudain une dispute éclata.
⎯ Retirez ce mot ou vous êtes mort, rugissait un militaire à belle moustache.
⎯ Mot, quel mot ? Vous faites bien l'important !
⎯ Vous m'avez traité de "népenthès", je n'ai jamais ouï une telle insulte.
⎯ Je n'en doute pas.
⎯ Retirez ou je vous rentre ma lame dans la gorge.
⎯ Encore faudrait-il que vous y parveniez !
L'homme qui avait parlé ainsi était aussi jeune que moi. Grand, maigre, la main négligemment posée sur le pommeau de son épée, il semblait très sûr de lui. Le militaire avait une voix ridiculement haute. Le ton montait. Il avait reculé de trois pas et sorti son épée. Le jeune indifférent avait fait de même, mais plus calmement et en esquissant une moue dédaigneuse propre à narguer son adversaire, ce qui réussit car l’autre vitupéra de plus belle, toujours avec sa voix de fausset. C’était un hercule, le contraste était donc surprenant.
⎯ Je vous ferai voir si je suis un "népenthès".
J'éclatai de rire, m'avançai et tentai de calmer le jeu.
⎯ Mais enfin monsieur, ce n'est pas une insulte, c’est un mot grec qui se traduit par "qui dissipe la tristesse."
⎯ En un mot que vous êtes grotesque, rajouta son adversaire. Quelque part un rire fusa, l'auteur en était une ravissante jeune personne, en justaucorps mauve de danseuse, la poitrine étroitement serrée dans un corselet rouge qui faisait ressortir la naissance de deux jeunes seins appelants les caresses.
⎯ Est-ce l'objet de la querelle ?
⎯ Oui, mais apparemment ce militaire, aussi épais que sa voix est ridicule, confond les cantinières et les demoiselles d’opéra. Ses Lettres se limitent à peu de choses puisqu'il s'offense de mots qu’il ne connaît pas. Je vais lui enseigner le beau langage à l'encre rouge, grâce à cette plume-là.
Ce disant, il se mit en garde lui aussi.
⎯ Butor, répliqua le militaire qui fendit sans prévenir.
⎯ Enchanté, moi, c'est monsieur de Vigneules.
Le Vigneules en question para facilement l'épée de son adversaire, dont il agrippa au passage le poignet qu'il immobilisa, preuve d'une poigne de fer. Toute la salle applaudit. Il changea de ton.
⎯ Nous ne sommes pas sur un champ de bataille, et vous semblez ignorer les civilités de l’escrime courtoise, je vais donc vous les enseigner. On commence par enlever son feutre.
Il fit voler celui de son adversaire. Le militaire recula, furieux et humilié.
⎯ Faquin.
⎯ On ne s’insulte pas, ce sont les valets qui ont recours aux invectives, les gentilshommes se saluent.
Il eut un geste large en direction de son adversaire et de l’assistance, qui apprécia.
⎯ Comédien !
⎯ La comédie est un art, mais l’art vous est inconnu bien sûr, j’ajoute que vous offensez notre beau public.
Les demoiselles saluèrent, joli spectacle pour qui aiment les seins palpitants prêts à jaillir du corset qui les met en valeur.
⎯ Je vais te larder comme un dindon.
⎯ Dindon ? Je n’aime pas la violence, mais vous exagérez et je vais vous corriger comme vous le méritez. Abusus non tollit usus, ou si vous préférer, l’abus n'empêche pas l'usage.
Je ne pensais pas que tout irait aussi vite. Une charge brutale, un enrobé du poignet, une arme qui vole dans les airs et tombe à côté de moi, la fureur de l’autre, ses hurlements de rage, et le voilà qui se précipite pour reprendre son arme. Je pose le pied dessus pour l’en empêcher, tout cela ne prit que quelques secondes. Ce fut à mon tour d'être insulté.
⎯ Rends-moi mon épée, coquin, sinon je jure que je ne t’oublierai pas.
⎯ Quo quisque stultior, eo magis insolescit.
Vigneules traduisit pour l'assistance.
⎯ Plus un homme est stupide, plus il est insolent.
L’autre nous regarda, aussi ahuri qu’imbécile.
⎯ Vous êtes médecins ?
⎯ Je fais des saignées en effet, répondit Vigneules, qui allait devenir mon meilleur ami. Voulez-vous que je guérisse votre apoplexia ?
Il était temps de faire cesser cette querelle. Je me tournai vers la jeune fille.
⎯ Soyez juge.
Elle ne manquait pas d’esprit.
⎯ Eh bien moi, messieurs, je ne vous oublierai ni l'un ni l'autre, mais je vous supplie de vous réconcilier sur-le-champ. Monsieur le capitaine est beaucoup trop bel homme pour avoir besoin d’un langage aussi savant. Quant à vous monsieur l'intellectuel, vous êtes trop difficile à comprendre. Réconciliez-vous, je l'ordonne, j'embrasserai celui qui fera le premier geste.
Le militaire fut le plus rapide, il tendit une main dont Vigneules se saisit à regret, puis ils se donnèrent une sorte d'accolade. La belle offrit un baiser et tout rentra dans l’ordre, en apparence, car le militaire fila droit au Grand Châtelet où officiait un commissaire plein de zèle, Salgard. Je m'approchai, attendant une sorte de remerciement. Vigneules n'en fit rien.
⎯ N'était-ce point dangereux de risquer votre vie pour un simple mot ?
Il parut surpris et m'envisagea gravement.
⎯ Qui vous dit que je risquais ma vie !
Corbinien était vicomte, ce titre était sa seule richesse avec cette très belle épée qu’il tenait de son père, mystérieusement assassiné quand il était encore jeune. Cela nous faisait un point commun. Son nom complet était Corbinien Achille Bertin de Vigneules-la-Hire. Il possédait dix-huit quartiers de noblesse, ce dont il était très fier, était chevalier de Malte et vivotait à Paris. D'origine bourguignonne, il possédait là-bas encore quelques terres entourant les ruines d’un château. Avoir un ami, c'est commencer une nouvelle vie, ce fut le cas.
Pour modeste qu'il fût, mon revenu me permettait de profiter de ces quelques semaines ultimes de liberté. Je me levais tard, donnais à ma toilette le temps nécessaire, sans excès car mon portemanteau10 expédié par Probus ne me laissait qu'un choix raisonnable. J'aurais pu facilement l’étoffer en allant chercher quelques regrats11 chez les fripiers, mais comme Corbinien je m'y refusais. « Change-t-on de colonne vertébrale quand on a mal au dos ! » disait-il en ajoutant, « l'idée de souiller mes assises de la sueur d’un autre m'est abominable. » De fait, il n'avait qu'un seul habit, son titre et cette flamberge quasi historique puisqu’elle avait sauvé la vie de son père lors d’un duel resté fameux en Bourgogne. Le tout lui tenait lieu de richesse. J'étais mieux pourvu. J'avais deux paires de bottes, l'une de cavalier en bon cuir bouilli, l'autre vernie et à boucles d’argent pour jouer les gentilshommes quand j'allais le rejoindre. Il aimait se promener aux Tuileries. On y rencontrait tout ce que la capitale comptait de jeunes beautés. La diversité des atours, les robes aux étoffes légères formant comme un parterre de couleurs quand on était en été (ce qui n'était pas le cas mais je le croyais sur parole), gaze, linon, rubans, coiffures audacieuses, tout cela était pour lui un sujet permanent de plaisir. Qu'en pensais-je ? Lui répondre fut pour moi l'occasion d'aborder avec lui la question des femmes. Cette conversation eut lieu au Café de Foy, c'est Corbinien qui l'entama.
⎯ Je pourrais facilement me marier. Elles sont nombreuses, les familles bourgeoises qui rêvent de faire de leur fille unique une vicomtesse, la dot me permettrait de reconstruire mon château. Cependant je m'y refuse. Ces gens-là sont vulgaires, nouveaux riches.
⎯ Et nous d’anciens !
⎯ Ne plaisante pas. La noblesse est menacée et je ne parle pas de privilèges, je n’en ai guère. Les bourgeois prennent nos places, nos châteaux, nos noms !
⎯ Tu préfères vivre aux crochets de l’ordre de Malte ?
⎯ En échange je donne des cours de latin. Mon rêve serait de rencontrer une jeune fille pure, mais riche, celle d'un petit baron cousu d'or.
⎯ C'est amusant car c'est mon histoire, à l'envers.
Je lui expliquai qu'Éléonore était la fille unique du marquis de Fierville dont les terres jouxtaient les miennes, que nous étions amis d'enfance, qu'on voulait me la faire épouser, que c'est elle qui avait tout organisé, tout prévu, tout planifié, sauf de m'en informer à l'avance, que je m'étais enfui le jour du mariage, que je savais que c'était une folie et que j'en avais honte. Corbinien se fit sentencieux.
⎯ Riche, très moche et avec un mauvais caractère, tu as eu raison de t'enfuir. Cave tibi a cane muto et aqua silenti12. Et en même temps, tu aurais dû te dire que quand une femme est affreuse, on lui fait l’amour dans le noir.
⎯ Éléonore n’est pas affreuse, elle est magnifique, brune, avec une chevelure noire de jais, des attaches fines, un buste à faire rêver la Montespan. Elle est mince, élancée, sportive, courageuse. Elle n’a peur de rien, monte mieux que moi, tire indifféremment à la carabine ou au pistolet sans jamais manquer son coup. Elle est intelligente, sérieuse, économe sans être ladre. Elle gère elle-même les biens de son père depuis que celui-ci est tombé malade. Elle le fait avec une autorité sur ses paysans dont je serais bien incapable, et pour clore le tout, c’est l’une des six plus riches héritières de Saintonge !
⎯ Riche, magnifique, mais qu'est-ce que tu fais là !
⎯ Tu épouserais une femme qui te domine en tout ?
Corbinien ne répondit pas tout de suite. Il laissa son regard errer dans la salle. Sans ma générosité, il se savait incapable de s'offrir le luxe de boire un chocolat dans un tel établissement. La lumière y était abondante, renvoyée par des miroirs aussi hauts que larges. Les soubrettes étaient ravissantes et la clientèle de bon goût. À ses yeux, il n'y avait qu’un seul fou dans l’assistance, moi, ce qu'il formula à sa façon.
⎯ Te rends-tu compte que tu viens de décrire la femme idéale ?
⎯ Je le sais. Je sais aussi que quand nous serons mariés, c'est elle qui gérera mes terres, s’occupera de mes gens, recevra ses amies, belle, fidèle, pendant que moi, dilettante, je me consacrerai tout entier à mes livres. Elle s'offre un animal de compagnie.
⎯ Donc, tu ne l'aimes pas.
⎯ Cela me serait facile, je la connais depuis l'enfance, nous jouions ensemble. Elle était déjà très belle dans sa robe de velours, avec une couronne de princesse en carton doré. Son jeu préféré était de me donner des ordres. « Chevalier, tuez-moi ce dragon et je vous offrirai mon cœur. » En guise de dragon, c'était un simple buisson de ronce dans lequel son foulard de soie s’était pris. Je me suis griffé jusqu’au sang. « Merci chevalier, mais pour avoir mon cœur il y a une autre épreuve, vous devez dompter Bucéphale-le-terrible. »
⎯ Elle commence à me plaire ton Éléonore.
⎯ Il s’agissait de la plus terrible biquette d’un de nos pauvres métayers, une noiraude avec des cornes redoutables. Elle m’a défié. « Vous avez peur, chevalier ? » J’y suis allé, la chèvre a rué, puis foncé tête baissée droit devant elle. J’entends encore la voix d’Éléonore, « chevalier, chevalier, revenez. »
⎯ Mais vous étiez enfants, alors, la suite ?
⎯ Des années de couvent, de rares sorties. Elle était mauvaise élève, ses bois lui manquaient. Je la voyais de loin en loin, elle devenait une très jolie jeune fille. Comment aurais-je deviné qu’elle m’aimait !
⎯ Idiot.
⎯ Mon père voulait faire de moi un militaire, m'endurcir. Ah ça, j'en ai pris des coups de plats d'épée ! À quinze ans, il m'a associé à une de ses missions, c'était d'ailleurs chez toi, en Bazois. Il espérait redorer notre blason en démasquant un faux noble. On l'a assassiné. J'ai repris mes chères études, mais quelque chose avait changé.
⎯ Elle avait décidé que tu serais son époux.
⎯ Je ne me suis douté de rien. Les beaux carrosses défilaient dans sa cour, un seul claquement de doigts et dix soupirants se présentaient, tous plus riches et plus titrés que moi.
⎯ Mais c'est toi qu'elle a choisi.
⎯ Et qu'elle est en passe d'enchaîner.
10 Comprendre "garde-robe";
11 Objets de seconde main.
12 "Prends garde au chien qui se tait et à l'eau qui dort."
5 La nostalgie est un poison lent
Cette conversation m'avait fait du mal. Était-ce seulement l'orgueil d'être inférieur à ma future épouse qui m'avait poussé à fuir ? Comment tenir tête à ma femme si elle tenait les cordons de la bourse, me laissant le rôle de simple géniteur de sa descendance ? Enfin, si je l'épousais, serais-je contraint d'habiter Fierville ? L'idée m'horrifiait. Je n'avais qu'une maison et ne voulais pas en changer, encore moins pour Éléonore dont le caractère ressemblait à celui de ma mère et serait vite étouffant, aussi belle et riche soit-elle. De mes trois sœurs, une seule avait réussi son mariage. Bernadette était devenue madame de Boisjollan, elle habitait le château de Beaufief, près de Saint-Jean d’Angély. Alexandrine était devenue madame Madaillan d'Estissac, elle vivait au château de Coulonges-sur-l'Autize, à côté de Fontenay-le-Comte, et portait plus de cornes qu'un troupeau entier. Pascale s'ennuyait auprès d'un époux aussi terne qu'une soutane de capucin. Toutes trois m'avaient sévèrement condamné. Connaissaient-elles l'étrange proposition d'Éléonore ? Assurément. Elles devaient attendre le retour du frère prodigue. Cicéron avait raison, ut fata trahunt, à quoi bon se révolter contre le destin ! Et Pétrone encore plus, carpe diem, à chaque jour suffit sa peine.
Rentrer après avoir épuisé toutes mes ressources serait leur donner un argument supplémentaire pour juger ma conduite. Je fis donc un calcul savant, choisis la date idéale, n'écrivis pas en Saintonge, et me fixai un ultime programme de réjouissances. Paris abondait en jardins ouverts au public. Outre celui des Tuileries, Corbinien adorait aller au Luxembourg. Je préférais les jardins à l'Anglaise où tout était fait pour se perdre, se dissimuler. Des artifices savants y créaient des cascades, de fausses ruines évoquaient des colonnades, des temples. Il y avait des collines, des grottes, des labyrinthes, de petits lacs. Il m'accompagnait aussi chez les libraires du Palais Royal. Des myriades de prostituées déambulaient sous les arcades, leurs œillades assassines invitaient à des plaisirs dangereux pour la santé. On y passait devant les plus belles boutiques de Paris, bijoutiers, marchands d'éventails, commerces de nouveautés. La mode changeait fréquemment. Rien n'égalait la gravité d'une fabricante à façon combinant des poufs, des gazes, des fleurs, pour faire naître une forme nouvelle dans l'édifice d’un bonnet, auquel elle donnait son nom.
Un autre plaisir que je regretterai était les boulangeries. En Saintonge, on ne mangeait que le pain cuit par Geneviève Curchod, un pain blanc certes, mais qui ne pouvait se comparer à celui des meilleurs artisans du monde. Les boulangers travaillaient la nuit. Quand le bois était rare, ils avaient le privilège d'être servis en premier, car il faut que le four chauffe avant la marmite. Leur boutique était ouverte à toute heure, la réverbération en éclairait la rue. Après leur travail, ils se mettaient sur le pas de la porte, quasi nus, blafards, enfarinés.
Enfin, ce qui me manquerait le plus serait la fréquentation des cafés. Il y a des cabarets en Saintonge, mais ce ne sont que des établissements grossiers, à l’image de leur clientèle. Rien de tel ici, les limonadiers vendaient toutes sortes de boissons, sorbets, orangeades, eau de fruits ou de fleurs, ratafias13 et autres liqueurs, sans parler de l’inénarrable café. Non seulement on y dégustait confitures, fruits confits, glaces, fromage blanc, massepain, macarons, bonbons et autres gourmandises, mais on y lisait les gazettes, on s'y livrait aux plaisirs du jeu, ou on y allait tout simplement pour observer les autres clients et participer aux conversations. Chez Foy se tenait une sorte d’académie où l'on jugeait les auteurs, les pièces de théâtre, on y assignait des rangs, des valeurs. Certains parlaient fort, ne ménageant pas leurs reproches, le plus impitoyable des critiques étant souvent un auteur méprisé. D'autres monnayaient leur talent en rédigeant lettres d’amour, demande d’argent, requêtes diverses. Ils écrivaient à grands coups de plumes, le geste large, la manche tachée d'encre, faisant tout pour se faire remarquer. C'est en les écoutant chercher le mot qui fait mouche, qu’ayant fait provision de salive, je me mêlais parfois de ce qui ne me regardait pas, donnant un conseil, corrigeant une tournure, et finalement me liant d'amitié avec certains. Je tutoyais Boyer d'Argens, payais les sorbets de Pinot Duclos, et affrontais en joutes orales François-Antoine Chevrier, qui, tout âgé qu'il fût, gardait l'esprit suffisamment clair pour avoir toujours le dernier mot. Corbinien m'écoutait, un sourire moqueur au coin des lèvres. Pouvais-je lui dire que ce qui est beau parlait à mon âme comme la bonne chère parle au ventre, un paysage à l'imagination, ou une bonne odeur à nos souvenirs. Virgile me faisait quitter Troyes en flammes. Salluste m'emmenait en Numidie traquer Jugurtha. J'accompagnais Rousseau en Suisse. Lire me faisait vivre en pensée des félicités dont j'étais le seul maître, plaisir infini et renouvelé au rythme des pages que je tournais. Rentrer en Saintonge, c'était retrouver une femme à la beauté sublime, certes, mais trop prosaïque, et qui allait me digérer avec la bénédiction de tous.
13 Liqueur composée d'eau de vie, de sucre et de certains fruits.
6 Bérénice
Je ne pouvais pas quitter Paris sans visiter Versailles. Corbinien s'offrit à m'accompagner et à me servir de guide. Entrer au château était facile, il suffisait d’être bien vêtu et de porter l’épée. Outre une foule de courtisans, dans laquelle je me sentis vite perdu, le décor, l'omniprésence des dorures, les lustres, les tenues extravagantes des femmes, la morgue des hommes furent vite fatigants. Déçu sans oser le dire, je priai Corbinien de me conduire jusqu'au hameau de Trianon. Il me répondit que c'était un domaine strictement privé, même la plus haute noblesse ne pouvait y pénétrer sans le "jeton" de la reine. Qu'à cela ne tienne, j'avais mon idée. Négligeant l'entrée principale, étroitement gardée, nous longeâmes les grilles jusqu'à un groupe de bâtiments complètement à l'opposé. C’est là que logeaient les jardiniers du roi, et parmi eux, le père de mon régisseur. Si Probus était devenu ce qu’il était, un être instruit, courageux et intelligent, c’est à Paul-Marie Lemoine qu’il le devait. Jardinier en chef, responsable des roseraies de la reine, fin latiniste, il nous reçut sans façon, nous fit visiter le domaine et accepta avec modestie une avalanche de compliments sur son fils. J'étais aux anges. Le lac artificiel, le temple de la musique, une grotte à mystère, un chêne multi centenaire, un joli petit hameau où des maisonnettes, dont une laiterie et un vieux moulin, se groupaient autour de la maison de campagne de la reine, c'était une vision de paradis que je ramènerai en Saintonge.
Je devais informer de mon départ maître Piranesi. Le notaire habitait rue des Fontaines, dans un immeuble cossu, tout en pierre, haut de trois étages. Dès la porte franchie, un escalier de chêne menait aux bureaux de l'office notarial. En Saintonge, j'étais un petit roi dans mon royaume, ici je n'étais rien. Chaque marche était le chemin de croix de ma pauvreté. Ma seigneurie rapportait sept à huit mille livres l’an, somme suffisante pour entretenir deux domestiques, trois servantes, quelques chevaux, chauffer mon petit château et nourrir toute la maisonnée pendant une année. J'avais déjà dépensé la moitié de cette somme. Piranesi me fit attendre, puis quelqu'un vint me chercher. Je me retrouvai en face d'un homme d'une soixantaine d'années qui m'accueillit d'un grand sourire.
⎯ Monsieur le baron, que puis-je pour vous ?
⎯ Je vais incessamment quitter Paris pour rentrer chez moi. Il faut donc que nous soldions mes comptes.
⎯ Soit.
Piranesi agita une petite clochette, un tabellion entra, il lui fit un signe, trois minutes plus tard l’individu revint avec un dossier modeste par sa minceur, mais sur la couverture duquel se lisait calligraphiée avec art, ″Seigneurie des Gonds". De la somme envoyée par Probus, il restait à peine trois cents livres. Je n'avais pas dépensé l'argent d'Éléonore. Devait-il me le donner ou le renvoyer à l'expéditrice ? Quelle humiliation ! Quel débat ! L'accepter, c'était renforcer ma soumission, ma mise sous tutelle. Le faire renvoyer, c'était blesser un peu plus une femme qui ne m'avait rien fait. Je lui répondis que je m'en chargerai moi-même. Il eut un petit sourire. Piranesi avait un coffre-fort, meuble volumineux venu d'Allemagne. Trois clés en ouvraient la porte, par précaution il en portait une sur lui, la seconde restait sur la porte du meuble pour faire comprendre au visiteur qu'il inspirait confiance, et la troisième, soigneusement cachée, lui donnait le temps de se ressaisir en cas de violences imprévues. L'argent fut soigneusement empilé, compté et recompté. Piranesi le mit ensuite dans une bourse prévue à cet effet et me la tendit, ainsi qu'un reçu et une invitation surprenante. « Monsieur le baron me ferait-il l'honneur de venir souper ce soir ?» J'acceptai sans savoir que le destin m'ouvrait une autre route, bien plus tourmentée que celle de mon retour en Saintonge.
J'arrivai à vingt heures sonnantes. Piranesi me reçut avec la superbe d’un homme riche, c’était lui le prince et moi le gueux. « Ces dames ne sont pas encore prêtes » dit-il en désignant un fauteuil dans lequel je m'installai. Mon regard parcourut l’élégant salon. Partout ce n’étaient que délicates porcelaines, dressoir en argent, rideaux de soie cramoisie, fauteuils, bergères, ottomanes. Un buste de Voltaire trônait au-dessus d’un bureau à cylindre, son sourire ironique semblait m’interpeller.