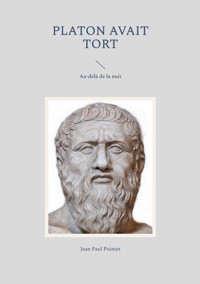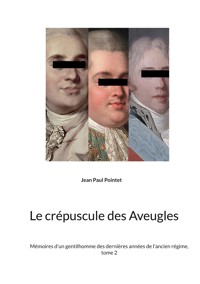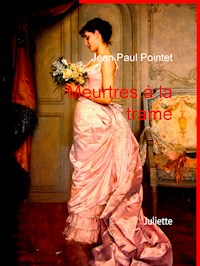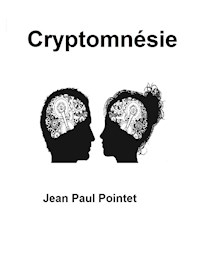Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mémoires d'un gentilhomme des dernières années de l'ancien régime
- Sprache: Französisch
Mémoires d'un gentilhomme des dernières années de l'ancien régime est une tétralogie qui s'adresse avant tout aux lecteurs exigeants, passionnés d'histoire, soucieux d'authenticité et qui aiment s'instruire, tout en lisant un bon roman. Elle s'adresse aussi à ceux qui aiment qu'une histoire se termine bien. Edmond-Alfé, chevalier de Sémontré et baron Des Gonds, n'est qu'un petit nobliau de campagne désargenté lorsqu'il entame, par son mariage, une ascension sociale qui le conduit jusqu'au Garde-Meuble royal dont il devient responsable en second. À ce titre, c'est lui qui est chargé de vider Versailles lorsque la famille royale est ramenée de force à Paris, en octobre 1789. La disparition de la censure favorise une intense vie intellectuelle, les pièces patriotiques se multiplient, contribuant à l'éducation politique des foules, des femmes d''exception émergent, les clubs politiques commencent à s'affronter alors que plane l'ombre de la guillotine. La bande noire des banquiers pille la France, Mirabeau tente de séduire la reine, les 48 sections parisiennes sont de plus en plus puissantes, Desmoulins crache son fiel, on s'interroge sur ces mystérieux chevaliers du poignard, qui ont juré de sauver Louis XVI. Fusillades du Champ de Mars, Prise des Tuileries, premières exécutions en attendant que la guillotine soit au point, arrestations, massacre des innocents, peu à peu l'enfer s'installe, alors que la santé de Bérénice décline.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
1. Prolégomène
2. Vider Versailles
3. Favras
4. Rue Saint-Florentin
5. Infamie et lâcheté
6. La bande noire
7. Des Tuileries à Saint-Cloud
8. Douloureux souvenirs
9. Charles IX
10. Deleyrant
11. Les Actes des Apôtres
12. De Saint-Cloud au faubourg Saint-Germain
13. Conséquences d'un déménagement difficile
14. Premières angoisses
15. Les brouettes du Champ-de-Mars
16. De Châteauvieux à Montmédy
17. Brutus, le rouge ou le noir ?
18. Éléonore change de vie
19. André Chénier
20. La mort du lion
21. Richelieu contre Saint-Germain
22. Lettre d'un jeune mécanicien
23. Voltaire sous la pluie.
24. Mars sanglant
25. Un royaume en reconstruction
26. Automne en Saintonge.
27. Un hiver difficile
28. La marche vers l'abîme.
29. La fin d'un monde
30. Le début des Temps obscurs
31. Chez les Rouges
32. En Enfer
33. Le massacre des innocents
1 Prolégomène1
Dix octobre 1789.
Cela faisait cinq jours qu'une troupe de femelles en furies avait envahi Versailles. Elles étaient suivies de tapes-durs, qui avaient enlevé le roi et sa famille. Depuis, le monarque était prisonnier dans Paris, et les députés se demandaient ce qu'ils devaient faire. Rejoindre le roi, c'était se mettre à la merci des révolutionnaires. Ne pas y aller, c'était abandonner le pouvoir à la toute puissante municipalité parisienne. Les avis divergeaient, le débat devenait houleux. Jusqu'à présent, les députés de l'Assemblée Nationale avaient mené la danse à contretemps, tant ils attendaient un geste du roi, dont personne ne comprenait l'attitude.
J'étais assis à la tribune, presque en face d'Éléonore. M'avait-elle vu ? Madame la marquise de Fierville était mariée depuis quelques semaines à peine. Elle avait choisi d'épouser son vieil oncle par alliance, devenant de là sorte comtesse de la Doussetière et de Dampierre. Que de titres dans une époque qui ne tarderait pas à les fouler aux pieds ! Je connaissais bien son époux. Monsieur de la Doussetière était un homme bon, paisible, n'aimant pas les remous. Il avait été élu, malgré lui, député de la noblesse de Saintonge aux états généraux. Homme de devoir, il entendait s'acquitter de sa tâche le mieux possible, hélas, une forte surdité l'empêchait de suivre les débats. Il se tenait dans la partie droite de l'Assemblée, le plus près possible du Président pour tenter de saisir au moins les réponses de celui-ci, Bailly, un homme honnête.
Suivant les yeux d'Éléonore, je ne pus m'empêcher d'admirer son époux, très élégant, aussi droit que le lui permettait son dos douloureux, attentif comme on peut l'être quand le sort du royaume se joue sous ses yeux. La situation était grave. Outre un gouffre abyssal dans les finances publiques, la vacance du pouvoir ouvrait la porte aux ambitieux. Beaucoup étaient dans cette salle, il était facile de les reconnaître. Les regards se tournaient constamment vers Riquetti2, le plus craint. Ambitieux, habile, le faciès d'un lion défiguré, jouissant d'une popularité surprenante pour un homme vénal, on le surnommait l'hercule de la Liberté. Il se voyait déjà gouvernant la France, mais pour cela, il fallait être à Paris. Il avait trois rivaux : Duport, l'homme des châteaux de sable, Barnave, à l'éloquence redoutable, et Lameth, un militaire. Ce "triumgueusat" de polissons, méchants, criants, intriguant, s’agitant au hasard et sans mesure, partageait avec lui la volonté de suivre le roi à Paris. Pour s'installer où ? La France n'était pas une monarchie parlementaire, pas encore. Déjà à Versailles il avait fallu improviser, d'où cette salle des Menus-Plaisirs, que j'avais aidé Ville d'Avray à installer. Quitter Versailles pour rejoindre le roi était une évidence, les mille deux cents députés savaient qu'ils devaient s'y résoudre, mais plonger dans l'inconnu ! Tous avaient présent à l'esprit l'égorgement des gardes du corps, dont le sang souillait encore les parquets du château d'un roi qui leur avait interdit de se défendre.
Dieu qu'elle était lourde à prendre cette décision, et voilà qu'un presque inconnu demandait la parole ! Je vis Ange Josnet décontenancé, il n'entendait rien. Là-haut, dans la tribune, Éléonore saisit son désarroi. Elle connaissait son rôle : prêter son oreille à celles défaillantes de son mari, afin que ce soir, elle puisse corriger ce qui lui avait échappé. Dieu qu'elle était belle, ma petite marquise ! Je savais qu'elle détestait la politique. Elle ne comprenait pas nos contemporains et se posait mille questions. Notre roi était animé de bonnes intentions, pourquoi rejetait-on systématiquement ses propositions, qui pourtant allaient dans le sens que tous souhaitaient ? Quel Dieu calamiteux avait envoyé sur le royaume ces circonstances climatiques désastreuses, provoquant, outre disette et chômage, un enchaînement de conjonctions qui avaient été autant d'occasions de ruptures entre le roi et son peuple, alors qu'aucun groupe politique n'était suffisamment structuré pour éviter que des milliers de désœuvrés soient la proie d'agitateurs de ruisseaux, comme ce Desmoulins qui ne bégayait plus quand il s'agissait d'appeler aux armes. Pourquoi cette obstination du clergé à ne pas payer d'impôts ? Pourquoi ce manque de détermination qui avait découragé les partisans du roi ? Pourquoi cette haine du duc d'Orléans, finançant secrètement les journaux les plus orduriers du royaume ? Pourquoi aucun des modérés, pourtant majoritaires et au milieu desquels siégeait son époux, n'avait-il prévu la rapidité des évènements, et encore moins la brutalité des affrontements ? Éléonore n'avait que vingt et un ans, et j'étais désespérément amoureux d'elle, alors que j'aimais tout autant mon épouse, qui venait de me donner un fils. C'est par désespoir qu'elle avait épousé monsieur de la Doussetière, et par désespoir que je m'étais jeté dans le combat politique, pour défendre un roi que je ne comprenais plus.
De quoi parlait l'orateur ? J'essayais de suivre et pris ces propos en chemin …
D'hier à aujourd'hui, l'exécution de la peine capitale a toujours différé selon le forfait et le rang social du condamné : les nobles étaient décapités au sabre, les roturiers à la hache, les régicides et criminels d'État écartelés, les hérétiques brûlés, les voleurs roués ou pendus, et, il n'y a pas si longtemps, les faux-monnayeurs se retrouvaient bouillis vifs dans un chaudron, soit une mort aussi lente que douloureuse. ….
La mort était un spectacle, les exécutions publiques une occasion de réjouissance, surtout si le bourreau était maladroit, ou si la victime tentait de résister. Une estrade permettait à chacun de bien voir, on louait à prix d'or les fenêtres, on commentait, on riait, on achetait des douceurs aux marchands ambulants.
… Je demande que désormais la loi soit égale pour tous, y compris quand il s'agit de la privation de la vie. Je demande aussi qu'il ne puisse être exercé aucune torture envers les condamnés, plus de roue douloureuse, plus de pendaison infamante, plus de décollation hasardeuse. Pour tous les malfaiteurs, la même exécution mécanique et instantanée qu'ils aient la tête tranchée à l'aide d'une machine si bien conçue qu'ils ne sentiront qu'un souffle frais sur la nuque. …
La formule eut un succès inattendu, toute l’Assemblée s’esclaffa. Il est vrai qu'il faisait très chaud en ce 10 octobre 1789, dans une salle où s'entassaient près de mille cinq cents personnes. Ce "souffle frais sur la nuque", tous en rêvaient : Camille Desmoulins, le talentueux journaliste qui n'avait que la haine à la bouche, Georges Danton, avec sa tête de Méduse, le poète Fabre d'Églantine, qui ridiculisait la reine dans ses chansons, Brissot, les yeux dans des nuages qu'il était seul à voir, Robespierre, l'homme qui avait rédigé le cahier de doléances des savetiers d'Arras, et qui cachait ses petits yeux faux derrière des lunettes bleues cerclées d'acier, et même le gros Louis Philippe d'Orléans, qui rêvait de prendre la place de son royal cousin et ne désespérait pas d'y parvenir. Tous riaient à gorge déployée, les lazzis fusaient … bravo Guillotin, vive la machine à rafraîchir … Ange-Josnet de la Doussetière essayait de comprendre la cause de cette liesse générale. Il se tournait à droite et à gauche, cherchant son épouse dans la tribune.
L'orateur ne s'attendait pas à un tel succès, il laissa les rires se calmer, et expliqua que Sa Majesté approuvait l'idée. Le roi avait étudié les croquis et proposé de judicieuses améliorations. Joseph-Ignace Guillotin était un homme sérieux, connu pour sa droiture. C'était l'un des rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme, dont le texte venait d'être gravé sur une plaque d'airain rangé dans un coffre de bois de cèdre, qui serait encastré dans la future colonne de la Liberté élevée sur les ruines de la Bastille. Il était natif de Saintonge, comme moi, et regorgeait de bonnes idées, comme la disposition en hémicycle de la future salle dédiée à la représentation nationale, dont le roi avait accepté le principe. Une telle disposition permettrait aux élus du peuple de se voir et de s'entendre. Pour en revenir à sa machine, il avait conclu en expliquant qu'elle n'était pas encore totalement au point, trois moutons en avaient fait l'expérience. Cela avait déclenché d'autres rires.
1 Longue introduction.
2 Mirabeau
2 Vider Versailles
Je fuyais Éléonore et elle me fuyait, c'était facile, mes fonctions m'écrasaient. Le château n'avait pas été nettoyé, tout partait à vau-l'eau, personne ne savait ce qu'il fallait faire. Dès le 7 octobre, Ville d'Avray, monsieur Thierry pour ses détracteurs, avait dû organiser de longs convois pour transporter le mobilier royal vers la capitale. Sa préoccupation principale était d’améliorer l’ameublement et la décoration des appartements des Tuileries, fort délaissés depuis des décennies. Il fallait procéder au transfert de nombreux éléments mobiliers, dessinés et réalisés pour Versailles, qu'il tenterait d’adapter à leur nouvelle destination. Vider Versailles, c'était transformer le château en sépulcre, il ne le supportait pas, et m'avait proposé de nous partager les tâches, lui à Paris, moi sur place. J'organisais et escortais les longs convois de mobiliers, tapisseries, tentures, vaisselles, vêtements qui partaient de Versailles pour Paris. L’entreprise était périlleuse, les attaques fréquentes, tout ce qui partait n’arrivait pas. Comme j'en étais responsable, et que le Garde-Meuble ne disposait que de peu de soldats, j'eus l'idée de protéger les voitures de couvertures bleues, semées de fleurs de lys, avec les trois couronnes en broderies, afin qu'en ces temps de pénurie, les gens mal intentionnés ne puissent imaginer qu'elles transportaient des vivres. Passant ma vie à cheval, je m'épargnais la souffrance de penser au désastre de ma vie privée.
De son côté, Ville d'Avray avait entrepris en urgence les premières réparations des Tuileries. Construit sous Catherine de Médicis, le palais n'était plus habité depuis 1722. Je ne connaissais pour ainsi dire pas ce long bâtiment, s'étirant autour de trois pavillons. Celui de Marsan était un peu sinistre. Le pavillon de l'Horloge, au centre, était coiffé d'un dôme. Mes préférences allaient au pavillon de Flore, au sud, d'abord parce qu'il donnait sur la Seine, mais aussi parce qu'il était relié au Louvre par une longue galerie où j'avais de doux souvenirs3. Le château comportait quelques appartements, un théâtre, et un pied-à-terre pour la reine, à ses retours de l’Opéra. La famille royale y était arrivée fourbue, après un voyage qui avait duré neuf heures. Elle s'y était entassée dans quelques pièces lugubres et inhospitalières, pendant que Monsieur et Madame gagnaient leur somptueux palais du Luxembourg. « Comme c’est laid ici, maman, » s’était écrié le dauphin, ce à quoi la reine avait répondu avec un certain humour, « mon fils, Louis XIV s’en contentait bien. » Les meubles que j'apportais étaient donc les bienvenus. Après plusieurs nuits de campement sur des lits de fortune, la reine avait retrouvé un semblant de confort. Le roi s’était attribué trois pièces au rez-de-chaussée, une chambre à coucher au premier étage, et un cabinet de travail. La reine s’était installée, elle aussi, au rez-de-chaussée, dans l’aile sud. Madame Royale et le dauphin couchaient au-dessus, à côté de la chambre de leur père.
Les convois que j'escortais, jour après jour, permirent d'aménager un appartement d’apparat, avec chambres de parade, un nouveau salon de l’Œil-de-Bœuf, des antichambres, ainsi qu’une salle de billard installée dans une partie de la galerie de Diane. En dépit de mes efforts et de ceux de Ville d'Avray, pour ceux qui avaient connu Versailles, c’était fort réduit. Madame de Tourzel, gouvernante de la jolie Marie-Thérèse-Charlotte de France, et du timide Louis-Charles, dauphin depuis la mort de son frère, prit possession des pièces voisines, qu'elle dut partager avec les gentilshommes de service et le personnel. Madame Élisabeth, sœur du roi, et la princesse de Lamballe, proche amie de la reine, transportèrent leurs malles dans le pavillon de Flore. Le palais était complet, Ville d'Avray dut loger les ministres en ville. Il me fit remarquer que pour la première fois, depuis Louis XIII, la Cour et le gouvernement étaient séparés. Ville d'Avray ne savait plus où donner de la tête, il lui fallait surveiller dessinateurs et orfèvres apportant leurs soins à la transformation des pièces d'argenterie nécessaires au service de la cour, étudier un projet de décoration des appartements des Enfants de France, veiller de près à la mise en œuvre d’un projet d’ameublement pour l’hôtel du ministre des Contributions du roi, et même s’intéresser à la nouvelle livrée des gardes Suisses ! À cela s'ajoutait la commande de nouveaux meubles, faire pratiquer des escaliers particuliers pour communiquer plus facilement entre les appartements royaux, installer un cabinet de géographie pour le roi, et surtout se faire ramener de Versailles le grand portrait de Charles Ier par Van Dyck. Ébranlé par les avertissements répétés de Malesherbes, le roi éprouvait plus que jamais le besoin de méditer sur l'effrayant destin de son lointain cousin Stuart.
De l'entourage de Leurs Majestés, j'étais le seul à retourner régulièrement à Versailles, donc à voir les dégradations inévitables qui avaient suivi le départ de la cour. « Tâchez de préserver mon beau château » avait dit le roi en partant, encore fallait-il en prendre les moyens. Il ne restait plus personne, à part quelques unités de Suisses, et le personnel du château, passé sous mes ordres puisque Ville d'Avray était à Paris. Modeste gentilhomme de Saintonge, j'étais devenu, par le poids des circonstances, le maître officieux d'une grande ruche royale aujourd'hui déserte. L'aurais-je cru quatre ans plus tôt, lorsque mon épouse avait giflé un grand seigneur pour défendre sa vertu ? Bérénice n'était pas encore devenue baronne, elle méprisait la noblesse, mais aimait se promener dans ce parc, à présent doublement engourdi des ombres automnales, et du départ de ses hôtes habituels. La reine, Monsieur et Madame, Madame Élisabeth, Madame de Tourzel, Madame la princesse de Chimay, les dames du palais, la suite du roi, le service ordinaire, tous étaient partis. Puis ça avait été la ruée éperdue de 1500 courtisans, dont certains avaient suivi le roi à Paris, la majorité préférant se réfugier en province. Les allées étaient vides. Le regard souriant des Bacchus, Daphné, Flore et autre Pomone laissait indifférent les curieux venus voir ce qu'il y avait à piller. Un état de dépérissement s’était emparé du domaine, les coupes sauvages se multipliaient, des arbres séculaires étaient abattus, leur souche extirpée. Les parterres étaient piétinés ou préparés pour être labourés ! On avait commencé à arracher les canalisations en plomb du bassin de Neptune. Les bains d'Apollon étaient souillés des orgies auxquelles s'était livrée la populace. Les dalles de la cour de marbre étaient menacées, ainsi que les grilles dorées. On parlait d'assécher le grand canal pour le rendre à l'agriculture. Les clés étaient volées. On vidait sans vergogne les magasins. L’or, l’argent, le vermeil, les galons, les franges et même le cuivre attiraient les convoitises, il se disait qu'il y en avait pour 2 millions de livres !
La ville de Versailles connaissait les mêmes affres, 2000 logements étaient sans locataires, les affaires des commerçants allaient très mal, charrons, voituriers, livreurs de bois, palefreniers, domestiques et autres métiers n'avaient plus de pratiques. La ville était ruinée, je ne pouvais rien faire. En théorie, c'était monsieur de la Tour du Pin, ministre de la guerre, qui aurait dû me donner les moyens de protéger au moins le château. Il avait d'autres chats à fouetter, et ne savait même pas combien de temps il garderait son poste. Versailles était comme le royaume, sans maître. Terrorisés, les rares domestiques restés sur place n'osaient pas se montrer. On pissait dans la galerie des Glaces, déféquait dans la chambre de la reine, et crachait sur les parquets. Il était temps que je quitte, moi aussi, ce lieu maudit. Juste avant de partir, je tombai par hasard sur François Gamain. Ville d'Avray détestait cet homme qui avait su capter la confiance du roi. Le serrurier était dans une forte expectative, Leurs Majestés reviendraient-elles, fallait-il rester ou partir ? J'étais bien en peine de lui répondre. Observant cette figure un peu veule, une remarque, faite en privé par Ville d'Avray, me revint en mémoire. « Quand le roi s'empare des ouvrages du peuple, c'est le peuple qui s'empare des ouvrages du Roi. » Était-ce déjà le cas ? En vérité personne n'en savait rien. Nous avions tous peur qu'une fois prisonniers des Parisiens, Leurs Majestés ne subissent des humiliations quotidiennes.
Ce ne fut pas tout de suite effectif, pour plusieurs raisons. Le peuple voulait jouir de sa victoire, et contempler ses otages dans leur cage dorée. Le roi le comprit et n'hésita pas à faire sa promenade quotidienne en public. Là où les malfaisants voyaient une forme d'abaissement, un moyen commode d'apostropher le souverain en déversant des griefs rancis, ils en furent pour leurs frais. Dès le matin du 7 octobre, de bonne heure, les Tuileries étaient pleines d’un peuple ému, affamé de voir son roi, Olympe au premier rang. Elle entendit les commentaires, qu'elle me rapporta. « Maintenant, tout allait s'arranger, la misère cesserait, l'industrie reprendrait, il y aurait du travail pour tous, les paysans ayant fui les campagnes pleines de brigands retourneraient travailler leur champ. Il y aurait du pain. La Révolution était finie, voilà le roi délivré de ses courtisans et de ses mauvais conseillers. »
Il avait d'abord fallu se montrer patient, le roi recevait l’hommage des corps constitués, long défilé de carrosses, plutôt de bon augure, puisqu'en apparence ils se soumettaient. Dehors, la foule observait, attendait, cherchait à l’apercevoir à travers les vitres. Dès qu’il parût au balcon, ce furent des applaudissements, des cris de joie, d’amour, de reconnaissance pour celui qui revenait vivre au milieu d’eux. Le roi aurait pu facilement reprendre les choses en main, il choisit une politique expectante, ce que personne ne comprit. Il fallait un retour à l'ordre, c'était urgent dans tout le royaume, hélas comment gouverner quand on ne sait pas à qui est réellement le pouvoir. En théorie il était à l'Assemblée nationale pour les grandes décisions, et au roi pour la mise en œuvre. Il était donc urgent que les députés le rejoignent à Paris, ils hésitaient, ils avaient peur, et cela non sans raison. Les émotions populaires étaient soudaines, violentes et cruelles, Berthier et Foulon en avaient fait l'expérience. Pour que les députés consentent à rejoindre le roi, il fallait une loi de sévérité garantissant la sécurité de tous, mais il fallait, aussi et surtout, que cette loi soit exécutée par une autorité qui ne fasse pas défaut. Or le roi n'avait que trop montré son incapacité. Cette loi fut votée, elle remettait aux municipalités le droit de requérir des troupes pour dissiper les rassemblements. Chaque ville pouvait donc disposer à son gré de la Garde nationale, il était aisé de comprendre que ces soldats n'obéiraient pas au roi, mais à leurs chefs. C'était un terrifiant contre-pouvoir qui se mettait en place, une formidable puissance dont s'empareraient aisément d'audacieux démagogues. D'un côté, un roi faible, qui prétendait être prêt à respecter les nouvelles lois, et serait, en théorie, soutenu par l'Assemblée, mais gouverne-t-on quand on est mille ! De l'autre, la municipalité parisienne, où une douzaine d'hommes disposaient des 40 000 gardes nationaux de la capitale. Bérénice était très inquiète, le souci s'ajoutant à la dégradation continue de sa santé depuis son dernier accouchement.
⎯ Tant qu'il était à Versailles, notre roi avait les cartes en main me disait-elle, le soir, quand je rentrais de mes incessants va-et-vient entre Versailles et les Tuileries. À présent, il est offensé qu'on lui ait fait violence, il ne gouverne plus à longue vue, mais au présent. Il se contente d'apparence, comme ces applaudissements dont il se délecte. Mirabeau lui conseille de se retirer à Rouen. Il refuse. La reine le pousse à rejoindre l'armée de Bouillé à Metz, il ne l'écoute pas. Il s'accroche à l'espoir que les députés le rejoindront, sans comprendre que là n'est pas la solution.
⎯ Comment cela ?
⎯ Pour deux raisons. La carence du pouvoir favorise les ambitions. Plusieurs ont déjà jeté le masque, comme Mirabeau qui se voit déjà en homme providentiel, et n'a peut-être pas tort, ou La Fayette, dont le dernier exploit fait beaucoup parler.
Passant ma vie à cheval, je n'avais plus le temps de rencontrer mes amis. D'Osny était toujours officier au Grand Châtelet, donc responsable de la sécurité des rues. Corbinien était dans l'état-major de La Fayette, c'est par lui que mon épouse avait appris ce qu'elle me conta. Républicain avant le 6 octobre, il avait été horrifié de voir bafouer la personne du roi, et attribuait cette humiliation à son cousin, le duc d'Orléans. On disait que la marche des Parisiennes sur Versailles avait été organisée par ce maudit prince, que La Fayette était allée le trouver pour lui signifier haut et fort que sa présence à Paris excluait toute tranquillité, et que s'il ne partait pas, lui-même le provoquerait en duel et le tuerait, le salut de la nation étant à ce prix. Cartel courageux, mais on ne pouvait attendre moins du héros de l'Amérique. Pour Bérénice, La Fayette était l'homme clé qui pouvait stabiliser la situation. Militaire, il savait commander. Il était immensément populaire, y compris, et c'était fondamental, parmi les 40 000 volontaires de la Garde-National, dont il avait le commandement. Déjà cent cinquante députés avaient fait leur malle et demandé des passeports pour quitter le royaume, si on voulait que s'arrête cette hémorragie, il fallait agir vite, d'un côté en rétablissant l'ordre dans les rues, de l'autre en faisant de bonnes lois et en rédigeant une solide constitution. Presque tout le monde était d'accord sur le rôle que La Fayette aurait à jouer, tout le monde sauf le roi, qui lui attribuait, on ne sait pourquoi, l'humiliation du 6 octobre. La reine le détestait. La situation était donc bloquée, comme d'habitude, par la faute de Leurs Majestés. Le roi se contentait des hochets que la foule lui distribuait. La reine, après avoir refusé de recevoir les hommages des vainqueurs de la Bastille, avait mis de l'eau dans son vin en acceptant ceux des dames de la Halle, mais à distance, bien défendue par les larges paniers des dames de la cour, qui lui avaient fait comme un rempart. Dans chaque grande ville de France, l'autorité était donc désormais entre les mains des municipalités. C'était pire dans les campagnes, où il n'y en avait plus du tout. Les nobles les plus riches avaient fait leurs malles, à petit bruit, pour gagner l'étranger. Les plus pauvres s'étaient réfugiés en ville, où ils attendaient frileusement l'évolution de la situation. Il y avait une exception, Fierville, où Probus et sa milice exerçaient une surveillance sévère sur mes terres et celles d'Éléonore, dont il espérait le retour, et à qui il écrivait régulièrement.
3 Cf le 1er tome de ces Mémoires, "Bérénice".
3 Favras
Ange Josnet de la Doussetière, bien que sourd et très âgé, conservait toute sa tête. Il ne cessait de marteler une évidence : le roi était à Paris, le devoir des députés était de le rejoindre. Il se heurtait au mur de la peur, comment convaincre des gens qui avaient été à deux doigts de se faire égorger les 5 et 6 octobre dernier ? Il choisit de donner l'exemple, et annonça à tous ses collègues qu'il partirait le 13 octobre pour rejoindre Sa Majesté. Un échange de courriers avec Ville d'Avray ouvrit une première porte, les députés qui viendraient pourraient tenir séance dans les luxueuses salles de l'archevêché. Dès lors ce fut pratiquement toute l'assemblée qui choisit de faire de même. Ange-Josnet de la Doussetière avait gagné. Quand il informa sa très jeune épouse qu'ils partaient pour Paris, Éléonore eut un instant d'hésitation. Suivre son mari, c'était courir le risque de me revoir, ne pas le suivre, c'était faillir à ses devoirs. Avec un éclat de malice dans les yeux, Ange-Josnet lui expliqua qu'il avait écrit à un vieil ami qu'elle appréciait beaucoup, maître Piranesi. Celui-ci avait accepté avec empressement de les loger. Éléonore se soumit.
Le quartier du Temple était calme, très gai, c'était un îlot de prospérité dans une ville frappée par les difficultés. La rotonde, équivalent du Palais-Royal, puisqu’on y trouvait quantité de boutiques bien achalandées, des cafés, des restaurants, des chocolatiers, était un lieu de promenade apprécié. Quant à Piranesi, c'était un homme passionnant, bavard, toujours bien informé, donc un interlocuteur précieux pour Ange Josnet. Habile financier, notaire, banquier à ses heures, l'homme gérait une partie de sa fortune. De même il conseillait sa fille, dont la dot prodigieuse avait été investie en valeurs refuges. S'installer chez lui offrait donc une foule d'avantages, dont le plus précieux était sa chère filleule, qu'elle aurait ainsi l'occasion de revoir souvent. Éléonore écrivit à Probus pour lui donner sa nouvelle adresse, et s'installa dans la grande maison de la rue des Fontaines.
Né dans la roture, mon beau-père se savait supérieur à bien des nobles, non seulement par sa fortune, mais aussi par le talent, or la grande question qu'allaient avoir à traiter les députés de l'Assemblée nationale était celle des Biens du clergé. C'est par leur confiscation que la dette abyssale de la monarchie serait réglée, tous les financiers de la capitale avaient donc les yeux braqués sur l'Assemblée, et se réjouissaient qu'elle soit venue s'installer à Paris, c'est de cela qu’il fut question lors du premier repas que les Piranesi partagèrent avec Éléonore et son époux.
Un inconnu figurait à table, mon beau père le présenta comme le marquis Thomas de Mahy de Favras. C'était un homme curieux, de belle figure, la taille haute, portant un habit noir un peu râpé. Il avait des papiers plein les poches, et leur expliqua avec beaucoup de chaleur et d’entrain, des plans qui étaient peut-être très bons, mais que Piranesi ne songeait nullement à exécuter. En effet, ce chevalier de Saint-Louis, remarquable par la hauteur de sa taille, par la beauté de sa figure, par l’énergie de son regard, et par la mâle simplicité de son langage, avait, ni plus ni moins, envisagé de sauver le roi. Il avait besoin d'un emprunt de deux millions, garantis par le comte de Provence. Cet argent permettrait de lever une troupe armée, qui enlèverait le roi et le conduirait en lieu sûr. Exalté au grand cœur, ardent et généreux, débordant d'imagination, entreprenant, mais imprudent, Favras ne doutait pas de l'adhésion de mon beau-père, lequel se rétracta prudemment. À la grande surprise d'Éléonore, Ange-Josnet sembla s'intéresser au projet. Il voulut connaître les détails. Piranesi et madame de La Doussetière tombèrent des nues. Ce bel homme, visiblement sans un sou, avait séduit et épousé une princesse allemande, Caroline d’Anhalt, fille légitime du prince d’Anhalt-Bernbourg-Shaumbourg. Puis il avait fait une carrière à la fois militaire et mondaine. Beau, jeune, spirituel et brave, il avait connu une progression fulgurante, passant du grade de capitaine de dragons à celui de colonel de la garde suisse du Comte de Provence, frère du roi. Ce qu'il expliqua avec faconde.
⎯ On me dit bonne épée, monsieur, au moins autant que ce baron Des Gonds qui a l'honneur d'être votre gendre. J'étais à Versailles les 5 et 6 octobre dernier, ce que j'ai échoué ce jour, je veux le tenter à nouveau.
Comme tout le monde, Piranesi avait été surpris par cette marche des femmes sur Versailles, et encore plus surpris qu'elle ait réussi. Le retour de la monarchie dans la capitale ne pouvait que favoriser ses entreprises financières, il voulut en savoir plus sur ces deux jours funestes pour la monarchie. Favras ne demandait que ça, mais l'avertit que son récit serait enrichi de ce qu'il avait appris après coup.
⎯ Ce funeste 5 octobre, Paris s’était réveillé aux tintements lugubres du tocsin. Les Parisiens se demandaient avec effroi ce qui se préparait. Une bande de femmes, et d’hommes déguisés en femmes, avait forcé tout à coup la porte de l’Hôtel-de-Ville. La garde résistait. Une lutte avait lieu. De nouvelles bandes, armées de piques, arrivaient de tous les faubourgs. L’émeute couvrit bientôt la Grève, les quais, et les rues adjacentes. La disette, factice ou réelle, qui régnait à Paris était le prétexte bien plus que la cause véritable de cette manifestation. « À Versailles ! à Versailles ! » hurlait-on de toutes parts, quand La Fayette survint. Il déclara très courageusement qu’il n’irait point, et défendit à la garde nationale de se mettre en mouvement. Sa voix ne fut point écoutée. Il avait trop compté sur sa popularité, et pour toute réponse, on lui montra la lanterne.
⎯ On n'est général du peuple qu’à la condition de servir ses passions et ses colères, murmura Ange-Josnet.
⎯ Dans l’espoir de modérer au moins cette multitude, qu’il ne pouvait plus arrêter, et de contenir la garde nationale, qui méconnaissait sa voix, La Fayette prit le parti de conspirer avec elle.
⎯ Comme le paratonnerre conspire avec la foudre.
⎯ Exactement madame. Il donna le signal du départ, au milieu d’un applaudissement général, et partit pour Versailles, à la tête de plusieurs bataillons de gardes.
⎯ C'est pour cela que la reine le déteste, et ne veut pas être sauvée par lui.
⎯ La hideuse armée de Maillard suivait.
⎯ Qui est-ce ? demanda Éléonore.
⎯ L'un des assassins de ce pauvre Delaunay. Un grand tumulte se fit à Versailles, dès qu’on y apprit la marche de cette colonne, qu’on prétendait être de quarante mille hommes. Le roi était à la chasse, on l’envoya prévenir en toute hâte. L’Assemblée était réunie, et Mirabeau, le premier, vint avertir le président Mounier, des événements qui se préparaient, l’engageant à lever la séance, ce qu'il fit.
⎯ Que pouvions-nous faire d'autre ? murmura Ange-Josnet, nous ne sommes pas des soldats, c'était au roi à se défendre, il en avait alors les moyens !
⎯ La colonne des insurgés défilait déjà dans l’avenue de Paris, sous une pluie battante, La Fayette à sa tête. Au château, tout était dans la confusion, les gentilshommes et les courtisans se regardaient, ne sachant que faire, et l’Œil-de-bœuf retentissait de leurs altercations bruyantes. J'étais fou de colère, de désespoir et d'impuissance. … « Il est honteux de laisser de pareilles hordes s’avancer sans résistance vers le palais du roi ! » … m'écriai-je, et j'ai proposé aux courtisans qui m'entouraient de sortir l’épée à la main, d’appeler à leur aide quelques soldats fidèles, et de se jeter sur la colonne de Maillard pour la disperser, ou tout au moins pour lui barrer passage. On m'a objecté que cette colonne était trop nombreuse, et qu’il faudrait des chevaux pour la charger avec quelque avantage. … « Eh bien ! j’aurai des chevaux ! » … ai-je crié, et je me suis rendu sur-le-champ chez Saint-Priest. … « Monsieur le comte, lui ai-je dit, en mon nom et au nom de deux cents gentilshommes réunis en ce moment dans l’Œil-de-bœuf, je viens vous demander la permission de disposer pendant une heure des chevaux du roi. Nous nous faisons fort, si vous le voulez bien, de disperser la horde qui vous arrive, et de lui enlever ses canons. »
⎯ Et alors ?
⎯ Il m'a répondu qu'il ne pouvait rien faire sans l’assentiment du roi. Sa Majesté fut consultée. Elle refusa au titre que M. de La Fayette et plusieurs bataillons de la garde nationale se trouvaient avec le peuple de Paris. Qu'il n’y avait qu’à attendre. Attendre ! Alors que le château serait envahi dans deux heures par ces brigands ! J'étais désespéré. Les grilles furent forcées, des scènes horribles eurent lieu, malgré les efforts de M. de Lafayette qui fit des prodiges de courage. Maillard et sa bande d'avinés envahirent le château. Piques et pistolets étaient partout, des femmes brandissaient des poignards et poussaient des cris de mort, ne songeant qu'à piller et à assassiner le roi. J'étais toujours dans l’Œil-de-bœuf lorsqu'arriva Cromwell.
⎯ Cromwell ?
⎯ C'est ainsi que j'interpellai La Fayette, qui me répondit fièrement que « Cromwell ne serait pas venu seul. »… Il avait raison, j'admirai son courage, car à cette heure, nous étions tous ses ennemis. Il sut admirablement prendre les choses en main, sortit sur le balcon, harangua la foule, et tenta de réconcilier le roi avec son peuple. Il ne le put qu'avec la promesse que l'on sait. J'obtins d'escorter Leurs Majestés jusqu'à Paris. Une colonne hideuse nous entourait. Les gardes du corps, désarmés, marchaient à pied, entourés de brigands le sabre nu à la main. Des femmes, couvertes de cocardes et de rubans tricolores, entouraient la voiture du roi, chantaient des chansons grossières, se mettaient à califourchon sur les pièces d’artillerie. Un feu roulant de mousqueterie terrorisait les enfants, qui, Dieu merci, ne voyaient pas, en tête de cortège, les têtes de messieurs des Huttes et de Varicourt, qui s’étaient fait tuer au château en essayant de protéger la reine. Notre affreux cortège n'arriva qu'à la nuit. Depuis, je me bats pour réunir autour du roi un parti d’amis dévoués, et prêts à tout pour sa défense.
⎯ D'où les deux millions que vous essayez de réunir !
⎯ Il faut des armes, des chevaux, des officiers. Durant ce funeste voyage de Versailles à Paris, j'avais remarqué, auprès de la portière du carrosse royal, un jeune officier de la garde nationale, qui pleurait en voyant le roi et la reine dans une situation aussi affreuse. J'ai demandé son nom. Il s'appelle Pierre Marquier, il est sous-lieutenant d’une compagnie de grenadiers du faubourg Saint-Antoine. Il est prêt à marcher avec nous.
⎯ Une conspiration ?
⎯ Un acte de guerre, monsieur. J'ai aussi rencontré un sieur Tourcaty, officier d’infanterie, qui s'engage à recruter et à former ce que j'appellerai notre phalange royaliste. Il a pour associé un de ses amis, nommé Morel, officier de la garde nationale.
⎯ Vous êtes donc quatre !
⎯ Quatre recruteurs qui parcourons les rues de Paris et constatons que l'anarchie est partout, dans les groupes, dans les cafés, dans les lieux publics. On y tient des propos affreux, il n'est question que de vengeances et d’assassinats. Le massacre du roi et de sa famille est projeté, à voix basse encore, certes, mais presque sans mystère. Regardez les théâtres, chacun participe, comme toujours, aux excitations de la rue. On y joue ouvertement des pièces de circonstance, et la fièvre révolutionnaire s’y dissimule à peine sous des allusions perfides. Séduits par le mot Liberté, de vrais poètes, comme Chénier ou Fabre d'Églantine, ennoblissent, en les traduisant en beau langage, les déclamations populaires. C'est un volcan souterrain, il faut l'éteindre avant qu'il n'entre en éruption.
⎯ Je n'ai pas ces deux millions, conclut Piranesi, qui ne se laissait pas emporter facilement.
⎯ Et moi, je suis trop vieux pour tirer l'épée.
⎯ Ce que je ne comprends pas, reprit Piranesi, c'est que vous soyez mandaté par le comte de Provence, qui est l'un des hommes les plus riches du royaume.
⎯ Le prince est très surveillé, il ne peut agir que dans l'ombre.
⎯ Agir pour faire quoi : enlever le roi avez-vous dit ?
⎯ Oui, et le conduire à Péronne.
⎯ Que ne part-il tout seul, il n'est pas captif, que je sache !
⎯ Mon cher monsieur Piranesi, on voit qu'ici, vous habitez loin des Tuileries. Certes le roi n'est pas prisonnier, mais il ne tardera pas à l'être. On le considère déjà comme un otage précieux. Mille bruits circulent, reproduits par les journaux les plus violents, qui dénoncent de furieux complots.
⎯ Auxquels je ne prendrai jamais part, sachez-le bien.
⎯ Monseigneur le comte de Provence…
⎯ Qu'il emprunte l'argent à ses amis, ou bien ouvre sa propre bourse.
⎯ Et vous, monsieur de la Doussetière ?
⎯ Je vous soutiendrai, mais pas avec mon argent, car il est en bonnes terres, forêt et troupeaux ; ni par mon épée, car elle n'est plus ce qu'elle a été. Je ne dirai pas que je suis ami avec monsieur de Riquetti, mais je connais son frère, André-Boniface-Louis. C'est un homme d'action, je suis sûr qu'à défaut d'argent il vous prêtera son concours.
4 Rue Saint-Florentin
Je savais, bien entendu, qu'Éléonore et son oncle s'étaient installés rue des Fontaines. J'avais bien d'autres soucis. Si de la Doussetière, en tant que député à l'Assemblée nationale, représentait la noblesse modérée de province, notre ami Deleyrant était un membre actif du clergé. Imitant l'oncle d'Éléonore, il m'avait demandé de l'héberger, en utilisant des arguments propres à me convaincre.
⎯ La rue Saint-Florentin est à deux pas des Tuileries, et surtout de cette salle du Manège que Ville d'Avray fait aménager à la hâte, cela sera commode pour moi et pour vous, qui ainsi saurez, avant la gazette, la teneur des propos que mes estimables collègues vont tenir.
⎯ C'est un local qui n'est pas adapté à la vie parlementaire.
⎯ Taratata.
Son enthousiasme était suspect. Je le soupçonnais surtout d'apprécier le confort de mon logis, et la fréquentation quotidienne de mon épouse, qui luttait contre le mal mystérieux qui la rongeait.
⎯ Vous y êtes allé ?
⎯ Pas encore.
⎯ Alors je vous souhaite bien du plaisir quand vous serez logé à plus de mille, dans un quadrilatère six fois plus long que large, parallèle à la Seine, plus fait pour l'équitation et les parades équestres que pour réformer la monarchie.
⎯ Ville d'Avray a dû très bien faire les choses.
⎯ Il a fait élever six rangées de banquettes en gradins, et, à chaque extrémité, neuf rangées de tribunes pour le public.
⎯ Nous reverrons donc cette délicieuse Olympe, qui, j'en suis sûr, ne manquera pour rien au monde une seule délibération.
⎯ Tel que je vous connais, Deleyrant, vous ne briguerez pas le siège du président, mais plutôt les coulisses.
⎯ Que voulez-vous, je suis comme vous, pas fait pour la lumière. Alors, ce sera beau ?
⎯ Ce sera laid, à l'image des temps que nous vivons : quelques draperies, des bustes en plâtre et de faux marbres, un décor à la romaine, sobre pour ne pas dire austère.
⎯ Mon cher Edmond, le problème n'est pas la commodité de cette salle, mais l'équilibre des pouvoirs qui s'y construiront. Le roi n'est plus tout puissant, pas plus que nous, qui allons désormais siéger sous la menace des foules révolutionnaires, si faciles à mettre en marche.
⎯ Vous mourrez donc, et ce pour une indemnité de 18 livres par jour, soit vingt fois plus que ce que gagne un ouvrier.
⎯ Quel cynisme ! Ces 18 livres représentent, je ne le nie pas, une jolie somme, mais la gestation et le vote de la loi sont des tâches difficiles. Songez que l'œuvre à accomplir est immense : il faut tout réformer, l'administration, la justice, les impôts, l'armée, tout cela en construisant un régime parlementaire, donc en créant une loi électorale intelligente, dans un pays où un homme sur deux ne sait pas écrire.
Quant au danger que vous évoquez, je ne le nie pas, mais en tant que législateurs, les représentants de la nation sont sacrés, et leurs personnes inviolables.
⎯ Puissiez-vous avoir raison.
Deleyrant me regarda amicalement. Il avait trouvé chez moi une famille, et en Bérénice, ma tendre épouse, une véritable sœur. S'il appréciait sa beauté, c'était surtout son âme qui le séduisait. Bérénice était extrêmement instruite, elle ajoutait, à sa grande culture, une intuition et un sens politique qui me laissaient souvent pantois. Profondément agnostique, elle se plaisait à taquiner l'abbé, mais s'arrêtait quand elle avait crainte de le blesser.
⎯ Edmond, mon ami, d'où vous vient ce pessimisme inhabituel ? Des souffrances de votre épouse ?
⎯ Elle souhaite rentrer en Vendée, c'est impossible, à cela s'ajoute un très grand souci pour la reine. Vous savez que Bérénice est très intelligente, et même au-delà de ce qu'on pourrait imaginer.
⎯ Elle l'a prouvé en gérant très habilement vos petits problèmes de couple.
"Petit" était un mot impropre. J'avais renoncé à Éléonore, mais la souffrance était là, pour elle, pour moi, pour mon épouse. J'aimais deux femmes et deux femmes m'aimaient. Le plus cruel, c'était qu'elles s'estimaient et s'appréciaient. Elles étaient amies, sans calcul, sans trahison, partageant la même confiance, connaissant mes faiblesses et m'entourant de leur protection.
⎯ Laissez la comtesse de la Doussetière en dehors, je vous prie, ce qui est fait est fait. Vous n'êtes pas sans savoir que la reine vivait dans une très grande solitude, ces dernières semaines.
Deleyrant comprit que je voulais éviter ce sujet, il hocha la tête. Je lui expliquais que la reine avait changé. Courageuse et rancunière, véritable princesse de la maison de Lorraine, elle voulait vaincre et se venger, mais sans s'appuyer sur La Fayette, et encore moins Riquetti, qui l'horrifiait par sa grossièreté et son immoralité.
⎯ Elle proclame sans cesse qu'elle est comme Henriette d'Angleterre, que les reines ne peuvent pas se noyer, même dans une tempête. Que sa mère, Marie-Thérèse, avait été près de périr, mais n’avait pas péri.
⎯ Parce qu'elle avait pour elle le peuple, alors que sa fille l'a contre elle.
⎯ Vous savez que mon ami, Corbinien de Vigneules, est dans l'état-major de La Fayette.
⎯ Sa charmante Julie est l'un des ornements de votre maison.
⎯ Et un grand réconfort pour Bérénice, qu'elle soutient dans sa lutte contre la maladie. Pour en revenir à La Fayette, il sait que la reine le déteste. Elle ne lui a su aucun gré de l'avoir protégée le 6 octobre, et d'avoir chassé le duc d’Orléans. Que le général la suive partout l'agace, elle y voit une sorte de cour. Elle est inconsciente des efforts prodigieux qu’exige de lui le maintien de l’ordre, ni de l'héroïsme avec lequel il essaie de surmonter la répugnance que lui inspire Mirabeau. Il a écrit deux fois à monsieur de Bouillé, le priant de s’unir à lui pour sauver la royauté. Bouillé ne bouge pas, Paris lui fait peur, et il n'est pas sûr de ses troupes, comme La Fayette n'est pas sûr des hommes de la garde nationale. Corbinien rentre chaque soir fourbu, il parle peu, ou seulement pour se soulager. C'est par lui que je connais les efforts désespérés de La Fayette pour sauver l'ordre, et accessoirement la royauté.
⎯ Pendant que le roi se satisfait des acclamations de la foule, et abandonne le pouvoir à l'Assemblée, d'où n'émerge pas l'homme providentiel que tous attendent !
⎯ Hélas.
Si Corbinien était très inquiet, je l'étais, moi aussi, mais pour d'autres raisons. Bérénice souffrait d'un mal dont elle ne parlait jamais, les médecins étaient impuissants. Après les terribles journées d'octobre, il avait fallu prendre une décision. Rester à Versailles, ou suivre le roi et nous réinstaller rue Saint-Florentin ? Bérénice était très partagée. Le pavillon de Sigoll, où nous habitions, avait abrité mes amours coupables avec la belle Olympe de Gouges, elle ne s'y sentait pas chez elle. Rentrer rue Saint-Florentin était le meilleur choix, mais elle avait vu passer le cortège des furies marchant sur Versailles, or nous habitions tout près des Tuileries. Si de nouvelles émotions populaires avaient lieu, nous serions en première ligne. En fait, son rêve était de rentrer en Saintonge, mais elle n'osait pas me le demander. Mon petit château avait été brûlé par les émeutiers, mais il restait Fierville, Fierville, où Probus, notre intendant, menait une garde efficace, Fierville, ou Éléonore lui avait offert une amitié sincère et sans calcul, Fierville, où, consciente de son état d'épuisement, elle avait même envisagé, implicitement, de me partager, ce que ma petite marquise avait compris et refusé avec élégance. Nous avions donc choisi Paris.
Corbinien était natif du Bazois. Je l'avais connu vicomte désargenté, n'ayant d'autre fortune que son titre et son épée, c'était peu pour épouser Julie, laquelle ne se souciait guère de pauvreté, n'ayant jamais eu d'autres ressources que de vivre chez sa tante, à qui elle servait de lectrice. Je n'avais appris que par hasard, qu'il descendait en ligne directe de l'un des héros de l'épopée johannique. Son nom complet était Corbinien Achille Bertin de Vigneules-la-Hire. Il possédait, outre ses dix-huit quartiers de noblesse, un château en ruines, proche de Nevers, c'était là que son glorieux ancêtre cachait le fruit de ses rapines. Retrouvé par hasard, l'or anglais lui avait permis de redorer son blason et d'épouser Julie. Le couple s'était installé rue Plumet, à deux pas de la Bastille. Corbinien avait assisté à l'odieuse exécution de monsieur de Launay, à qui on avait promis la vie. Il avait pris ce quartier en horreur, et accepté mon offre de les héberger. Nous ne pouvions pas prévoir que la réinstallation de la monarchie aux Tuileries allait répéter des scènes d'horreur.
Le 18 au soir, nos deux voitures s'étaient engagées sous mon porche. Julie nous attendait, tout était prêt. Elle s'était bien gardée de faire une remarque sur la pâleur de mon épouse. En notre absence, c'est elle qui était devenue la maîtresse de maison, rôle qu'elle s'attendait à lui rendre. Cela n'avait pas été le cas. Julie avait continué à diriger les domestiques, c'est elle qui recevait, elle qui s'occupait des enfants.
Bérénice vivait dans la crainte d'une invitation de la reine, invitation qu'elle ne pourrait décliner, l'émigration ayant décimé l'entourage de la souveraine. Hélas, elle ne s'en sentait pas la force, sa santé déclinant lentement, au point que Louis-Anne ne connaissait sa mère que couchée, ce qui convenait parfaitement à l'enfant. Il était le seul. Bérénice se sentait, non dans la gorge du loup, mais à proximité, c'est pour cela qu'elle souhaitait de toutes ses forces retourner en Vendée. Sans le faire exprès, Corbinien distillait la peur. Où était l'ordre ? La puissance ? Le roi aurait pu aisément reprendre le pouvoir, ses partisans étaient nombreux. Le respect les paralysait, ils attendaient des ordres, des directives qui ne venaient jamais. C'est ce qui expliquait l'inaction de Bouillé, dont l'armée se délitait, mais aussi les hésitations de La Fayette, les manœuvres souterraines de Riquetti, les intrigues de Monsieur pour écarter son frère et se faire confier la régence du royaume, voire devenir Louis XVII. Quant à Orléans, il s'agitait dans l'ombre, guettant son heure. Corbinien me pressait d'entrer aux Jacobins. Je n'y tenais guère. Avais-je le choix ? Le chaos s’étendait à toute la France, l’armée était gangrenée par l’indiscipline, les officiers émigraient pour fuir un état de mutinerie permanente, un climat insurrectionnel s’était installé dans presque toutes les grandes villes, des rixes sanglantes éclataient un peu partout. Dans cette ambiance délétère, le poids politique des clubs devenait prépondérant, or, de tous, le plus puissant, le mieux organisé, c'était la Société des Amis de la Constitution. Ces Jacobins, puisqu'on les appelait ainsi depuis qu'ils s'étaient installés dans l'ancien couvent du même nom, n'étaient pas encore ce qu'ils devinrent par la suite. C'était alors une société policée et raffinée, qui portait bien son nom. Être "ami de la Constitution", c'était alors souhaiter l'ordre, le respect de la loi, je ne pouvais qu'y souscrire. De plus, ils étaient en passe de devenir un véritable parti, comme les Whigs4 en Angleterre. Les Jacobins avaient des cadres, des militants et de nombreuses ramifications provinciales, et, cerise sur le gâteau, ils n'étaient pas hostiles à la monarchie. Ce serait pour plus tard. Voyant que j'hésitai, Corbinien avait insisté.
⎯ Le roi a, depuis longtemps, montré qu'il n'était pas l'homme de la situation. Nous avons des enfants. Veux-tu laisser ton pays sombrer dans l'anarchie ? La prolifération des gazettes de ruisseau entretient la licence de la presse. Personne ne peut plus la contrôler. Des journalistes méprisables, comme Marat et Hébert, ou pire, dangereux, parce que talentueux, comme Brissot et Desmoulins, se répandent en diatribes haineuses qui colportent sans vergogne mensonges et calomnies. Tu veux laisser faire ?
⎯ Il n'y a donc pas de presse royaliste ?
⎯ Oh si, il y en a une, mais elle s'adresse à une élite. La reine lit les Actes des Apôtres, et, paraît-il, s'en délecte, il est vrai que c'est un journal plein d'humour, mais c'est par là qu'il pèche. On ne reconstruit pas une société en faisant rire, mais en proposant des idées. Il y avait autrefois trente-six imprimeurs dans Paris, aujourd'hui, ils sont dix mille, ils se sont multipliés à tel point que l'imprimerie, après avoir fait tant de bien, menace d'être épouvantablement funeste. Il n'y a pas de maison où il n'y ait aujourd'hui une presse, à la cave, au grenier, dans les mansardes, avec deux ou trois journalistes qui rêvent de célébrité, et croient la gagner par la puissance de médire et de satiriser du soir au matin, car leur seule raison d'être est la critique. Royalistes ou opposants, tous veulent abattre ce qui reste de gouvernement. Y a-t-il des progrès ? Ils le nient. Ces folliculaires s'introduisent partout, y compris dans la salle du manège, et je tremble à l'idée qu'il n'y a qu'une banquette qui les sépare des législateurs. Comment ne se croiraient-il pas une puissance ! Ils précipitent leur plume sur tout ce qui bouge, leurs assertions deviennent vérité. Ils affectent un style satirique même quand la nature ne leur en a pas donné le talent. Ils entassent censure, sarcasme et raillerie, en confondant toutes ces nuances. Toute phrase leur est bonne à imprimer, pourvu qu'elle soit caustique. La vérité, pour eux, est le gémissement de l'offensé. Envenimer les actions d'un homme public, c'est le faire marcher droit. Toute administration, toute autorité leur est tyrannique dès qu'elle n'est pas parfaitement obéissante à leurs idées. Tout gouvernement est corrompu et assassinable dès qu'il heurte leurs productions déréglées. Aujourd'hui le public ne fait plus la différence entre les journalistes sensés et les séditieux, c'est comme s'il confondait le chirurgien, qui fait une opération anatomique, et le boucher qui découpe un bœuf. Et ces excès n'en sont qu'à leurs débuts, je le crains. C'est pour ça que des gens comme toi et moi doivent rentrer aux Jacobins. Il faut de l'ordre, Edmond. On est passé d'une monarchie absolue à un rationalisme ravageur, sans transition ni souci d’empirisme, abolissant de façon précipitée tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une organisation.
⎯ Tu veux que je rejoigne des gens qui ont tout fait pour détruire l'ordre établi !
⎯ Et dont la plupart le regrettent et s'inquiètent à présent. Si je te disais que même ton ennemi, Duport de Prélaville, a bien changé. C'est lui qui a négocié avec les moines pour louer leur réfectoire avec mobilier, tables, chaises. Mais comme nous sommes de plus en plus nombreux, ça ne suffisait pas, il s'est fait prêter la bibliothèque, et enfin l’église. Les tombeaux des anciens moines, ces confrères de Jacques Clément, se trouvent ainsi les témoins muets de nos débats. Il faut que les choses changent, et comme on ne peut pas compter sur le roi, dont personne ne sait ce qu'il pense (pense-t-il ?), nous allons œuvrer pour lui imposer une constitution.
⎯ C'est le rôle des députés.
⎯ Nous sommes juste en face, et parmi nous, nombre siègent dans les deux assemblées. À propos, ton autre ami, Saint-Maixent, sais-tu qu'il vient de rejoindre les Cordeliers ?
Corbinien savait parfaitement que ce nom détesté entraînerait mon adhésion. Il m'expliqua qu'il fallait six parrainages, à cette condition seulement, j'obtiendrai la carte qui permettrait d'entrer. Les jacobins voulaient marier la monarchie et la Révolution, y compris en se passant du roi s'il s'opposait à eux. Les prétendants ne manquaient pas. Corbinien n'en était pas là, monarchiste sans être légitimiste, son seul parti était celui de l'ordre, comme La Fayette.
Corbinien m'avait convaincu, mais je voulais entendre un autre conseil, celui de mon autre ami, Jean D'Osny, l'aîné de nous trois. Lui aussi était militaire, dans la police parisienne, il était officier au Grand Châtelet, lieu redoutable, d'où l'on ne sortait généralement que pour l'échafaud. Il m'accueillit avec un empressement suspect, et quand je lui demandai ce qu'il pensait des Jacobins, il éluda pour évoquer quelque chose d'urgent et grave, selon lui.
⎯ Cela fait presque un mois que Leurs Majestés sont aux Tuileries, sais-tu combien il y a déjà eu de complots pour prétendument les libérer ? Huit.
⎯ Mais le roi n'est pas prisonnier, il se promène tous les jours, et fait même des séjours à Saint-Cloud.
⎯ Connais-tu Omer Talon ? Non, bien sûr, c'est le remplaçant de ton ami, Louis Thiroux de Crosne5. Quand il y a des dénonciations, c'est sur son bureau qu'elles aboutissent, l'une concerne ton beau-père.
⎯ Piranesi ? C'est l'homme le plus prudent du monde, j'ajoute qu'il est comme moi, il déteste la politique. Si on a essayé de l'entraîner dans une intrigue, c'est en pure perte.
⎯ Je n'en doute pas, l'ennui, c'est qu'il héberge madame de Fierville et son époux.
⎯ Je le sais et tu ne vas pas t'en plaindre, puisque c'est à Éléonore que tu as confié la sécurité de Violaine au printemps dernier.
⎯ Un agitateur imprudent a récemment soupé rue des Fontaines, chez ton beau-père. Il a essayé d'entraîner Piranesi dans une aventure très dangereuse, il a refusé. Hélas pour toi, monsieur de la Doussetière s'est laissé convaincre.
⎯ Tu le connais, tu l'as vu, c'est un vieillard !
⎯ Mais qui compte de nombreux amis. C'est très grave, Edmond. Favras a un nom honorable, une jolie figure, une bonne épée et un grand courage, tout ce qu'il faut pour plaire, et je ne parle pas de ton ancienne fiancée, que seul un fou a pu abandonner au pied de l'autel. Je ne te juge pas, tu as été suffisamment puni pour avoir fait le malheur de deux femmes.
⎯ Je sais que Violaine ne me l'a jamais pardonné. Alors, ce Favras ?
⎯ C'est une âme ardente. Il est de ceux, qui, même lorsqu'ils n’atteignent pas leur but, puisent dans l’impulsion qu’ils ont suivie, une force nouvelle. C'est un touche-à-tout : littérature, finance, économie, dessin, architecture, et à présent, politique. Hélas pour lui, s'il s'attaque à tout, il s'en lasse aussi vite et va rarement au fond des choses, changeant aisément de direction et de mobile, et de ce fait, prenant des risques dont il n'est pas conscient. Je ne veux pas que cet inventeur inépuisable, cet individu que tout excite et rien n’arrête, entraîne dans sa chute monsieur de la Doussetière, et par ricochet son épouse.
⎯ Éléonore serait en danger ?
⎯ Tout le monde l'est aujourd'hui, plus ou moins. Que Favras use sa vie sans profit, ni pour lui ni pour personne, à suivre des idées chimériques, ou à tracer des plans irréalisables, ce n'est pas mon problème. Mais qu'à cause de lui, Éléonore se retrouve aux Madelonnettes, et que tu commettes mille folies pour la délivrer, là, ça devient mon affaire. C'est un de ses illuminés un peu naïf, qui ne se rendent pas compte qu'on les manipule.
⎯ Orléans ?
⎯ Provence, répondit D'Osny en baissant la voix. Favras n'est pas dangereux, son projet de rassembler dans les anciennes gardes françaises de quoi créer une compagnie de gens résolus, prêts à se rendre aux Tuileries au premier signal, serait même intelligent, si on ne voyait pas des complots partout, et surtout si le frère du roi ne s'en était pas mêlé. Quoi qu'il en soit, Favras a été dénoncé, on l'a pris en filature et il est à deux doigts d'être arrêté, lui et sa femme. Les dénonciations, vraies ou fausses, s'empilent, certaines amusantes. Favras aurait été payé pour faire siffler la pièce de Chénier, Charles IX, le roi qui fait massacrer son peuple. Favras serait l'auteur d'un pamphlet, Ouvrez donc les yeux, où l'on appelle à rendre tout son pouvoir au roi. Un mystérieux Barrauz dénonce son plan comme visant à faire assassiner La Fayette et Bailly. Tu en veux encore ? Non ? Favras est perdu, parce que Provence est certainement derrière tout ça, et qu'il le lâchera à la première occasion. Tu dois donc courir rue des Fontaines et prévenir monsieur de la Doussetière, et si ton Éléonore est là, ferme les yeux.
4 Ancêtres de l'actuel parti travailliste.
5 Lieutenant général de police.
5 Infamie et lâcheté
Piranesi était un homme avisé, à peine Favras avait-il quitté son domicile, qu'il prévenait son hôte de se montrer prudent. Trois jours plus tard, Favras était arrêté. Ne connaissant pas personnellement l'homme, j'eus l'occasion d'apprécier une attitude pleine de courage et d'abnégation, un modèle que j'aurais bien été en peine de suivre. De quoi l'accusait-on, en somme ? De dire qu'il aimait le roi et préférait la monarchie qui existait, à la république que d’autres voyaient en songe ? Oubliant que la liberté d'opinion et d'expression était l'un des premiers acquis de la Révolution, le tribunal y vit un crime. Favras ne nia pas avoir voulu inciter la garde nationale à reprendre son ancien nom de Garde-Française, son uniforme, et son véritable service auprès du roi. C'était habile, nombre d'officiers et de soldats avaient le même sentiment, il aurait suffi d'un geste de Sa Majesté pour qu'ils accourent à son appel. Le comité des recherches de l'Assemblée en était tellement convaincu, qu'il venait de promettre une somme de mille louis à quiconque dénoncerait un ennemi de la révolution. C'était une grosse somme, il fallait un exemple, la tête de Favras serait à ce prix.
Ce qui effrayait le plus ces messieurs du comité de recherches, c'était l'énormité de la somme que Favras essayait de rassembler. Avec deux millions, on pouvait recruter une armée, renverser l'Assemblée, et rétablir l'ancien régime. Si la collusion de Piranesi avait été prouvée, il aurait lui aussi été perdu, ainsi que ce brave Josnet de la Doussetière, et peut-être Éléonore. Ne venait-on pas d'arrêter cette princesse d’Anhalt, dont pouvait penser qu'elle était de mèche avec Provence ? Le frère du roi ne vivait plus. À peine Favras était-il sous les verrous qu'il se précipita à la commune pour se justifier. Oui, il avait chargé Favras de rencontrer des banquiers pour financer en son nom un emprunt, mais c'était pour couvrir les dépenses de sa maison, pas pour enlever le roi. Les représentants de la commune se sentirent extrêmement flattés de voir un prince du sang venir à leur barre, prendre le titre de citoyen, et faire devant leur juridiction, encore si récente, une telle démarche. Soupçonnaient-ils sa sincérité, quand il demandait comme une grâce de n’être point mêlé à cette affaire ? Sans doute oui, mais le pauvre Favras accumula les maladresses. À peine était-il arrêté et conduit à la prison de l’Abbaye-Saint-Germain, qu'un billet, tiré à des milliers d’exemplaires, courait dans tout Paris, reproduit par plusieurs journaux. … Le marquis de Favras, et la dame son épouse, ont été arrêtés hier, pour un plan qu’ils avaient fait de soulever trente mille hommes pour assassiner Monsieur de Lafayette, le maire de Paris, et ensuite nous couper les vivres… Monsieur était à la tête de ce complot. …