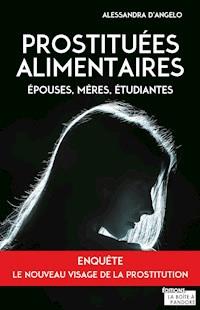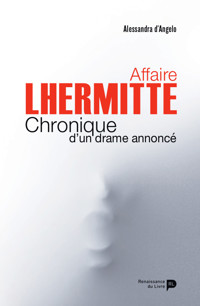
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Résumé :Alors que son mari devait rentrer d’un séjour au Maroc plus tard dans cette journée fatidique du 28 février 2007, en début d’après-midi, Geneviève Lhermitte décide de mettre fin à ses jours en emportant avec elle ses cinq enfants. Le 19 décembre 2008, après deux semaines de procès, Geneviève Lhermitte est condamnée par la Cour d’Assises du Brabant Wallon à la réclusion criminelle à perpétuité. Sur ce quintuple infanticide, l’arrêt de la cour précise que : « (...) ni le lourd passé familial de l’accusée, ni ses sentiments pénibles d’isolement et de dépendance, ni sa fragilité mentale et son état dépressif (...) ne peuvent suffire à expliquer les faits considérés comme (...) particulièrement atroces (...) ». Geneviève Lhermitte est déclarée pénalement responsable et coupable d’assassinat. Coupable et responsable ? L’est-elle ? Pour répondre à cette question, il convient de prendre le recul nécessaire, malgré toute l’horreur non contestée des faits. C’est à ce travail que s’est attelée Alessandra d’Angelo dans cet ouvrage qui a l’ambition, en interrogeant toutes les parties et en analysant les archives du procès, de contextualiser le geste posé et, par là, de tenter d’expliquer l’inexplicable.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Juriste de formation, ex-avocate au Barreau de Bruxelles, journaliste d’investigation judiciaire, chroniqueuse radio, conférencière et auteur, Alessandra d’Angelo publie en 2016 Case prison, un jeu d’échecs, un essai sur le sens à donner à l’enfermement. Elle publie la même année Présumé Coupable, une réflexion en filigrane sur l'Affaire Wesphael.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
affaire lhermitte
Chronique d’un drame annoncé
Avenue du Château Jaco, 1 - 1410 Waterloo
www.renaissancedulivre.be
@editionsrl
Affaire Lhermitte
Alessandra d’Angelo
Couverture : Emmanuel Bonaffini
ISBN : 978-2-507-05509-7
Dépôt légal : D/2017/12.763/14
© Renaissance du livre, 2017
Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.
alessandra d’angelo
Affaire Lhermitte
Chronique d’un drame annoncé
Avant-propos
Le 19 décembre 2008, après deux semaines de procès, Geneviève Lhermitte est condamnée par la Cour d’assises du Brabant wallon, siégeant à Nivelles (session II/2008 – NI30.LA.1386/07), à la réclusion criminelle à perpétuité. Le chef d’inculpation :« avoir, à Nivelles, le 28 février 2007, volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation,commis un homicide sur les personnes de Moqadem Yasmine, née le 13 août 1992, Moqadem Nora, née le 13 février 1995, Moqadem Myriam, née le 20 avril 1997, Moqadem Mina, née le 20 mai 1999, Moqadem Mehdi, né le 9 août 2003 », ses enfants, âgés de 3 ans et demi à 14 ans.
Alors que son mari, Bouchaib Moqadem, doit rentrer d’un séjour au Maroc en début d’après-midi de cette journée fatidique, Geneviève Lhermitte décide de mettre fin à ses jours en emportant avec elle ses cinq enfants. Méthodiquement, prétextant une surprise, elle les appelle un à un à l’étage de la maison familiale et les égorge avec un couteau de cuisine, avant de s’enfoncer l’arme du crime dans le thorax. Le coup est malencontreusement porté trop bas pour toucher le cœur. Toujours consciente, celle qui vient de commettre l’impensable, a fortiori pour une mère, alerte elle-même les services de secours.
Sur ce quintuple infanticide qui fera, pendant des mois, la une de tous les médias, l’arrêt de la cour précise que « ni le lourd passé familial de l’accusée, ni ses sentiments pénibles d’isolement et de dépendance, ni sa fragilité mentale et son état dépressif, ni sa volonté de s’en sortir par un suicide, ni même un manque d’aide adéquate, ne peuvent suffire à expliquer les faits considérés comme […] particulièrement atroces […], d’une violence extrême […] et froidement exécutés ». Geneviève Lhermitte est déclarée pénalement responsable et coupable d’assassinat.
Le jury écarte, sans motivation claire, les rapports sous serment de trois experts judiciaires psychiatres et de deux psychologues unanimes qui concluent catégoriquement à un état de déséquilibre mental grave la rendant incapable du contrôle de ses actions au moment des faits. Aucune circonstance atténuante n’est retenue. Sans doute parce que les faits dépassent l’entendement et qu’il faut, symboliquement, les punir à la hauteur de l’effroi qu’ils inspirent. Et pourtant, « qui peut douter que dans un état autre qu’un déséquilibre mental, elle pouvait faire du mal à ses enfants ? », avaient plaidé avec arguments étayés à la décharge de leur cliente maîtres Xavier Magnée et Daniel Spreutels, avocats de la défense.
Coupable et responsable ? L’était-elle ? Coupable, mais irresponsable ? L’était-elle ? Au-delà de l’affaire Lhermitte, c’est un bien vaste et récurrent débat cornélien qui se joue, dans les prétoires, en matière criminelle. Car cette question de la culpabilité et de la responsabilité se pose en droit, à chaque fois que les conséquences d’un acte posé sont préjudiciables pour autrui. Mais le fait qu’une personne soit l’auteure d’une action dommageable implique-t-il nécessairement qu’elle soit coupable du dommage subi ? Pour répondre à cette question, il convient d’essayer de s’élever, de prendre le recul utile, malgré l’horreur hors normes et non contestée des faits. Réussir à penser la notion de responsabilité, en dehors du lien de causalité qui unit l’auteur aux actes qui lui sont reprochés. Apprécier que sous le poids d’une série de facteurs cumulés, qui résultent de son anamnèse, l’auteur puisse en effet être à l’origine d’une action sans pour autant avoir évalué les conséquences de celle-ci. Cette « contrainte irrésistible », cause d’excuse juridique prévue à l’article 71 du Code pénal, c’est tout l’écart si difficilement appréciable qui existe entre l’intention et le résultat.
Force est de constater que l’être humain n’étant pas une machine, mais un être porté par des ressentis qui lui sont complexes et moteur, en agissant d’une certaine manière, il ne maîtrise pas toujours la portée de ses actes, même si c’est bien sa seule et unique volonté qui lui dicte sur l’instant d’agir… et de commettre.
Si l’incompréhensible ne peut se comprendre, il ne se justifie certainement pas. Mais ne peut-on pas à tout le moins tenter de l’expliquer ? Il existe nécessairement un enchaînement de situations qui s’invitent en déclencheur de l’acte final. Prison ferme ou internement ? Face à l’étendue de l’imprévisible, quelle responsabilité pour des jurés ! Celle de poser correctement le diagnostic et de rendre un jugement. Un jugement qui se doit d’être éclairé à la lumière de tous les facteurs contextuels propres à l’accusé.
Bagage, circonstances de la vie, rendez-vous manqués, nous ne sommes qu’addition. Une addition qui fait de nous un total. Aggravant ou atténuant. Équilibre fragile, sur un fil, fine barrière entre lumière et ombre. Tout est contexte, rien n’est que contexte. Un contexte qui s’est aussi imposé à Geneviève Lhermitte. Et si l’on accepte que la construction soit résultante, malgré un refus premier de l’affronter, qui plus est lorsque l’enfance est touchée, une autre question s’invite dès lors à la table des réflexions. Aussi dure soit-elle face à l’indicible, elle remonte, persistante, et s’impose : avec son passif émotionnel, cette femme a-t-elle vraiment eu le choix des armes ?
C’est là que réside toute la difficulté, à chaque verdict prononcé, pour la justice des hommes d’être rendue avec justesse. Or, terrible délégation de pouvoir, elle est décidée par ces mêmes hommes et, partant, conserve son inévitable part de failles, ce qui rend certaines décisions, dans leurs motivations, parfois inattendues. Mais la vérité prononcée est judiciaire. Dont acte !« Comment a-t-elle pu ? » Ceci, par contre, n’est qu’opinion.
« Aristote apprend que dans tous les drames,
le premier détail est la moitié de l’histoire. »
Xavier Magnée, Somme toute. Mémoire à la Barre,Avant-Propos, 2014, p. 47.
Dire toute la vérité, rien que la vérité
Le jugement qui ressort d’un tribunal est revêtu des oripeaux de la fameuse « vérité judiciaire », une vérité, ou plutôt une intime conviction, qui résulte d’une instruction et d’un procès. La sentence prononcée fige juridiquement la couleur donnée aux faits. La condamnation s’impose et, sans présager des voies de recours éventuellement ouvertes, les parties, comme leurs conseils, doivent s’incliner devant la décision, fondement de notre conception démocratique d’un État de droit.
« Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité ? » L’expression date du XIXe siècle, lorsque les écrivains réalistes prirent ce serment comme étant le leur, jurant ainsi que leurs romans n’enjoliveraient pas le réel, mais le retranscriraient de façon brute et fidèle.
La solennité de la formulation devint ensuite serment devant les cours et tribunaux. Mais cette vérité-là, individuelle, est encore tout autre que la « vérité judiciaire ». Et pour cause. Même si nous sommes tous témoins d’une même scène, ne dit-on pas communément dans le langage courant :« Chacun détient sa vérité » ? Alors, entre ce dont on se souvient, ce que l’on croit, ce que l’on pense, ce que l’on ressent, ce que l’on espère et ce que l’on prétend, portés par nos propres perceptions que nous pensons à juste titre légitimes, on ne fait que trop d’efforts pour se convaincre de la tenir ferme entre nos mains, cette fameuse vérité.
Une vérité somme toute relative, mais que l’avocat se doit de défendre de manière ultime, car elle est celle de son client, fruit de leurs colloques singuliers. Le verdict ne sera donc au final qu’une juxtaposition de vérités. Alchimie particulière de ce mets sans recette aux assises, c’est indéniablement la qualité du dossier, la composition de la cour, la sensibilité des jurés, l’attitude de l’accusé comme les plaidoiries respectives des avocats, ténors ou non, qui feront que le résultat sera plus satisfaisant pour l’une des parties, et immanquablement frustrant pour l’autre. C’est ça aussi, la justice. On est finalement bien peu de choses…
« La vérité, c’est une agonie qui n’en finit pas.
La seule vérité de ce monde c’est la mort.
Il faut choisir, mourir ou mentir.
Je n’ai jamais pu me tuer moi. »
Céline
La machine est en route
Femme au foyer ordinaire, mère de famille aimante, épouse responsable, voisine sans histoires, silencieuse, quasiment invisible, forcément, le drame dont elle est la source apparaît comme totalement inconcevable aux yeux de l’opinion publique. Et pourtant, cet acte terriblement extrême posé sur ses enfants par celle qui leur a donné la vie, Geneviève Lhermitte en est bien l’auteure. L’incompréhension populaire totale se double d’une absence a priori de mobile. Les crimes perpétrés ne se justifient ni par la vengeance, ni par la jalousie, ni pour assouvir des besoins pervers, ni par l’appât du gain. Pas de mobile apparent. Tout au long de l’instruction, comme devant ses juges, Geneviève Lhermitte dira qu’elle « aimait profondément ses enfants », qu’elle était juste « exténuée »…
Une fatigue qu’elle formalisera être essentiellement d’ordre psychologique. Dès sa première audition, quelques heures seulement après les faits, au service des soins intensifs du centre hospitalier de Jolimont-Lobbes où elle est hospitalisée, Geneviève Lhermitte, en dépression chronique depuis des années, affirme aux enquêteurs avoir été poussée à l’irrémédiable par le manque de soutien de son mari, souvent absent et insensible à sa détresse, et par le rôle particulièrement envahissant dans l’intimité du couple d’un certain docteur Michel Schaar, qui partage leur vie et leur demeure.
Extrait du Pro Justicia ‒ dossier 13/07 ‒ notices du parquet no NI30.LA.0011386/07 :
« Nous vous donnons connaissance des préventions mises à votre charge et reprises dans le réquisitoire verbal du procureur du Roi en date de ce mercredi 28 février 2007, confirmé par écrit ce jeudi 1er mars 2007 […].
Question : Pourquoi avez-vous pris la décision de tuer vos enfants ?
Réponse : Parce que j’étais à bout de désespoir, pas d’avenir financier. Nous avons acheté la maison où nous vivons, mais une partie a été achetée par le Dr Schaar. J’ai accepté cela par la force des choses. Il est avec nous depuis le premier jour où j’ai rencontré mon mari. Il ne nous a pas lâchés. On fait tout ensemble, même partir en vacances. Je n’avais plus aucune intimité avec mes enfants et mon mari.
Question : Avez-vous parlé à votre mari de ce problème ?
Réponse : Oui, j’ai dit plusieurs fois à Bouchaib que j’en avais marre de Michel. Il a dit que cela allait passer.
Question : Quand avez-vous pris la décision de tuer vos enfants ?
Réponse : C’est un coup de tête. Il était une heure. J’ai fermé mon GSM et j’ai entendu une voix qui m’a dit “maintenant, la machine est en route”. J’ai écrit une lettre à mon amie Valérie et je lui ai remis mes bijoux. J’ai donné l’adresse de mes sœurs. J’ai sonné chez Valérie pour la prévenir car sa boîte aux lettres était défectueuse. J’ai sonné et j’ai eu son conjoint. Je lui ai dit que j’avais mis quelque chose de très important dans la boîte aux lettres et qu’il devait lui remettre. Je suis ensuite descendue au Champion et je me suis directement rendue au rayon des couteaux. J’en ai pris deux, comme ça (Madame mime la longueur des couteaux : environ 30 cm).
Question : Que pensiez-vous faire avec ces couteaux ?
Réponse : Tuer mes enfants.
Question : Pourquoi ne pas les avoir laissés vivre ?
Réponse : Il n’y avait pas d’avenir pour eux. Je voyais très mal mon mari s’occuper des enfants, il ne sait pas s’en occuper. Il traite les enfants de petites salopes, petites crasses. La seule chose qu’il fait avec eux c’est ranger la cave ou ramasser des cailloux dans le jardin.
Question : Vous avez expliqué aux enquêteurs les circonstances de la mort des enfants. Vous vous êtes ensuite frappée vous-même. Pourquoi avoir appelé les secours si vous vouliez mourir ?
Réponse : Parce que je m’étais ratée. J’ai fait un, deux, trois et je me suis écrasée en m’enfonçant le couteau. Après, je sentais une ouverture et je sentais le couteau qui bougeait comme cela (de la main, Madame mime un mouvement de la droite vers la gauche). J’ai enlevé le couteau et je l’ai déposé sur le lit. Je suis descendue, j’ai pris le téléphone et j’ai fait le 100.
Question : Je vous inculpe du chef d’assassinat. Le procureur du Roi me demande de décerner mandat d’arrêt à votre encontre, qu’avez-vous à dire ?
Réponse : Je veux soigner ma tête… Je demande pardon à mes enfants, à mes sœurs, à Valérie et à mon mari.
[…]
Audition terminée à 13h32
Lecture faite
L’inculpée n’est pas en état de signer sa déclaration. »
Geneviève Lhermitte sera rapidement considérée comme étant hors de danger, ce qui sèmera le doute sur sa volonté réelle de se suicider. Les constatations médicales précisent :« [L]a patiente présente une plaie unique par instrument tranchant et piquant dans la région préthoracique gauche […] avec absence d’atteinte cardiaque […]. Elle présente en outre des petites plaies superficielles de la main gauche, à hauteur de l’index, liées aux manipulations de l’instrument utilisé […] son état physique permet son audition. »
« C’était les limites de ce qu’elle pouvait faire,
de ce qu’il était possible d’assumer qu’elle fasse,
qu’elle ferait, qu’elle avait fait aussi. »
Stéphanie Chaillou, Alice ou le choix des armes,Alma, 2016, p. 99.
Donner la vie et la reprendre
Élément non négligeable qui va ajouter à l’absence de clémence dans le chef des jurés : c’est une femme qui se trouve dans le box des accusés. Or, par nature, la femme est perçue dans l’inconscient collectif comme disposant, en principe, d’un potentiel « agressif » moins élevé que l’homme. L’idée qu’une femme, qui représente la maternité, la protection et la douceur, puisse être une tueuse, qui plus est de sa propre chair, méthodique, sans scrupules et sans états d’âme, est repoussée, presque tabou. Moralement et éthiquement, l’idée est socialement inconcevable.
L’affaire Fiona, l’infanticide de Berck, l’octuple infanticide de Dominique Cottrez, l’affaire Véronique Courjault, également appelée l’« affaire des bébés congelés », les enfants noyés de Ronchamp, le triple infanticide de Barc-le-Duc ou encore cette maman schaerbeekoise qui, en février 2016, a étranglé froidement son fils de 8 ans : les cas nombreux d’infanticide recensés ces dernières années infirment cependant cette conception du meurtre au féminin.
Fait surprenant : dans la majorité des cas, aucune suspicion de maltraitance n’est relevée. Le cadre familial des enfants est stable, la famille n’est connue ni des services sociaux ni des services de la justice. Par contre, les profils psychologiques des auteures font fréquemment état de personnes très isolées socialement. Un déni de grossesse non assumé vient parfois compléter le profil de ces personnalités criminelles complexes…
Le 27 mars 2015, Valérie Cornut (48 ans) fut reconnue, par la Cour d’assises de Namur, coupable d’infanticide sur son bébé qui venait de naître. Elle fit 8 mois de détention préventive avant d’être libérée dans l’attente de son procès. Aux assises, la défense plaida un état de stress aigu, confirmé par un collège d’experts judiciaires, ce pour quoi le procureur général lui-même, Vincent Macq, requit une peine de maximum cinq ans avec sursis probatoire total et la poursuite d’un suivi thérapeutique. Malgré l’évocation d’un lourd passé familial chaotique et l’absence de passé judiciaire en circonstances atténuantes, le jury populaire décida, à la surprise générale des parties et du parquet, d’infliger le double de la peine, soit dix ans fermes. Son verdict : coupable d’homicide volontaire avec intention de donner la mort sur un nouveau-né.
Une condamnation sévère qui illustre combien la société est réfractaire lorsque l’on touche à des enfants. Même si, en criminologie, le passage à l’acte recèle toujours une part de mystère, même si le trouble du jugement est aussi un facteur déterminant, il demeure très difficile de comprendre ce qui pousse une maman à franchir la ligne rouge de l’interdit. Au procès Lhermitte, le jury d’assises sera composé de huit femmes et de quatre hommes, ce qui pouvait induire plus de compréhension, parce que majoritairement féminin. Les avocats de la défense l’espéraient, mais il ne se montrera pas plus indulgent.
Suicide altruiste ?
Infanticide « salvateur », c’est ainsi que les spécialistes nomment ces meurtres d’enfants, en général suivis d’un suicide. Quand l’existence devient insupportable, se donner la mort est vu comme l’ultime solution pour échapper et faire échapper les siens à un monde que la personne perçoit comme hostile. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la littérature psychiatrique parle paradoxalement d’acte généreux dans le chef du parent infanticide, qui pense agir pour le « bien » de sa progéniture, envers laquelle un lien affectif fort est nourri.
Pour sa femme, ses enfants et ses parents, Jean-Claude Romand était un médecin brillant au parcours irréprochable. Un soir de janvier 1993, ce notable français sans histoires les tua et tenta de se suicider quelques heures plus tard, en avalant de l’essence et des médicaments, avant de mettre le feu au domicile familial de Prévessin. L’enquête révéla que l’homme n’étaitpas médecin et que toute sa vie professionnelle était bâtie sur le mensonge. De l’avis des experts, voulant épargner à ses proches l’opprobre public, il aurait préféré les soustraire à la souffrance d’une existence entière basculée dans la honte. Le 2 juillet 1996, il fut condamné par la Cour d’assises de l’Ain à la peine maximale : réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans. Son histoire inspirera un long-métrage adapté du roman d’Emmanuel Carrère et réalisé par Nicole Garcia, L’Adversaire. Un autre fait divers, survenu dans les années 1960, inspirera Jacques Rouffio pour la réalisation de son polar culte, Sept morts sur ordonnance, avec Michel Piccoli et Gérard Depardieu dans les rôles principaux. Un chirurgien français de province décima toute sa famille pour la soustraire à la calomnie.
Plus près de nous, le 10 mars 2016, les jurés de la Cour d’assises de Liège eurent à trancher dans un dossier extrêmement sensible. Rita Henkinet, une infirmière de 57 ans, était accusée de l’assassinat de ses deux enfants handicapés, Audrey (26 ans) et Arnaud (24 ans). Inquiète pour l’avenir de ses enfants, elle porta atteinte à leurs jours en réduisant en poudre, pour les endormir, des médicaments dans une mousse au chocolat servie au dîner, avant de se résoudre à les étouffer dans leur sommeil avec la couverture qui leur faisait office de doudou. Son frère Benoît, au courant depuis des mois du projet de sa sœur, fut également inculpé. Le soir du 1er mars, il aurait reçu un texto de cette dernière :« Je pense que ce soir, nous allons partir en voyage. » Rita Henkinet fut retrouvée inanimée, mais toujours vivante, allongée auprès d’eux. Le motif de l’irréparable plaidé par la défense : l’amour d’une mère lié au désespoir d’une femme, plongée dans une terrible angoisse existentielle depuis la naissance de ses enfants diagnostiqués infirmes moteurs cérébraux. L’avis du ministère public fut cependant autre :« Rita Henkinet n’était pas et n’est toujours pas dans un état de déséquilibre mental altérant son jugement. » Après quatre heures de délibérations, les jurés la condamnèrent à une peine de réclusion de dix ans et son frère Benoît à une peine de deux ans avec sursis pour non-assistance à personne en danger.
Dans Le Suicide (1897), devenu un classique des sciences sociales, le sociologue français Émile Durkheim explique que le suicide, dont on pourrait penser de prime abord qu’il est déterminé par des raisons relevant exclusivement de l’intime, est également éclairé par des causes sociales. Les situations dans lesquelles les personnes sont engagées exercent sur elles un pouvoir coercitif et extérieur. Dans sa typologie sociologique du suicide, il en définit plusieurs formes. Si dans le suicide égoïste, l’acte intervient lors d’un défaut d’intégration, la personne n’étant pas suffisamment rattachée aux autres pour rester en vie, dans le suicide altruiste intervient un excès d’intégration. Les individus ne s’appartiennent plus et peuvent en arriver à tuer et à se tuer par devoir. Ils ne voient plus d’avenir ni pour eux ni pour ceux qu’ils aiment par-dessus tout.
Parmi les suicides altruistes, il cite les homicides-suicides familiaux et les filicides-suicides, tel celui opéré par Geneviève Lhermitte. Dans une nouvelle audition datée du 31 mai 2007 (PV no 003150/2007), la prévenue déclare aux enquêteurs :« Vous me demandez comment je me sens aujourd’hui et je vous réponds que j’ai un mal de vivre quotidien. Je vis avec une énorme douleur de culpabilité. J’ai bien conscience que j’ai massacré mes enfants. Je me culpabilise également d’avoir raté mon suicide, d’être toujours vivante. Tous les jours, je fais un effort pour continuer à vivre, je survis. »
Ces homicides-suicides, qui surviennent cinq à six fois par an selon les statistiques, sont en réalité pathologique. Ils peuvent être masculins comme féminins et concernent le plus souvent des individus mélancoliques, au sens psychiatrique du terme, une mélancolie associée à un état dépressif grave, mais aussi, dans certains cas, à un délire paranoïaque, une schizophrénie, une psychose ou des syndromes délirants. Le déprimé voit l’avenir en noir, le mélancolique pense ne pas avoir d’avenir. C’est un état de damnation, un sentiment d’être déjà mort.