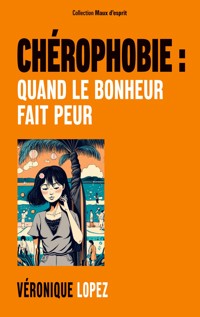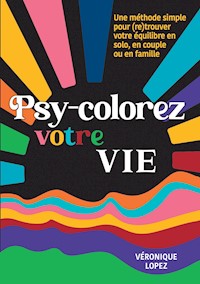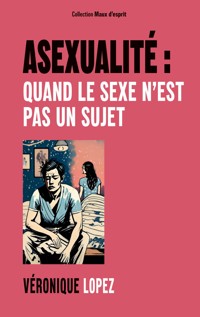
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Dans cet ouvrage, l'auteure nous invite à mieux comprendre l'asexualité, orientation encore méconnue et taboue. À travers des témoignages et une analyse fouillée, elle explore la réalité complexe des personnes ne ressentant pas d'attirance sexuelle. Loin des idées reçues, elle montre la diversité des expériences asexuelles : absence de pulsion charnelle, mais aussi quête d'amour profond et de lien social. Elle aborde avec empathie les difficultés spécifiques rencontrées par les asexuels : incompréhension, solitude, dépression. Leur parcours vers l'acceptation de soi est souvent semé d'embûches. Des pistes sont proposées pour un meilleur accompagnement thérapeutique de cette orientation singulière. Car comprendre n'est pas pathologiser : l'auteure appelle à considérer l'asexualité avec naturalité plutôt que comme un "problème à résoudre". Éclairant les débats actuels sur la diversité des identités, ce livre offre une lecture nuancée d'une sexualité atypique. Il nous rappelle en filigrane que l'épanouissement ne se résume pas au désir charnel. Et qu'être soi est la plus belle des libertés.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 77
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
"Le sexe n'est pas l'amour, ce n'est qu'un territoire que l'amour s'approprie."
Milan Kundera
SOMMAIRE
Avant-propos
Introduction
Histoire de l’asexualité
Principaux symptômes de l’asexualité
Les différents visages des asexuels
Des origines plurielles
L’asexualité à l’adolescence
L’asexualité chez les seniors
Asexualité au masculin et au féminin
Asexualité et homosexualité
Vivre sereinement son asexualité
Conclusion
Glossaire
Bibliographie
AVANT-PROPOS
Au fil de mes années de pratique de la psychothérapie, je n'ai que rarement reçu en consultation des patients se définissant spontanément comme asexuels. Cependant, plusieurs personnes sont venues me voir, inquiètes de leur manque de désir et d'appétit sexuel. Sans employer le terme "asexualité", leurs témoignages exprimaient une même détresse face à une intimité physique qu'ils ne parvenaient pas à éprouver.
Ces récits m'ont profondément touchée et ont éveillé ma curiosité pour ce trouble de l'identité sexuelle encore tabou. J'ai alors entrepris d'enquêter plus avant sur l'asexualité, afin de mieux accompagner ces patients en souffrance. Leurs confidences ont été le point de départ d'un cheminement personnel et professionnel pour mieux appréhender ce phénomène méconnu.
À travers leurs confidences parfois douloureuses, j'ai découvert le sentiment de marginalisation, l'incompréhension sociale, la solitude affective qui constituent le quotidien de nombre d'asexuels. J'ai aussi pu constater à quel point ce sujet restait tabou y compris dans le monde médical et psychologique.
C'est de ce constat qu'est né le projet de cet ouvrage. Mon ambition est d'apporter un éclairage nuancé sur l'asexualité, pour contribuer à une meilleure appréhension de cette orientation minoritaire. Je souhaite offrir des clés de compréhension et d'acceptation, tant aux personnes concernées qu'à leurs proches. Car comprendre l'asexualité, c'est avant tout comprendre la détresse de l'asexuel prisonnier de doutes et d'incompréhensions. C'est reconnaître sa quête légitime d'identité et de sens, au-delà des normes établies en matière de sexualité.
Les exemples concrets issus de ma pratique clinique viendront illustrer ce voyage au cœur de l'intimité asexuelle. Ils sont pour moi la plus belle des motivations pour percer les mystères de cette orientation méconnue et promouvoir l'acceptation bienveillante de la différence.
INTRODUCTION
La sexualité occupe une place prépondérante dans la société contemporaine. Une sexualité épanouie est souvent perçue comme indispensable à l'équilibre physique et mental. Pourtant, certaines personnes semblent échapper à cette quête de plaisir charnel et de rapport intime. On parle alors d'asexualité.
Concrètement, l'asexualité se définit comme l'absence ou la très faible intensité du désir sexuel. L'asexuel ne ressent pas ou très peu d'attirance pour les rapports physiques, que ce soit de façon situationnelle ou durable.
Je tiens à préciser que l'asexualité ne doit pas être confondue avec l'absence de sexualité ou de masturbation. Certains asexuels pratiquent la masturbation pour des raisons de bien-être, et non par désir sexuel. L'asexualité renvoie à une absence de pulsion sexuelle dirigée vers autrui.
Longtemps ignorée, voire niée, cette absence d'appétence sexuelle intrigue et interroge. Comment comprendre qu’autrui puisse se passer de rapports intimes et s’en porter bien ? Le sexe ne serait-il pas ce besoin primaire si ancré dans la nature humaine ?
Dans cet ouvrage, je vais tenter d'apporter un éclairage nuancé sur cette orientation méconnue. J’aborderai ses manifestations concrètes, ses origines possibles, ses répercussions psycho-sociales. L'objectif est de mieux comprendre l'asexuel dans toute sa complexité, afin de favoriser l'acceptation de cette sensibilité singulière.
Je précise que les témoignages de patients présentés ne concernent pas uniquement des personnes s'identifiant pleinement et en permanence comme asexuelles. Certains récits illustrent des épisodes d'asexualité transitoire ou contextuelle chez des patients au parcours varié. Car l'asexualité peut surgir à différents moments d'une vie, de manière passagère ou durable. Mon propos est ici d'explorer l'asexualité sous toutes ses formes, qu'elle soit une orientation identitaire affirmée ou une phase temporaire. Dans tous les cas, ces exemples éclairent avec acuité le rapport complexe qu'entretiennent certains individus avec l'absence de désir sexuel, source de nombreux tourments.
Ensemble, nous explorerons les multiples façons d'habiter son corps et de vivre l'intime. Car il existe une infinité de manières légitimes de s'épanouir au-delà du seul prisme de la sexualité.
HISTOIRE DE L’ASEXUALITÉ
L’asexualité est un concept relativement récent qui commence seulement à être reconnu comme une orientation sexuelle à part entière. Longtemps ignorée, voire niée, cette absence de pulsion sexuelle intrigue et interroge. Qu’entend-on exactement par asexualité ? D’où vient ce terme ? Comment le distinguer d’autres troubles de la libido ? Clarifions ensemble les contours de cette notion.
QU’EST-CE QUE L’ASEXUALITÉ ?
Le terme « asexualité » désigne l’absence ou la très faible intensité du désir sexuel. L’asexuel ressent peu ou pas d’attirance pour les rapports physiques et intimes. Contrairement aux idées reçues, cette absence de pulsion sexuelle n’est pas nécessairement liée à un dégoût du sexe. Elle se distingue d’une frigidité, d’une inhibition ou d’une phobie des contacts physiques.
L’asexualité se définit avant tout comme une orientation, une façon d’être au monde et de nouer des liens sans passer par la sexualité. Bien que la majorité des asexuels ne ressentent pas le besoin d’avoir des relations sexuelles, certains peuvent néanmoins en avoir pour satisfaire leur partenaire ou répondre à une pression sociale. Mais le désir spontané n’est pas là.
On estime qu’environ 1% de la population serait asexuelle. Mais ce chiffre est probablement sous-évalué en raison du manque de visibilité du phénomène et de la complexité des études réalisées (questions gênantes, anonymat relatif, etc.).
Les degrés d’asexualité sont variés : certaines personnes sont asexuelles de manière transitoire, d’autres de façon durable, voire définitive. Cette orientation recouvre donc des réalités humaines diverses.
ORIGINE DU TERME ASEXUALITÉ
Si l’absence de désir sexuel a toujours existé, le terme « asexualité » est relativement récent. Il a été formulé pour la première fois en 1977 par le psychologue Michael Storms dans un article intitulé « Theories of sexual orientation1 ».
Michael Storms souhaitait proposer un modèle plus nuancé des orientations sexuelles, au-delà du clivage hétérosexualité/ homosexualité. Son échelle incluait l’asexualité comme absence de désir pour l’un ou l’autre sexe.
Mais ce n’est que dans les années 2000 que le terme a commencé à se populariser, notamment via des forums en ligne rassemblant des personnes s’identifiant comme asexuelles. En 2001 est fondé le Asexual Visibility and Education Network2 (AVEN), qui joue un rôle clé dans l’émergence d’une conscience communautaire asexuelle. L'asexualité est d'ailleurs représentée par la lettre A dans l'acronyme LGBTQIA+. Elle possède aussi son propre drapeau, qui est composé de quatre bandes horizontales :
- Noir en haut : représente l’asexualité
- Gris pâle : la zone grise entre sexualité et asexualité
- Blanc : l'allié, ami ou partenaire sexuel d'un asexuel
- Violet : la communauté asexuelle
Le noir, le gris et le blanc symbolisent l'asexualité elle-même dans toutes ses nuances. Le violet est la couleur de la fierté asexuelle.
Ce drapeau est devenu un symbole important pour les personnes asexuelles, leur permettant de s'identifier visuellement et de gagner en visibilité. Il est régulièrement brandi lors des marches des Fiertés ou porté sous forme de bracelet ou de badge par les activistes asexuels.
Progressivement, l’asexualité s’affirme comme une orientation à part entière et non comme un trouble à soigner. Les personnes asexuelles revendiquent leur droit à ne pas ressentir d’attirance sexuelle sans être pathologisées. Depuis 2011, le 6 avril est même devenu la Journée internationale de la visibilité de l'asexualité.
Ces avancées symbolisent la lutte des asexuels pour une meilleure acceptation et intégration dans la société.
LES NUANCES DE L’ASEXUALITÉ
L'asexualité est un spectre, et certaines personnes se situent dans une zone grise entre l'allosexualité (attraction sexuelle envers d’autres personnes, quelles que soient leurs orientations sexuelles) et l'asexualité complète. C'est notamment le cas des demisexuels et des grissexuels (ou greysexuels).
Les demisexuels ne ressentent une attirance sexuelle que dans le cadre d'une relation affective très forte. Ils ont donc besoin d'un lien émotionnel profond avant de désirer une relation physique. Quant aux grissexuels, ils éprouvent une attirance sexuelle occasionnelle ou d'intensité limitée. Leur degré de libido et d'intérêt pour le sexe se situe entre celui des asexuels et celui des allosexuels.
Ces orientations nuancées montrent que l'asexualité est un continuum. De nombreuses expériences et réalités différentes coexistent sous ce terme. Demisexuels et grissexuels partagent des points communs avec les asexuels, mais ont un rapport au sexe et à la séduction plus complexe. Ils peuvent rencontrer de l'incompréhension et se sentir "pas assez asexuels" pour faire partie de cette communauté. Pourtant, ils y ont toute leur place s'ils s'y reconnaissent.
DIFFERENCIER ASEXUALITÉ ET AUTRES TROUBLES
Il est important de distinguer l’asexualité de quelques troubles pouvant impliquer une baisse de libido :
L'anaphrodisie
Il s’agit d’une difficulté ou incapacité à ressentir du désir sexuel. Causée par des facteurs hormonaux, psychologiques ou relationnels, elle se distingue de l’asexualité, car elle est vécue comme problématique par la personne.
Les dysfonctions sexuelles
Elles désignent des troubles physiques empêchant l’accomplissement des rapports sexuels (vaginisme, éjaculation précoce...). Là encore, la personne ressent de la frustration.
L’hypoactivité sexuelle
Ce trouble se caractérise par un faible désir pour le sexe en lien avec des causes médicales ou psychologiques. À la différence de l’asexualité, l’hypoactivité s’accompagne d’une détresse.