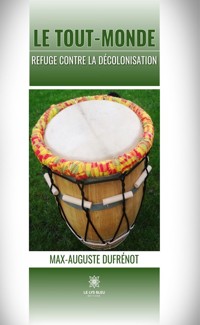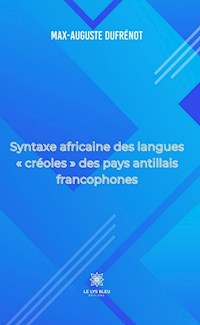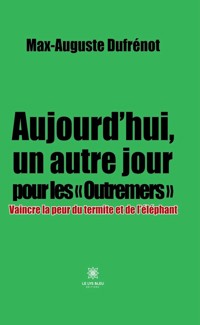
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Une fois de plus,
Max-Auguste Dufrénot examine de manière critique la situation des territoires français d’outre-mer. Il analyse les rapports entre la France, souvent désignée comme la Métropole, et ses dépendances extracontinentales qui sont actuellement gérées comme des colonies. Sa conclusion est que le statut de ces territoires doit évoluer et que la France doit véritablement embrasser sa nature multiculturelle. Il préconise d’accorder une autonomie républicaine à tous ces territoires, à l’image de ce qui est envisagé pour la Corse, et de faire face à cette responsabilité plutôt que de continuer à fuir cette réalité.
À PROPOS DE L'AUTEUR
D’origine martiniquaise,
Max-Auguste Dufrénot a exercé en tant que professeur d’université au Togo et à Haïti, avant de pratiquer le métier de pharmacien biologiste en Martinique et en France. Militant nationaliste, son expérience lui a permis d’écrire plusieurs ouvrages pour analyser la situation de son peuple dans un monde en pleine mutation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max-Auguste Dufrénot
Aujourd’hui, un autre jour
pour les « Outremers »
Vaincre la peur du termite
et de l’éléphant
Essai
© Lys Bleu Éditions – Max-Auguste Dufrénot
ISBN : 979-10-422-1864-5
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Avant-propos
Quand je parle des outremers, je veux dire les colonies, car, dans la longue histoire coloniale, ces deux vocales sont synonymes ; mais le lecteur se doute bien qu’officiellement l’État français n’a plus de colonies nominativement ; mais elles sont camouflées sous des vocables astucieux de départements et de territoires d’outre-mer.
Quand je parle du termite ou de l’éléphant, je parle du même personnage dont j’ai déjà exposé les métamorphoses dans un livre intitulé « le termite et l’éléphant (1), écrit du temps où nous avions créé avec Lucienne Charles, Cyr Chelim, Gouai dit Diop et d’autres camarades, le CPM (Congrès Populaire martiniquais » (2). C’est évidemment le colonialisme sous ses deux visages : celui de la gauche au pouvoir, le termite sournois qui ronge le siège sur lequel vous êtes assis, ou celui de la droite brutale comme un éléphant qui met les pieds dans la porcelaine.
Mais l’objectif de l’un ou l’autre, quel que soit le masque, est le même.
Pour amadouer les plus rétifs il fait des arrangements institutionnels donc qui ne sont qu’administratifs et ne changent en rien le mode de relation politique entre la France et les Outremers, ainsi désignés par les hexagonaux.
L’analyse de l’évolution des positions des nationalistes montre au fil des années un effacement des revendications allant dans le sens d’une décolonisation ;ils tendent à se lancer dans une demande utopique, qui a débuté depuis soixante-dix ans, d’égalité réelle entre la France et les outremers.
On navigue dans un « État dit de droit » qui s’obstine à renouveler au fil des années les mêmes types de fausses solutions à des problèmes qui persistent avec obstination.
Le plus curieux est que beaucoup de nationalistes, de guerre las, et habités par la peur des deux monstres, termite ou éléphant, laissent leurs convictions anticolonialistes au vestiaire pour se lancer à la conquête d’honneurs dans un système qui entretient chez eux un état schizophrénoïde.
Devant ce constat, nous pouvons avoir deux attitudes très différentes ; nous dire que, finalement notre avenir est personnellement assuré, et que nous n’avons rien à cirer des problèmes des autres. Chacun doit voir midi à sa porte. J’aurais pu avoir cette attitude, ayant un bon métier, une bonne retraite et travaillant de surcroît, mes enfants ont tous atteints un haut niveau de formation et occupent tous des postes enviables.
Mais il y a l’autre attitude ; celle qui vous assaille quand vous aimez votre pays, votre peuple, qu’on le traite de tous les noms, c’est votre peuple ; il honore l’épopée de vos ancêtres ; et vous vous sentez, quoi que vous fassiez, membre de cette communauté.
Il nous semble que la désillusion des nationalistes vient peut-être du fait qu’ils ont posé le problème de notre avenir de façon émotionnelle. Ils ont considéré et je parle surtout des indépendantistes dont j’ai fait partie et qui demeure mon utopie, que définir d’abord le statut pouvait entraîner systématiquement une amélioration des infrastructures ; alors qu’il fallait faire l’inverse : définir les objectifs attendus au niveau des infrastructures pour choisir une évolution ou un statut.
Il y a ce psychologue de la Guadeloupe qui jette un pavé dans la mare, dans un essai en affirmant qu’après avoir observé la société guadeloupéenne il a conclu (et c’est le titre de son ouvrage) que « le Guadeloupéen se cache pour être français » (79).
Notre étude se propose, sans prétention, de sonder ces phénomènes et en fin d’analyse, de savoir si ce processus d’extinction du nationalisme est inexorable et conduit vers l’accomplissement total de la créolisation voulue des africains réduits en esclavage et de leurs descendants.
Nous essaierons de voir sans complaisance les moyens utilisés par l’État pour parvenir à ses fins. Et nous tâcherons de déduire à partir des objectifs des infrastructures le statut juridico-politique qui sied aux outremers.
Demeurer esclave sous toutes ses formes et s’y complaire, est-ce une malédiction qui nous frappe ?
I
Panorama de nos sociétés coloniales
Les sociétés post-esclavagisées coloniales du Nouveau Monde ont une caractéristique : elles ne sont pas nées de la colonisation.
1. Ces sociétés ne sont pas nées de la colonisation
Ou du moins elles n’ont pas connu ce phénomène au départ.
En effet, le fait de coloniser est d’aller en intrus chez quelqu’un et de prendre possession de son territoire, d’y ériger ses lois et d’imposer des droits et des devoirs ; cela se fait par l’usage de la force.
En revanche, on peut affirmer que la France a colonisé les peuples asiatiques ; une véritable course à la voracité s’engage entre les grandes puissances :
En 1887, c’est lacréation de l’Union indochinoise qui réunit sous contrôle français la Cochinchine, le Cambodge, le Laos, l’Annam, le Tonkin.
L’Angleterre répond en 1888 : en étendant son Empire du Pakistan actuel à la Birmanie, aux États malais et au nord de l’île de Bornéo (Sarawak et Bornéo-Septentrional).
Dans les années 1890 : De nouvelles puissances s’immiscent dans les rivalités impériales : le Japon prend possession de l’île de Formose après sa victoire sur la Chine en 1895 ; en 1898, les Allemands s’installent à Qingdao en Chine et les États-Unis arrachent les Philippines à l’empire espagnol en déclin.
1910 : L’achèvement du chemin de fer du Yunnan reliant Haiphong à Yunnansen concrétise la stratégie française d’entrée sur le marché chinois.
La France s’est battue pour conquérir ces territoires, elle en a administré certains, leur a donné des dénominations ; et ces pays se sont libérés par la lutte pour retrouver leur souveraineté ; le 7 mai 1954 est un jour de désastre pour l’armée française ; après 57 jours de combat, elle est défaite à Dien Bien Fu et c’est la fin du rêve asiatique français.
Ces pays, envahis, ont connu la colonisation.
On peut dire aussi que quand Napoléon III a zieuté l’Algérie, il était un intrus dans ce lieu et qu’à partir de là a commencé l’envahissement de ce pays par les Français. Dès 1830, la conquête de l’Algérie est accompagnée d’une colonisation de peuplement forcée par la nécessité de ravitailler en vivres les forces militaires grandissantes : les militaires français deviennent des colons en s’installant et aménageant le territoire conquis. Les pionniers sont par la suite rejoints par des Corses ou des Alsaciens-Lorrains dont la région a été annexée par l’Allemagne en 1870, mais également par un petit nombre de migrants étrangers arrivant par vagues successives des pays méditerranéens frontaliers, surtout d’Espagne, mais aussi d’Italie et de Malte, possession britannique depuis 1814. Les ressortissants d’Allemagne et de Suisse sont également encouragés à prendre part à la colonisation.
Ce pays a été vraiment colonisé.
Napoléon III avait même fait une tentative au Mexique. La guerre du Mexique a eu comme élément déclencheur le projet colonial de l’empereur français de renverser le président mexicain et de transformer le Mexique en un empire latin hispanique.
De même l’Afrique a connu la colonisation ; les puissances européennes ont fait irruption sur le continent et ont même poussé l’outrecuidance jusqu’à faire un congrès à Berlin sous l’égide de Bismarck pour se partager ce continent en 1884.
Les Européens ont envahi des territoires habités par des peuples autochtones qui ont donc subi une colonisation.
Au regard de tous ces exemples, les compatriotes qui réfutent le fait que nos îles et pays n’étaient pas colonisés n’ont pas tout à fait raison par respect pour les Amérindiens qui, eux, ont subi la colonisation avant l’extermination ; mais ils ont raison quand ils disent que le peuplement actuel de nos îles et territoires n’est pas né d’une colonisation. On ne peut pas dire que la base de nos peuples actuels était les quelques dizaines d’Amérindiens encore esclaves quand le gros de nos ancêtres africains constituait le cheptel corvéable à merci.
*
*
2. Leur peuplement est le résultat d’une agression ; la mise en esclavage
On peut dire que la première rencontre des Européens même avec l’Afrique n’a pas été un acte de colonisation, mais plutôt un acte d’agression ; en effet leur but n’était pas encore l’exploitation des substances minérales (en dehors de l’or qui a permis de « dépotioler » les civilisations d’Amérique du Sud par les Espagnols quelques années auparavant.
Au départ, l’exploitation des populations d’Amérique était la coutume pour parvenir à avoir assez de main-d’œuvre pour cultiver les champs des colons. Mais ces populations étaient fières et refusaient la servitude ; c’est ainsi que dans chaque île existe pratiquement une colline des sauteurs, du haut de laquelle les Caraïbes se jetaient pour échapper à l’esclavage. En Martinique, il s’agit d’un gros rocher situé sur la route du prêcheur et dénommé tombeau des Caraïbes. On a entendu un raisonnement d’un franco colonisé jusqu’à la moelle, professeur d’université qui réfutait que ce soit le site d’où se jetaient les Caraïbes parce que la mer n’arrivait pas jusqu’à ses pieds ; n’importe quoi, les gars, s’ils voulaient se noyer, ils iraient tout droit à la mer ; mais ils se jetaient pour s’écraser au sol.
C’est un missionnaire de l’ordre des Dominicains, Bartholomé de la casas qui a eu la trouvaille la plus extravagante, confirmée par le pape catholique de l’époque, comme quoi ces Indiens avaient une âme, mais que sur le continent africain existaient des animaux à allure humaine, dénués d’âme, et qui étaient voués à l’esclavage.
Les européens s’intéressaient alors au commerce de l’ébène, à la traite des noirs qu’ils exportaient cers le nouveau Monde où ils avaient besoin de main-d’œuvre pour cultiver leurs plantations de canne à sucre, de coton et de tabac.
C’est leur supériorité en armement qui leur a permis de s’adonner à leur trafic ; des flèches contre des armes à feu, y pas photo. D’ailleurs quand un blanc apparaissait à la cour d’Abomey chez le roi Béhanzin, le gardien annonçait au roi sa venue en ces termes :
— « Zo di agué ! » c.-à-d., le feu est entré dans la maison ! (3)
Les peuples dont ils ont volé les terres en Amérique, ils n’ont pas pensé à les coloniser, mais à les faire disparaître ; l’élimination physique a été la règle. Le génocide des Amérindiens a duré de 1625 à 1660.
Le président Chirac qui était un admirateur de la civilisation des Taïnos des Grandes Antilles mettait souvent l’accent sur l’extermination de ces peuples par les Espagnols ; mais il se gardait bien de regarder vers les Petites Antilles où la France avait exercé toute sa nuisance en tuant les indigènes.
En effet, quand arrivèrent les premiers Européens, ils trouvèrent les Caraïbes installées dans les petites îles, notamment à Iounacaera, Martinique, Aichi, Marie-Galante, Karukera, Guadeloupe, Yurumein, Saint-Vincent, et surtout Waïtoikubuli, Dominique. Cette dernière île servait d’étape aux kalinagos venus du Venezuela.
Entre 1625 et 1636, le massacre de ces populations devient systématique. Ceux de Saint-Christophe sont visés les premiers puis ceux de Martinique et Guadeloupe.
À cette époque se dessinent déjà les deux visages de l’agresseur, l’éléphant qui met ses pieds dans la porcelaine et massacre, tandis que le termite passe la main sur le dos et signe des traités trompeurs de partage de territoires. Traités qui seront toujours rompus.
Notons que dans toutes ces guerres contre les indigènes, les européens, quoique concurrents, font alliance.
Les premiers esclaves aux Amériques furent les Amérindiens ; en effet, en 1654, dans l’île de la Tortue sous occupation française, sur 450 esclaves, 250 étaient amérindiens. Une partie de ces esclaves indiens proviennent de capture sur le continent américain, brésilien ou canadien.
Les Indiens se montrant particulièrement rétifs à l’esclavage, pour éviter une révolte de masse, les colons se décidèrent à les éliminer carrément physiquement.
Il y eut une époque où Africains et Indiens se retrouvèrent esclaves en même temps ; par exemple en 1671, ils étaient 2 % des esclaves de la Guadeloupe et 1 % de la Martinique. En Guyane, ce pourcentage est passé de 6 % en 1685 à 1 % en 1737. D’où le justificatif de certains compatriotes revendiquant des ancêtres caraïbes. Mais quand ils en font une exclusivité dans leur filiation ancestrale, il y a de toute évidence un problème dans la tête. Car pour que quelques dizaines d’Amérindiens résiduels aient pu avoir une descendance aussi nombreuse, il faut supposer qu’ils avaient des testicules nucléaires et infatigables en action 24/24.
De ce génocide du peuple amérindien, un groupe y échappa. Ce sont les garifunas, un groupe de métis caraïbes-nègre marron échappé des îles voisines et résidant à Saint-Vincent où ils seront combattus par les Anglais et déportés sur l’île de Roaten puis disséminés en Amérique centrale, à Bélize, au Guatemala et au Honduras.
Donc ni aux Antilles, ni à la Réunion, ni en Guyane, la population actuelle n’est issue d’un acte de colonisation ; les vrais colonisés sont morts ou parqués dans la région escarpée du nord-est de l’île de la Dominique ; leurs villages s’appellent Salika, Bataka, Sinaku, Kalinago Barana, Auté. Ils sont à peu près un millier et ne pèsent pas dans l’avenir de ces territoires.
La population actuelle de nos pays est issue des Africains réduits en esclavage et de métissage avec des colons, quelques Amérindiens, des Indiens des Indes et des minorités comme les Orientaux ; mais la composante majeure est afro descendante.
Notre histoire commence non pas sur les plantations, mais sur le continent de nos ancêtres africains. Pourtant on rencontre quelques hurluberlus qui affirment leur peuple être né là où leur a désigné le colon comme lieu de naissance, sur la plantation. Mais oui, ces gens-là existent chez nous et surtout chez des intellos.
Le formatage faisant du colon, notre maître a créé chez eux une curieuse manière de commencer leur histoire à leur mise en esclavage, et en faisant abstraction de ceux qui depuis des lustres avaient transmis leurs gamètes, c-à-d nos ancêtres africains.
L’Afrique et les colonies d’outremers ont en commun un lien : l’esclavage.
Nous n’oublions pas que l’esclavage a été pratiqué pendant plusieurs siècles par les Arabes avant que les Européens ne s’y adonnent ; nous condamnons évidemment cette pratique qui explique peut-être le peu d’affection que nous portons aux Arabes dans nos îles, renforcée par les sornettes que rapportaient sur les Algériens les Français en guerre contre eux.
Ouvrons une parenthèse pour consoler ceux qui veulent déculpabiliser les Européens en rappelant d’autres esclavages ayant eu lieu dans le monde ; ils excusent les maîtres, en disant que l’esclavage n’a pas été subi que par des noirs ; c’est vrai, sous la Rome antique, la plupart des esclaves étaient des gens capturés en temps de guerre ; les gens des contrées vaincues étaient réduits en esclavage à Rome. Ils étaient blancs comme les Romains.
Ces esclaves étaient soit des domestiques, soit des paysans, soit des esclaves publics.
Allons plus loin pour soulager ceux des nôtres qui veulent déculpabiliser les Européens d’avoir fait le trafic des nègres ; ils rappellent que le terme esclave vient du mot d’un peuple, les slaves ; eurêka, c’est vrai ! il y a même eu la traite des Slaves, l’esclavage des blancs.
Il y eut deux traites des Slaves : l’une occidentale, qui s’exerça en Europe centrale qui dura 300 ans du VIIIe siècle au XIe siècle et l’autre orientale qui sévit de la Pologne à l’Oural qui dura mille ans à partir du VIIIe siècle. Elles impliquèrent, l’une et l’autre, des peuples variés, qu’il s’agisse des victimes, les divers locuteurs de langues slaves répandus de la Bohême à l’Ukraine, de la Pologne aux Balkans, ou qu’il s’agisse, côté prédateurs, de nomades turco-mongols venus des steppes de l’Asie centrale, les Polovtses, les Khazars et surtout les Tatars, auxquels il faut ajouter les Francs et les Juifs rhadhânites des États carolingiens, les Varègues de Scandinavie, les Génois et les Vénitiens, enfin les Turcs ottomans, lesquels prirent part à ce crime contre l’humanité à diverses époques historiques.
Notons que la traite des Slaves fut contemporaine des traites arabo – et turco – musulmanes (4) qui ravagèrent l’Afrique Noire et de la guerre de course menée par les Barbaresques qui hantèrent les côtes de Méditerranée occidentale, un peu mieux connues grâce aux travaux de MM. Pétré-Grenouilleau, Tidiane N’Diaye, Robert C. Davis et Jacques Heers, pour ne citer que ceux-là. Le point commun qui rapproche ces différentes traites est qu’elles ont toutes, à quelques rares exceptions près, été entreprises pour le compte d’États musulmans qui furent les plus gros demandeurs d’esclaves de l’histoire.
Avoir reconnu l’existence d’autres traites n’absout pas les Européens de leur crime qui a duré 400 ans ; mais nous, c’est cette traite-là qui nous intéresse, car elle nous concerne en tout premier lieu.
La population actuelle de nos îles et territoires, à l’exception de la Guyane, a grandi avec un apport massif d’Africains réduits en esclavage.
Des contacts sexuels entre maîtres et esclaves, une classe de mulâtres a vu le jour, d’ailleurs jamais reconnu par leurs pères leucodermes.
D’ailleurs un certain nombre de mots utilisés en créole antillais dénotent de l’activité sexuelle intense des békés avec des femmes originaires de la Côte des esclaves ; en effet, le béké est celui qui dit (be) ké (écarte) ; le verbe copuler koké vient de ce que disait les békés aux femmes adja-ewé, c.-à-d. ko (soulève) et ké (écarte) ; et le sexe de la femme est devenu la chose (nya) qu’on soulève (koko), c.-à-d. kokonya qui donne counia puis coucoune. Même la putain (manawa) est la traduction de la question posée par les femmes aux blancs (ma na wo a ?) c.-à-d. (est-ce que je te donne ?)
La masse noire a toujours été très importante ; elle s’est toujours révoltée ; et si dans les petits territoires ces révoltes ont été vite contenues, dans des îles plus grandes, elles ont eu du succès ; par exemple, à la Jamaïque en 1739. 1740, la révolte des Coromantes a abouti à la partition de l’île par un traité entre anglais et marrons (5) ; et en Haïti, la victoire a été totale sur l’armée de Napoléon Bonaparte, et ce pays a été la première République noire indépendante en janvier 1802 (6).
Puis vint la fameuse abolition de l’esclavage en 1848 et les anciens esclaves refusant d’aller retravailler pour leurs anciens maîtres, les colons firent venir des Indiens de l’Inde des comptoirs français et quelques Chinois ; et même des Africains libres ; tout ce monde avait des contrats de travailleurs libres.
Tous ces apports de populations ont contribué à la formation de nos peuples qui restent néanmoins très marqués du sceau de l’Afrique. Pourtant, malgré cela, se manifestent des comportements d’évitements, de contre-investissements pour parler comme les psychologues, de fuite, générés par le bouchardage du colon, pour diluer dans un génome imaginairement modifié l’apport évident de l’Afrique. Cela crée malheureusement des comportements schizophrénoïdes.
Il s’est institué une échelle de valeurs totalement ubuesque basée sur le degré de coloration de la peau ; et entre les blancs et les noirs, s’est instituée une classe de mulâtres et de noirs affranchis qui n’ont qu’un but, jouer le rôle des blancs. Le célèbre écrivain haïtien Jean Fouchard dans son livre « les marrons de la liberté » (7) a montré toute l’incongruité de cette échelle en démontrant que des familles de mulâtres ont une origine nègre et que des familles noires ont des origines blanches ; en Haïti, cette différence a été atténuée du fait que c’est tout le peuple, noirs et mulâtres, qui ont participé à la révolution ; de sorte que s’il y eut des généraux noirs célèbres comme Toussaint Louverture et Dessalines, il y en eut également des mulâtres célèbres comme Pétion et Boyer.
Il faut noter que la valeur de l’homme en fonction de sa pigmentation se retrouve dans tous les pays que le blanc a colonisés ; on retrouve cette échelle de couleur en Inde où les femmes noires se blanchissent le visage avec de la farine.
*
*
3. Celui qui attaque essaie toujours de légitimer ses actes d’agression
Ainsi les Français ont été les champions du dénigrement de la race noire. Le siècle dit des Lumières en France est caractéristique pour les sornettes et les contrevérités émises par leurs éminents cerveaux, de Gobineau à Montaigne en passant par Jules Ferry, Victor Hugo ; même Karl Marx justifia ce commerce. Et des philosophes allemands s’y sont adjoints comme Hegel. Beaucoup de ceux dont on nous a abreuvés des chefs-d’œuvre à l’école de la République.
Nous devons citer la mémoire d’un grand homme de culture noir, Antênor Firmin (8) ; c’est un Haïtien ; il est normal que l’occident ne le porte pas en exergue ; mais c’est lui qui a fermé le clapet de Gobineau qui prônait la supériorité de la race blanche ; c’est lui qui fut l’un des premiers à relier l’Afrique et les Afros descendants à la civilisation égyptienne.
L’essai sur l’inégalité des races retrace l’histoire des civilisations du monde ordonnée par le concept de race. Gobineau pose l’existence de trois races, jaune, blanche et noire, et conçues comme inégalitaires.
La race blanche a le monopole de la beauté, de l’intelligence et de la force ; au sein de celle-ci existe la super race aryenne ; la race noire se voit attribuer des facultés pensantes médiocres ou même nulles ; elle a certains sens plus développés que les deux autres races comme le goût et l’odorat ; son infériorité se trouve dans l’exacerbation de ces sens ; quant à la race jaune, Dieu n’a voulu n’en faire qu’une ébauche et elle aussi est encline à la médiocrité.
Anténor Firmin (8) lui avait répondu spontanément par un essai intitulé « De l’égalité des races humaines. Anthropologie positive ».
Le livre aborde notamment la problématique de la différence de taille du cerveau. L’intelligence ne saurait être déterminée par la taille du cerveau, mais le serait davantage par les qualités, encore peu connues, du tissu cérébral.
Le livre expose aussi les réalisations des Noirs à travers l’histoire. Selon lui, les mathématiques auraient ainsi été inventées par les Noirs égyptiens.
Firmin démontre l’inanité des conclusions d’anthropologues tels que Paul Broca de la Société d’anthropologie de Paris et d’un autre membre de la Société d’Anthropologie : « Si la morphologie du nez constitue, comme l’affirme le savant M. Topinard, un de ces caractères qui établissent un passage de l’homme au singe, il y a tout lieu de croire que la race blanche caractérisée leptorhinienne est un type intermédiaire entre les singes et l’homme ».
Dans son discours de Dakar, l’ex-président Sarkosy a montré au grand jour son indigence intellectuelle par le mépris qu’il porte aux noirs en s’inspirant d’une pensée de Hegel comme quoi l’homme africain n’est pas encore entré dans l’histoire ; cela montre, entre autres, à quel point sa culture est pétrie d’ignorances volontairement entretenues par leurs savants et notamment leurs égyptologues qui ont caché les preuves de toute la science noire des Égyptiens anciens (9).
La période d’esclavage a vu cette pratique s’appliquer au Nouveau Monde, mais également sur le continent africain et notamment au Sénégal par la France. Ce territoire a toujours été considéré par l’État français comme un prolongement de l’Hexagone, car en plus de Gorée, des villes telles que Dakar, Rufisque et Saint-Louis devinrent des communes françaises et leurs habitants auront la nationalité française.
Un autre modèle du genre a été l’assassinat du colonel Kadafi. Des États occidentaux ont prétexté que le guide de la Jamarya libyenne tirait sur sa population, pour obtenir un mandat de l’ONU pour voler au secours du peuple libyen.
Il fallait à tout prix justifier sa disparition forcée ; pourtant si l’on passe en revue toutes les facilités accordées à cette population par le gouvernement de Kadhafi, on se pose toujours des questions :
En effet, en Lybie, les gens ne payaient pas d’impôts, l’essence était à vil prix pour ne pas dire gratuite, le logement était gratuit ; une jeune mariée recevait un pécule pour démarrer sa vie de famille. Mais surtout, Kadhafi arrivait à maintenir d’une main de fer toute tentative de brigandage dans sa région.
La seconde raison est la plus plausible : Kadafi allait sortir le continent africain des griffes de l’occident ; il avait déjà lancé un premier satellite de communication pour l’Afrique, et au-delà de la prouesse technologique, c’est de l’unité africaine dont il est question, quelques jours après le sommet de l’OUA. Déjà, 40 des 53 pays africains soutiennent le projet et 35 d’entre eux avaient envoyé une délégation à l’assemblée de la RASCOM.
Ce qui allait définitivement sceller son sort c’est le dinar or, une invention révolutionnaire. En 2009, le colonel Kadhafi, alors président de l’Union africaine, propose aux États du continent africain de passer à une nouvelle monnaie indépendante du dollar américain : le dinar or pour ne plus utiliser le dollar pour les transactions pétrolières. L’Égypte, le Nigeria, la Tunisie ou encore l’Angola étaient prêts à changer de monnaie ; mais surtout, pour les Français, il allait créer une monnaie unique africaine, sortant les Africains du système du franc CFA pour les francophones. Là, enlever la gestion de la monnaie des quatorze États qu’elle maintient sous son joug c’était la goutte d’eau de trop qui allait faire chuter la France au vingtième rang des nations développées (10). D’où son assassinat camouflé en opération sauvetage du peuple qui n’avait rien demandé comme secours.
On a dit aussi que c’est parce que Kadhafi avait prêté de l’argent à Sarko pour sa campagne électorale ; sur ce point nous laissons le tribunal dépatouiller l’affaire qui est en cours.
En tout cas nous avons noté les agissements d’un drôle de philosophe champion dans la transmission d’information mensongère au détriment de la cible que vise l’occident, BHL.
Il faut savoir que le propre de l’occident est l’affabulation ; des éléments civilisationnels occidentaux ont été usurpés à l’Afrique ; et au lieu de reconnaître leurs méfaits, les Occidentaux vont s’évertuer à masquer la vérité sous des raisons fallacieuses impliquant toujours la force.
Les religions ont été à la manœuvre ; ainsi on nous a fait avaler que Moïse a reçu des Tables de la loi imprimées de la main de Dieu sur le mont Sinaï ; alors qu’en fait il y a un doute ; en effet les dix commandements font partie des quarante-deux lois de la Mât égyptienne que Moïse et les siens connaissaient pour avoir vécu dans ce pays.
Et il y a ainsi une foulée d’arguments et de trucs inventés que l’on nous a fait avaler.
*
*
4. L’abolition par la France a été un calcul pour la survie de la main-d’œuvre servile au service des maîtres
Pourquoi je précise abolition par les puissances européennes, dont la France ? C’est parce que l’idée d’abolir ce trafic n’a pas germé initialement dans leurs cerveaux.
La première proclamation d’abolition de l’esclavage date du 13e siècle ; en effet c’est dans l’empire mandingue que fut promulguée dans les années 1236 la charte du Mandé qui est en fait la première déclaration des droits de l’homme dans un État africain, l’Empire du Mali de Soundiata Keita.
La charte du Manden, charte du Mandé, charte de Kouroukan Fouga, ou encore, en langue malinkée, Manden siguikan, est la transcription d’un contenu oral, lequel remonterait au règne du premier souverain Soundiata Keïta qui vécut de 1190 à 1255. Elle aurait été solennellement proclamée le jour de l’intronisation de Soundiata Keïta comme empereur du Mali à la fin de l’année 1236. Il existe plusieurs textes de la Charte, celui décrit en annexe (11) qui remonterait à 1222 et provient des travaux menés à partir des années 1970 par Wa Kamissoko et Youssouf Tata Cissé, est inscrit en 2009 par l’UNESCO sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Ce texte est considéré par les Mandenkas (peuples qui ont en commun la langue mandingue) comme l’une des plus anciennes références concernant les droits fondamentaux. Sa reconnaissance par l’UNESCO devrait confirmer sa valeur juridique et sa portée universelle.
La seconde fois, c’est un roi d’un grand royaume esclavagiste africain, le royaume du Dahomey qui en 1818 a proposé d’arrêter ce commerce qu’il trouvait inhumain ; ce roi s’appelait Adandozan (12), fils d’Agonglo ; le colonialisme a tellement influencé les élites béninoises qu’elles appellent ce roi « Daa Gbolometon » (roi inconnu), qui est décrit par l’histoire adoptée par les Béninois pour sa cruauté ; le trafiquant d’esclave de Ouidah, métis brésilien Chacha 1ER, qui tirait sa richesse de ce commerce, très influent et très riche a financé le frère d’Adandozan pour qu’il fasse un coup d’État à son demi-frère ; il s’appelait Gakpé et a régné sous le nom de Guezo (13).
Pendant longtemps on a brandi chez nous le schœlcherisme qui a été la doctrine qui a abouti à l’abolition ; mais avec le recul et l’apport des archives, nous avons pu nous rendre compte qu’il s’agissait d’une vaste supercherie.
Notre artiste Imanyé Dalila Daniel a publié dans un de ses livres les 13 autres articles et décrets qui ont été signés concernant l’abolition ; sur le site de l’Assemblée nationale française vous ne trouverez mentionné que le premier article tant les autres sont écœurants et indignes d’une nation qui fit sienne la devise « liberté, égalité, fraternité ». Je mets à la fin de cet écrit la citation de l’auteure (14).
L’abolition a une explication de celles et ceux qui veulent minimiser le caractère trompeur de l’acte : beaucoup de compatriotes endoctrinés par les discours de la mère patrie qui arrange l’histoire comme d’habitude à son honneur vous diront qu’avec l’ère industrielle le travail des esclaves n’était plus nécessaire.
L’explication réelle est toute différente :
Les révoltes d’esclaves et leur résistance se sont toujours manifestées depuis le début de la traite, d’abord sur le sol africain ; nous avions dans d’autres écrits mentionné l’existence de villages témoins de la résistance aux esclavagistes en Afrique de l’Ouest notamment au Togo les villages de Ahokpè et de Agbodranfo et au Bénin celui de Dotoenou(15). Certains compatriotes se gaussent en disant que cela correspondait aux jacqueries qui se produisaient en France et qui étaient vite réduites par la force armée des colons.
Rappelons que la plupart des jacqueries en France depuis le moyen âge ont été le fait des paysans qui se révoltaient contre les traitements fiscaux que leur imposait l’État ; Colbert a connu sa jacquerie en 1675 et au 21e siècle le mouvement des gilets jaunes a les caractéristiques d’une jacquerie ; les révoltes d’esclaves étaient au contraire le fait d’hommes et de femmes qui se battaient pour recouvrer leur liberté.
Nous avons démontré avec notre co-auteure Lucienne Charles dans un livre que la résistance à l’esclavage constitue l’épopée de toutes les nations de la Caraïbe (16). Certaines révoltes ont partiellement abouti comme à la Jamaïque, au Surinam et totalement en Haïti.
*
*
5. L’assimilation a été concomitante de l’esclavage
En effet, l’État français était conscient que le moteur principal de l’être humain c’est sa culture. Sa culture assure sa cohésion à son groupe ethnique.
Donc dès l’arrivée des Africains dans les colonies les deux actions des békés seront :
a. Séparer ceux provenant d’une même région
Ainsi, toute communication était en principe perturbée ; et même le langage devait être celui utilisé par les maîtres. D’où l’erreur des premiers créolistes pensant le méfait accompli et s’obstinant à voir dans notre langue du petit français. En effet nous exposons dans un autre livre sur la syntaxe africaine des créoles antillais que les trafiquants français prélevaient des gens de régions éloignées territorialement, mais pratiquement identiques culturellement et donc linguistiquement ; mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir (17).
b. Les créoliser ; c’est-à-dire vider leur cerveau de leurs valeurs culturelles ancestrales et les remplacer par les valeurs des colons békés
Ce terme a été dévoyé par un philosophe martiniquais Edouard Glissant qui s’est rendu inconsciemment complice du processus d’assimilation.
En vérité, la créolisation était un acte de soumission ; en effet les esclaves étaient créolisés pendant deux ans, c.-à-d. qu’ils devaient laisser au vestiaire leurs coutumes et apprendre celles de leurs maîtres ; au bout de ces deux ans, ils pouvaient recevoir les corrections d’usage (18).
Cette notion de créolisation, à l’origine du mal-être de nos peuples, car accompagnée du dénigrement systématique de la race noire, a été dévoyée par Edouard Glissant qui a cru résoudre le problème de la décolonisation de son pays en banalisant la créolisation et en faisant le point de départ d’une identité rhizomique. Il va jusqu’au Tout monde (19).
Le dévoiement de l’acte de créolisation et son attribution d’un contenu acceptable sont le signe d’un début de normalisation par les colons de ce qui n’est pas normal ; et pour cela, trouver l’aide d’intellectuels colonisés formatés à l’école de la pensée française est une aubaine considérable. Si on lui déroule le tapis rouge, ses compatriotes vont s’incliner du fait de leur complexe d’infériorité vis-à-vis du blanc qu’ils ont intégré par la force du milieu.
L’un des premiers outils de l’assimilation était le baptême imposé par le Code noir (20) aux propriétaires d’esclaves. Nous rappelons le rôle primordial de l’église au plus haut sommet dans ce trafic humain ; en effet, le Pape Nicolas V, Tommaso Parentucelli (1398 – 1455), autorisa l’esclavage le 8 janvier 1454. Ce 8 janvier 1454, le jour où le Vatican déclara la guerre sainte contre l’Afrique dans sa bulle papale « Romanus Pontifex ». Une bulle papale est un document à travers lequel le pape pose un acte juridique important.
L’assimilation reposait en partie sur ceux que l’on appelait les nègres de maison, par opposition aux nègres des champs ; ce sont ces nègres de maison qui représentaient ce qu’il fallait devenir pour se rapprocher de la civilisation. De nos jours ils constituent une classe de résistance à la recherche de liberté ; ce sont les chiens de garde du système colonial, aussi bien aux Antilles et dans le Pacifique qu’en Afrique.
Pour les personnes qui aiment le cinéma, cette espèce de nègre de maison est représenté dans le film Django par ce vieux serviteur qui se fait la conscience de son maître et dénoncé tous les autres noirs qui ne se plient pas à la règle de l’habitation. Nous sommes soulagés quand, à la fin du film, Django le fait exploser en dynamitant la maison dans laquelle il gît au sol, blessé aux jambes.
*
*
6. L’assimilation a toujours été contournée par les captifs
En effet pour ce qui est de la première action de séparation ; les maîtres ne connaissaient pas la composition des régions africaines en aires culturelles. Ces aires sont bien délimitées sur le continent, nous l’avons exposé dans un ouvrage intitulé « Visages d’Afrique dans la Caraïbe » (17) ; si bien que la majorité des esclaves amenés au début provenaient de l’endroit appelé par les trafiquants français la côte des esclaves, en effet elle s’identifie à l’aire culturelle adja-éwe ; malgré la diversité des langues, elles sont du même groupe et les locuteurs se comprenaient d’une ethnie à l’autre. Les Français ramassaient des éwés, des minas, des fons, des adangbes, des ouatchis, des adjas, des popos, des aradas et plus tard des kabyès du nord Togo qui commerçaient avec ces ethnies du sud. Pour eux c’étaient des gens de provenance différente ; mais en fait c’étaient des gens dont les langues étaient de la même famille et qui se comprenaient entre eux.
Nous avons en lisant la grammaire créole de l’abbé germain, une liste d’esclaves déposés en Guadeloupe eu début du 17e siècle. Ils ont encore leurs noms d’origine et 60 pour cent d’entre eux sont des adja-ewe (21).
Arguer que la provenance des esclaves était plus diversifiée, c’est cacher le fait que les Français étaient des petits navigateurs dont le lieu de prélèvement était réduit à une portion congrue qu’ils appelaient eux-mêmes la côte des esclaves ; et puis, ils avaient le Sénégal. Mais en suivant les survivances culturelles, les ethnies sénégalaises n’ont rien laissé aux Antilles ; cependant leur présence est manifeste dans les îles Gullah, des îles situées en Caroline du Sud et en Géorgie. Leurs ancêtres ont été placés là pour cultiver non pas la canne ou le coton, mais le riz. On fait venir leurs ancêtres de Sierra Leone, mais je remarque qu’ils dansent comme les wolofs !
Si bien qu’au final ils inventèrent une langue adaptée à leur culture en bâtissant sur la syntaxe des langues adja-ewe dans une proportion de soixante pour cent, une langue gbe à vocabulaire français, et ceci dans toutes les îles colonisées par la France (22).
Cette thèse, nous l’avons démontrée en comparant grâce à la grammaire créole de Bernabé et Pinali, le créole antillais au mina. Avant nous Suzanne Combhaire Sylvain (23) avait déduit que le créole haïtien venait de l’éwé ; et bien avant Fernand Charles Pressoir(24), auteur haïtien avait suggéré un rapport avec le fon.
Au fond, nous avons tous les trois raison, car ces trois langues sont des langues (gbe) du même groupe adja-éwé. Avec donc la même syntaxe et une petite variation dans certains mots.
Ce qui est évident c’est qu’au niveau du langage il n’y a pas eu assimilation, mais les esclaves ont contourné le problème en greffant sur la syntaxe de leur langue le vocabulaire phonétiquement africanisé du français.
Cela fait partie aussi du Détour pratiqué par les peuples antillais décrit par Edouard Glissant dans son « Discours antillais » (25).
L’Afrique après l’abolition de l’esclavage a connu un prolongement par le travail forcé dont Houphouët Boigny obtint l’arrêt. Le travail forcé a été pratiqué par la France dans ses colonies d’Afrique de 1900 à 1946.
Le travail forcé était organisé par le canal de plusieurs dispositions légales et imposées dans le cadre du code de l’indigénat : la réquisition, la prestation (rétablissement pour les Africains de la corvée abolie par la Révolution), la main-d’œuvre pénale, l’obligation de cultiver, la deuxième portion du contingent. Jusqu’en 1919 le recrutement se fit par la force.
À la différence de l’esclave, le travailleur forcé recevait parfois un salaire, mais ce salaire était dérisoire. Les conditions de travail étaient généralement inhumaines, entraînant une forte mortalité.
C’est la loi du 11 avril 1946, prise à l’initiative du député Félix Houphouët-Boigny, qui enclencha le processus mettant un terme à cette pratique qui ne cessa guère avant 1952 26).
Certaines coutumes ont apparu, résultant de l’adaptation de l’esprit antillais à la culture française ; ainsi la coutume des chanter-noël est spécifique à nos peuples ; et l’esprit de dérision s’y donne à cœur joie. On peut y voir une résurgence africaine si l’on fait le rapprochement avec le gospel des noirs américains.
L’art culinaire résulte également d’un mélange culturel avec une forte tendance à se rapprocher de la cuisine africaine : usage du piment, des beignets de légumes appelés acra chez nous et qui sont les petits frères des acara de la côte des esclaves en Afrique du beignet chez les adja-éwé et akla, au Brésil.
Le matété de crabes fait avec de la farine de manioc se retrouve également en Afrique de l’Ouest. Le migan de fruit à pain pour un nom plein de signification pour les Africains réduits en esclavage ; ils n’avaient pas grand-chose à manger de la part du maître et à partir du fruit à pain ils préparèrent un mets en disant « mi gan » c.-à-d. « nous sommes sauvés » en langue Gbe.
Nous avons adapté également la recette du boudin ; chez nous, à la différence du français qui est dur, il est assez mou et très épicé.
Et toutes les dénominations que l’on retrouve dans différents domaines, culinaires, folkloriques sont de dénominations africaines ; nous avons développé ces notions dans deux tomes intitulés « Visages d’Afrique dans la Caraïbe » (27)
*
*
7. Mais des processus d’acculturation ont eu lieu notamment aussi bien en Afrique que dans les autres colonies
L’Afriqueavait déjà connu sous la traite arabo-musulmane un vaste courant d’acculturation religieuse ; en effet, le fait que tant de pays africains soient de confession musulmane résulte d’une imposition de cette religion islamique par la force, en certains endroits, mais aussi par le biais des commerçants haoussas, soninkés, peuls, dioulas qui fréquentaient l’empire du Ghana, si bien que ce pays comptera une élite politique musulmane autour d’un roi demeuré « animiste ».
La colonisation voitl’imposition de religions européennes et l’anathème jetée sur toutes les valeurs spirituelles ancestrales africaines présentées comme sauvages et chargées de sorcellerie comme le vaudou.
Cette imposition de la religion catholique notamment a été encouragée au plus haut sommet de l’église, par le pape lui-même ; on peut dire que l’Église a participé activement à l’œuvre coloniale aussi bien en Afrique que dans le nouveau monde.
Les œuvres d’art qui pour les Africains sont souvent des objets de cultes sont dérobés par les étrangers qui vont les placer dans leurs musées nationaux et édicter des lois empêchant leur restitution à leurs propriétaires légitimes.
Dans les écoles africaines, plus tard, comme dans celles des îles, l’usage de la langue locale était interdit sous peine de punition.