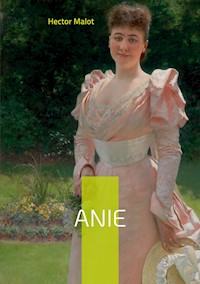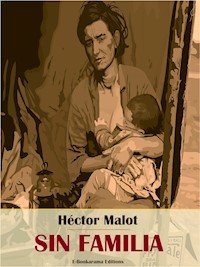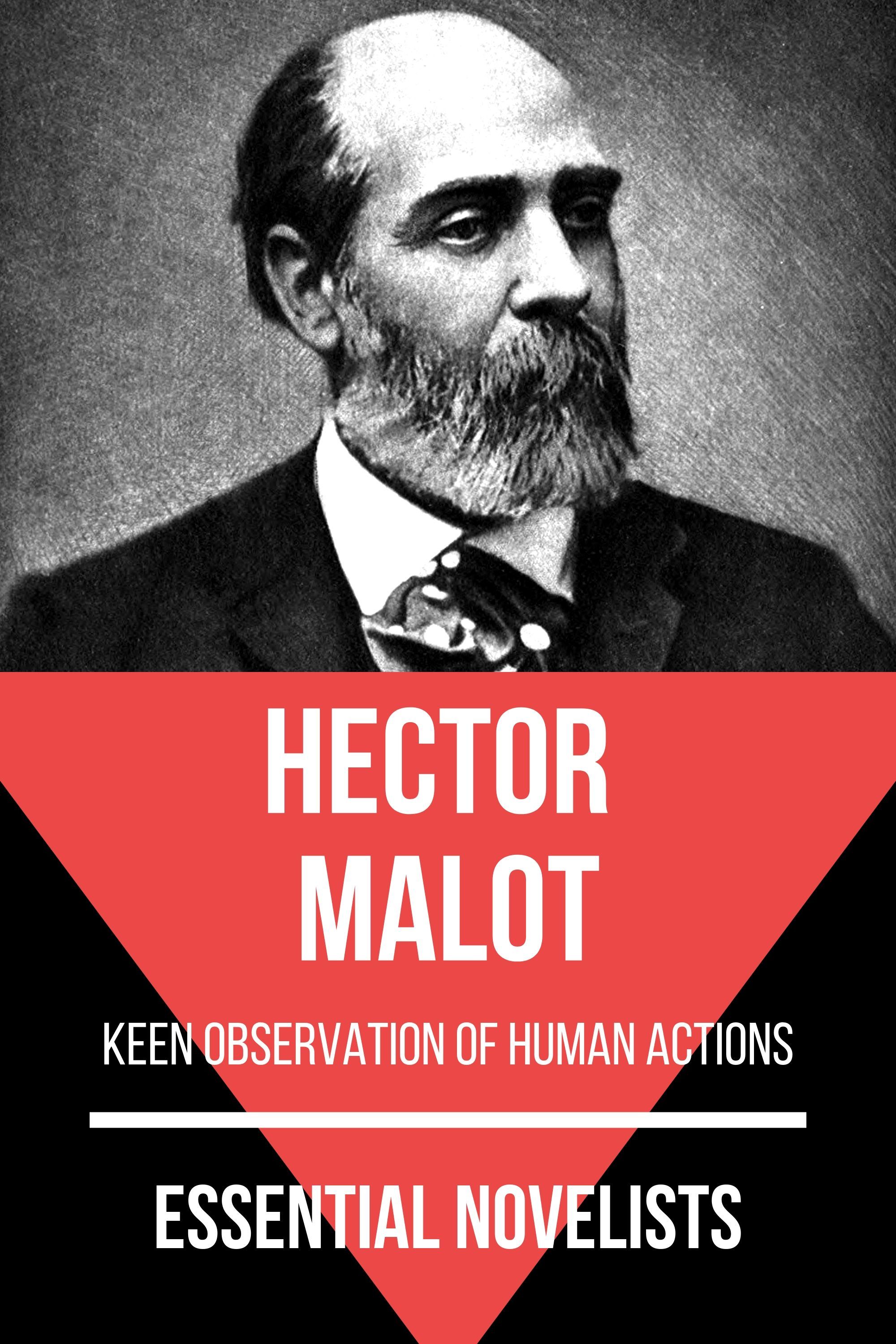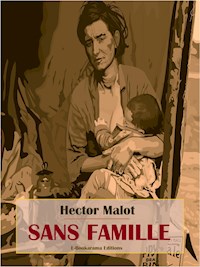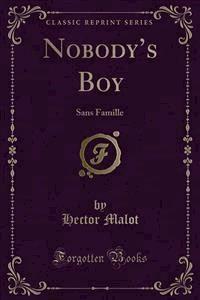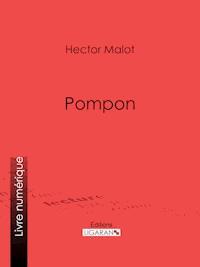2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
En bon père de famille soucieux du bien-être de sa progéniture, monsieur Adeline cherche une situation qui lui permettra de gagner l'argent nécessaire au mariage de sa fille. Aussi, lorsque Constant Adeline débarque à Paris, sa figure respectable en fait la victime idéale de Frédéric et Raphaëlle. Les deux compères comptent bien abuser de sa bonne volonté en lui proposent de devenir président d'un cercle de jeu : Le Grand International. L'honnêteté, la candeur et l'intégrité bien établie de M. Adeline servira de vitrine à leurs tricheries et diverses manigances. Mais quand les masques seront tombés, M. Adeline pourra-t-il duper sa propre conscience? Le gentilhomme saura-t-il refuser les compromissions et les sommes providentielles ?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Baccara
Pages de titrePremière partieIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXDeuxième partieI - 1II - 1III - 1IV - 1V - 1VI - 1VII - 1VIII - 1IX - 1Troisième partieI - 2II - 2III - 2IV - 2V - 2VI - 2VII - 2VIII - 2IX - 2X - 1XIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXQuatrième partieI - 3II - 3III - 3IV - 3V - 3Page de copyrightHector Malot
Baccara
Première partie
I
Ouvrez les livres de géographie les plus complets, étudiez les cartes, même celle de l’état-major, et vous y chercherez en vain un petit affluent de la Seine, qui cependant a été pour la ville qu’il traverse ce que le Furens a été pour Saint-Étienne et l’eau de Robec pour Rouen. – Cette rivière est le Puchot. Il est vrai que de sa source à son embouchure elle n’a que quelques centaines de mètres, mais si peu long que soit son cours, si peu considérable que soit le débit de ses eaux, ils n’en ont pas moins fait la fortune industrielle d’Elbeuf.
Pendant des centaines d’années, c’est sur ses rives que se sont entassées les diverses industries de la fabrication du drap qui exigent l’emploi de l’eau, le lavage des laines en suint, celui des laines teintes, le dégraissage en pièces, et il a fallu l’invention de la vapeur et des puits artésiens pour que les nouvelles manufactures l’abandonnent ; encore n’est-il pas rare d’entendre dire par les Puchotiers que la petite rivière n’a pas été remplacée, et que si Elbeuf n’est plus ce qu’il a été si longtemps, c’est parce qu’on a renoncé à se servir des eaux froides et limpides du Puchot, douées de toutes sortes de vertus spéciales qui lui appartenaient en propre. Mauvaises, les eaux des puits artésiens et de la Seine, aussi mauvaises que le sont les drogues chimiques qui ont remplacé dans la teinture le noir qu’on obtenait avec le brou des noix d’Orival.
Le Puchot a donc été le berceau d’Elbeuf ; c’est aux abords de ses rives basses et tortueuses, au pied du mont Duve d’où il sort, à quelques pas du château des ducs, rue Saint-Étienne, rue Saint-Auct qui descend de la forêt de la Londe, rue Meleuse, rue Royale, que peu à peu se sont groupés les fabricants de drap ; et c’est encore dans ce quartier aux maisons sombres, aux cours profondes, aux ruelles étroites où les ruisseaux charrient des eaux rouges, bleues, jaunes, quelquefois épaisses comme une bouillie laiteuse quand elles sont chargées de terre à foulon, que se trouvent les vieilles fabriques qui ont vécu jusqu’à nos jours.
Une d’elles que le Bottin désigne ainsi : « Adeline (Constant), O. *, médailles A. 1827 et 1834, O. 1839, 1844, 1849, 1re classe Exposition universelle de 1855, hors concours 1867, médaille de progrès Vienne, nouveautés pour pantalons, jaquettes et paletots », occupe, impasse du Glayeul, une de ces cours étroites et noires ; et c’est probablement la plus ancienne d’Elbeuf, car elle remonte authentiquement à la révocation de l’Édit de Nantes, quand les grands fabricants qui avaient alors accaparé l’industrie du drap en introduisant les façons de Hollande et d’Angleterre, forcés comme protestants de quitter la France, laissèrent la place libre à leurs ouvriers. Un de ces ouvriers se nommait Adeline ; il était intelligent, laborieux, entreprenant, doué de cet esprit d’initiative et de prudence avisée qui est le propre du caractère normand : mais, lié par l’engagement que ses maîtres lui avaient imposé, comme à tous ses camarades, d’ailleurs, de ne jamais s’établir maître à son tour, il serait resté ouvrier toute sa vie. Libéré par le départ de ses patrons, il avait commencé à fabriquer pour son compte des draps façon de Hollande et d’Angleterre, et il était devenu ainsi le fondateur de la maison actuelle ; ses fils lui avaient succédé ; un autre Adeline était venu après ceux-là ; un quatrième après le troisième, et ainsi jusqu’à Constant Adeline, que le nom estimé de ses pères, au moins autant que le mérite personnel, avaient fait successivement conseiller général, président du tribunal de commerce, chevalier puis officier de la Légion d’honneur, et enfin député.
C’était petitement que le premier Adeline avait commencé, en ouvrier qui n’a rien et qui ne sait pas s’il réussira, et il avait fallu des succès répétés pendant des séries d’années pour que ses successeurs eussent la pensée d’agrandir l’établissement primitif ; peu à peu cependant ils avaient pris la place de leurs voisins moins heureux qu’eux, rebâtissant en briques leurs bicoques de bois, montant étages sur étages, mais sans vouloir abandonner l’impasse du Glayeul, si à l’étroit qu’ils y fussent. Il semblait qu’il y eût dans cette obstination une religion de famille, et que le nom d’Adeline formât avec celui du Glayeul une sorte de raison sociale.
Pour l’habitation personnelle, il en avait été comme pour la fabrique : c’était impasse du Glayeul que le premier Adeline avait demeuré, c’était impasse du Glayeul que ses héritiers continuaient de demeurer ; l’appartement était bien noir cependant, peu confortable, composé de grandes pièces mal closes, mal éclairées, mais ils n’avaient besoin ni du bien-être ni du luxe que ne comprenaient point leurs idées bourgeoises. À quoi bon ? C’était dans l’argent amassé qu’ils mettaient leur satisfaction ; surtout dans l’importance, dans la considération commerciale qu’il donne. Vendre, gagner, être estimés, pour eux tout était là, et ils n’épargnaient rien pour obtenir ce résultat, surtout ils ne s’épargnaient pas eux-mêmes : le mari travaillait dans la fabrique, la femme travaillait au bureau, et quand les fils revenaient du collège de Rouen, les filles du couvent des Dames de la Visitation, c’était pour travailler, – ceux-ci avec le père, celles-là avec la mère.
Jusqu’à la Restauration, ils s’étaient contentés de cette petite existence, qui d’ailleurs était celle de leurs concurrents les plus riches, mais à cette époque le dernier des ducs d’Elbeuf ayant mis en vente ce qui lui restait de propriétés, ils avaient acheté le château du Thuit, aux environs de Bourgtheroulde. À la vérité, ce nom de « château » les avait un moment arrêtés et failli empêcher leur acquisition ; mais de ce château dépendaient une ferme dont les terres étaient en bon état, des bois qui rejoignaient la forêt de la Londe ; l’occasion se présentait avantageuse, et les bois, la ferme et les terres avaient fait passer le château, que d’ailleurs ils s’étaient empressés de débaptiser et d’appeler « notre maison du Thuit », se gardant soigneusement de tout ce qui pouvait donner à croire qu’ils voulaient jouer aux châtelains : petits bourgeois étaient leurs pères, petits bourgeois ils voulaient rester, mettant leur ostentation dans la modestie.
Cependant cette acquisition du Thuit avait nécessairement amené avec elle de nouvelles habitudes. Jusque-là toutes les distractions de la famille consistaient en promenades aux environs le dimanche, aux roches d’Orival, au chêne de la Vierge, en parties dans la forêt qui, quelquefois, en été, se prolongeaient par le château de Robert-le-Diable jusqu’à la Bouille, pour y manger des douillons et des matelotes. Mais on ne pouvait pas tous les samedis, par le mauvais comme par le beau temps, s’en aller au Thuit à pied à la queue leu leu ; il fallait une voiture ; on en avait acheté une ; une vieille calèche d’occasion encore solide, si elle était ridicule ; et, comme les harnais vendus avec elle étaient plaqués en argent, on les avait récurés jusqu’à ce qu’il ne restât que le cuivre, qu’on avait laissé se ternir. Tous les samedis, après la paye des ouvriers, la famille s’était entassée dans le vieux carrosse chargé de provisions, et par la côte de Bourgtheroulde, au trot pacifique de deux gros chevaux, elle s’en était allée à la maison du Thuit, où l’on restait jusqu’au lundi matin ; les enfants passant leur temps à se promener à travers les bois, les parents parcourant les terres de la ferme, discutant avec les ouvriers les travaux à exécuter, estimant les arbres à abattre, toisant les tas de cailloux extraits dans la semaine écoulée.
Cependant ces mœurs qui étaient alors celles de la fabrique elbeuvienne s’étaient peu à peu modifiées ; le bien-être, le brillant, le luxe, la vie de plaisir, jusque-là à peu près inconnus, avaient gagné petit à petit, et l’on avait vu des fils enrichis abandonner le commerce paternel, ou ne le continuer que mollement, avec indifférence, lassitude ou dégoût. À quoi bon se donner de la peine ? Ne valait-il pas mieux jouir de leur fortune dans les terres qu’ils achetaient, ou les châteaux qu’ils se faisaient construire avec le faste de parvenus ?
Mais les Adeline n’avaient pas suivi ce mouvement, et chez eux les habitudes, les usages, les procédés de la vieille maison étaient en 1830 ce qu’ils avaient été en 1800, en 1870 ce qu’ils avaient été en 1850. Quand la vapeur avait révolutionné l’industrie, ils ne l’avaient point systématiquement repoussée mais ils ne l’avaient admise que prudemment, au moment juste où ils auraient déchu en ne l’employant pas ; encore, au lieu de se lancer dans des installations coûteuses, s’étaient-ils contentés de louer à un voisin la force motrice nécessaire à la marche de leurs métiers mécaniques. Bonnes pour leurs concurrents, les innovations, mauvaises pour eux. Ils étaient les plus hauts représentants de la fabrique en chambre, ils voulaient rester ce qu’ils avaient toujours été. Les manufactures puissantes qui s’étaient élevées autour d’eux ne les avaient point tentés. Ils n’enviaient point ces casernes vitrées en serres et ces hautes cheminées qui, jour et nuit, vomissaient des tourbillons de fumée. C’était le chiffre d’affaires qui seul méritait considération, et le leur était supérieur à ceux de leurs rivaux. Ils pouvaient donc continuer la vieille industrie elbeuvienne, celle où les nombreuses opérations de la fabrication du drap, le dégraissage de la laine en suint, la teinture, le séchage, le cardage, la filature, le bobinage, l’ourdissage, le tissage, le dégraissage en pièces, le foulage, le lainage, le tondage, le décatissage s’exécutent au dehors dans des ateliers spéciaux ou chez l’ouvrier même, et où la fabrique ne sert qu’à visiter les produits de ces diverses opérations et à créer la nouveauté au moyen de l’agencement des fils et du coloris.
Ailleurs qu’à Elbeuf cette prudence et ces façons de gagne-petit eussent peut-être amoindri et déconsidéré les Adeline, mais en Normandie on estime avant tout la prudence et on respecte les gagne-petit. Quand on disait : « Voyez les Adeline », ce n’était pas avec pitié, c’était avec envie quelquefois et le plus souvent avec admiration. Avec eux on écrasait les imprudents qui s’étaient ruinés, aussi bien que les parvenus fils d’épinceteuses ou de rentrayeuses qui, au lieu de continuer le commerce de leurs pères, jouaient à la grande vie dans leurs hôtels ou leurs châteaux.
Constant Adeline, le chef de la maison actuelle, était le digne héritier de ces sages fabricants ; d’aucun de ses pères on n’avait pu dire aussi justement que de lui : « Voyez Adeline » ; et on l’avait dit, on l’avait répété à satiété, à propos de tout, dans toutes les circonstances : – dès le collège où il s’était montré intelligent et studieux, bon camarade, estimé de ses professeurs, le Benjamin de l’aumônier, heureux de trouver en lui un garçon élevé chrétiennement et de complexion religieuse, ce qui était rare dans la génération de 1830 ; – plus tard au tribunal de Commerce, au conseil général et enfin à la Chambre, où il était un excellent député, appliqué au travail, vivant en dehors des intrigues de couloir, ne parlant que sur ce qu’il connaissait à fond et alors se faisant écouter de tous, votant selon sa conscience tantôt pour, tantôt contre le ministère, sans qu’aucune considération de groupe ou d’intérêt particulier pesât sur lui.
À un certain moment cependant, ce modèle avait inspiré des craintes à ses amis. Après avoir travaillé quelques années dans la fabrique paternelle en sortant du collège, il avait fait un voyage d’études en Allemagne, en Autriche, en Russie, et alors on avait dit, à Elbeuf, qu’une femme galante l’accompagnait ; un acheteur en laines les avait rencontrés dans des casinos, où Adeline jouait gros jeu.
– Un Adeline ! Était ce possible ? Un garçon si sage ! La « femme galante », on la lui pardonnait ; il faut bien que jeunesse se passe. Mais les casinos ?
Épouvanté, le père avait couru en Allemagne, ne s’en rapportant à personne pour sauver son fils. Celui-ci n’avait fait aucune résistance, et, soumis, repentant, il était revenu à Elbeuf : il s’était laissé entraîner ; comment ? il ne le comprenait pas, n’aimant pas le jeu ; mais humilié d’avoir perdu son argent, il avait voulu le rattraper.
On l’avait alors marié.
Et depuis cette époque, il avait été, comme ses amis le disaient en plaisantant, l’exemple des maris, des fabricants, des juges au tribunal de Commerce, des conseillers généraux, des jurés d’exposition et des députés.
– Voyez Adeline !
Que lui manquait-il pour être l’homme le plus heureux du monde ? N’avait-il pas tout, – l’estime, la considération, les honneurs, la fortune ? – et une honnête fortune, loyalement acquise si elle n’était pas considérable.
II
C’était dans le gros public qu’on parlait de la fortune des Adeline, là où l’on s’en tient aux apparences et où l’on répète consciencieusement les phrases toutes faites sans s’inquiéter de ce qu’elles valent ; il y avait cent cinquante ans que cette fortune était monnaie courante de la conversation à Elbeuf, on continuait à s’en servir.
Mais, parmi ceux qui savent et qui vont au fond des choses, cette croyance à une fortune, solide et inébranlable, commençait à être amoindrie.
À sa mort, le père de Constant Adeline avait laissé deux fils : Constant, l’aîné, chef de la maison d’Elbeuf, et Jean, le cadet, qui, au lieu de s’associer avec son frère, avait fondé à Paris une importante maison de laines en gros, si importante qu’elle avait des comptoirs de vente au Havre et à Roubaix, d’achat à Buenos-Ayres, à Moscou, à Odessa, à Saratoff. Celui-là n’avait que le nom des Adeline ; en réalité, c’était un ambitieux et un aventureux ; la fortune gagnée dans le commerce petit à petit lui paraissait misérable, il lui fallait celle que donne en quelques coups hardis la spéculation. S’il avait vécu, peut-être l’eût-il réalisée. Mais, surpris par la mort, il avait laissé de grosses, de très grosses affaires engagées qui s’étaient liquidées par la ruine complète – la sienne, celle de sa femme, celle de sa mère. À la vérité, elles pouvaient ne pas payer, mais alors c’était la faillite. Elles s’étaient sacrifiées et l’honneur avait été sauf. Pour acquitter ce lourd passif, la femme avait abandonné tout ce qu’elle possédait, et la mère, après avoir vendu ses propriétés et ses valeurs mobilières, s’était encore fait rembourser par son fils aîné la part qui lui revenait dans la maison d’Elbeuf. Constant eût pu résister à la demande de sa mère ; en tout cas, il eût pu ne donner que la moitié de cette part ; il l’avait donnée entière, autant par respect pour la volonté de sa mère que pour l’honneur de son nom qui ne devait pas figurer au tableau des faillites.
Un commerçant ne retire pas douze cent mille francs de ses affaires sans embarras et sans trouble, cependant Constant Adeline avait pu s’imposer cette saignée sans compromettre, semblait-il, la solidité de sa maison ; s’il s’en trouvait un peu gêné, quelques bonnes années combleraient ce trou ; il n’avait qu’à travailler.
Mais justement à cette époque avait commencé une crise commerciale qui dure encore, et un changement radical dans la mode qui, à la nouveauté en tissu foulé, fabriqué à Elbeuf depuis trente ou quarante ans avec une supériorité reconnue, a fait préférer le tissu fortement serré en chaîne et en trame, fabriqué en Angleterre et à Roubaix ; – au lieu des bonnes années attendues, les mauvaises s’étaient enchaînées ; au lieu de travailler pour combler le trou creusé, il avait fallu travailler pour qu’il ne s’agrandit pas démesurément, et encore n’y avait-on pas réussi. Car, pour la nouveauté beaucoup plus que pour les autres industries, les crises sont une cause de ruine : il en est d’elle comme des primeurs, elle ne se garde pas. Une pièce de drap uni, noir, vert, bleu, reste en magasin sans autre inconvénient pour le fabricant que la perte d’intérêt de l’argent avancé et du bénéfice manqué. Une pièce de nouveauté ne peut pas y rester, le mot même le dit. Lorsque tout a été disposé par le fabricant pour faire une étoffe neuve : mélange de la matière, laine de telle espèce avec telle autre laine ou avec la soie ; teinture de ces laines et de cette soie ; filature selon l’effet cherché ; tissage d’après certaines combinaisons déterminées pour le dessin, la force, la façon ; apprêt spécial aussi varié dans ses combinaisons que celles de la teinture, de la filature et du tissage – il faut que cette étoffe soit vendue à son heure précise et pour la saison en vue de laquelle elle a été créée, ou la saison suivante elle ne vaut plus rien. Et comment la vendre quand, par suite d’une raison quelconque, crise commerciale ou changement de mode, les acheteurs pour lesquels on a travaillé ne se présentent pas ? La mode, le fabricant doit la pressentir, et tant pis pour lui s’il est sa victime. Mais il n’a pas la responsabilité des crises commerciales, il n’est ni ministre ni roi, et ce n’est pas lui qui souffle ou écarte les maladies, les fléaux et les guerres.
Député, Constant Adeline ne pouvait plus s’occuper de sa fabrique comme au temps de sa jeunesse, du matin au soir, mais, pour passer ses journées au palais Bourbon, il ne l’abandonnait pas cependant. Elbeuf n’est qu’à deux heures et demie de Paris ; tous les samedis, après la séance, il prenait le train, et à neuf heures et demie il arrivait chez lui, où il trouvait les siens qui l’attendaient. Ce jour-là, le dîner retardé était un souper ; et tout le monde, même la vieille madame Adeline, âgée de quatre-vingt-quatre ans, infirme et paralysée des jambes, qu’on appelait « la Maman », même la jeune Léonie Adeline, fille de Jean Adeline, qui depuis la mort de sa mère demeurait chez son oncle, ne se mettait à table qu’après que le chef de la famille s’était assis à sa place, vide pendant toute la semaine ; les visages étaient épanouis, et, malgré le retard qui avait dû aiguiser les appétits, on causait plus qu’on ne mangeait.
– Comment vas-tu, la Maman ?
– Bien, mon garçon ; et toi ? Il y a encore eu du tapage à la Chambre cette semaine, tu as dû te brûler les sangs, c’est vraiment trop arkanser.
La Maman, restée vieille Elbeuvienne, avait conservé, sans se donner la peine de les modifier en rien, ses usages d’autrefois aussi bien pour la toilette que pour le langage et le parler : en été ses robes étaient en indienne de Rouen, en hiver en drap d’Elbeuf ; ses bonnets de tulle noir garnis de dentelle étaient à la mode de 1840, la dernière à laquelle elle eût fait des concessions ; et avec un accent traînant elle lâchait les mots de patois normand et les locutions elbeuviennes avec lesquelles elle avait été élevée, sans s’inquiéter des effarements de ses petites-filles qui, n’osant pas la reprendre en face, insinuaient adroitement que les chaircuitiers s’appelaient maintenant des charcutiers, que les castoroles sont devenues des casseroles, et que « ne rien faire de bon » vaut mieux qu’arkanser, qu’on doit traduire pour ceux qui n’entendent pas le normand.
Il fallait qu’Adeline expliquât pourquoi on avait arkansé, car la Maman, assise du matin au soir dans son fauteuil roulant, lisait l’Officiel d’un bout à l’autre, et elle ne lui faisait grâce d’aucun détail, plus au courant de ce qui se passait à la Chambre que bien des députés. Quand son fils avait parlé, elle discutait les raisons que ses contradicteurs lui avaient opposées et les pulvérisait, s’indignant que tout le monde n’eût pas voté comme lui. Sur un seul point, elle le blâmait – c’était sur tout ce qui touchait aux choses religieuses ; ne mettrait-il donc jamais la religion au-dessus de la politique ? Quel chagrin pour elle que dans ces questions il ne votât point comme elle aurait voulu ! il était si soumis, si pieux, quand il était petit !
Respectueusement il se défendait, mais le plus souvent il cherchait à changer la conversation en faisant signe à sa femme ou à sa fille de venir à son secours ; il en avait assez de la politique, et ce n’était point pour reprendre et continuer les discussions de la semaine qu’il avait hâte d’arriver chez lui. C’était pour se retrouver avec les siens dans cette maison toute pleine de souvenirs, où il avait été enfant, où il avait grandi, où son père était mort, où il s’était marié, où sa fille était née, où il n’y avait pas un meuble, pas un coin qui ne lui parlât au cœur et ne le reposât de la vie parisienne vide et fatigante qu’il menait pendant neuf mois. Comme ces vastes pièces un peu noires d’aspect, comme ces vieux meubles démodés qu’il avait toujours vus, ces fauteuils de style Empire, ces pendules en bronze doré à sujets mythologiques, ces fleurs en papier conservées sous des cylindres depuis la jeunesse de sa mère, lui étaient plus doux aux yeux que le mobilier du petit appartement de garçon qu’il occupait dans une maison meublée de la rue Tronchet. Comme le fumet du pot-au-feu qui lui chatouillait l’appétit dès qu’il poussait sa porte le disposait mieux à se mettre à table que les bouffées chaudes qui le frappaient au visage quand il entrait dans les restaurants parisiens où il mangeait seul ! À mesure qu’il revenait dans son milieu d’autrefois, l’homme d’autrefois se retrouvait. Des cases de son cerveau s’ouvraient, d’autres se refermaient. Le Parisien restait à Paris, à Elbeuf il n’y avait plus que l’Elbeuvien, l’odeur fade des cuves d’indigo l’avait rajeuni ; le commerçant remplaçait le député ; il n’était plus que mari et père de famille.
Aussi se fâchait-il contre la politique qu’il lui déplaisait de retrouver à Elbeuf : c’était de paroles affectueuses, de regards tendres qu’il avait besoin, du laisser-aller de l’intimité, de sorte que bien souvent, pendant que la Maman continuait ses discussions, ses approbations ou ses réprimandes, il oubliait de lui répondre ou ne le faisait qu’en quelques mots distraits : « Oui, maman ; non, maman ; tu as raison, certainement, sans aucun doute. »
C’était assez indifféremment qu’à son retour d’Allemagne il s’était laissé marier par son père avec une jeune fille née dans une condition inférieure à la sienne, au moins pour la fortune, mais depuis vingt ans il vivait dans une étroite communion de sentiment et de pensée avec sa femme, car il s’était trouvé que celle qu’il avait acceptée pour la grâce de sa jeunesse était une femme douée de qualités réelles que chaque jour révélait : l’intelligence, la fermeté de la raison, la droiture du caractère, la bonté indulgente, et, ce qui pour lui était inappréciable depuis son entrée dans la vie politique – le flair et le génie du commerce qui faisaient d’elle une associée à laquelle il pouvait laisser la direction de la maison aussi bien pour la fabrication que pour la vente. Pendant qu’à Paris il s’occupait des affaires de la France, à Elbeuf elle dirigeait d’une main aussi habile que ferme celles de la fabrique ; en vraie femme de commerce, comme il n’était pas rare d’en rencontrer autrefois derrière les rideaux verts d’un comptoir, mais comme on n’en voit plus maintenant, trouvant encore le temps d’accomplir avec un seul commis la besogne du bureau : la correspondance, la comptabilité, la caisse et la paye qu’elle faisait elle-même.
Si bon commerçant que fût Adeline, ce n’était cependant pas d’affaires qu’il avait hâte de s’entretenir en arrivant chez lui – ces affaires, il les connaissait, au moins en gros, par les lettres que sa femme lui écrivait tous les soirs ; c’était sa femme même, c’était sa fille qui occupaient son cœur, et tout en mangeant, tout en répondant avec plus ou moins d’à-propos à sa mère, ses yeux allaient de l’une à l’autre. S’il aimait celle-ci tendrement, il adorait celle-là, et il n’était pas rare que tout à coup il s’interrompît pour se pencher vers elle et l’embrasser en la prenant dans ses bras :
– Eh bien, ma petite Berthe, es-tu contente du retour du papa ?
Il la regardait, il la contemplait avec un bon sourire, fier de sa beauté qui lui semblait incomparable ; où trouver une fille de dix-huit ans plus charmante ? Elle avait des cheveux d’un blond soyeux qu’il ne voyait chez aucune autre, une fraîcheur de carnation, une profondeur, une tendresse dans le regard vraiment admirables, et avec cela si bonne de cœur, si facile, si aimable de caractère !
Comme il ne voulait pas faire de jaloux, il avait aussi des mots affectueux pour la petite Léonie, sa nièce, âgée de douze ans, dont il était le tuteur et qui vivait chez lui, travaillant sous la direction de maîtres particuliers, parce qu’elle était trop faible de santé pour être envoyée à Rouen au couvent des Dames de la Visitation où toutes les filles des Adeline avaient été élevées.
Le dîner se prolongeait ; quand il était fini, l’heure était avancée ; alors il roulait lui-même sa mère jusqu’à la chambre qu’elle occupait au rez-de-chaussée, de plain-pied avec le salon, depuis qu’elle était paralysée ; puis, après avoir embrassé Berthe et Léonie, qui montaient à leurs chambres, il passait avec sa femme dans le bureau, et alors commençait entre eux la causerie sérieuse, celle des affaires, qui, plus d’une fois, se prolongeait tard dans la nuit.
Ils avaient là sous la main les livres, la correspondance, les carrés d’échantillons, ils pouvaient discuter sérieusement et se mettre d’accord sur ce qui, pendant la semaine, avait été réservé : elle lui rendait compte de ce qu’elle avait fait et de ce qu’elle voulait faire ; à son tour, il racontait ses démarches à Paris dans l’intérêt de leur maison, il disait quels commissionnaires, quels commerçants il avait vus, et, tirant de ses poches les échantillons qu’il avait pu se procurer chez les marchands de drap et chez les tailleurs, ils les comparaient à ceux qui avaient été essayés chez eux.
Pendant quelques années, quand ils avaient arrêté ces divers points, leur tâche était faite pour la soirée : la semaine finie était réglée, celle qui allait commencer était décidée ; mais des temps durs avaient commencé où les choses ne s’étaient plus arrangées avec cette facilité : la consommation se ralentissant, il fallait être plus accommodant pour la vente et accepter des acheteurs avec lesquels les petits fabricants seuls, forcés de courir des aventures, avaient consenti à traiter jusqu’à ce jour ; de grosses faillites avaient été le résultat de ce nouveau système ; elles s’étaient répétées, enchaînées, et il était arrivé un moment où la maison Adeline, autrefois si solide, avait eu de la peine à combiner ses échéances.
III
Un soir qu’on attendait Adeline, la famille était réunie dans le bureau dont on venait de fermer les volets après le départ des ouvriers et des employés. Dans son fauteuil, la Maman achevait la lecture de l’Officiel, Berthe tournait les pages d’un livre à images, devant un pupitre Léonie achevait ses devoirs, et en face d’elle madame Adeline couvrait de chiffres un cahier formé de lettres de faire part qui, cousues ensemble, servaient de brouillon et économisaient une main de papier écolier. La cour si bruyante dans la journée était silencieuse ; au dehors, on n’entendait que les rafales d’un grand vent de novembre, et dans le bureau que le poêle qui ronflait, le gaz qui chantait et la plume de madame Adeline courant sur la papier. De temps en temps elle s’interrompait pour consulter un carnet ou un registre, puis le frôlement de sa main descendant le long des colonnes de ses additions, recommençait. C’était hâtivement qu’elle faisait son travail, et le geste avec lequel elle tirait ses barres trahissait une main agitée.
– Est-ce que vous avez une erreur de caisse, ma bru ? demanda la Maman.
– Non.
La Maman, relevant ses lunettes, la regarda longuement :
– Qu’est-ce qui ne va pas !
– Mais rien.
Autrefois, la Maman ne se serait pas contentée de cette réponse, car évidemment, puisqu’il n’y avait pas d’erreur de caisse, quelque chose préoccupait sa bru ; mais depuis qu’elle s’était fait rembourser sa part de propriété dans la maison de commerce, elle n’avait plus la même liberté de parole. Ce remboursement ne s’était pas fait sans résistance, sinon chez Adeline soumis à la volonté de sa mère, au moins chez madame Adeline. Qu’une mère avec deux enfants donnât la moitié de sa fortune à l’un de ses fils, il n’y avait rien à dire, mais qu’elle voulût la donner entière en dépouillant ainsi l’un pour l’autre, ce n’était pas juste. Et la bru s’était expliquée là-dessus avec la belle-mère nettement. De ce jour, les relations entre elles avaient changé de caractère. Quand la Maman possédait la moitié de la maison de commerce, elle était une associée, et on lui devait les comptes qu’on rend à un associé. Sa part remboursée, les inventaires ne lui avaient plus été communiqués, les comptes ne lui avaient plus été rendus. Qu’eût-elle pu demander ? elle n’était plus rien dans cette maison. À la vérité, son fils semblait s’entretenir aussi librement avec elle qu’autrefois, mais le fils et la bru faisaient deux ; d’ailleurs, c’était sur certains sujets seulement que cette liberté se montrait ; sur la marche des affaires, ils étaient avec elle aussi réservés l’un que l’autre. Quand elle insistait près de Constant, il répondait invariablement que les choses allaient aussi bien qu’elles pouvaient aller ; mais l’embarras et même la réticence se laissait voir dans ses réponses. Et alors, avec inquiétude, avec remords, elle se demandait si, en enlevant douze cent mille francs à son fils, elle ne l’avait pas mis dans une situation critique : les affaires allaient si mal, on parlait si souvent de faillites ; les acheteurs qu’elle était habituée à voir autrefois venaient maintenant si rarement à Elbeuf. Si encore elle avait pu rejeter sur sa bru la responsabilité de cette situation, c’eût été un soulagement pour elle. Mais, malgré l’envie qu’elle en avait, cela ne semblait pas possible. Jamais, il fallait bien le reconnaître, la fabrique n’avait été dirigée avec plus d’intelligence et plus d’ordre ; la surveillance était de tous les instants du haut jusqu’en bas, aussi bien pour les grandes que pour les petites choses ; et dans tous les services on trouvait de ces économies ingénieuses que seules les femmes savent appliquer sans rien désorganiser et sans soulever des plaintes.
Elle n’avait pas pu insister, il avait fallu que, se contentant de ce rien, elle reprît la lecture de son journal : cependant, il était certain qu’il se passait quelque chose de grave ; jamais elle n’avait vu sa bru aussi nerveuse, et cela était caractéristique chez une femme calme d’ordinaire, qui mieux que personne savait se posséder, et ne dire comme ne laisser paraître que ce qu’elle voulait bien.
Cependant, si absorbée qu’elle voulût être dans sa lecture, elle ne pouvait pas ne pas entendre les coups de plume qui rayaient le papier ; à un certain moment, n’y tenant plus, elle risqua encore une question :
– Est-ce que vous craignez quelque nouvelle faillite ?
– MM. Bouteillier frères ont suspendu leurs payements.
Madame Adeline reprit ses comptes en femme qui voudrait n’être pas interrompue ; mais l’angoisse de la Maman l’emporta.
– Vous êtes engagée avec eux pour une grosse somme ?
– Assez grosse.
– Et elle vous manque pour votre échéance ?
– Constant doit m’apporter les fonds.
Le soulagement qu’éprouva la Maman l’empêcha de remarquer le ton de cette réponse : quand son fils devait faire une chose, il la faisait, on pouvait être tranquille. La suspension de payement des frères Bouteillier suffisait et au delà pour expliquer l’état nerveux de madame Adeline ; ils étaient parmi les meilleurs clients de la maison, les plus anciens, les plus fidèles, et leur disparition se traduirait par une diminution de vente importante. Sans doute cela était fâcheux, mais non irrémédiable ; elle avait foi dans la maison de son fils au même point que dans la fortune d’Elbeuf, et n’admettait pas que la crise qu’on traversait ne dû bientôt prendre fin ; les beaux jours qu’elle avait vus reviendraient, il n’y avait qu’à attendre. Elle demandait à Dieu de vivre jusque-là ; si après avoir sauvé l’honneur des Adeline elle pouvait voir la solidité de leur maison assurée, elle serait contente et mourrait en paix. Depuis soixante-cinq ans elle n’avait pas manqué une seule fois, excepté pendant ses couches, la messe de sept heures à Saint-Étienne, où, par sa piété, elle avait fait l’édification de plusieurs générations de dévotes, mais jamais on ne l’avait vue prier avec autant de ferveur que depuis que les affaires de son fils lui semblaient en danger. Bien qu’elle ne quittât pas son fauteuil roulant et ne put pas se prosterner â genoux, au mouvement de ses lèvres et à l’exaltation de son regard on sentait l’ardeur de sa prière. Ses yeux ne quittaient pas la verrière où saint Roch, patron des cardeurs, tisse, avec des ouvriers, du drap sur un métier des vieux temps et c’était lui qu’elle implorait particulièrement pour son fils comme pour son pays natal.
La plume de madame Adeline continuait à courir sur son brouillon quand dans la cour on entendit un bruit de pas. Qui pouvait venir ? Il semblait qu’il y eût deux personnes. Les pas s’arrêtèrent â la porte du bureau, où discrètement on frappa quelques coups.
– Ma tante, faut-il ouvrir ? demanda Léonie, se levant avec l’empressement d’un enfant qui saisit toutes les occasions d’interrompre un travail ennuyeux.
– Mais, sans doute, répondit madame Adeline, bien qu’un peu surprise qu’à cette heure on frappât â cette porte et non à celle de l’appartement.
Les verrous furent promptement tirés et la porte s’ouvrit.
– Ah ! c’est M. Eck et M. Michel, dit Léonie.
C’était en effet le chef de la maison Eck et Debs, le père Eck, comme on l’appelait à Elbeuf, accompagné d’un de ses neveux.
– Ponchour, matemoiselle, dit le père Eck avec son plus pur accent alsacien et en entrant dans le bureau, suivi de son neveu.
L’oncle était un homme de soixante ans environ, rond de corps et rond de manières, court de jambes et court de bras, à la physionomie ouverte, gaie et fine, dont les cheveux frisés, le nez busqué et le teint mat trahissaient tout de suite l’origine sémitique ; le neveu, au contraire, était un beau jeune homme élancé, avec des yeux de velours, et des dents blanches qui avaient l’éclat de la nacre entre des lèvres sanguines et une barbe noire frisée.
– Ponchour, mestames Ateline, continua M. Eck, Ponchour, matemoiselle Perthe.
Ce dernier bonjour fut accompagné d’une révérence.
– Gomment, continua-t-il, M. Ateline n’est bas-là, je groyais qu’il tevait refenir te ponne heure ; et, en foyant te la lumière au pureau, j’ai gru que c’était lui qui trafaillait ; foilà gomment j’ai frappé à cette borte ; excusez-moi, mestames.
Ce fut une affaire de leur trouver des sièges, car le bureau était meublé avec une simplicité véritablement antique : une table en bois noir, deux pupitres, des rayons en sapin régnant tout autour de la pièce pour les registres et la collection des échantillons de toutes les étoffes fabriquées par la maison depuis près de cent ans, quatre chaises en paille, et c’était tout ; pendant deux cents ans, cela avait suffi à plus de trois cent millions d’affaires.
C’était après la guerre que les Eck et Debs, établis jusque-là en Alsace, avaient quitté leur pays pour venir créer à Elbeuf une grande manufacture de « draps lisses, élasticotines, façonnés noirs et couleurs », comme disaient leurs en-têtes, où s’accomplissaient, sans le secours d’aucun intermédiaire, toutes les opérations par lesquelles passe la laine brute pour être transformée en drap prêt à être livré à l’acheteur, et tout de suite ils étaient entrés en relations avec Constant Adeline, que son caractère autant que sa position mettaient au-dessus de l’envie et de la jalousie, et auprès de qui ils avaient trouvé un accueil plus libéral qu’auprès de beaucoup d’autres fabricants. Sans arriver à l’amitié, ces relations s’étaient continuées, s’étendant même aux familles. À la vérité, madame Adeline mère n’avait point vu madame Eck mère, une vieille femme de quatre-vingts ans, aussi fervente dans la religion juive qu’elle pouvait l’être dans la sienne ; mais mesdames Eck et Debs faisaient à madame Constant Adeline des visites que celle-ci leur rendait, et les enfants, les deux frères Eck et les trois frères Debs avaient plus d’une fois dansé avec Berthe.
Les politesses échangées, le père Eck prit son air bonhomme, et, regardant le cahier sur lequel madame Adeline faisait ses chiffres :
– Touchours à l’oufrage, matame Ateline, dit-il, je foutrais bien afoir une embloyée gomme fous et... au même brix.
Et il partit d’un formidable éclat de rire, car il était toujours le premier à sonner la fanfare pour ses plaisanteries, sans s’inquiéter de savoir s’il n’était pas quelquefois le seul à les trouver drôles.
Mais ses éclats de rire se calmaient comme ils partaient, c’est-à-dire instantanément ; il prit une figure grave, presque désolée :
– À brobos, matame Ateline, afez-fous tes noufelles de MM. Bouteillier frères ? demanda-t-il.
– J’en ai reçu ce matin.
– Fous safez qu’ils susbendent leurs bayements ?
– C’est ce qu’on m’écrit.
– Est-ce que fous étiez engagés afec eux ?
– Malheureusement. Et vous ?
– Nous ? Oh ! non. Ils auraient pien foulu, mais nous n’avons bas foulu, nous. Tebuis trois ans, ils ne m’insbiraient blus gonfiance ; c’était tes chens qui menaient drop de drain : abbardement aux Champs-Élysées, château aux enfirons de Baris, filla à Trouville, séchour à Cannes pendant l’hiver, cela ne bouvait bas turer.
Il y eut un silence ; le père Eck paraissait assez gêné, et madame Adeline l’était aussi jusqu’à un certain point, se demandant ce que pouvait signifier cette visite insolite ; elle voulut lui venir en aide :
– Est-ce que vous êtes satisfait de vos nouveaux procédés de teinture ? demanda-t-elle en portant la conversation sur un sujet de leur métier, qui pouvait fournir une inépuisable matière et que d’ailleurs elle était bien aise de tirer au clair.
– Oh ! drès satisvait.
– Et cela vous revient vraiment moins cher que, chez MM. Blay ?
Il ouvrit la bouche pour répondre, puis il la referma, et ce fut seulement après quelques secondes de réflexion qu’il se décida :
– Matame Ateline, matame Adeline, je ne beux bas fous tire, l’infentaire n’a bas été vait.
Cela fut répondu avec une bonhomie si parfaite qu’on aurait pu croire à sa sincérité, mais il la compromit malheureusement en se hâtant de changer de sujet.
– Quand fous foutrez fenir à la maison, chaurai le blaisir de fous montrer ça ; mais ce que je foutrais pien fous montrer, c’est nos nouveaux métiers-fixes à filer ; c’est fraiment une pelle infention ; seulement tepuis un an que nous les avons installés, tous les fils cassaient, nous allions faire bour cinquante mille vrancs de véraille, quand mon betit Michel a drouvé un bervectionnement aussi simple que barvait ; il faut voir ça ; je lui ai fait brendre un prefet. Il a vraiment le chénie de la mécanique, ce garçon-là.
– Est-ce que M. Michel va directement exploiter son brevet ?
– Il le fentra ; tous les Eck, tous les Debs restent ensemble, touchoure.
– Ce qu’on appelle à Elbeuf les Cocodès, dit Michel en riant et en répétant une plaisanterie qui était spirituelle à Elbeuf.
Il y eut encore un silence, puis M. Eck se levant, vint auprès de madame Adeline :
– Est-ce que je bourrais fous tire un mot en barticulier ?
Passant la première, madame Adeline le conduisit dans le salon.
IV
– Quelle mauvaise nouvelle lui apportait-on ?
Ce fut la question que madame Adeline, troublée, se posa, mais qu’elle eut la force, cependant, de retenir pour elle.
Bien qu’elle n’eût aucune raison de se défier de M. Eck, qu’elle savait droit en affaires, brave homme et bonhomme dans les relations de la vie, elle avait été si souvent, en ces derniers temps, frappée de coups qui s’abattaient sur elle à l’improviste et tombaient précisément d’où on n’aurait pas dû les attendre, qu’elle se tenait toujours et avec tous sur ses gardes, inquiète et craintive.
Dans la ville, on disait que les Eck et Debs tentaient depuis longtemps des essais pour fabriquer la nouveauté mécaniquement et en grand comme ils fabriquaient le drap lisse : était-ce là la cause de cette visite étrange ? Dans ces Alsaciens ingénieux qui savaient si bien s’outiller et qui réussissaient quand tant d’autres échouaient, allait-elle rencontrer des concurrents qui rendraient plus difficile encore la marche de ses affaires !
Était ce un danger menaçant leur maison ou la situation politique de son mari qu’il venait lui signaler dans un sentiment de bienveillance amicale ?
De quelque côté que courût sa pensée, elle ne voyait que le mauvais sans admettre le bon ou l’heureux ; et ce qui augmentait son trouble, c’était de voir l’embarras qui se lisait clairement sur cette physionomie ordinairement ouverte et gaie.
Elle s’était assise en face de lui, le regardant, l’examinant, et elle attendait qu’il commençât ; ce qu’il avait à dire était donc bien difficile ?
Enfin il se décida :
– Quand nous nous sommes expatriés pour fenir à Elpeuf, nous n’afons pas drouvé ici tout le monde bien tisposé à nous recevoir. On tisait : « Qu’est-ce qu’ils fiennent faire ; nous n’afons bas pesoin t’eux ? M. Ateline n’a bas été parmi ceux-là, au gontraire, il n’a obéi qu’à un sentiment patriotique pour les exilés et aussi pour sa ville où nous apportions du trafail ; et cela, matame, nous a été au cœur ; tans la position où nous étions, quittant notre pays, recommençant la vie à un âge où beaucoup ne bensent blus qu’au repos, nous afons été heureux de troufer une main loyalement ouferte.
Ces paroles n’indiquaient rien de mauvais, l’inquiétude de madame Adeline se détendit.
– Quand l’année ternière, continua M. Eck, nous afons eu le chagrin de perdre mon peau-frère Debs, nous afons encore retrouvé M. Ateline. Fous safez ce qui s’est passé à ce moment et comment des gens se sont récusés pour ne pas lui faire des funérailles convenables ; on tisait : « Quel besoin d’honorer ce chuif qui est fenu nous faire concurrence ? » Toutes sortes de mauvais sentiments s’étaient élevés contre le chuif autant que contre le fabricant, et ceux-là mêmes qui auraient dû se mettre en avant se sont mis en arrière. M. Ateline était alors à Baris, retenu bar les travaux de la Chambre, et il bouvait très pien y rester s’il avait foulu. Mais, aferti de ce qui se passait ici, – peut-être même est-ce bar fous, matame ?
– Il est vrai que je lui ai écrit.
M. Eck se leva et avec une émotion grave il salua respectueusement :
– J’aime à safoir, comme je m’en toutais, que c’est fous. Enfin, aferti, il a quitté Baris et sur cette tombe, lui député, il n’a pas craint de tire ce qu’il pensait d’un honnête homme qui avait apporté ici une industrie faisant vivre blus de mille personnes, dans une ville où il y a tant de misère. Et pour cela il a trouvé des paroles qui retentissent toujours dans notre cœur, le mien et celui de tous les membres de notre famille.
Il fit une pause, ému bien manifestement par ces souvenirs ; puis reprenant :
– Ne fous temantez pas, matame pourquoi je rappelle cela ; fous allez le savoir ; c’est pour fous le tire que je bous ai demandé ce moment d’entretien bartigulier. Après ces exbligations, fous gomprenez quelle estime nous avons pour M. Ateline et tans quels termes nous barlons de lui : ma mère, ma sœur, ma femme, mes fils, mes nefeux et moi-même ; il n’est bersonne à Elpeuf pour qui nous avons autant d’estime et, permettez-moi le mot, autant d’amitié. Ce qui vous touche nous intéresse et pien souvent nous nous sommes réchouis en apprenant une ponne affaire pour fous, comme nous nous sommes affligés en en apprenant une mauvaise : – ainsi celle de ces Bouteillier.
Peu à peu, madame Adeline s’était rassurée : tout cela était dit avec une bonhomie et une sympathie si évidentes que son inquiétude devait se calmer comme elle s’était en effet calmée ; mais à ces derniers mots, qui semblaient une entrée en matière pour une question d’argent, ses craintes la reprirent. Ces protestations de sympathie et d’amitié qui se manifestaient avec si peu d’à-propos n’allaient-elles aboutir à une conclusion cruelle, que M. Eck, qui n’était pas un méchant homme avait voulu adoucir en la préparant : c’était le terrible de sa situation de voir partout le danger.
– Certainement, continua M. Eck, il n’y a bas pésoin d’être dans des conditions bartigulières pour être charmé en voyant mademoiselle Perthe : c’est une pien cholie personne... qui sera la fille de sa mère, et un jeune homme, alors même qu’il ne connaît pas sa famille, ne peut pas ne pas être séduit par elle, mais combien blus fortement doit-il l’être quand il partage les sentiments que je fiens de fous exprimer. C’est chustement le cas de mon betit Michel ; je tis betit parce que je l’ai vu tout betit, mais c’est en réalité un sage garçon plein de sens, un travailleur, qui nous rend les blus grands services dans notre fabrique, et qui est pien le caractère le blus aimable, le blus facile, le blus affectueux, le blus égal que je gonaisse. Enfin pref il aime matemoiselle Perthe, et je vous temande pour lui la main de fotre fille.
Bien des fois et depuis longtemps déjà, madame Adeline avait marié sa fille, choisissant son gendre très haut, alors que leurs affaires étaient en pleine prospérité, descendant un peu quand cette prospérité avait décliné, baissant à mesure qu’elles avaient baissé, jamais elle n’avait eu l’idée de Michel Debs. Un juif !
Sa surprise fut si vive que M. Eck, qui l’observait, en fut frappé.
– Je fois, dit-il, que fous pensez à matame Ateline mère, qui est une personne si rigoureuse dans sa religion. Nous aussi nous afons notre mère qui pour notre religion n’est pas moins rigoureuse que la vôtre. C’est ce que j’ai tit à mon betit Michel quand il m’a barlé de ce mariage. « Et ta grand’mère, et la grand’mère de mademoiselle Perthe, hein ! »
Justement après être revenue un peu de son étourdissement, c’était à ces grand’mères qu’elle pensait, à celle de Berthe et à celle de Michel.
De celle-ci, que personne ne voyait parce qu’elle vivait cloîtrée comme une femme d’Orient, tout le monde racontait des histoires que le mystère et l’inconnu rendaient effrayantes.
Que n’exigerait-elle pas de sa bru, cette vieille femme soumise aux pratiques les plus étroites de sa religion ? De quel œil regarderait-elle une chrétienne à sa table, elle qui ne mangeait que de la viande pure, c’est-à-dire saignée par un sacrificateur, ouvrier alsacien versé dans les rites, qu’elle avait fait venir exprès ?
Bien qu’elle n’eût ni le temps ni le goût d’écouter les bavardages qui couraient la ville, madame Adeline n’avait pas pu ne pas retenir quelques-unes des bizarreries qu’on attribuait à cette vieille juive et ne pas en être frappée.
Avant l’arrivée des Eck et des Debs à Elbeuf, on s’occupait peu des usages des juifs, mais du jour où cette vieille femme s’était installée dans sa maison, son rigorisme l’avait imposée à la curiosité et aussi à la critique. C’était monnaie courante de la conversation de raconter qu’elle se faisait apporter le gibier vivant pour que son sacrificateur le saignât ; – qu’elle ne mangeait pas des poissons sans écailles ; qu’on faisait traire son lait directement de la vache dans un pot lui appartenant ; – qu’elle avait une vaisselle pour le gras, une autre pour le maigre ; – que le poisson seul pouvait être arrangé au beurre, à l’huile ou à la graisse ; – que, dans les repas où il était servi de la viande, elle ne mangeait ni fromage, ni laitage, ni gâteaux ; – qu’on préparait sa nourriture le vendredi pour le samedi, et, comme ce jour-là les Israélites ne doivent pas toucher au feu, on mettait une plaque de fer sur des braises, et sur cette plaque on plaçait le vase contenant les mets tout cuits, ce vase ne pouvait être pris que par des mains juives ; – enfin, que ses cheveux coupés étaient recouverts d’un bandeau de velours, et qu’elle obligeait sa fille et sa belle-fille à ne pas laisser pousser leurs cheveux.
Sans doute il y avait dans tout cela des exagérations, mais le vrai n’indiquait-il pas un rigorisme de pratiques religieuses peu encourageant ? Elle le connaissait, ce rigorisme dans la foi, depuis vingt ans qu’elle en avait trop souffert auprès de sa belle-mère pour vouloir y exposer sa fille. Et puis, femme d’un juif ! Si bien dégagée qu’elle fût de certains préjugés, elle ne l’était point encore de celui-là. Aucune jeune fille de sa connaissance et dans son monde n’avait épousé un juif : cela ne se faisait pas à Elbeuf.
Mais M. Eck ne lui laissa pas le temps de réfléchir, il continuait :
– Pien entendu, Michel n’a jamais entretenu matemoiselle Perthe de son amour, c’est un honnête homme, un calant homme, croyez-le, matame Ateline. Je ne tis pas que ses yeux n’aient pas barlé, mais ses lèvres ne se sont pas ouvertes. Peut-être sait-elle cependant qu’elle est aimée, car les jeunes filles sont bien fines pour teviner ces choses, mais elle ne le sait pas par des baroles formelles. Michel a foulu qu’avant tout les familles fussent d’accord, et c’est là ce qui m’amène chez vous. J’espérais trouver M. Ateline ; et Michel, qui ne manque pas les occasions où il peut voir matemoiselle Perthe, a tenu à m’accompagner, pien que cela ne soit peut-être pas très convenable. Le hasard a foulu que M. Ateline fût absent et j’en suis heureux, puisque j’ai pu fous adresser ma demande : en ces circonstances une mère vaut mieux qu’un père. Vous la transmettrez à M. Ateline et, si fous le jugez pon, à matemoiselle Perthe. Pour Michel, je fous prie d’insister sur son amour ; c’est sincèrement, c’est tentrement qu’il aime et bour lui ce n’est pas un mariage de convenance, c’est un mariage d’inclination. Bour moi, je vous prie d’insister sur l’honneur que nous attachons à unir notre famille à la vôtre. Je veux vous barler franchement, à cœur ouvert ; je n’ai pas d’ampition et ne recherche pas une alliance avec M. Ateline parce qu’il est député et sera un jour ou l’autre ministre ; je suis técoré et n’ai rien à attendre du gouvernement ; quant à la situation de nos affaires, elle est ponne ; là où d’autres berdent de l’argent, nous en gagnons ; les inventaires vous le brouferont, quand nous pourrons vous les communiquer, vous verrez, vous verrez qu’elle est ponne.
Il se frotta les mains :
– Elle est ponne, elle est ponne ; la maison Eck et Debs est organisée pour bien marcher, elle marchera et durera tant qu’il y aura un Eck, tant qu’il y aura un Debs pour la soutenir. Et je ne crois pas que la graine en manque de sitôt. Donc, ce que nous cherchons uniquement dans ce mariage, c’est l’honneur d’être de fotre famille : le père Eck ne fiffra pas toujours ; les fils, les neveux le remplaceront, et alors, est-ce que ce serait une mauvaise raison sociale : Eck et Debs-Ateline ? La fieille maison continuerait ; le fieil arbre repousserait avec des rameaux nouveaux ; les enfants de Michel seraient des Ateline.
Sur ce mot, il se leva.
– Vous n’attendez pas mon mari ? demanda madame Adeline.
– Non ; je remets notre cause entre vos mains, elle sera mieux blaidée que je ne la blaiderais moi-même.
Ils rentrèrent dans le bureau, où ils trouvèrent Léonie, la figure épanouie par un éclat de rire.
– Je fois qu’on s’est amusé, dit le père Eck, on a taillé une ponne pafette.
– C’est M. Michel qui nous fait rire, dit Léonie.
– Il est pien heureux, Michel, de faire rire les cholies filles ; et qu’est-ce donc qu’il vous contait ?
– Il nous apprenait pourquoi les Carthaginois mettaient des gants ; le savez-vous, monsieur Eck ?
– Ma foi, non, matemoiselle ; de mon temps, les sciences historiques n’étaient pas aussi avancées que maintenant, et nous ne savions pas que les Carthaginois se cantaient.
– Ils se gantaient parce qu’ils craignaient les Romains.
– Ah ! vraiment ? dit le père Eck qui n’avait pas compris.
– Pardonnez-moi, madame, dit Michel en s’adressant avec un sourire d’excuse à madame Adeline, mademoiselle Léonie faisait un devoir sur Annibal qui ne l’amusait pas beaucoup ; j’ai voulu l’égayer. Je crois que maintenant elle n’oubliera plus Annibal.
– M. Michel sait trouver un mot agréable pour chacun, dit la maman.
Madame Adeline regardait sa fille dans les yeux, et à leur éclat il était évident que, pour Berthe aussi, Michel avait trouvé quelque chose d’agréable, – mais à coup sûr de moins enfantin que pour Léonie. L’aimait-elle donc ?
V
L’oncle et le neveu partis, madame Adeline ne reprit pas son travail ; elle n’avait plus la tête aux chiffres ; et, d’ailleurs, le temps avait marché.
On quitta le bureau, Berthe roula sa grand-mère dans la salle à manger, et madame Adeline, qui, pour diriger la fabrique, n’en surveillait pas moins la maison, alla voir à la cuisine si tout était prêt pour servir quand le maître arriverait, puis elle revint dans la salle à manger attendre.
– Comment va le cartel ? demanda la Maman ; est-ce qu’il n’avance pas ?
– Non, grand-mère, répondit Berthe, il va comme Saint-Étienne.
– Comment ton père n’est-il pas arrivé ? aurait-il manqué le train ?
Cela fut dit d’une voix qui tremblait, avec une inquiétude évidente, en regardant sa belle-fille, qui, elle aussi, montrait une impatience extraordinaire.
Tout le monde avait l’oreille aux aguets ; on entendit des pas pressés dans la cour, Berthe courut ouvrir la porte du vestibule.
Presque aussitôt Adeline entra dans la salle à manger, tenant dans sa main celle de sa fille ; tout de suite il alla à sa mère, qu’il embrassa, puis, après avoir embrassé aussi sa femme et Léonie, il se débarrassa de son pardessus, qu’il donna à Berthe, et de son chapeau, que lui prit Léonie.
Alors il s’approcha de la cheminée où, sur des vieux landiers en fer ouvragé, brûlaient de belles bûches de charme avec une longue flamme blanche.
– Brrr, il ne fait pas chaud, dit-il en passant ses deux mains largement ouvertes devant la flamme.
Sa mère et sa femme le regardaient avec une égale anxiété, tâchant de lire sur son visage ce qu’elles n’osaient pas lui demander franchement ; ce visage épanoui, ces yeux souriants ne trahissaient aucun tourment.
Tout à coup, il se redressa vivement ; déboutonnant sa jaquette, il fouilla dans sa poche de côté et en tira cinq liasses de billets de banque qu’il tendit à sa femme :
– Serre donc cela, dit-il.
La Maman laissa échapper un soupir de soulagement ; madame Adeline ne dit rien, mais à l’empressement avec lequel elle prit les billets et à la façon dont elle les pressa entre ses doigts nerveux, on pouvait deviner son émotion et son sentiment de délivrance.
Aussitôt que madame Adeline revint dans la salle à manger ; on se mit à table.
Bien entendu, ce soir-là les affaires personnelles passèrent avant la politique, et la Maman fut la première à mettre la conversation sur les frères Bouteillier :
– Comment une maison aussi vieille, aussi honorable, a-t-elle pu en arriver à cette catastrophe ?
– L’ancienneté et l’honorabilité ne sauvent pas une maison, répondit Adeline, c’est même quelquefois le contraire qu’elles produisent.
Cela fut dit avec une amertume qui frappa d’autant plus qu’ordinairement il était d’une extrême bienveillance, prenant les choses, même les mauvaises, avec l’indulgence d’une douce philosophie, en homme qui, ayant toujours été heureux, ne se fâche pas pour un pli de rose, convaincu que celui qui le gêne aujourd’hui sera effacé demain.
Il est vrai qu’il n’insista pas et qu’il se hâta même d’atténuer ce mot qui lui avait échappé : la catastrophe qui frappait les Bouteillier n’était pas ce qu’on avait dit tout d’abord : c’était une suspension de payement, non une banqueroute avec insolvabilité complète ; il paraissait même certain que les payements reprendraient bientôt et qu’on perdrait peu de chose avec eux.