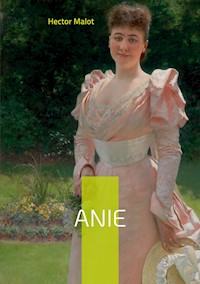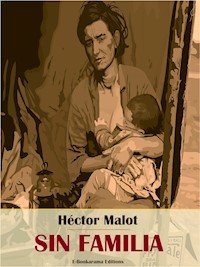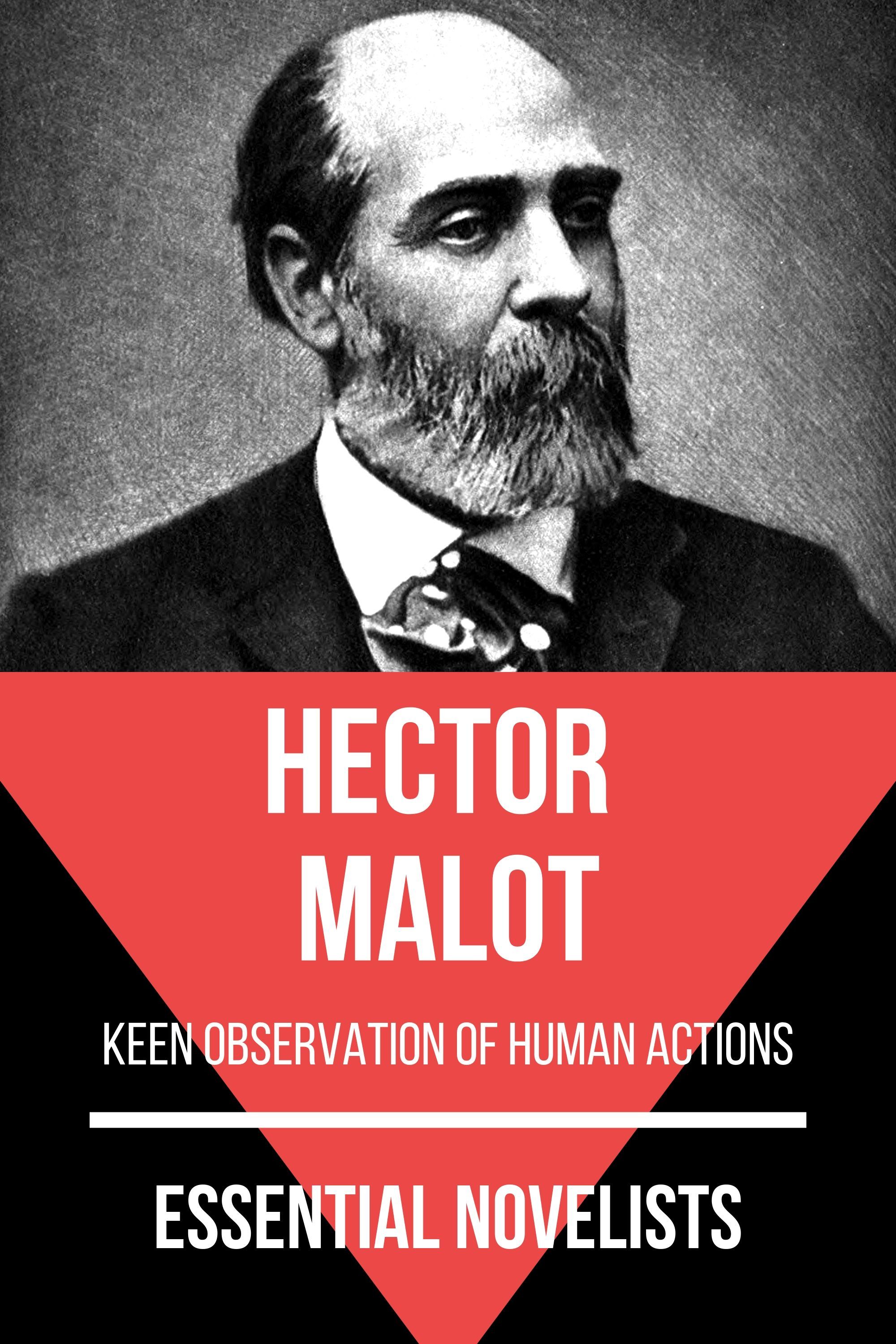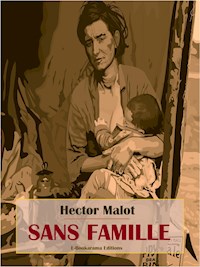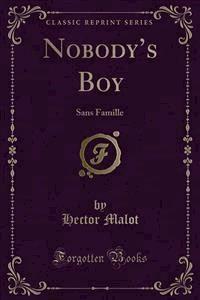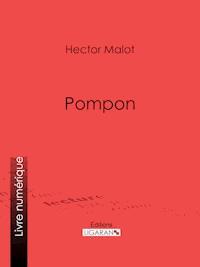2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une belle-mere, Madame Daliphare, possessive etouffe sa belle-fille, Juliette, accapare son mari et son enfant. Quand le couple est brise, elle a s'ingenie faire prendre la jeune femme adultere, all events and the conserver pour elle seule, les deux etres qu'elle s'est appropries. Le drame des lane survient: l'epoux, Adolphe, tue Juliette et son amant. Acquitte, il se separe a jamais de sa mere, emmenant avec son fils lazy Felix. L'argument Etude de caractere, possessive, comme celui de la mere dance Mere. Considerations sur l'amour, le mariage, la famille. Le mariage dans lequel on peut carcan apparait comme un etouffer. Apparait acceptable lorsque l'amour dans le L'adultere mariage est impossible. Dans ce roman, meme les personnages secondaires sont elabores, would follow and soigneusement est du vieux beau m. Decloizeaux dont le portrait ne manque pas de verite. '
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Le mariage de Juliette
Pages de titreIIIIIIIVVIVIIVIIIIXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVPage de copyrightHector Malot
Le mariage de
Juliette
I
Le quartier du Temple se présente sous un double aspect. Dans la partie qui confine au Marais, on trouve des rues larges, bordées de belles maisons qui ont été autrefois bâties pour la noblesse ou la magistrature. Dans la partie qui touche au quartier Saint-Martin, on ne rencontre au contraire que des rues étroites, dont les maisons laides et sales sont occupées par le commerce et la petite industrie parisienne.
La rue des Vieilles-Haudriettes, qui va de la rue du Chaume à la rue du Grand-Chantier, participe de ces deux caractères : par quelquesunes de ses constructions, qui sont vastes et architecturales, elle appartient au Marais ; par sa population ouvrière, au quartier du Temple. Elle est frontière, et comme telle elle tient de ses deux voisins, sans avoir une physionomie propre.
Nulle part on ne trouvera plus d’enseignes aux façades et d’écriteaux aux grandes portes : larges tableaux noirs s’étalant d’étages en étages, petites plaques de cuivre, écussons en tôle vernie, panonceaux, armoiries.
Si le curieux qui passe pour la première fois dans cette rue lève les yeux sur les enseignes qui ont pour but de provoquer son attention ou de le guider, il verra qu’il est en plein dans le quartier de l’industrie des bijoux ; pour un écusson qui lui indiquera les magasins d’un marchand de peaux de lapin ou les bureaux du journal hébraïque le Libanon , il trouvera vingt plaques de bijoutiers en or, en argent, en plaqué, de lapidaires, d’orfèvres, de fabricants de bagues, de boutons, d’épingles, de broches, de pendants, de colliers, de médaillons, de chaînes, de pendeloques, de breloques, de croix, de reliquaires, de cassolettes, de tabatières, d’étuis, de briquets.
Seule au milieu de ces enseignes, qui dans leur confusion peuvent troubler l’acheteur indécis, se montre au-dessus d’une porte cochère une longue plaque en marbre noir sur laquelle on lit en lettres d’or gravées en creux, un simple nom :
DALIPHARE
Pas d’autres indications. Ce nom tout seul en dit assez sans doute et les explications ne sont pas nécessaires.
Pour les habitants du quartier ou pour ceux qui connaissent l’industrie des métaux, cela est possible ; mais pour le passant ou l’étranger, ce nom propre ne dit rien de précis, malgré sa physionomie originale. Que vend-on, que fabrique-t-on dans la maison Daliphare ?
Si l’on regarde par la grande porte, on aperçoit une cour plus large que longue, autour de laquelle s’élève au fond une maison à deux étages, et de chaque côté, en retour d’équerre, des bâtiments qui paraissent occupés par des ateliers.
La maison, construite au XVII e siècle, dans les jardins du couvent des religieuses hospitalières qui ont donné leur nom à la rue, est un vieil hôtel qui a dû avoir belle apparence avant d’être approprié aux besoins de l’industrie moderne. De sa splendeur passée il conserve des fenêtres décorées de rinceaux, et çà et là quelques morceaux de sculpture qui n’ont point encore disparu sous les nombreux tuyaux de tôle et de poterie appliqués sur sa façade, contre laquelle ils ont laissé couler, dans les jours de grande pluie, des traînées de suie et de rouille. Élevées en brique et en carreaux de plâtre, les deux constructions latérales n’ont aucun caractère ; elles sont occupées par des hangars et des ateliers.
Au-dessus de celui de gauche se dresse une haute cheminée en tôle, semblable à celle d’un bateau à vapeur, et du matin au soir elle vomit des tourbillons de fumée qui vont noircir la cime d’un vieux peuplier planté au milieu de la cour.
Un appareil de transmission traverse cette cour et va se perdre dans les bâtiments de droite, d’où sortent les ronflements de plusieurs cylindres en mouvement.
Cette rapide inspection ne permet pas, bien entendu, de deviner quel est le genre d’industrie de cette maison ; cependant elle fait comprendre que ce vieil hôtel est occupé, au rez-de-chaussée et au premier étage, par des comptoirs et des bureaux, et que dans les bâtiments annexes se trouve une pompe à feu avec des machines. Mais que vend-on dans ces comptoirs ? à quoi servent ces machines ? Les cylindres qu’on entend tourner écrasent-ils du cacao ? lustrent-ils des étoffes ou bien laminent-ils des métaux ? Ces questions ne peuvent pas être résolues par un simple coup d’œil.
Mais si le passant arrêté devant cette porte est un curieux qui sait par lui-même se rendre compte des choses, il n’aura pas besoin d’interroger les voisins pour connaître l’industrie de la maison Daliphare : en restant quelques instants en observation devant cette maison, en examinant et en écoutant ceux qui entrent et qui sortent par la grande porte, il aura bien vite une réponse aux questions que se posait son esprit.
Un jeune homme de tournure plus élégante que distinguée, le visage pâli et flétri, l’œil éteint, se promène sur le trottoir, allant de la rue du Chaume à la rue du Grand-Chantier. Son pas est impatient ; en marchant, il se retourne souvent pour regarder derrière lui. Il fouette l’air avec sa canne et murmure entre ses lèvres serrées des mots inintelligibles ; dans chaque voiture qui passe il plonge un regard curieux. À mesure que l’attente se prolonge, son impatience s’accroît et les mouvements de sa canne sont plus saccadés.
Enfin une voiture de remise arrive par la rue du Chaume, les stores baissés, et elle s’arrête devant la porte de la maison Daliphare. Une femme ouvre la portière et descend sur le trottoir. Elle est vêtue d’une toilette sombre, une voilette de laine empêche de distinguer les traits de son visage : à travers les mailles étroites de la voilette on aperçoit seulement deux yeux brillants et un teint pâle.
Le jeune homme accourt vivement près d’elle.
Encore en retard !
Il ne voulait pas sortir.
Alors tu n’as rien ?
Le coffre est dans la voiture ; vous pouvez le prendre.
Le jeune homme prend dans la voiture un coffret recouvert de maroquin qui paraît peser un poids assez lourd, et, suivi de la femme voilée, il entre dans la maison.
Ils ont disparu sous le vestibule du rez-dechaussée. Deux hommes les remplacent devant la porte cochère. L’un est un petit vieillard sec et nerveux, au nez busqué, aux cheveux crépus, qui porte des bagues à tous les doigts, des anneaux d’or aux oreilles, et autour du cou une grosse chaîne qui s’arrondit sur son ventre proéminent ; en tout, l’apparence d’un marchand de lorgnettes qui fait des affaires . L’autre est un grand jeune homme imberbe, qui peut être peint d’un mot : « un pâle voyou ».
J’étais sûr de te voir ici, dit le petit vieux.
Et vous me guettiez, père Meyer ?
Oui, mon garçon, depuis une heure, dans ton intérêt, pour t’empêcher de faire une bêtise qui pourrait, passage gratis, te mener loin, au-delà des mers, comme qui dirait du côté de Cayenne.
Vous savez, je n’aime pas ces plaisanterieslà. En tous cas, je préfère risquer le coup plutôt que de me faire encore
recurer
par vous. Vous n’êtes pas raisonnable non plus.
Tu ne sais pas ce que tu dis.
Je sais que l’or vaut 1500 fr. les 500 grammes et que vous ne voulez le payer que 1 fr. 75 cent. le gramme, ce qui met la livre pour vous à 875 fr. Vous gagnez trop et sans risques.
Et toi, mon petit, tu veux aussi gagner trop, mais avec risques, et entre nous deux voilà la différence. Pour le moment, ça n’a l’air de rien, mais plus tard ça pourrait être sensible, très sensible pour toi, je veux dire. Crois-tu qu’ils vont t’acheter ton magot sans te questionner ?
Je dirai que c’est de la
cassure
que j’ai fondue.
Comment ça, fondue ?
Dans une marmite.
Et où l’auras-tu eue, ta
cassure
? Tu t’embrouilleras dans tes réponses et tu seras pincé. Ils tiennent leurs comptes dans des livres ; moi je tiens les miens dans ma tête, et quand la
rousse
veut me faire causer, je réponds pour le mieux de mes amis. Combien pèse ton culot ?
1 kilogramme 500 grammes.
Je t’en donne 2 francs le gramme ; en tout, 3000 francs.
Au lieu de 4500 francs.
Tu calcules bien, mais tu raisonnes mal, puisque dans ton compte tu oublies la tranquillité que tu trouves avec moi. Estime-la ce qu’elle vaut pour toi, et viens chez le marchand de vin de la rue du Chaume : c’est moi qui paye. Nous ferons nos comptes ensemble.
Pendant ce dialogue, le mouvement des entrées et des sorties sous la porte cochère a continué.
On a vu passer des apprentis qui sur leurs blouses noires portent des petites boîtes suspendues à leur cou par des chaînes de fer ; – des femmes pâlies par la misère, qui entrent là comme au mont-de-piété ; – des hommes au teint bronzé qui parlent entre eux de placers et de poudre d’or : un défilé de brocanteurs.
Alors, si l’on rapproche ces diverses observations et si on les complète les unes par les autres, on trouve que les cheminées au-dessus des ateliers sont celles d’une fonderie, – que les cylindres sont des laminoirs à métaux, – que la caisse en maroquin apportée par la femme voilée devait contenir de l’argenterie qu’on venait vendre, – que le marchand de lorgnettes était un recéleur, et le pâle voyou un filou qui cherchait à se débarrasser d’un lingot volé ; – que les hommes qui parlaient de placers étaient des mineurs californiens ou australiens qui voulaient vendre leur poudre d’or avant de rentrer dans leur village, – que les apprentis en blouses noires venaient chercher des matières d’or et d’argent pour être travaillées chez les orfèvres et les bijoutiers, et l’on arrive à cette conclusion que la maison Daliphare fait le commerce des métaux précieux, qu’elle achète de toutes mains, à l’état de vieille argenterie, de galon, de cassures, de poudre, de résidus, de déchets, l’or et l’argent ; qu’elle fond ces métaux, et qu’après les avoir affinés, elle les revend pour la bijouterie.
II
Le jour où ce récit commence, un vendredi soir, les employés de la maison Daliphare étaient en émoi.
Depuis huit jours monsieur Daliphare était gravement malade, et les nouvelles qui d’heure en heure étaient parvenues dans les bureaux avaient été de plus en plus mauvaises. Ces bureaux occupant tout le rez-de-chaussée et le premier étage de la maison, tandis que le second était réservé à l’habitation personnelle, les commis se trouvaient en rapports continuels avec les domestiques, et par ceux-ci ils suivaient pas à pas, pour ainsi dire, la marche de la maladie.
D’ailleurs Lutzius, le caissier, un Allemand curieux et bavard, qui était toujours aux aguets pour apprendre ce qui ne le regardait point, s’était adroitement arrangé pour rencontrer comme par hasard le médecin dans l’escalier, et avec un sourire bonhomme, l’œil mouillé, se frottant les mains, inclinant sur l’épaule son crâne rouge et poli, riant des dents et pleurant du nez, « il s’était permis de demander des nouvelles positives du patron, non par curiosité, car, grâce à Dieu, n’étant point affligé de ce défaut, il n’avait pas l’habitude de s’occuper des affaires des autres, mais par intérêt, par ce sentiment naturel qui fait qu’on prend souci de ceux qu’on aime, et quand on a été dix ans dans une maison, on s’attache, si l’on a du cœur, à ceux sous la direction desquels on a travaillé. »
Ainsi interpellé, le médecin avait secoué gravement la tête et avait répondu que maintenant un miracle seul pouvait sauver monsieur
Daliphare. Puis profitant de l’accablement obligé dans lequel ses paroles avaient jeté le caissier, il s’était adroitement esquivé en s’effaçant contre la rampe.
Rentré derrière son grillage, Lutzius avait envoyé chercher le chef de la fonderie, et à l’oreille il lui avait confié la communication du médecin. Puis après le chef de la fonderie il avait fait la même confidence à un autre, puis après cet autre, à un autre encore. De sorte que tous l’avaient successivement reçue, depuis le grand
Mayadas, le commis chargé de la correspondance, jusqu’au petit Flavien, et, bien entendu, toujours à l’oreille, avec émotion et componction.
Cette nouvelle s’ajoutant à toutes celles qui se succédaient depuis le commencement de la semaine, avait provoqué les conversations de voisin à voisin. Puis à l’heure de la fermeture des bureaux, on s’était groupé dans la cour ; on avait diagnostiqué, disputé. On s’était reconduit dans la rue. Et en fin de compte on s’était séparé chacun rentrant chez soi assez inquiet.
Pour être exact, il faut préciser ce sentiment d’inquiétude et ne pas laisser croire qu’il était inspiré chez ces employés par la crainte égoïste de se trouver du jour au lendemain sur le pavé, sans place, par suite de l’écroulement de leur maison.
Que monsieur Daliphare mourût ou ne mourût pas de la maladie dont il était atteint, la maison de la rue des Vieilles-Haudriettes n’en continuerait pas moins à être ce qu’elle était depuis trente ans.
Il pouvait disparaître, la maison à laquelle il avait donné son nom, mais qu’il n’avait jamais dirigée, resterait après lui debout et solide.
Le vrai chef de cette maison n’était point en effet monsieur Daliphare, c’était madame Daliphare, ou plus justementMadame, comme disaient les employés en parlant d’elle. C’était elle, elle seule qui l’avait fondée et qui, par son travail, son intelligence, son énergie, l’avait amenée à ce degré de prospérité ; c’était elle qui, après la mort de son mari (s’il devait mourir), continuerait d’en être le patron, le maître absolu.
Fille d’un brocanteur de la rue des Quatre-Fils, mademoiselle Félicité Choichillon, à l’âge où les enfants jouent encore à la poupée, s’était associée à son père ; mais au lieu de s’en tenir aux habitudes paternelles, c’est-à-dire à l’achat et à la vente de la friperie, de la ferraille et des vieilleries de toutes sortes qui forment le fonds d’un brocanteur du quartier du Temple, elle avait entrepris le commerce de l’or et de l’argent.
Elle avait alors treize ans, et, pour toute instruction, elle savait lire, sûrement et rapidement calculer de tête, et à peu près écrire, pourvu que ce ne fût pas en caractères très fins et qu’elle eût le temps de s’appliquer.
Heureusement pour elle, la nature l’avait douée de ce que l’étude ne donne pas : une volonté qui ne connaissait ni le doute, ni la fatigue, ni le découragement, un âpre besoin de gagner, et l’intelligence, on peut même dire le génie du commerce.
Pourvu qu’il achetât sa friperie bon marché et la revendît cher, le père Choichillon était satisfait, et il ne demandait rien de plus à la vie ; brocanteur il avait commencé, brocanteur il finirait. Sa fille avait d’autres idées en tête, des rêves d’enfant si l’on veut ; mais qui mieux que l’enfant sait poursuivre et finalement obtenir ce qu’il désire ?
En prenant dans la maison de son père la place de sa mère morte, la petite Félicité, maniant l’argent de la caisse pour la première fois, avait remarqué que ce qui donnait les plus gros bénéfices, c’étaient les vieux galons, les vieilles épaulettes, les timbales d’argent, les fourchettes cassées. Cette remarque n’avait point été perdue pour elle : en moins de six mois, la boutique de friperie avait été vendue, et le père Choichillon n’avait plus acheté que des matières d’or ou d’argent.
Il en avait coûté au vieux brocanteur de renoncer à ses habitudes. Il tenait à ses courses du matin par les rues de la ville, à son cri :Habits, galons !qui était une sorte de propriété héréditaire comme une enseigne ; il tenait surtout à ses stations chez les marchands de vins. Avec une adresse toute féminine, la jeune fille n’avait point attaqué de front ces idées ; mais manœuvrant avec prudence, elle les avait habilement accommodées à ses désirs. Le père Choichillon avait continué ses courses et aussi ses stations rafraîchissantes ; seulement, au lieu d’accepter toutes espèces de marchandises comme autrefois, il n’avait plus acheté que celles dans lesquelles l’or ou l’argent entrait à un titre quelconque, les vieux bijoux et la vieille argenterie.
Pour Félicité, s’emparant dans la boutique de la place donnée jusque-là à la friperie et à la ferraillerie, elle y avait installé un fourneau à réverbère et des creusets en fer battu margés avec de l’argile ; puis cela fait elle avait été chercher un habile ouvrier chez un affineur de la rue Aubry-le-Boucher et elle avait entrepris la fonte des métaux précieux.
Le commerce de ces métaux ne consiste pas uniquement à peser exactement les matières qu’on vous apporte et à les payer d’après la valeur connue de l’or ou de l’argent ; puis, cela fait, à les fondre et à les revendre affinés aux orfèvres et aux bijoutiers. Ces matières, en effet, ne sont pas pures, elles contiennent un alliage variable. En France, le titre de ces alliages a été légalement fixé : pour les monnaies d’argent, il est de 900/1000es; pour la vaisselle, de 950/1000es; pour la bijouterie, de 800/1000es. Si ceux qui font métier d’acheter les vieilles vaisselles ou les vieux bijoux n’avaient à peser dans leurs balances que des matières argentifères fondues en France depuis que leur titre a été fixé, le calcul qu’ils ont à faire serait des plus faciles. Mais il n’en est pas ainsi ; les objets qu’achètent les fondeurs n’ont pas tous été fabriqués en France ; quelques-uns l’ont été dans les pays étrangers et à des époques plus ou moins reculées ; leur titre varie donc, et conséquemment leur valeur.
En moins de trois ans, « la petite Choichillon », comme on disait en parlant de celle qui devait devenir bientôt
« Mademoiselle », puis « Madame », apprit à connaître les métaux au point d’en remontrer au meilleur essayeur. Sa pratique valait la plus savante théorie, et plus promptement, plus sûrement qu’un employé du Cabinet des médailles, elle savait reconnaître et estimer les florins de Florence, les sterling et les nobles d’Angleterre, les ducats de Venise ou de Gênes, les écus, les henris, les louis d’or, les médailles, les méreaux et les jetoirs, les lingots frappés à l’écu de Castille qui pendant si longtemps ont été en usage dans les Amériques. Dans sa boutique sombre, assise du matin au soir à son comptoir, ayant devant elle ses balances brillantes, cette jeune fille de dix-sept ans livrait bataille au juif le plus retors et ne se laissait pas prendre aux histoires les mieux arrangées de recéleurs. Sans
jamais écrire un mot sur le papier, elle faisait de tête, en quelques secondes, des calculs compliqués, et ne se trompait jamais dans ses comptes.
Bientôt la boutique de la rue des Quatre-Fils devint trop petite, non pour placer ses employés, elle n’en prenait aucun, mais pour construire les nouveaux fourneaux qui lui étaient nécessaires. Elle loua alors le rez-de-chaussée de la maison de la rue des Vieilles-Haudriettes, et, dans les bâtiments annexés qu’elle fit construire, elle installa avec sa fonderie des ateliers d’affinage et de laminage.
Elle avait alors juste vingt-et-un ans, et, en huit années, d’un pauvre petit fripier elle avait fait un industriel qui pouvait ouvrir des crédits à tous les petits fabricants d’orfèvrerie et de bijouterie du quartier du Temple.
Pendant ces huit années elle ne s’était pas donné une journée de plaisir, pas une promenade à la campagne ; ses seules distractions avaient été, tous les ans, une visite à la foire aux pains d’épice, et de temps en temps, de loin en loin, en été, une soirée à la Gaîté ou à l’Ambigu.
Mais l’accroissement de son commerce et de sa fortune avait enfin modifié sa vie : il avait fallu prendre des commis, établir une comptabilité, et confier à des étrangers la marche de ses affaires jusque-là secrète.
C’était afin d’échapper autant que possible à cette nécessité, pour elle véritablement cruelle, car elle était mystérieuse et cachottière en tout, qu’elle s’était mariée. Le chef de sa comptabilité, Benoît Daliphare, était un bel homme, élève de monsieur Prudhomme autant que Brard et SaintOmer ; elle en avait fait son mari, sans exiger de lui, – dans la vie conjugale, rien que sa belle prestance, – dans la vie commerciale, rien que sa belle écriture.
Pendant trente années, le digne homme n’avait jamais été autre chose, dans le monde, que le mari de madame Daliphare, et, dans sa maison, que le premier commis de sa femme.
Son fils même n’avait jamais été son fils. Il avait eu le droit de le promener les jours de sortie au jardin des Plantes, sur les boulevards, aux Champs-Élysées, mais à cela s’étaient bornés ses devoirs de père. Pour tout le reste, Adolphe avait été le fils de sa mère. C’était celle-ci qui avait choisi les premiers professeurs de son enfant, qui plus tard avait fixé le collège où il entrerait, et qui, plus tard encore, avait décidé qu’il lui succéderait dans sa maison. Enfin c’était elle qui, depuis sa naissance, l’avait d’heure en heure dirigé, faisant sentir en tout et pour tout sa volonté de maître autant que sa tendresse de mère, car cette femme, douée de plus de tête que de cœur, adorait son fils.
Dans ces conditions, la guérison ou la mort de monsieur Daliphare ne touchait donc pas ses employés dans leurs intérêts directs. Qu’il mourût ou qu’il ne mourût pas, ils étaient certains que la maison resterait debout, et, au point de vue de leur position personnelle et de leurs appointements, c’était là l’essentiel.
III
Cependant le lendemain matin les employés furent d’une exactitude extraordinaire pour arriver au bureau ; plusieurs même devancèrent l’heure de l’ouverture des portes.
Après tout, c’était le patron ; la curiosité était excitée.
Il n’avait jamais été en situation de rendre service, cela était vrai ; mais, d’un autre côté, il n’avait jamais fait de mal à personne ; et cela lui eût été facile s’il l’avait voulu, car, si peu de pouvoir qu’on ait pour le bien, on en a toujours assez pour le mal.
C’était un pauvre homme ; ce n’était pas un méchant homme. Et, avec une autre femme, moins despote, il eût pu, comme bien d’autres, tenir sa place dans le monde ; non au premier rang, bien entendu, mais dans la foule. C’était heureux qu’il eût plié sous la volonté de sa femme, car s’il avait tenté de résister, il eût assurément été brisé. Ils avaient fait bon ménage, grâce à la facilité de son caractère, et grâce à l’intelligence de sa femme, ils avaient fait fortune.
Quelle était cette fortune ?
Les évaluations variaient ; comme toujours, elles allaient à l’extrême.
Si madame Daliphare n’avait pas fait tant de crédits à tous les orfèvres, cette fortune serait considérable. Mais, par ses crédits, elle a perdu beaucoup d’argent. Combien de comptes n’a-telle pas ouverts qui n’ont jamais été soldés ! Pour une visite qu’on lui faisait, pour un compliment qu’on lui adressait, pour un bouquet qu’on lui apportait de la campagne en lui disant qu’on l’avait cueilli à son intention, elle livrait pendant des mois, pendant des années, des fournitures d’or et d’argent sur lesquelles elle n’avait pas touché vingt pour cent. Combien de petits bijoutiers besogneux, combien de gros fabricants gênés dans leurs affaires n’ont pas eu honte d’exploiter son faible pour la flatterie et la vanité ! On savait qu’en l’appelant « ma bonne dame Daliphare », qu’en lui disant qu’on lui devait tout, qu’en se mettant franchement (ou hypocritement) sous sa protection ou dans sa dépendance, on faisait d’elle ce qu’on voulait, et l’on en avait largement usé.
Sans nier ces crédits, ils n’étaient pas ce qu’on voulait bien dire, et la fortune de la maison Daliphare, fortune liquide et certaine, était magnifique.
Magnifique est un mot. Quel était le montant de cette fortune ? À cela on ne pouvait répondre par un chiffre, et l’on était d’accord que trois personnes seulement à Paris pouvaient le fixer : l’agent de change de madame Daliphare, son banquier et son notaire, monsieur de la Branche ; et encore pour cela eût-il fallu les réunir tous les trois ; car, si le banquier connaissait les valeurs de banque, l’agent de change, les valeurs de bourse, et le notaire, les valeurs immobilières, aucun d’eux ne pouvait additionner ces trois chiffres et en former un total.
L’ouverture des portes par l’homme de peine, chargé de la garde des bureaux, interrompit ces discussions des employés. On l’entoura, on se jeta sur lui pour avoir des nouvelles de la nuit.
Elles étaient aussi mauvaises que possible. On avait été, à cinq heures du matin, chercher l’abbé Turgis, le vicaire des Blancs-Manteaux, et maintenant on attendait la catastrophe d’un moment à l’autre. À ce moment entra dans le bureau un petit homme, le front baigné de sueur et les chaussures blanches de poussière.
Comment va le patron ? dit-il en accrochant son chapeau à la patère qui était derrière sa place.
Mal, très mal.
Peu satisfait de cette réponse, le petit homme se mit à faire le tour du bureau, interrogeant ses confrères les uns après les autres, à tous posant la même question : « Est-ce qu’on croit que c’est pour aujourd’hui ? Comme c’est malheureux ! Pour ce matin peut-être ? »
Ainsi s’avançant toujours, il arriva à la caisse de Lutzius, et il posa ces questions à celui-ci :
Vous êtes vraiment trop curieux, dit le caissier du ton rogue que prennent les gens lorsqu’ils croient de leur devoir de donner une leçon de morale ; je ne connais rien de plus mauvais que la curiosité. La Bible nous apprend...
Que vous importe, mon cher Pommeau, que ce soit pour aujourd’hui ou pour demain ? interrompit Mayadas, qui précisément était en conférence avec le caissier. Ce qu’il y a de certain, c’est que monsieur Daliphare est perdu ; ce soir, demain, ce n’est plus qu’une affaire de temps, d’heures, de minutes peut-être.
Voilà précisément pourquoi j’insistais, répliqua Pommeau d’un air naïf. Puisque le patron est condamné, il doit mourir. Alors je voulais savoir s’il mourrait ce matin, parce que mort on ferme la maison, n’est-ce pas ? et, dans ce cas, je peux retourner tout de suite à la Varenne.
Est-ce que votre femme est malade ?
Oh ! non ; seulement j’ai de la salade à planter, et, de ce temps sec, si elle n’est pas arrosée plusieurs fois par jour, elle ne reprendra pas. Que M. Daliphare meure aujourd’hui, on l’enterrera lundi. Ça me ferait trois jours à la maison ; ma salade serait sauvée.
Franchement, s’écria Mayadas en riant, vous êtes superbe. Toutes les passions, même celle du jardinage, nous rendent féroces.
Je ne souhaite pas la mort de monsieur Daliphare, pauvre cher homme.
Non, répliqua sévèrement le caissier, seulement vous l’exploitez d’avance, ce qui est tout aussi immoral.
Pour moi, continua Mayadas, je ne la désire pas plus que je ne l’exploite, cependant j’avoue que je me demande avec une certaine curiosité ce que « Madame » répondra désormais aux propositions qui lui seront faites. Quand elle ne voulait pas les refuser franchement, elle avait l’habitude de dire : « Il faut que je consulte mon mari. » Comme si le pauvre homme avait été autre chose qu’un zéro dans la maison !
Maintenant, comment se tirera-t-elle d’affaire ?
Elle dira qu’il faut qu’elle consulte son fils, répliqua le caissier en riant silencieusement de cette plaisanterie.
Monsieur Adolphe n’est pas à Paris, continua Pommeau.
Il y reviendra ; je lui ai envoyé hier une dépêche à Amsterdam, dit le caissier ; il arrivera sans doute aujourd’hui ou demain, car il connaît la situation de son père.
Oui, mais restera-t-il à Paris ? demanda Mayadas, et « Madame » voudra-t-elle l’associer à ses affaires ? Vous savez mieux que moi comme elle est jalouse de son autorité ; elle ne pourra pas faire de son fils ce qu’elle a fait de son mari ; il faudrait qu’elle partageât avec lui.
Si, au lieu d’être depuis un an seulement dans la maison, continua Lutzius, vous y étiez comme moi depuis dix ans, vous ne parleriez pas ainsi. Que « Madame » veuille être maîtresse chez elle, c’est vrai ; mais s’il y a quelqu’un au monde devant qui elle ne passe que la seconde, c’est son fils. Non seulement elle céderait sans crier son autorité à monsieur Adolphe, mais encore elle la lui offrirait.
Alors pourquoi l’a-t-elle envoyé à Liverpool, à Londres et à Amsterdam ? On dit que c’est pour qu’il apprenne le commerce à l’étranger, mais pour moi ce n’est là qu’un prétexte. La vérité est que monsieur Adolphe n’était plus un jeune homme qu’on pouvait faire marcher comme on voulait ; il prenait trop d’empire dans la maison, on l’a exporté comme dangereux.
Vous avez raison de croire que monsieur Adolphe n’apprend pas le commerce à l’étranger, attendu qu’il sait tout ce qu’il a besoin de savoir et même plus ; mais vous avez tort de penser qu’on l’a renvoyé parce qu’il prenait trop d’empire dans la maison.
Alors ?
Lutzius regarda à travers le grillage de sa caisse. Les commis étaient à leur place, et déjà quelques personnes étaient devant les guichets, faisant peser les objets qu’elles apportaient pour les vendre. On pouvait causer dans la caisse sans être entendu au dehors.
Cependant, pour plus de sûreté, il fit signe à Mayadas et à Pommeau de s’approcher.
Vous, Pommeau, qui êtes depuis longtemps ici, dit-il à mi-voix et en mettant sa main devant sa bouche, vous avez vu monsieur Adolphe dans la maison, et vous savez si « Madame » avait peur de lui laisser prendre de l’autorité. Elle le poussait toujours en avant au contraire, et comme il est naturellement assez timide, prêt à voir des difficultés et à se faire des scrupules dans tout, elle le forçait à prendre tout seul des décisions importantes. Ce n’est donc pas la raison que donne Mayadas qui fait que monsieur Adolphe se promène à l’étranger, où il avait tout d’abord été envoyé pour un mois et où il est depuis bientôt un an. C’en est une autre.
J’ai entendu dire, interrompit Pommeau, que « Madame » avait peur de voir M. Adolphe faire un mauvais mariage, et que c’est pour cela qu’elle l’a envoyé voyager. Seulement, comme ça ne me regardait pas, je n’en sais pas davantage.
Moi non plus, ça ne me regardait pas, continua Lutzius, et, si j’en sais plus que Pommeau, c’est par hasard, c’est que j’ai causé avec les uns et les autres, et que tout naturellement j’ai appris bien des choses. Je n’ai pas pour habitude de me mêler de ce qui n’est pas mes affaires ; ma caisse le jour, le soir, quatre ou cinq chopes avec ma pipe, et je suis content. Nous ne sommes pas, nous autres têtes carrées, comme les Français qui se fourrent dans tout et qui ne peuvent pas entendre parler d’une histoire de femme sans ouvrir les yeux et les oreilles. Moi, les histoires de femme, ça m’ennuie... comme toutes les histoires d’ailleurs.
Enfin, vous savez celle-là, interrompit Mayadas.
Vous voilà bien avec votre curiosité ! Quel drôle de caractère que celui des Français ! Mais comme je suis bon enfant, je veux vous satisfaire. Vous avez dîné à Nogent, n’est-ce pas, avec tous les employés, lors de la fête de madame ?
Oui.
Alors, si vous avez des yeux pour voir, vous avez remarqué une jeune fille qui à table était placée à la droite de monsieur Adolphe ?
Assurément, et je la vois encore ; je vois ses yeux profonds, sa bouche souriante et ses cheveux. Oh ! quels cheveux ! elle s’habillerait avec !
Eh bien ! cette jeune personne était mademoiselle Juliette Nélis. Mademoiselle Nélis est la fille du financier Nélis dont vous avez sûrement entendu parler. À seize ans, elle a perdu son père, et elle est restée avec sa mère, complètement ruinée, si bien ruinée qu’elle a été forcée de travailler pour vivre. Heureusement, elle avait étudié la peinture ; elle a peint pour gagner le pain quotidien. Madame Daliphare était liée avec la famille Nélis. Quand celle-ci a été ruinée, elle a continué à recevoir la mère et la fille le dimanche à Nogent. La jeune personne était jolie et elle retenait monsieur Adolphe à la maison, en l’empêchant de canoter, d’aller aux courses et de s’amuser avec les gueuses. Il paraît qu’il y a en France des mères qui spéculent sur la beauté des jeunes filles pour garder leur fils près d’elles et les préserver de certains dangers. Peutêtre que si monsieur Adolphe avait fait de mademoiselle Juliette sa maîtresse, ça aurait continué à bien marcher. Madame Daliphare aurait fermé les yeux, heureuse d’avoir son fils sous son aile. Mais ça ne s’est pas arrangé comme ça, monsieur Adolphe s’est mis à aimer mademoiselle Nélis pour tout de bon, et celle-ci, qui est une fine mouche, n’a pas été assez bête pour devenir la maîtresse d’un homme riche, très riche, dont elle pouvait faire son mari. Quand madame Daliphare s’est doutée de la tournure que les choses prenaient, elle a envoyé monsieur Adolphe à l’étranger ; maintenant elle le fait revenir pour la mort de son père ; mais le gardera-t-elle à Paris ? S’il aime toujours mademoiselle Nélis, on ne peut point, n’est-ce pas, lui laisser épouser une femme qui n’a pas un sou de dot ?
À ce moment, un commis, descendant des appartements particuliers, se précipita dans la caisse et s’approchant de Lutzius :
Le patron est mort, dit-il.
C’est vrai ?
Il vient de mourir : c’est Françoise qui me l’a dit.
IV
L’entrée bruyante du commis dans la caisse avait attiré l’attention de tous les employés. On savait qu’il descendait du second étage, et son air effaré annonçait une catastrophe.
Chacun se leva et accourut vers le bureau de Lutzius.
Deux commis qui étaient à ce moment même occupés à peser des matières d’or, abandonnèrent leurs balances pour venir savoir ce qui se passait.
Les personnes qui étaient devant leurs guichets, en voyant cette disparition inexplicable, restèrent ébahies : l’une était une femme du peuple, qui tenait un enfant au maillot dans ses bras, l’autre était une femme élégante et distinguée.
Eh bien ! s’écrièrent les deux commis en arrivant dans la caisse.
Le patron est mort, répondit doucement Pommeau ; Flavien le sait par Françoise : c’est certain.
Messieurs, dit Lutzius, retournez donc à vos places ; ce que vous faites là est inconvenant.
Sans répliquer, les deux curieux revinrent à leurs comptoirs.
Est-ce que vous n’allez pas me payer mon anneau ? demanda la femme à l’enfant, qui avait entendu la réponse de Pommeau ; je ne pourrais pas attendre.
Si... 2 grammes d’or à 2 fr. 80 le gramme, cela fait 5 fr. 60. Où demeurez-vous ?
Rue du Chevaleret.
Derrière la gare d’Orléans !. Et vous venez jusqu’ici pour vendre deux grammes d’or ?
On m’a dit que vous m’achèteriez plus cher que les bijoutiers.
Avez-vous des papiers ?
Non.
Alors on va aller avec vous ; on vous payera
à domicile.
Croyez-vous donc que j’ai volé cet anneau ? c’est celui de mon mariage.
Pendant ce temps on pesait le lot de la femme élégante : chaînes, bagues d’où l’on retirait les pierres, montres d’où l’on retirait le mouvement, et on lui donnait un bon à toucher de 5400 fr.
Les deux femmes parties, comme il ne se trouvait pas d’autres vendeurs dans le bureau, les commis revinrent promptement à la caisse où tout le monde était réuni, discutant sur l’événement qui venait d’arriver.
Il est certain qu’on va fermer la maison, disait l’un d’eux.
Il est huit heures et demie, dit Pommeau en regardant à sa montre, si l’on fermait tout de suite, je pourrais prendre le train de neuf heures cinq minutes ; je serais à dix heures dans mon jardin.
Ce pauvre monsieur Daliphare ! Qui nous aurait dit il y a quinze jours qu’il en viendrait là ?
Et si vite.
Ce n’était pas un homme solide, il était soufflé.
C’est vraiment malheureux quand on a la fortune, mourir avant d’en avoir joui.
Certainement c’est très malheureux, continua Pommeau, seulement, si on ne ferme pas tout de suite, je manquerai le train de neuf heures, je ne pourrai prendre que celui de dix heures. J’arriverai à onze heures : le soleil sera trop chaud, ce sera une journée perdue.
Puis s’adressant au caissier :
Croyez-vous qu’il ne serait pas à propos de faire demander à « Madame » si l’on ne doit pas fermer ?
Madame n’est pas femme à perdre la tête.
On peut oublier ; dans le trouble, le chagrin, l’émotion...
Elle n’oublie rien. Si elle trouve bon de fermer les bureaux, elle nous le fera dire ; jusquelà, attendons et gardons nos places. Nous avons l’air d’écoliers échappés ; véritablement ce n’est pas convenable.
Alors on se mit à parler de convenances, de respect humain, d’usages. Et l’on fut unanime à dire que les convenances et le respect humain exigeaient la fermeture immédiate des bureaux.
Quand il y a un mort dans une maison, l’usage veut qu’on ferme les portes. « Fermé pour cause de décès », c’est obligé.
Pommeau n’était pas seul à avoir des raisons personnelles pour partir immédiatement. Chacun avait « sa salade à planter ». L’un venait de se souvenir qu’il n’avait pas vu depuis longtemps sa mère, qui demeurait aux environs de Beauvais : la mort de M. Daliphare lui offrait une occasion favorable pour entreprendre ce voyage. L’autre avait des copies de pièces à faire pour un avoué : elles étaient pressées et il devait passer dans ce travail ses deux nuits du samedi et du dimanche. S’il pouvait rentrer tout de suite chez lui, il pourrait s’acquitter tranquillement de sa besogne et dormir dans son lit. Flavien, le plus jeune des commis, qui n’avait que dix-sept ans, comptait et recomptait sa bourse : il y trouvait quatorze francs, et il interrogeait ses camarades pour savoir si avec sept francs il pourrait passer la journée du dimanche au Havre, parce qu’alors il prendrait le train de plaisir du soir. Sept francs de chemin de fer et sept francs de dépenses diverses pour se nourrir et s’amuser, cela employait son capital. Il n’avait jamais vu la mer, quelle fête ! et les phares, et les navires d’émigrants, et les barques de pêche, et la marée basse avec ses coquillages sur la grève, et le soleil, et les étoiles ! Flavien était poète ; au moins il s’essayait à faire des vers qu’un imprimeur du quartier lui avait promis d’éditer à cent cinquante exemplaires en échange de l’obtention des fournitures d’imprimés pour la maison Daliphare.
Pour que tout cela pût se réaliser, il fallait que les bureaux fussent immédiatement fermés et que l’enterrement se fît le lundi.
N’aurait-il pas lieu le dimanche ?
Grave question qu’on discutait sans pouvoir se mettre d’accord, tant les raisons étaient solides de l’un et l’autre côté.
Monsieur Daliphare étant mort le samedi matin, on pouvait très bien l’enterrer le dimanche dans l’après-midi. – Alors on n’avait pas de messe. – Sans doute, mais l’inconvénient de n’avoir pas de messe ne serait-il pas compensé, aux yeux de madame Daliphare, par l’avantage d’ouvrir les bureaux dès le lundi matin ? elle n’aimait pas à perdre du temps. – Non, mais d’un autre côté elle n’aimait pas non plus à blesser les convenances : elle voudrait un bel enterrement, une grande messe et tout ce qui s’ensuit. – Elle aimerait mieux gagner de l’argent dans ses bureaux que d’en dépenser à l’église. –
L’enterrement se ferait le lundi, il se ferait le dimanche ; on fermerait tout de suite, on ne fermerait pas.
Les discussions allaient ainsi : Pommeau interrogeait sa montre de minute en minute, Flavien cherchait dans leBottindes restaurants à bon marché au Havre, lorsque tout à coup on entendit des craquements et des bruits de pas au haut d’un petit escalier tournant qui du second étage descendait à la caisse. Construit en ces derniers temps, ce petit escalier servait à faire communiquer les appartements particuliers avec les bureaux du premier étage et du rez-dechaussée, et il permettait à madame Daliphare de surveiller facilement tout ce qui se passait dans la maison.
En entendant ce bruit bien connu, chacun regagna sa place en toute hâte et prit son air affairé ; Lutzius lui-même ouvrit rapidement son journal de caisse, et, une plume à la main, se mit à suivre des colonnes de chiffres.
Une petite femme sèche et nerveuse descendit l’escalier. C’était madame Daliphare : cinquante ans, la mine et la vivacité d’une souris, la figure pâle, ne disant rien, mais cachant beaucoup de choses ; à la ceinture, se détachant, sur une robe de grenadine noire, un trousseau de clefs polies par l’usage.
En l’entendant marcher dans sa caisse, Lutzius se retourna vivement ; l’expression de son visage était habilement composée, elle voulait montrer une profonde douleur et en même temps une respectueuse discrétion ; il s’inclina, puis relevant la tête il s’apprêtait à parler, lorsque madame Daliphare, lui imposant silence d’un geste sec, s’avança vers la porte grillée qui de la caisse communique avec les bureaux.
Monsieur Pommeau, dit-elle.
Puis, sans attendre, elle revint sur ses pas, et prenant une clef à son trousseau elle ouvrit une porte qui se trouvait à l’extrémité opposée, celle de son cabinet particulier.
Pommeau en entrant la trouva assise devant son bureau parcourant une liasse de papiers.
Monsieur Pommeau, dit-elle d’une voix nette et sans lever les yeux sur son employé, vous vous rendrez à trois heures à la gare d’Orléans, et vous prendrez votre billet pour Foix. Vous emporterez avec vous le livre sur lequel vous avez inscrit l’achat que vous avez fait à Salomon de 3 kilogrammes 540 grammes d’or. Il s’agit de donner des explications au jury dans une affaire où Salomon est inculpé comme recéleur. Vous produirez votre livre et vous direz comment vous avez fait cet achat à Salomon, avec qui nous étions depuis longtemps en relation comme faisant métier d’acheter du galon.
Mais, madame...