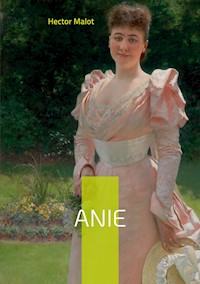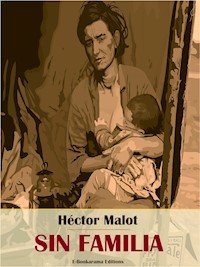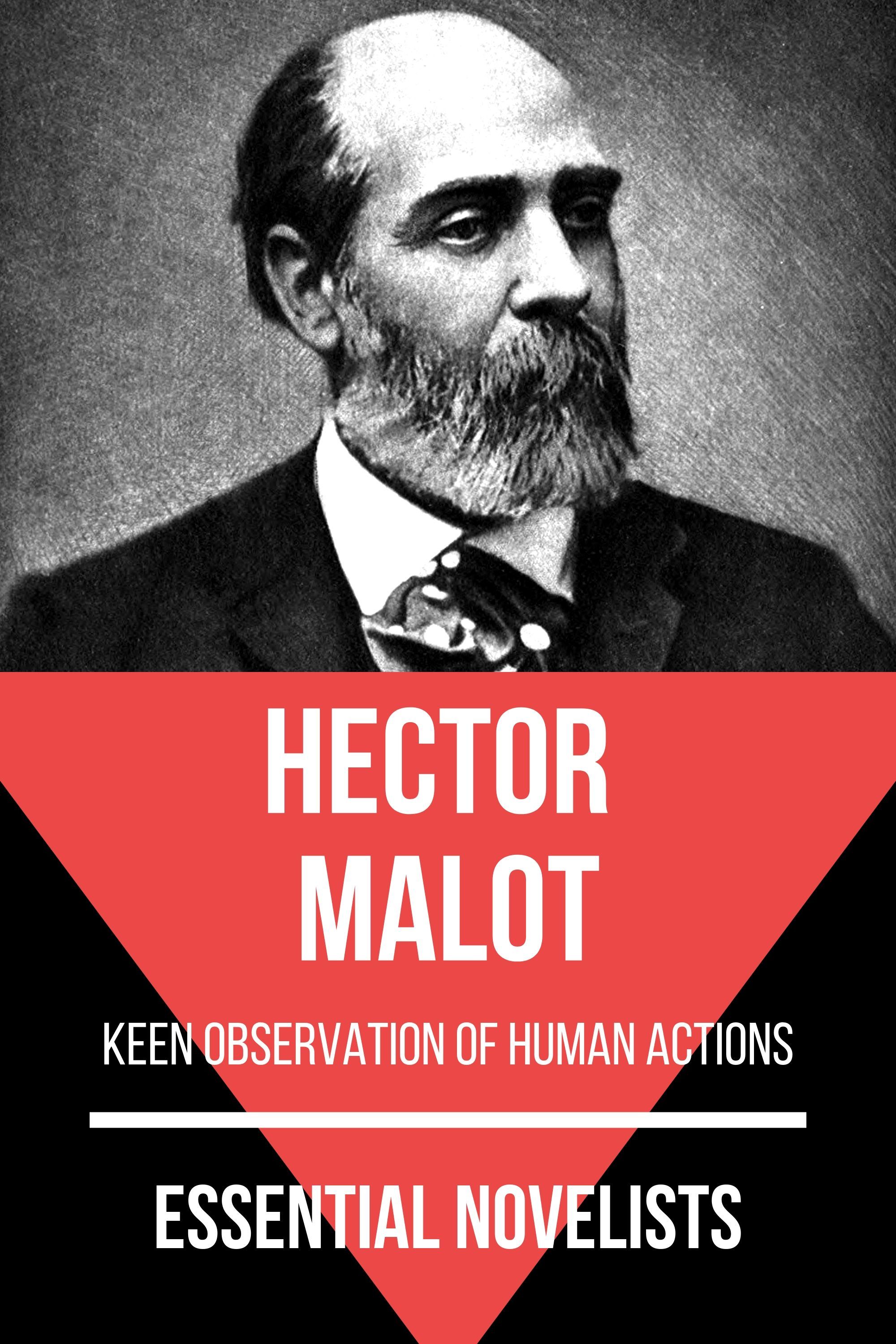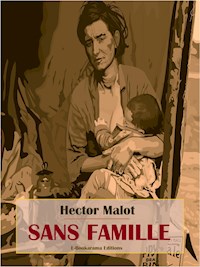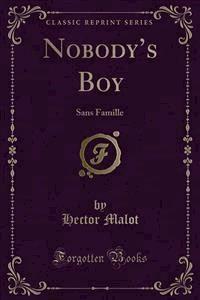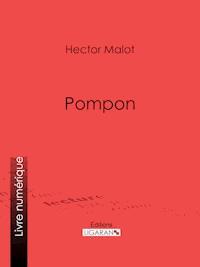0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HECTOR MALOT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Voici l'édifiante histoire de Rémi, enfant trouvé, recueilli par la brave mère Barberin, puis acheté par le signor Vitalis, ancien chanteur qui possède une troupe d'animaux savants. Rémi part avec eux, apprend le métier. Un jour, après bien des vicissitudes inhérentes à la condition de pauvres saltimbanques ambulants, Vitalis meurt de froid dans les carrières de Gentilly. Rémi se trouve alors d'autres maîtres : un jardinier, avec une fille muette, Lise. Mais ces temps heureux ne durent guère...Nous ne vous dévoilerons pas toutes les aventures que va connaître Rémi, dont la légitime obsession est de retrouver ses parents. Comme vous pouvez vous en douter, il y parviendra. Un grand classique de la littérature pour la jeunesse, que nous vous recommandons, et que vous pouvez lire à tout âge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Sans famille
Hector Malot
A French writer, born in La Bouille, on May 20, 1830. Studied law in Rouen and Paris. Worked as a dramatic critic for Lloyd Francais and as a literary critic for L'Opinion Nationale. Les Amants, his first book, was published in 1859. Malot wrote over 70 books, of which perhaps the most famous became Sans Famille (Nobody's Boy, 1878, also published as The Foundling in English.) Hector Malot died on July 17, 1907.
À Lucie Malot.
Pendant que j’ai écrit ce livre, j’ai constamment pensé à toi, mon enfant, et ton nom m’est venu à chaque instant sur les lèvres. – Lucie sentira-t-elle cela ? – Lucie prendra-t-elle intérêt à cela ? Lucie, toujours. Ton nom, prononcé si souvent, doit donc être inscrit en tête de ces pages : je ne sais la fortune qui leur est réservée, mais quelle qu’elle soit, elles m’auront donné des plaisirs qui valent tous les succès, – la satisfaction de penser que tu peux les lire, – la joie de te les offrir.
HECTOR MALOT.
Partie 1
Chapitre1 Au village.
Je suis un enfant trouvé.
Mais jusqu’à huit ans j’ai cru que, comme tous les autres enfants, j’avais une mère, car lorsque je pleurais, il y avait une femme qui me serrait si doucement dans ses bras, en me berçant, que mes larmes s’arrêtaient de couler.
Jamais je ne me couchais dans mon lit, sans qu’une femme vînt m’embrasser, et, quand le vent de décembre collait la neige contre les vitres blanchies, elle me prenait les pieds entre ses deux mains et elle restait à me les réchauffer en me chantant une chanson, dont je retrouve encore dans ma mémoire l’air, et quelques paroles.
Quand je gardais notre vache le long des chemins herbus ou dans les brandes, et que j’étais surpris par une pluie d’orage, elle accourait au-devant de moi et me forçait à m’abriter sous son jupon de laine relevé qu’elle me ramenait sur la tête et sur les épaules.
Enfin quand j’avais une querelle avec un de mes camarades, elle me faisait conter mes chagrins, et presque toujours elle trouvait de bonnes paroles pour me consoler ou me donner raison.
Par tout cela et par bien d’autres choses encore, par la façon dont elle me parlait, par la façon dont elle me regardait, par ses caresses, par la douceur qu’elle mettait dans ses gronderies, je croyais qu’elle était ma mère.
Voici comment j’appris qu’elle n’était que ma nourrice.
Mon village, ou pour parler plus justement, le village où j’ai été élevé, car je n’ai pas eu de village à moi, pas de lieu de naissance, pas plus que je n’ai eu de père et de mère, le village enfin où j’ai passé mon enfance se nomme Chavanon ; c’est l’un des plus pauvres du centre de la France.
Cette pauvreté, il la doit non à l’apathie ou à la paresse de ses habitants, mais à sa situation même dans une contrée peu fertile. Le sol n’a pas de profondeur, et pour produire de bonnes récoltes il lui faudrait des engrais ou des amendements qui manquent dans le pays. Aussi ne rencontre-t-on (ou tout au moins ne rencontrait-on à l’époque dont je parle) que peu de champs cultivés, tandis qu’on voit partout de vastes étendues de brandes dans lesquelles ne croissent que des bruyères et des genêts. Là où les brandes cessent, les landes commencent ; et sur ces landes élevées les vents âpres rabougrissent les maigres bouquets d’arbres qui dressent çà et là leurs branches tordues et tourmentées.
Pour trouver de beaux arbres, il faut abandonner les hauteurs et descendre dans les plis du terrain, sur les bords des rivières, où dans d’étroites prairies poussent de grands châtaigniers et des chênes vigoureux.
C’est dans un de ces replis de terrain, sur les bords d’un ruisseau qui va perdre ses eaux rapides dans un des affluents de la Loire que se dresse la maison où j’ai passé mes premières années.
Jusqu’à huit ans, je n’avais jamais vu d’homme dans cette maison ; cependant ma mère n’était pas veuve, mais son mari qui était tailleur de pierre, comme un grand nombre d’autres ouvriers de la contrée, travaillait à Paris, et il n’était pas revenu au pays depuis que j’étais en âge de voir ou de comprendre ce qui m’entourait. De temps en temps seulement, il envoyait de ses nouvelles par un de ses camarades qui rentrait au village.
– Mère Barberin, votre homme va bien ; il m’a chargé de vous dire que l’ouvrage marche fort, et de vous remettre l’argent que voilà ; voulez-vous compter ?
Et c’était tout. Mère Barberin se contentait de ces nouvelles : son homme était en bonne santé ; l’ouvrage donnait ; il gagnait sa vie.
De ce que Barberin était resté si longtemps à Paris, il ne faut pas croire qu’il était en mauvaise amitié avec sa femme. La question de désaccord n’était pour rien dans cette absence. Il demeurait à Paris parce que le travail l’y retenait ; voilà tout. Quand il serait vieux, il reviendrait vivre près de sa vieille femme, et avec l’argent qu’ils auraient amassé, ils seraient à l’abri de la misère pour le temps où l’âge leur aurait enlevé la force et la santé.
Un jour de novembre, comme le soir tombait, un homme, que je ne connaissais pas, s’arrêta devant notre barrière. J’étais sur le seuil de la maison occupé à casser une bourrée. Sans pousser la barrière, mais en levant sa tête par-dessus en me regardant, l’homme me demanda si ce n’était pas là que demeurait la mère Barberin.
Je lui dis d’entrer.
Il poussa la barrière qui cria dans sa hart, et à pas lents il s’avança vers la maison.
Jamais je n’avais vu un homme aussi crotté ; des plaques de boue, les unes encore humides, les autres déjà sèches, le couvraient des pieds à la tête, et à le regarder l’on comprenait que depuis longtemps il marchait dans les mauvais chemins.
Au bruit de nos voix, mère Barberin accourut, et au moment où il franchissait notre seuil, elle se trouva face à face avec lui.
– J’apporte des nouvelles de Paris, dit-il.
C’étaient là des paroles bien simples et qui déjà plus d’une fois avaient frappé nos oreilles, mais le ton avec lequel elles furent prononcées ne ressemblait en rien à celui qui autrefois accompagnait les mots : « Votre homme va bien, l’ouvrage marche. »
– Ah ! mon Dieu ! s’écria mère Barberin en joignant les mains, un malheur est arrivé à Jérôme.
– Eh bien, oui, mais il ne faut pas vous rendre malade de peur ; votre homme à été blessé voilà la vérité ; seulement il n’est pas mort. Pourtant il sera peut-être estropié. Pour le moment il est à l’hôpital. J’ai été son voisin de lit, et comme je rentrais au pays il m’a demandé de vous conter la chose en passant. Je ne peux pas m’arrêter, car j’ai encore trois lieues à faire et la nuit vient vite.
Mère Barberin, qui voulait en savoir plus long, pria l’homme de rester à souper ; les routes étaient mauvaises ; on parlait de loups qui s’étaient montrés dans les bois ; il repartirait le lendemain matin.
Il s’assit dans le coin de la cheminée et tout en mangeant, il nous raconta comment le malheur était arrivé : Barberin avait été à moitié écrasé par des échafaudages qui s’étaient abattus, et comme on avait prouvé qu’il ne devait pas se trouver à la place où il avait été blessé, l’entrepreneur refusait de lui payer aucune indemnité.
– Pas de chance, le pauvre Barberin, dit-il, pas de chance ; il y a des malins qui auraient trouvé là-dedans un moyen pour se faire faire des rentes, mais votre homme n’aura rien.
Et tout en séchant les jambes de son pantalon qui devenait raide sous leur enduit de boue durcie, il répétait ce mot : « pas de chance » avec une peine sincère, qui montrait que pour lui, il se fût fait volontiers estropier dans l’espérance de gagner ainsi de bonnes rentes.
– Pourtant, dit-il en terminant son récit, je lui ai donné le conseil de faire un procès à l’entrepreneur.
– Un procès, cela coûte gros.
– Oui, mais quand on le gagne !
Mère Barberin aurait voulu aller à Paris, mais c’était une terrible affaire qu’un voyage si long et si coûteux.
Le lendemain matin nous descendîmes au village pour consulter le curé. Celui-ci ne voulut pas la laisser partir sans savoir avant si elle pouvait être utile à son mari. Il écrivit à l’aumônier de l’hôpital où Barberin était soigné, et quelques jours après il reçut une réponse, disant que mère Barberin ne devait pas se mettre en route, mais qu’elle devait envoyer une certaine somme d’argent à son mari, parce que celui-ci allait faire un procès à l’entrepreneur chez lequel il avait été blessé.
Les journées, les semaines s’écoulèrent et de temps en temps il arriva des lettres qui toutes demandaient de nouveaux envois d’argent ; la dernière, plus pressante que les autres, disait que s’il n’y avait plus d’argent, il fallait vendre la vache pour s’en procurer.
Ceux-là seuls qui ont vécu à la campagne avec les paysans savent ce qu’il y a de détresses et de douleurs dans ces trois mots : « vendre la vache. »
Pour le naturaliste, la vache est un animal ruminant ; pour le promeneur, c’est une bête qui fait bien dans le paysage lorsqu’elle lève au-dessus des herbes son mufle noir humide de rosée ; pour l’enfant des villes, c’est la source du café au lait et du fromage à la crème ; mais pour le paysan, c’est bien plus et bien mieux encore. Si pauvre qu’il puisse être et si nombreuse que soit sa famille, il est assuré de ne pas souffrir de la faim tant qu’il a une vache dans son étable. Avec une longe ou même avec une simple hart nouée autour des cornes, un enfant promène la vache le long des chemins herbus, là où la pâture n’appartient à personne, et le soir la famille entière a du beurre dans sa soupe et du lait pour mouiller ses pommes de terre : le père, la mère, les enfants, les grands comme les petits, tout le monde vit de la vache.
Nous vivions si bien de la nôtre, mère Barberin et moi, que jusqu’à ce moment je n’avais presque jamais mangé de viande. Mais ce n’était pas seulement notre nourrice qu’elle était, c’était encore notre camarade, notre amie, car il ne faut pas s’imaginer que la vache est une bête stupide, c’est au contraire un animal plein d’intelligence et de qualités morales d’autant plus développées qu’on les aura cultivées par l’éducation. Nous caressions la nôtre, nous lui parlions, elle nous comprenait, et de son côté, avec ses grands yeux ronds pleins de douceur, elle savait très-bien nous faire entendre ce qu’elle voulait ou ce qu’elle ressentait.
Enfin nous l’aimions et elle nous aimait, ce qui est tout dire.
Pourtant il fallut s’en séparer, car c’était seulement par « la vente de la vache » qu’on pouvait satisfaire Barberin.
Il vint un marchand à la maison et après avoir bien examiné la Roussette, après l’avoir longuement palpée en secouant la tête d’un air mécontent, après avoir dit et répété cent fois qu’elle ne lui convenait pas du tout, que c’était une vache de pauvres gens qu’il ne pourrait pas revendre, qu’elle n’avait pas de lait, qu’elle faisait du mauvais beurre, il avait fini par dire qu’il voulait bien la prendre, mais seulement par bonté d’âme et pour obliger mère Barberin qui était une brave femme.
La pauvre Roussette, comme si elle comprenait ce qui se passait, avait refusé de sortir de son étable et elle s’était mise à meugler.
– Passe derrière et chasse-la, m’avait dit le marchand en me tendant le fouet qu’il portait passé autour de son cou.
– Pour ça non, avait dit mère Barberin.
Et, prenant la vache par la longe, elle lui avait parlé doucement.
– Allons, ma belle, viens, viens.
Et Roussette n’avait plus résisté ; arrivée sur la route, le marchand l’avait attachée derrière sa voiture, et il avait bien fallu qu’elle suivît le cheval.
Nous étions rentrés dans la maison. Mais longtemps encore nous avions entendu ses beuglements.
Plus de lait, plus de beurre. Le matin un morceau de pain ; le soir des pommes de terre au sel.
Le mardi gras arriva justement peu de temps après la vente de Roussette ; l’année précédente, pour le mardi gras, mère Barberin m’avait fait un régal avec des crêpes et des beignets ; et j’en avais tant mangé, tant mangé qu’elle en avait été toute heureuse.
Mais alors nous avions Roussette, qui nous avait donné le lait pour délayer la pâte et le beurre pour mettre dans la poêle.
Plus de Roussette, plus de lait, plus de beurre, plus de mardi gras ; c’était ce que je m’étais dit tristement.
Mais mère Barberin m’avait fait une surprise ; bien qu’elle ne fût pas emprunteuse, elle avait demandé une tasse de lait à l’une de nos voisines, un morceau de beurre à une autre et quand j’étais rentré, vers midi, je l’avais trouvée en train de verser de la farine dans un grand poêlon en terre.
– Tiens ! de la farine, dis-je en m’approchant d’elle.
– Mais oui, fit-elle en souriant, c’est bien de la farine, mon petit Rémi, de la belle farine de blé ; tiens, vois comme elle fleure bon.
Si j’avais osé, j’aurais demandé à quoi devait servir cette farine ; mais précisément parce que j’avais grande envie de le savoir, je n’osais pas en parler. Et puis d’un autre côté je ne voulais pas dire que je savais que nous étions au mardi gras pour ne pas faire de la peine à mère Barberin.
– Qu’est-ce qu’on fait avec de la farine ? dit-elle me regardant.
– Du pain.
– Et puis encore ?
– De la bouillie.
– Et puis encore ?
– Dame… Je ne sais pas.
– Si, tu sais bien. Mais comme tu es un bon petit garçon, tu n’oses pas le dire. Tu sais que c’est aujourd’hui mardi gras, le jour des crêpes et des beignets. Mais comme tu sais aussi que nous n’avons ni beurre, ni lait, tu n’oses pas en parler. C’est vrai ça ?
– Oh ! mère Barberin.
– Comme d’avance j’avais deviné tout cela, je me suis arrangée pour que mardi gras ne te fasse pas vilaine figure. Regarde dans la huche.
Le couvercle levé, et il le fut vivement, j’aperçus le lait, le beurre, des œufs et trois pommes.
– Donne-moi les œufs, me dit-elle, et, pendant que je les casse, pèle les pommes.
Pendant que je coupais les pommes en tranches, elle cassa les œufs dans la farine et se mit à battre le tout, en versant dessus, de temps en temps, une cuillerée de lait.
Quand la pâte fut délayée, mère Barberin posa la terrine sur les cendres chaudes, et il n’y eut plus qu’à attendre le soir, car c’était à notre souper que nous devions manger les crêpes et les beignets.
Pour être franc, je dois avouer que la journée me parut longue et que plus d’une fois j’allai soulever le linge qui recouvrait la terrine.
– Tu vas faire prendre froid à la pâte, disait mère Barberin, et elle lèvera mal.
Mais elle levait bien, et de place en place se montraient des renflements, des sortes de bouillons qui venaient crever à la surface. De toute la pâte en fermentation se dégageait une bonne odeur d’œufs et de lait.
– Casse de la bourrée, me disait-elle ; il nous faut un bon feu clair, sans fumée.
Enfin, la chandelle fut allumée.
– Mets du bois au feu ! me dit-elle.
Il ne fut pas nécessaire de me répéter deux fois cette parole que j’attendais avec tant d’impatience. Bientôt une grande flamme monta dans la cheminée, et sa lueur vacillante emplit la cuisine.
Alors mère Barberin décrocha de la muraille la poêle à frire et la posa au-dessus de la flamme.
– Donne-moi le beurre.
Elle en prit, au bout de son couteau, un morceau gros comme une petite noix et le mit dans la poêle, où il fondit en grésillant.
Ah ! c’était vraiment une bonne odeur qui chatouillait d’autant plus agréablement notre palais que depuis longtemps nous ne l’avions pas respirée.
C’était aussi une joyeuse musique celle produite par les grésillements et les sifflements du beurre.
Cependant, si attentif que je fusse à cette musique, il me sembla entendre un bruit de pas dans la cour.
Qui pouvait venir nous déranger à cette heure ? Une voisine sans doute, pour nous demander du feu.
Mais je ne m’arrêtai pas à cette idée, car mère Barberin qui avait plongé la cuiller à pot dans la terrine, venait de faire couler dans la poêle une nappe de pâte blanche, et ce n’était pas le moment de se laisser aller aux distractions.
Un bâton heurta le seuil, puis aussitôt la porte s’ouvrit brusquement.
– Qui est-là ? demanda mère Barberin sans se retourner.
Un homme était entré, et la flamme qui l’avait éclairé en plein m’avait montré qu’il était vêtu d’une blouse blanche et qu’il tenait à la main un gros bâton.
– On fait donc la fête ici ? Ne vous gênez pas, dit-il d’un ton rude.
– Ah ! mon Dieu ! s’écria mère Barberin en posant vivement sa poêle à terre, c’est toi, Jérôme ?
Puis me prenant par le bras elle me poussa vers l’homme qui s’était arrêté sur le seuil.
– C’est ton père.
Chapitre2 Un père nourricier.
Je m’étais approché pour l’embrasser à mon tour, mais du bout de son bâton il m’arrêta :
– Qu’est-ce que c’est que celui-là ?
– C’est Rémi.
– Tu m’avais dit…
– Eh bien oui, mais… ce n’était pas vrai, parce que…
– Ah ! pas vrai, pas vrai.
Il fit quelques pas vers moi son bâton levé et instinctivement je reculai.
Qu’avais-je fait ? De quoi étais-je coupable ? Pourquoi cet accueil lorsque j’allais à lui pour l’embrasser ?
Je n’eus pas le temps d’examiner ces diverses questions qui se pressaient dans mon esprit troublé.
– Je vois que vous faisiez mardi gras, dit-il, ça se trouve bien, car j’ai une solide faim. Qu’est-ce que tu as pour souper ?
– Je faisais des crêpes.
– Je vois bien ; mais ce n’est pas des crêpes que tu vas donner à manger à un homme qui a dix lieues dans les jambes.
– C’est que je n’ai rien : nous ne t’attendions pas.
– Comment rien ; rien à souper ? Il regarda autour de lui.
– Voilà du beurre.
Il leva les yeux au plafond à l’endroit où l’on accrochait le lard autrefois ; mais depuis longtemps le crochet était vide ; et à la poutre pendaient seulement maintenant quelques glanes d’ail et d’oignon.
– Voilà de l’oignon, dit-il, en faisant tomber une glane avec son bâton ; quatre ou cinq oignons, un morceau de beurre et nous aurons une bonne soupe. Retire ta crêpe et fricasse-nous les oignons dans la poêle.
Retirer la crêpe de la poêle ! mère Barberin ne répliqua rien. Au contraire elle s’empressa de faire ce que son homme demandait tandis que celui-ci s’asseyait sur le banc qui était dans le coin de la cheminée.
Je n’avais pas osé quitter la place où le bâton m’avait amené, et, appuyé contre la table, je le regardais.
C’était un homme d’une cinquantaine d’années environ, au visage rude, à l’air dur ; il portait la tête inclinée sur l’épaule droite par suite de la blessure qu’il avait reçue, et cette difformité contribuait à rendre son aspect peu rassurant.
Mère Barberin avait replacé la poêle sur le feu.
– Est-ce que c’est avec ce petit morceau de beurre que tu vas nous faire la soupe ? dit-il.
Alors prenant lui-même l’assiette où se trouvait le beurre, il fit tomber la motte entière dans la poêle.
Plus de beurre, dès lors plus de crêpes.
En tout autre moment, il est certain que j’aurais été profondément touché par cette catastrophe, mais je ne pensais plus aux crêpes ni aux beignets et l’idée qui occupait mon esprit, c’était que cet homme qui paraissait si dur était mon père.
– Mon père, mon père ! C’était là le mot que je me répétais machinalement.
Je ne m’étais jamais demandé d’une façon bien précise ce que c’était qu’un père, et vaguement, d’instinct, j’avais cru que c’était une mère à grosse voix, mais en regardant celui qui me tombait du ciel, je me sentis pris d’un effroi douloureux.
J’avais voulu l’embrasser, il m’avait repoussé du bout de son bâton, pourquoi ? Mère Barberin ne me repoussait jamais lorsque j’allais l’embrasser, bien au contraire, elle me prenait dans ses bras et me serrait contre elle.
– Au lieu de rester immobile comme si tu étais gelé, me dit-il, mets les assiettes sur la table.
Je me hâtai d’obéir. La soupe était faite. Mère Barberin la servit dans les assiettes.
Alors quittant le coin de la cheminée il vint s’asseoir à table et commença à manger, s’arrêtant seulement de temps en temps pour me regarder.
J’étais si troublé, si inquiet, que je ne pouvais manger, et je le regardais aussi, mais à la dérobée, baissant les yeux quand je rencontrais les siens.
– Est-ce qu’il ne mange pas plus que ça d’ordinaire ? dit-il tout à coup en tendant vers moi sa cuiller.
– Ah ! si, il mange bien.
– Tant pis ; si encore il ne mangeait pas.
Naturellement je n’avais pas envie de parler, et mère Barberin n’était pas plus que moi disposée à la conversation : elle allait et venait autour de la table, attentive à servir son mari.
– Alors tu n’as pas faim ? me dit-il.
– Non.
– Eh bien, va te coucher, et tâche de dormir tout de suite ; sinon je me fâche.
Mère Barberin me lança un coup d’œil qui me disait d’obéir sans répliquer. Mais cette recommandation était inutile, je ne pensais pas à me révolter.
Comme cela se rencontre dans un grand nombre de maisons de paysans, notre cuisine était en même temps notre chambre à coucher. Auprès de la cheminée tout ce qui servait au manger, la table, la huche, le buffet ; à l’autre bout les meubles propres au coucher ; dans un angle le lit de mère Barberin, dans le coin opposé le mien qui se trouvait dans une sorte d’armoire entourée d’un lambrequin en toile rouge.
Je me dépêchai de me déshabiller et de me coucher. Mais dormir était une autre affaire.
On ne dort pas par ordre ; on dort parce qu’on a sommeil et qu’on est tranquille.
Or je n’avais pas sommeil et n’étais pas tranquille.
Terriblement tourmenté au contraire, et de plus très-malheureux.
Comment cet homme était mon père ! Alors pourquoi me traitait-il si durement ?
Le nez collé contre la muraille je faisais effort pour chasser ces idées et m’endormir comme il me l’avait ordonné ; mais c’était impossible ; le sommeil ne venait pas ; je ne m’étais jamais senti si bien éveillé.
Au bout d’un certain temps, je ne saurais dire combien, j’entendis qu’on s’approchait de mon lit.
Au pas lent, traînant et lourd je reconnus tout de suite que ce n’était pas mère Barberin.
Un souffle chaud effleura mes cheveux.
– Dors-tu ? demanda une voix étouffée.
Je n’eus garde de répondre, car les terribles mots : « je me fâche » retentissaient encore à mon oreille.
– Il dort, dit mère Barberin ; aussitôt couché, aussitôt endormi, c’est son habitude ; tu peux parler sans craindre qu’il t’entende.
Sans doute, j’aurais dû dire que je ne dormais pas, mais je n’osai point ; on m’avait commandé de dormir, je ne dormais pas, j’étais en faute.
– Ton procès, où en est-il ? demanda mère Barberin.
– Perdu ! Les juges ont décidé que j’étais en faute de me trouver sous les échafaudages et que l’entrepreneur ne me devait rien.
Là-dessus il donna un coup de poing sur la table et se mit à jurer sans dire aucune parole sensée.
– Le procès perdu, reprit-il bientôt ; notre argent perdu, estropié, la misère ; voilà ! Et comme si ce n’était pas assez, en rentrant ici je trouve un enfant. M’expliqueras-tu pourquoi tu n’as pas fait comme je t’avais dit de faire ?
– Parce que je n’ai pas pu.
– Tu n’as pas pu le porter aux Enfants trouvés ?
– On n’abandonne pas comme ça un enfant qu’on a nourri de son lait et qu’on aime.
– Ce n’était pas ton enfant.
– Enfin je voulais faire ce que tu demandais, mais voilà précisément qu’il est tombé malade.
– Malade ?
– Oui, malade ; ce n’était pas le moment, n’est-ce pas, de le porter à l’hospice pour le tuer ?
– Et quand il a été guéri ?
– C’est qu’il n’a pas été guéri tout de suite. Après cette maladie en est venue une autre : il toussait, le pauvre petit, à vous fendre le cœur. C’est comme ça que notre petit Nicolas est mort ; il me semblait que si je portais celui-là à la ville, il mourrait aussi.
– Mais après ?
– Le temps avait marché. Puisque j’avais attendu jusque-là je pouvais bien attendre encore.
– Quel âge a-t-il présentement ?
– Huit ans.
– Eh bien ! il ira à huit ans là où il aurait dû aller autrefois, et ça ne lui sera pas plus agréable : voilà ce qu’il y aura gagné.
– Ah ! Jérôme, tu ne feras pas ça.
– Je ne ferai pas ça ! Et qui m’en empêchera ? Crois-tu que nous pouvons le garder toujours ?
Il y eut un moment de silence et je pus respirer ; l’émotion me serrait à la gorge au point de m’étouffer. Bientôt mère Barberin reprit :
– Ah ! comme Paris t’a changé ! tu n’aurais pas parlé comme ça avant d’aller à Paris.
– Peut-être. Mais ce qu’il y a de sûr, c’est que si Paris m’a changé, il m’a aussi estropié. Comment gagner sa vie maintenant, la tienne, la mienne ? nous n’avons plus d’argent. La vache est vendue. Faut-il que quand nous n’avons pas de quoi manger, nous nourrissions un enfant qui n’est pas le nôtre ?
– C’est le mien.
– Ce n’est pas plus le tien que le mien. Ce n’est pas un enfant de paysan. Je le regardais pendant le souper : c’est délicat, c’est maigre, pas de bras, pas de jambes.
– C’est le plus joli enfant du pays.
– Joli, je ne dis pas. Mais solide ! Est-ce que c’est sa gentillesse qui lui donnera à manger ? Est-ce qu’on est un travailleur avec des épaules comme les siennes ? On est un enfant de la ville, et les enfants des villes, il ne nous en faut pas ici.
– Je te dis que c’est un brave enfant, et il a de l’esprit comme un chat, et avec cela bon cœur. Il travaillera pour nous.
– En attendant, il faudra que nous travaillions pour lui, et moi je ne peux plus travailler.
– Et si ses parents le réclament, qu’est-ce que tu diras ?
– Ses parents ! Est-ce qu’il a des parents ? S’il en avait, ils l’auraient cherché, et depuis huit ans trouvé bien sûr. Ah ! j’ai fait une fameuse sottise de croire qu’il avait des parents qui le réclameraient un jour, et nous payeraient notre peine pour l’avoir élevé. Je n’ai été qu’un nigaud, qu’un imbécile. Parce qu’il était enveloppé dans de beaux langes avec des dentelles, cela ne voulait pas dire que ses parents le chercheraient. Ils sont peut-être morts, d’ailleurs.
– Et s’ils ne le sont pas ? Si un jour ils viennent nous le demander ? J’ai dans l’idée qu’ils viendront.
– Que les femmes sont donc obstinées !
– Enfin, s’ils viennent ?
– Eh bien ! nous les enverrons à l’hospice. Mais assez causé. Tout cela m’ennuie. Demain je le conduirai au maire. Ce soir, je vais aller dire bonjour à François. Dans une heure je reviendrai.
La porte s’ouvrit et se referma. Il était parti.
Alors me redressant vivement, je me mis à appeler mère Barberin.
– Ah ! maman.
Elle accourut près de mon lit :
– Est-ce que tu me laisseras aller à l’hospice ?
– Non, mon petit Rémi, non.
Et elle m’embrassa tendrement en me serrant dans ses bras.
Cette caresse me rendit le courage, et mes larmes s’arrêtèrent de couler.
– Tu ne dormais donc pas ? me demanda-t-elle doucement.
– Ce n’est pas ma faute.
– Je ne te gronde pas ; alors tu as entendu tout ce qu’a dit Jérôme ?
– Oui, tu n’es pas ma maman, mais lui n’est pas mon père.
Je ne prononçai pas ces quelques mots sur le même ton, car si j’étais désolé d’apprendre qu’elle n’était pas ma mère, j’étais heureux, j’étais presque fier de savoir que lui n’était pas mon père. De là une contradiction dans mes sentiments qui se traduisit dans ma voix.
Mais mère Barberin ne parut pas y prendre attention.
– J’aurais peut-être dû, dit-elle, te faire connaître la vérité ; mais tu étais si bien mon enfant, que je ne pouvais pas te dire, sans raison, que je n’étais pas ta vraie mère ! Ta mère, pauvre petit, tu l’as entendu, on ne la connaît pas. Est-elle vivante, ne l’est-elle plus ? On n’en sait rien. Un matin, à Paris, comme Jérôme allait à son travail et qu’il passait dans une rue qu’on appelle l’avenue de Breteuil, qui est large et plantée d’arbres, il entendit les cris d’un enfant. Ils semblaient partir de l’embrasure de la porte d’un jardin. C’était au mois de février ; il faisait petit jour. Il s’approcha de la porte et aperçut un enfant couché sur le seuil. Comme il regardait autour de lui pour appeler quelqu’un, il vit un homme sortir de derrière un gros arbre et se sauver. Sans doute cet homme s’était caché là pour voir si l’on trouverait l’enfant qu’il avait lui-même placé dans l’embrasure de la porte. Voilà Jérôme bien embarrassé, car l’enfant criait de toutes ses forces, comme s’il avait compris qu’un secours lui était arrivé, et qu’il ne fallait pas le laisser échapper. Pendant que Jérôme réfléchissait à ce qu’il devait faire, il fut rejoint par d’autres ouvriers, et l’on décida qu’il fallait porter l’enfant chez le commissaire de police. Il ne cessait pas de crier. Sans doute il souffrait du froid. Mais comme dans le bureau du commissaire il faisait très-chaud, et que les cris continuaient, on pensa qu’il souffrait de la faim, et l’on alla chercher une voisine qui voudrait bien lui donner le sein. Il se jeta dessus. Il était véritablement affamé. Alors on le déshabilla devant le feu. C’était un beau garçon de cinq ou six mois, rose, gros, gras, superbe ; les langes et les linges dans lesquels il était enveloppé disaient clairement qu’il appartenait à des parents riches. C’était donc un enfant qu’on avait volé et ensuite abandonné. Ce fut au moins ce que le commissaire expliqua. Qu’allait-on en faire ? Après avoir écrit tout ce que Jérôme savait, et aussi la description de l’enfant avec celle de ses langes qui n’étaient pas marqués, le commissaire dit qu’il allait l’envoyer à l’hospice des Enfants trouvés, si personne, parmi tous ceux qui étaient là, ne voulait s’en charger : c’était un bel enfant, sain, solide qui ne serait pas difficile à élever ; ses parents qui bien sûr allaient le chercher, récompenseraient généreusement ceux qui en auraient pris soin. Là-dessus, Jérôme s’avança et dit qu’il voulait bien s’en charger ; on le lui donna. J’avais justement un enfant du même âge ; mais ce n’était pas pour moi une affaire d’en nourrir deux. Ce fut ainsi que je devins ta mère.
– Oh ! maman.
– Au bout de trois mois, je perdis mon enfant, et alors je m’attachai à toi davantage. J’oubliais que tu n’étais pas vraiment notre fils. Malheureusement Jérôme ne l’oublia pas, lui, et, voyant au bout de trois ans que tes parents ne t’avaient pas cherché, au moins qu’ils ne t’avaient pas trouvé, il voulut te mettre à l’hospice. Tu as entendu pourquoi je ne lui ai pas obéi.
– Oh ! pas à l’hospice, m’écriai-je en me cramponnant à elle ; mère Barberin, pas à l’hospice, je t’en prie !
– Non, mon enfant, tu n’iras pas. J’arrangerai cela. Jérôme n’est pas un méchant homme, tu verras ; c’est le chagrin, c’est la peur du besoin qui l’ont monté. Nous travaillerons, tu travailleras aussi.
– Oui, tout ce que tu voudras. Mais pas l’hospice.
– Tu n’iras pas ; mais à une condition, c’est que tu vas tout de suite dormir. Il ne faut pas, quand il rentrera, qu’il te trouve éveillé.
Et, après m’avoir embrassé, elle me tourna le nez contre la muraille.
J’aurais voulu m’endormir ; mais j’avais été trop rudement ébranlé, trop profondément ému pour trouver à volonté le calme et le sommeil.
Ainsi, mère Barberin, si bonne, si douce pour moi n’était pas ma vraie mère ! mais alors qu’était donc une vraie mère ? Meilleure, plus douce encore ? Oh ! non, ce n’était pas possible.
Mais ce que je comprenais, ce que je sentais parfaitement, c’est qu’un père eût été moins dur que Barberin, et ne m’eût pas regardé avec ces yeux froids, le bâton levé.
Il voulait m’envoyer à l’hospice ; mère Barberin pourrait-elle l’en empêcher ?
Qu’était-ce que l’hospice ?
Il y avait au village deux enfants qu’on appelait « les enfants de l’hospice » ; ils avaient une plaque de plomb au cou avec un numéro ; ils étaient mal habillés et sales ; on se moquait d’eux ; on les battait ; les autres enfants les poursuivaient souvent comme on poursuit un chien perdu pour s’amuser, et aussi parce qu’un chien perdu n’a personne pour le défendre.
Ah ! je ne voulais pas être comme ces enfants ; je ne voulais pas avoir un numéro au cou, je ne voulais pas qu’on courût après moi en criant : « À l’hospice ! à l’hospice ! »
Cette pensée seule me donnait froid et me faisait claquer les dents.
Et je ne dormais pas.
Et Barberin allait rentrer.
Heureusement il ne revint pas aussitôt qu’il avait dit et le sommeil arriva pour moi avant lui.
Chapitre3 La troupe du signor Vitalis.
Sans doute je dormis toute la nuit sous l’impression du chagrin et de la crainte, car le lendemain matin en m’éveillant, mon premier mouvement fut de tâter mon lit et de regarder autour de moi, pour être certain qu’on ne m’avait pas emporté.
Pendant toute la matinée, Barberin ne me dit rien, et je commençai à croire que le projet de m’envoyer à l’hospice était abandonné. Sans doute mère Barberin avait parlé ; elle l’avait décidé à me garder.
Mais comme midi sonnait, Barberin me dit de mettre ma casquette et de le suivre.
Effrayé, je tournai les yeux vers mère Barberin pour implorer son secours. Mais, à la dérobée, elle me fit un signe qui disait que je devais obéir ; en même temps un mouvement de sa main me rassura : il n’y avait rien à craindre.
Alors, sans répliquer, je me mis en route derrière Barberin.
La distance est longue de notre maison au village : il y en a bien pour une heure de marche. Cette heure s’écoula sans qu’il m’adressât une seule fois la parole. Il marchait devant, doucement, en clopinant, sans que sa tête fît un seul mouvement, et de temps en temps il se retournait tout d’une pièce pour voir si je le suivais.
Où me conduisait-il ?
Cette question m’inquiétait, malgré le signe rassurant que m’avait fait mère Barberin, et pour me soustraire à un danger que je pressentais sans le connaître, je pensais à me sauver.
Dans ce but, je tâchais de rester en arrière ; quand je serais assez loin, je me jetterais dans le fossé, et il ne pourrait pas me rejoindre.
Tout d’abord, il se contenta de me dire de marcher sur ses talons ; mais bientôt, il devina sans doute mon intention et me prit par le poignet.
Je n’avais plus qu’à le suivre, ce que je fis.
Ce fut ainsi que nous entrâmes dans le village, et tout le monde sur notre passage se retourna pour nous voir passer, car j’avais l’air d’un chien hargneux qu’on mène en laisse.
Comme nous passions devant le café, un homme qui se trouvait sur le seuil appela Barberin et l’engagea à entrer.
Celui-ci me prenant par l’oreille me fit passer devant lui, et quand nous fumes entrés il referma la porte.
Je me sentis soulagé ; le café ne me paraissait pas un endroit dangereux ; et puis d’un autre côté c’était le café, et il y avait longtemps que j’avais envie de franchir sa porte.
Le café, le café de l’auberge Notre-Dame ! qu’est-ce que cela pouvait bien être ?
Combien de fois m’étais-je posé cette question !
J’avais vu des gens sortir du café la figure enluminée et les jambes flageolantes ; en passant devant sa porte, j’avais souvent entendu des cris et des chansons qui faisaient trembler les vitres.
Que faisait-on là dedans ? Que se passait-il derrière ses rideaux rouges ?
J’allais donc le savoir.
Tandis que Barberin se plaçait à une table avec le maître du café qui l’avait engagé à entrer, j’allai m’asseoir près de la cheminée et regardai autour de moi.
Dans le coin opposé à celui que j’occupais, se trouvait un grand vieillard à barbe blanche, qui portait un costume bizarre et tel que je n’en avais jamais vu.
Sur ses cheveux qui tombaient en longues mèches sur ses épaules, était posé un haut chapeau de feutre gris orné de plumes vertes et rouges. Une peau de mouton, dont la laine était en dedans, le serrait à la taille. Cette peau n’avait pas de manches, et, par deux trous ouverts aux épaules, sortaient les bras vêtus d’une étoffe de velours qui autrefois avait dû être bleue. De grandes guêtres en laine lui montaient jusqu’aux genoux, et elles étaient serrées par des rubans rouges qui s’entre-croisaient plusieurs fois autour des jambes.
Il se tenait allongé sur sa chaise, le menton appuyé dans sa main droite ; son coude reposait sur son genou ployé.
Jamais je n’avais vu une personne vivante dans une attitude si calme ; il ressemblait à l’un des saints en bois de notre église.
Auprès de lui trois chiens tassés sous sa chaise se chauffaient sans remuer. Un caniche blanc, un barbet noir, et une petite chienne grise à la mine futée et douce ; le caniche était coiffé d’un vieux bonnet de police retenu sous son menton par une lanière de cuir.
Pendant que je regardais le vieillard avec une curiosité étonnée, Barberin et le maître du café causaient à demi-voix et j’entendais qu’il était question de moi.
Barberin racontait qu’il était venu au village pour me conduire au maire, afin que celui-ci demandât aux hospices de lui payer une pension pour me garder.
C’était donc là ce que mère Barberin avait pu obtenir de son mari, et je compris tout de suite que si Barberin trouvait avantage à me garder près de lui, je n’avais plus rien à craindre.
Le vieillard, sans en avoir l’air, écoutait aussi ce qui se disait ; tout à coup il étendit la main droite vers moi, et s’adressant à Barberin :
– C’est cet enfant-là qui vous gêne ? dit-il avec un accent étranger.
– Lui-même.
– Et vous croyez que l’administration des hospices de votre département va vous payer des mois de nourrice.
– Dame, puisqu’il n’a pas de parents et qu’il est à ma charge, il faut bien que quelqu’un paye pour lui ; c’est juste, il me semble.
– Je ne dis pas non, mais croyez-vous que tout ce qui est juste se fait ?
– Pour ça non.
– Eh bien, je crois bien que vous n’obtiendrez jamais la pension que vous demandez.
– Alors, il ira à l’hospice ; il n’y a pas de loi qui le force à rester quand même dans ma maison si je n’en veux pas.
– Vous avez consenti autrefois à le recevoir, c’était prendre l’engagement de le garder.
– Eh bien, je ne le garderai pas ; et quand je devrais le mettre dans la rue, je m’en débarrasserai.
– Il y aurait peut-être un moyen de vous en débarrasser tout de suite, dit le vieillard après un moment de réflexion, et même de gagner à cela quelque chose.
– Si vous me donnez ce moyen-là, je vous paye une bouteille, et de bon cœur encore.
– Commandez la bouteille, et votre affaire est faite.
– Sûrement ?
– Sûrement.
Le vieillard quittant sa chaise, vint s’asseoir vis-à-vis de Barberin. Chose étrange, au moment où il se leva, sa peau de mouton fut soulevée par un mouvement que je ne m’expliquai pas : c’était à croire qu’il avait un chien dans le bras gauche.
Qu’allait-il dire ? Qu’allait-il se passer ?
Je l’avais suivi des yeux avec une émotion cruelle.
– Ce que vous voulez, n’est-ce pas, dit-il, c’est que cet enfant ne mange pas plus longtemps votre pain ; ou bien s’il continue à le manger, c’est qu’on vous le paye.
– Juste ; parce que…
– Oh ! le motif, vous savez, ça ne me regarde pas, je n’ai donc pas besoin de le connaître ; il me suffit de savoir que vous ne voulez plus de l’enfant ; s’il en est ainsi, donnez-le-moi, je m’en charge.
– Vous le donner !
– Dame, ne voulez-vous pas vous en débarrasser ?
– Vous donner un enfant comme celui-là, un si bel enfant, car il est bel enfant, regardez-le.
– Je l’ai regardé.
– Rémi ! viens ici.
Je m’approchai de la table en tremblant.
– Allons, n’aie pas peur, petit, dit le vieillard.
– Regardez, continua Barberin.
– Je ne dis pas que c’est un vilain enfant. Si c’était un vilain enfant, je n’en voudrais pas, les monstres ce n’est pas mon affaire.
– Ah ! si c’était un monstre à deux têtes, ou seulement un nain…
– Vous ne parleriez pas de l’envoyer à l’hospice. Vous savez qu’un monstre a de la valeur et qu’on peut en tirer profit, soit en le louant, soit en l’exploitant soi-même. Mais celui-là n’est ni nain ni monstre ; bâti comme tout le monde il n’est bon à rien.
– Il est bon pour travailler.
– Il est bien faible.
– Lui faible, allons donc, il est fort comme un homme, et solide, et sain ; tenez, voyez ses jambes, en avez-vous jamais vu de plus droites ?
Barberin releva mon pantalon.
– Trop mince, dit le vieillard.
– Et ses bras ? continua Barberin.
– Les bras sont comme les jambes ; ça peut aller ; mais ça ne résisterait pas à la fatigue et à la misère.
– Lui, ne pas résister ; mais tâtez donc, voyez, tâtez vous-même.
Le vieillard passa sa main décharnée sur mes jambes en les palpant, secouant la tête et faisant la moue.
J’avais déjà assisté à une scène semblable quand le marchand était venu pour acheter notre vache. Lui aussi l’avait tâtée et palpée. Lui aussi avait secoué la tête et fait la moue : ce n’était pas une bonne vache, il lui serait impossible de la revendre, et cependant il l’avait achetée, puis emmenée.
Le vieillard allait-il m’acheter et m’emmener ; ah ! mère Barberin, mère Barberin !
Malheureusement elle n’était pas là pour me défendre.
Si j’avais osé j’aurais dit que la veille Barberin m’avait précisément reproché d’être délicat et de n’avoir ni bras ni jambes ; mais je compris que cette interruption ne servirait à rien qu’à m’attirer une bourrade, et je me tus.
– C’est un enfant comme il y en a beaucoup, dit le vieillard, voilà la vérité, mais un enfant des villes ; aussi est-il bien certain qu’il ne sera jamais bon à rien pour le travail de la terre ; mettez-le un peu devant la charrue à piquer les bœufs, vous verrez combien il durera.
– Dix ans.
– Pas un mois.
– Mais voyez-le donc.
– Voyez-le vous-même.
J’étais au bout de la table entre Barberin et le vieillard, poussé par l’un, repoussé par l’autre.
– Enfin, dit le vieillard, tel qu’il est je le prends. Seulement, bien entendu, je ne vous l’achète pas, je vous le loue. Je vous en donne vingt francs par an.
– Vingt francs !
– C’est un bon prix et je paye d’avance : vous touchez quatre belles pièces de cent sous et vous êtes débarrassé de l’enfant.
– Mais si je le garde, l’hospice me payera plus de dix francs par mois.
– Mettez-en sept, mettez-en huit, je connais les prix, et encore faudra-t-il que vous le nourrissiez.
– Il travaillera.
– Si vous le sentiez capable de travailler, vous ne voudriez pas le renvoyer. Ce n’est pas pour l’argent de leur pension qu’on prend les enfants de l’hospice, c’est pour leur travail ; on en fait des domestiques qui payent et ne sont pas payés. Encore un coup, si celui-là était en état de vous rendre des services, vous le garderiez.
– En tous cas, j’aurais toujours les dix francs.
– Et si l’hospice au lieu de vous le laisser, le donne à un autre, vous n’aurez rien du tout ; tandis qu’avec moi, pas de chance à courir : toute votre peine consiste à allonger la main.
Il fouilla dans sa poche et en tira une bourse de cuir dans laquelle il prit quatre pièces d’argent qu’il étala sur la table en les faisant sonner.
– Pensez-donc, s’écria Barberin, que cet enfant aura des parents un jour ou l’autre ?
– Qu’importe ?
– Il y aura du profit pour ceux qui l’auront élevé ; si je n’avais pas compté là-dessus je ne m’en serais jamais chargé.
Ce mot de Barberin : « Si je n’avais pas compté sur ses parents, je ne me serais jamais chargé de lui, » me fit le détester un peu plus encore. Quel méchant homme.
– Et c’est parce que vous ne comptez plus sur ses parents, dit le vieillard, que vous le mettez à la porte. Enfin à qui s’adresseront-ils, ces parents, si jamais ils paraissent ? à vous, n’est-ce pas, et non à moi qu’ils ne connaissent pas ?
– Et si c’est vous qui les retrouvez.
– Alors convenons que s’il a des parents un jour, nous partagerons le profit, et je mets trente francs.
– Mettez-en quarante.
– Non pour les services qu’il me rendra, ce n’est pas possible.
– Et quels services voulez-vous qu’il vous rende. Pour de bonnes jambes, il a de bonnes jambes, pour de bons bras, il a de bons bras, je m’en tiens à ce que j’ai dit, mais enfin à quoi le trouvez-vous propre ?
Le vieillard regarda Barberin d’un air narquois et vidant son verre à petits coups :
– À me tenir compagnie, dit-il ; je me fais vieux et le soir quelquefois après une journée de fatigue, quand le temps est mauvais, j’ai des idées tristes ; il me distraira.
– Il est sûr que pour cela les jambes seront assez solides.
– Mais pas trop, car il faudra danser, et puis sauter, et puis marcher, et puis après avoir marché, sauter encore ; enfin il prendra place dans la troupe du signor Vitalis.
– Et où est-elle votre troupe ?
– Le signor Vitalis c’est moi, comme vous devez vous en douter ; la troupe, je vais vous la montrer, puisque vous désirez faire sa connaissance.
Disant cela il ouvrit sa peau de mouton, et prit dans sa main un animal étrange qu’il tenait sous son bras gauche serré contre sa poitrine.
C’était cet animal qui plusieurs fois avait fait soulever la peau de mouton ; mais ce n’était pas un petit chien comme je l’avais pensé.
Quelle pouvait être cette bête ?
Était-ce même une bête ?
Je ne trouvais pas de nom à donner à cette créature bizarre que je voyais pour la première fois, et que je regardais avec stupéfaction.
Elle était vêtue d’une blouse rouge bordée d’un galon doré, mais les bras et les jambes étaient nus, car c’étaient bien des bras et des jambes qu’elle avait et non des pattes ; seulement ces bras et ces jambes étaient couverts d’une peau noire, et non blanche ou carnée.
Noire aussi était la tête grosse à peu près comme mon poing fermé ; la face était large et courte, le nez était retroussé avec des narines écartées, les lèvres étaient jaunes ; mais ce qui plus que tout le reste me frappa, ce furent deux yeux très-rapprochés l’un de l’autre, d’une mobilité extrême, brillants comme des miroirs.
– Ah ! le vilain singe ! s’écria Barberin.
Ce mot me tira de ma stupéfaction, car si je n’avais jamais vu des singes j’en avais au moins entendu parler ; ce n’était donc pas un enfant noir que j’avais devant moi, c’était un singe.
– Voici le premier sujet de ma troupe, dit Vitalis, c’est M. Joli-Cœur. Joli-Cœur, mon ami, saluez la société.
Joli-Cœur porta sa main fermée à ses lèvres et nous envoya à tous un baiser.
– Maintenant, continua Vitalis étendant sa main vers le caniche blanc, à un autre : le signor Capi va avoir l’honneur de présenter ses amis à l’estimable société ici présente.
À ce commandement le caniche qui jusque-là n’avait pas fait le plus petit mouvement, se leva vivement et se dressant sur ses pattes de derrière il croisa ses deux pattes de devant sur sa poitrine, puis il salua son maître si bas que son bonnet de police toucha le sol.
Ce devoir de politesse accompli, il se tourna vers ses camarades, et d’une patte, tandis qu’il tenait toujours l’autre sur sa poitrine, il leur fit signe d’approcher.
Les deux chiens, qui avaient les yeux attachés sur leur camarade, se dressèrent aussitôt, et se donnant chacun une patte de devant, comme on se donne la main dans le monde, ils firent gravement six pas en avant puis après trois pas en arrière, et saluèrent la société.
– Celui que j’appelle Capi, continua Vitalis, autrement dit Capitanoen italien, est le chef des chiens, c’est lui qui, comme le plus intelligent, transmet mes ordres. Ce jeune élégant à poil noir est le signor Zerbino, ce qui signifie le galant, nom qu’il mérite à tous les égards. Quant à cette jeune personne à l’air modeste, c’est la signora Dolce, une charmante Anglaise qui n’a pas volé son nom de douce. C’est avec ces sujets remarquables à des titres différents que j’ai l’avantage de parcourir le monde en gagnant ma vie plus ou moins bien, suivant les hasards de la bonne ou de la mauvaise fortune. Capi !
Le caniche croisa les pattes.
– Capi, venez ici, mon ami et soyez assez aimable, je vous prie, – ce sont des personnages bien élevés à qui je parle toujours poliment, – soyez assez aimable pour dire à ce jeune garçon qui vous regarde avec des yeux ronds comme des billes, quelle heure il est. Capi décroisa les pattes, s’approcha de son maître, écarta la peau de mouton, fouilla dans la poche du gilet, en tira une grosse montre en argent, regarda le cadran et jappa deux fois distinctement ; puis après ces deux jappements bien accentués, d’une voix forte et nette, il en poussa trois autres plus faibles.
Il était en effet deux heures et trois quarts.
– C’est bien, dit Vitalis, je vous remercie, signor Capi ; et, maintenant, je vous prie d’inviter la signora Dolce à nous faire le plaisir de danser un peu à la corde.
Capi fouilla aussitôt dans la poche de la veste de son maître et en tira une corde. Il fit un signe à Zerbino et celui-ci alla vivement lui faire vis-à-vis. Alors Capi lui jeta un bout de la corde, et tous deux se mirent gravement à la faire tourner.
Quand le mouvement fut régulier, Dolce s’élança dans le cercle et sauta légèrement en tenant ses beaux yeux tendres sur les yeux de son maître.
– Vous voyez, dit celui-ci, que mes élèves sont intelligents ; mais l’intelligence ne s’apprécie à toute sa valeur que par la comparaison. Voilà pourquoi j’engage ce garçon dans ma troupe ; il fera le rôle d’une bête et l’esprit de mes élèves n’en sera que mieux apprécié.
– Oh ! pour faire la bête, interrompit Barberin.
– Il faut avoir de l’esprit, continua Vitalis, et je crois que ce garçon n’en manquera pas quand il aura pris quelques leçons. Au reste nous verrons bien. Et pour commencer nous allons en avoir tout de suite une preuve. S’il est intelligent il comprendra qu’avec le signor Vitalis on a la chance de se promener, de parcourir la France et dix autres pays, de mener une vie libre au lieu de rester derrière des bœufs, à marcher tous les jours dans le même champ, du matin au soir. Tandis que s’il n’est pas intelligent, il pleurera, il criera, et comme le signor Vitalis n’aime pas les enfants méchants, il ne l’emmènera pas avec lui. Alors l’enfant méchant ira à l’hospice où il faut travailler dur et manger peu.
J’étais assez intelligent pour comprendre ces paroles, mais de la compréhension à l’exécution, il y avait une terrible distance à franchir.
Assurément les élèves du signor Vitalis étaient bien drôles, bien amusants, et ce devait être bien amusant aussi de se promener toujours ; mais pour les suivre et se promener avec eux il fallait quitter mère Barberin.
Il est vrai que si je refusais, je ne resterais peut-être pas avec mère Barberin, on m’enverrait à l’hospice.
Comme je demeurais troublé, les larmes dans les yeux, Vitalis me frappa doucement du bout du doigt sur la joue.
– Allons, dit-il, l’enfant comprend puisqu’il ne crie pas, la raison entrera dans cette petite tête, et demain…
– Oh ! monsieur, m’écriai-je ; laissez-moi à maman Barberin, je vous en prie !
Mais avant d’en avoir dit davantage, je fus interrompu par un formidable aboiement de Capi.
En même temps le chien s’élança vers la table sur laquelle Joli-Cœur était resté assis.
Celui-ci, profitant d’un moment où tout le monde était tourné vers moi, avait doucement pris le verre de son maître, qui était plein de vin, et il était en train de le vider. Mais Capi, qui faisait bonne garde, avait vu cette friponnerie du singe, et, en fidèle serviteur qu’il était, il avait voulu l’empêcher.
– Monsieur Joli-Cœur, dit Vitalis, d’une voix sévère, vous êtes un gourmand et un fripon ; allez vous mettre là-bas, dans le coin, le nez tourné contre la muraille, et vous, Zerbino, montez la garde devant lui ; s’il bouge, donnez-lui une bonne claque. Quant à vous, monsieur Capi, vous êtes un bon chien ; tendez-moi la patte que je vous la serre.
Tandis que le singe obéissait en poussant des petits cris étouffés, le chien, heureux, fier, tendait la patte à son maître.
– Maintenant, continua Vitalis, revenons à nos affaires. Je vous donne donc trente francs.
– Non, quarante.
Une discussion s’engagea ; mais bientôt Vitalis l’interrompit :
– Cet enfant doit s’ennuyer ici, dit-il ; qu’il aille donc se promener dans la cour de l’auberge et s’amuser.
En même temps il fit un signe à Barberin.
– Oui, c’est cela, dit celui-ci, va dans la cour, mais n’en bouge pas avant que je t’appelle, ou sinon je me fâche.
Je n’avais qu’à obéir, ce que je fis.
J’allai donc dans la cour, mais je n’avais pas le cœur à m’amuser. Je m’assis sur une pierre et restai à réfléchir.
C’était mon sort qui se décidait en ce moment même.
Quel allait-il être ? Le froid et l’angoisse me faisaient grelotter.
La discussion entre Vitalis et Barberin dura longtemps, car il s’écoula plus d’une heure avant que celui-ci vînt dans la cour.
Enfin je le vis paraître : il était seul. Venait-il me chercher pour me remettre aux mains de Vitalis ?
– Allons, me dit-il, en route pour la maison.
La maison ! Je ne quitterais donc pas mère Barberin ?
J’aurais voulu l’interroger, mais je n’osai pas, car il paraissait de fort mauvaise humeur.
La route se fit silencieusement.
Mais environ dix minutes avant d’arriver, Barberin qui marchait devant s’arrêta :
– Tu sais, me dit-il en me prenant rudement par l’oreille, que si tu racontes un seul mot de ce que tu as entendu aujourd’hui, tu le payeras cher ; ainsi, attention !
Chapitre4 La maison maternelle.
– Eh bien ! demanda mère Barberin quand nous rentrâmes, qu’a dit le maire ?
– Nous ne l’avons pas vu.
– Comment, vous ne l’avez pas vu ?
– Non, j’ai rencontré des amis au café Notre-Dame, et quand nous sommes sortis, il était trop tard ; nous y retournerons demain.
Ainsi Barberin avait bien décidément renoncé à son marché avec l’homme aux chiens.
En route je m’étais plus d’une fois demandé s’il n’y avait pas une ruse dans ce retour à la maison, mais ces derniers mots chassèrent les doutes qui s’agitaient confusément dans mon esprit troublé. Puisque nous devions retourner le lendemain au village pour voir le maire, il est certain que Barberin n’avait pas accepté les propositions de Vitalis.
Cependant malgré ses menaces j’aurais parlé de mes doutes à mère Barberin, si j’avais pu me trouver seul un instant avec elle, mais de toute la soirée Barberin ne quitta pas la maison, et je me couchai sans avoir pu trouver l’occasion que j’attendais.
Je m’endormis en me disant que ce serait pour le lendemain.
Mais le lendemain, quand je me levai, je n’aperçus point mère Barberin.
Comme je la cherchais en rôdant autour de la maison, Barberin me demanda ce que je voulais.
– Maman.
– Elle est au village, elle ne reviendra qu’après midi.
Sans savoir pourquoi, cette absence m’inquiéta. Elle n’avait pas dit la veille qu’elle irait au village. Comment n’avait elle pas attendu pour nous accompagner, puisque nous devions y aller après midi ? Serait-elle revenue quand nous partirions ?
Une crainte vague me serra le cœur ; sans me rendre compte du danger qui me menaçait, j’eus cependant le pressentiment d’un danger.
Barberin me regardait d’un air étrange, peu fait pour me rassurer.
Voulant échapper à ce regard, je m’en allai dans le jardin.
Ce jardin, qui n’était pas grand, avait pour nous une valeur considérable, car c’était lui qui nous nourrissait, nous fournissant, à l’exception du blé, à peu près tout ce que nous mangions : pommes de terre, fèves, choux, carottes, navets. Aussi n’y trouvait-on pas de terrain perdu. Cependant mère Barberin m’en avait donné un petit coin dans lequel j’avais réuni une infinité de plantes, d’herbes, de mousse arrachées le matin à la lisière des bois ou le long des haies pendant que je gardais notre vache, et replantées l’après-midi dans mon jardin, pêle-mêle, au hasard, les unes à côté des autres.
Assurément ce n’était point un beau jardin avec des allées bien sablées et des plates-bandes divisées au cordeau, pleines de fleurs rares ; ceux qui passaient dans le chemin ne s’arrêtaient point pour le regarder par-dessus la haie d’épine tondue au ciseau, mais tel qu’il était, il avait ce mérite et ce charme de m’appartenir ; il était ma chose, mon bien, mon ouvrage ; je l’arrangeais comme je voulais, selon ma fantaisie de l’heure présente, et quand j’en parlais, ce qui m’arrivait vingt fois par jour, je disais « mon jardin ».
C’était pendant l’été précédent que j’avais récolté et planté ma collection, c’était donc au printemps qu’elle devait sortir de terre, les espèces précoces sans même attendre la fin de l’hiver, les autres successivement.
De là ma curiosité, en ce moment vivement excitée.
Déjà les jonquilles montraient leurs boutons, dont la pointe jaunissait, les lilas de terre poussaient leurs petites hampes pointillées de violet, et du centre des feuilles ridées des primevères sortaient des bourgeons qui semblaient prêts à s’épanouir.
Comment tout cela fleurirait-il ?
C’était ce que je venais voir tous les jours avec curiosité.
Mais il y avait une autre partie de mon jardin que j’étudiais avec un sentiment plus vif que la curiosité, c’est-à-dire avec une sorte d’anxiété.
Dans cette partie de jardin j’avais planté un légume qu’on m’avait donné et qui était presque inconnu dans notre village, – des topinambours. On m’avait dit qu’il produisait des tubercules bien meilleurs que ceux des pommes de terre, car ils avaient le goût de l’artichaut, du navet et plusieurs autres légumes encore. Ces belles promesses m’avaient inspiré l’idée d’une surprise à faire à mère Barberin. Je ne lui disais rien de ce cadeau, je plantais mes tubercules dans mon jardin ; quand ils poussaient des tiges, je lui laissais croire que c’était des fleurs ; puis un beau jour, quand le moment de la maturité était arrivé, je profitais de l’absence de mère Barberin pour arracher mes topinambours, je les faisais cuire moi-même, comment ? je ne savais pas trop, mais mon imagination ne s’inquiétait pas d’un aussi petit détail, et quand mère Barberin rentrait pour souper, je lui servais mon plat.
Qui était bien étonnée ? Mère Barberin.
Qui était bien contente ? Encore mère Barberin.
Car nous avions un nouveau mets pour remplacer nos éternelles pommes de terre, et mère Barberin n’avait plus autant à souffrir de la vente de la pauvre Roussette.
Et l’inventeur de ce nouveau mets, c’était moi, moi Rémi ; j’étais donc utile dans la maison.
Avec un pareil projet dans la tête, on comprend combien je devais être attentif à la levée de mes topinambours ; tous les jours je venais regarder le coin dans lequel je les avais plantés, et il semblait à mon impatience qu’ils ne pousseraient jamais.
J’étais à deux genoux sur la terre, appuyé sur mes mains, le nez baissé dans mes topinambours, quand j’entendis crier mon nom d’une voix impatiente. C’était Barberin qui m’appelait.
Que me voulait-il ?
Je me hâtai de rentrer à la maison.
Quelle ne fut pas ma surprise d’apercevoir devant la cheminée Vitalis et ses chiens.
Instantanément je compris ce que Barberin voulait de moi.
Vitalis venait me chercher, et c’était pour que mère Barberin ne pût pas me défendre que le matin Barberin l’avait envoyée au village.
Sentant bien que je n’avais ni secours ni pitié à attendre de Barberin, je courus à Vitalis :
– Oh ! monsieur, m’écriai-je, je vous en prie, ne m’emmenez pas.
Et j’éclatai en sanglots.
– Allons, mon garçon, me dit-il assez doucement, tu ne seras pas malheureux avec moi, je ne bats point les enfants, et puis tu auras la compagnie de mes élèves qui sont très-amusants. Qu’as-tu à regretter ?
– Mère Barberin ! mère Barberin !
– En tous cas, tu ne resteras pas ici, dit Barberin, en me prenant rudement par l’oreille ; monsieur ou l’hospice, choisis !
– Non ! mère Barberin !
– Ah ! tu m’ennuies à la fin, s’écria Barberin, qui se mit dans une terrible colère ; s’il faut te chasser d’ici à coups de bâton, c’est ce que je vas faire.
– Cet enfant regrette sa mère Barberin, dit Vitalis ; il ne faut pas le battre pour cela ; il a du cœur, c’est bon signe.
– Si vous le plaignez, il va hurler plus fort.
– Maintenant, aux affaires.
Disant cela, Vitalis étala sur la table huit pièces de cinq francs, que Barberin en un tour de main, fit disparaître dans sa poche.
– Où est le paquet ? demanda Vitalis.
– Le voilà, répondit Barberin en montrant un mouchoir en cotonnade bleue noué par les quatre coins.
Vitalis défît ces nœuds et regarda ce que renfermait le mouchoir ; il s’y trouvait deux de mes chemises et un pantalon de toile.
– Ce n’est pas de cela que nous étions convenus, dit Vitalis, vous deviez me donner ses affaires et je ne trouve là que des guenilles.
– Il n’en a pas d’autres.
– Si j’interrogeais l’enfant, je suis sûr qu’il dirait que ce n’est pas vrai. Mais je ne veux pas disputer là-dessus. Je n’ai pas le temps. Il faut se mettre en route. Allons, mon petit. Comment se nomme-t-il ?
– Rémi.
– Allons, Rémi, prend ton paquet, et passe devant Capi, en avant, marche !
Je tendis les mains vers lui, puis vers Barberin, mais tous deux détournèrent la tête, et je sentis que Vitalis me prenait par le poignet.
Il fallut marcher.
Ah ! la pauvre maison, il me sembla, quand j’en franchis le seuil, que j’y laissais un morceau de ma peau.
Vivement, je regardai autour de moi, mes yeux obscurcis par les larmes ne virent personne à qui demander secours : personne sur la route, personne dans les prés d’alentour.
Je me mis à appeler :
– Maman, mère Barberin !
Mais personne ne répondit à ma voix, qui s’éteignit dans un sanglot.
Il fallut suivre Vitalis, qui ne m’avait pas lâché le poignet.
– Bon voyage ! cria Barberin. Et il rentra dans la maison. Hélas ! c’était fini.
– Allons, Rémi, marchons, mon enfant, dit Vitalis. Et sa main tira mon bras.
Alors je me mis à marcher près de lui. Heureusement il ne pressa point son pas, et même je crois bien qu’il le régla sur le mien.
Le chemin que nous suivions s’élevait en lacets le long de la montagne, et, à chaque détour, j’apercevais la maison de mère Barberin qui diminuait, diminuait. Bien souvent j’avais parcouru ce chemin et je savais que quand nous serions à son dernier détour, j’apercevrais la maison encore une fois, puis qu’aussitôt que nous aurions fait quelques pas sur le plateau, ce serait fini ; plus rien ; devant moi l’inconnu ; derrière moi la maison où j’avais vécu jusqu’à ce jour si heureux, et que sans doute je ne reverrais jamais.
Heureusement la montée était longue ; cependant à force de marcher, nous arrivâmes au haut. Vitalis ne m’avait pas lâché le poignet.
– Voulez-vous me laisser reposer un peu ? lui dis-je.
– Volontiers, mon garçon.
Et, pour la première fois, il desserra la main.
Mais, en même temps, je vis son regard se diriger vers Capi, et faire un signe que celui-ci comprit.
Aussitôt, comme un chien de berger, Capi abandonna la tête de la troupe et vint se placer derrière moi.
Cette manœuvre acheva de me faire comprendre ce que le signe m’avait déjà indiqué : Capi était mon gardien ; si je faisais un mouvement pour me sauver, il devait me sauter aux jambes.
J’allai m’asseoir sur le parapet gazonné, et Capi me suivit de près.
Assis sur le parapet, je cherchai de mes yeux obscurcis par les larmes la maison de mère Barberin.
Au-dessous de nous descendait le vallon que nous venions de remonter, coupé de prés et de bois, puis tout au bas se dressait isolée la maison maternelle, celle où j’avais été élevé.