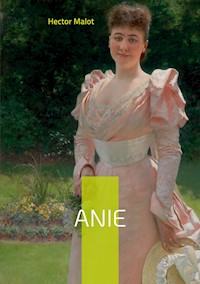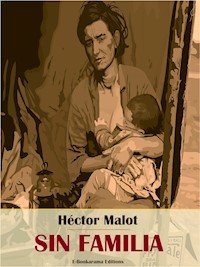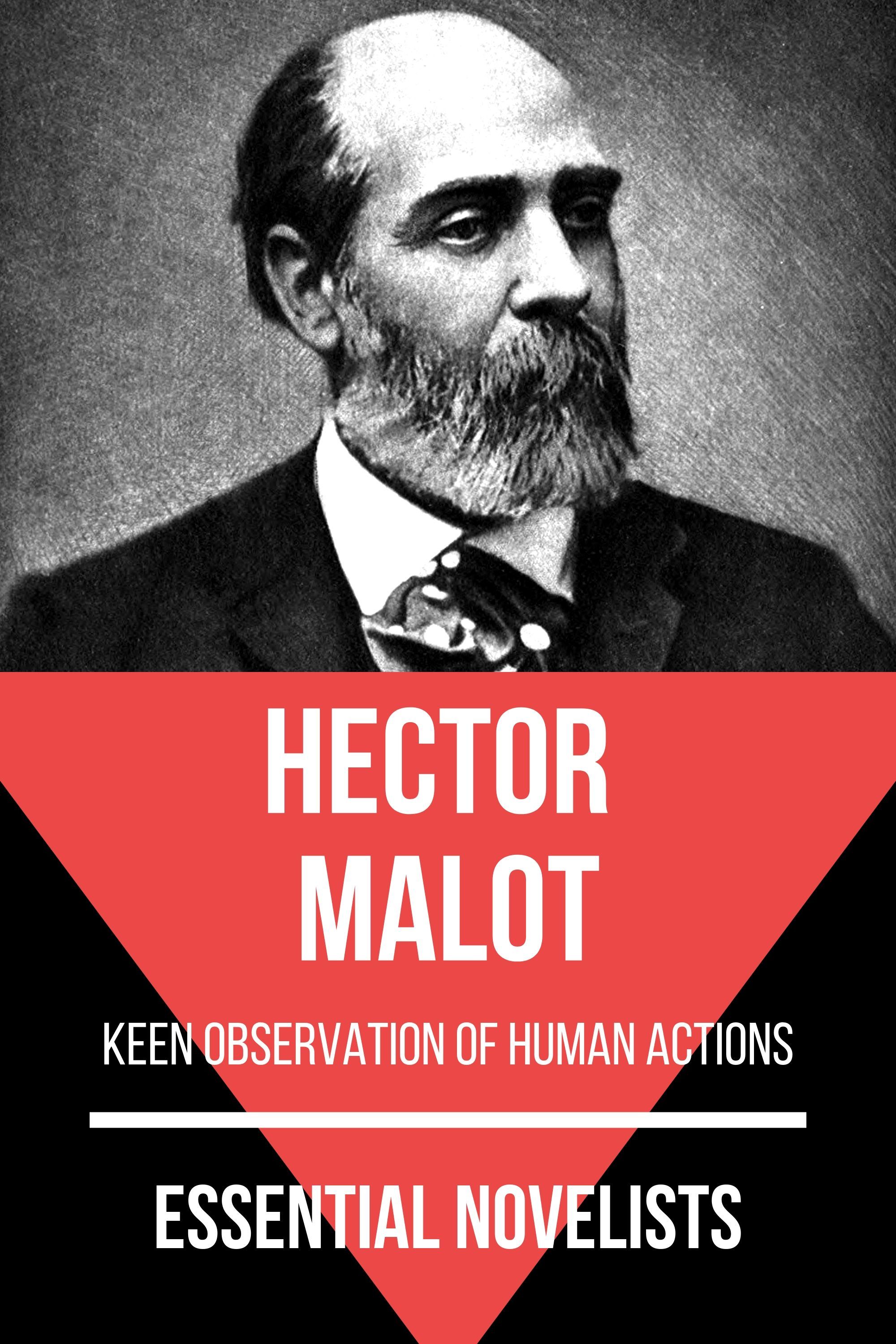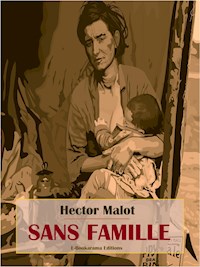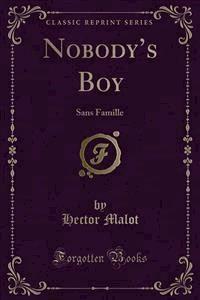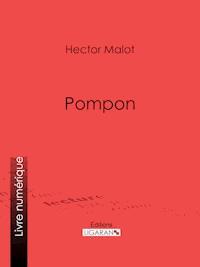2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La mode exige qu'on parte en voyage le jour où l'on se marie. Ceux qui les premiers ont adopté cet usage avaient probablement pour but d' échapper aux plaisanteries gauloises de quelques parents peu discrets ; mais, la bégueulerie du siècle aidant, ce qui tait tout d'abord l'exception est devenu la règle : aujourd'hui il n'y a que les gens du commun qui osent être heureux chez eux...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Une belle-mère
Pages de titreIIIIIIIVVIVIIVIIIIXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVPage de copyrightHector Malot
Une belle-mère
L’épisode qui précède Une Belle-Mère a pour titre Le Mariage de Juliette.
I
La mode exige qu’on parte en voyage le jour où l’on se marie.
Ceux qui les premiers ont adopté cet usage avaient probablement pour but d’échapper aux plaisanteries gauloises de quelques parents peu discrets ; mais, la bégueulerie du siècle aidant, ce qui était tout d’abord l’exception est devenu la règle : aujourd’hui il n’y a que les gens du commun qui osent être heureux chez eux.
En mariant leurs enfants, madame Daliphare et madame Nélis s’étaient donc rencontrées sur ce point que Juliette et Adolphe devaient partir en voyage. Il n’y avait point eu discussion à ce sujet, tant la chose paraissait naturelle aux deux mères ; les plaisanteries des amis ou des parents n’étaient pas à craindre, mais les convenances étaient à respecter.
De leur côté, Adolphe et Juliette n’avaient mis aucune opposition à cet arrangement.
Adolphe, parce qu’il était impatient d’avoir tout à lui celle qu’il aimait et que le voyage devait lui assurer un long tête-à-tête.
Juliette, parce qu’elle ne résistait à rien depuis qu’elle avait consenti à se marier. Elle considérait, en effet, qu’en donnant son consentement elle s’était engagée d’avance à accepter tout ce qu’on exigeait d’elle, et, bien que ce voyage ne fût pas pour lui plaire par toutes sortes de raisons, elle n’avait pas voulu le repousser. Il convenait à sa mère, à sa belle-mère, à son mari : il devait lui convenir aussi. Les explications qu’elle aurait pu apporter à l’appui de son refus étaient si vagues et même si bizarres, qu’elle n’eût pas voulu les formuler devant tout le monde : on l’aurait accusée d’originalité, on ne l’aurait sans doute pas comprise. Elle avait donc accueilli sans aucune résistance l’idée d’un voyage en Suisse. Après tout, pourquoi pas ? elle ne connaissait point la Suisse. Autant voyager que rester à Paris ; autant aller en Suisse qu’ailleurs.
Cependant, lorsqu’en attendant le départ du train de Genève elle se promena sur le quai au bras de son mari, elle éprouva une impression qui la troubla et la gêna. Pourquoi tous ces yeux se fixaient-ils sur elle ? pourquoi les hommes la regardaient-ils en souriant et les femmes avec curiosité ? qu’avait-elle qui la désignât à l’attention ? comment devinait-on qu’elle avait été mariée le matin même ? et en quoi d’ailleurs une jeune mariée est-elle plus curieuse à voir qu’une jeune fille ?
Si elle avait osé, elle aurait prié Adolphe de montrer moins de joie et de ne point crier son bonheur à toutes ces oreilles. Elle ne savait point que l’amour est celle de toutes nos passions qui échappe le plus difficilement à la curiosité, et que deux amants, comme deux jeunes mariés, sont devinés par les gens les moins observateurs :
alors on s’attache à eux, on les suit et on les épie.
Enfin elle put monter en voiture, et la portière fut fermée par un employé à l’air vainqueur, qui resta appuyé un peu plus longtemps qu’il ne fallait sur la poignée ; lui aussi était souriant et disait : « Je ne m’y trompe pas, je vous devine : vous êtes une mariée. Bon voyage ! Aimez-vous bien ! »
On partit.
Ils étaient seuls.
Adolphe alors se mit à tout arranger dans le coupé, à faire ce qu’on peut appeler le ménage du voyage, et cela prit un certain temps. Mais bientôt tout fut organisé et il s’assit près d’elle. Le train déjà filait à toute vitesse et les coteaux de Villeneuve-Saint-Georges disparaissaient dans le lointain sombre.
Il lui prit doucement la main et la garda dans les siennes.
Qu’allait-il dire ?
Son cœur se serra ; elle eut peur d’entendre le premier mot qu’il allait prononcer, comme si c’était celui qui devait décider de sa vie.
Et de fait le moment pour tous deux était solennel, et l’émotion était bien permise. Pour la première fois ils étaient seuls, en tête-à-tête, et maintenant ils étaient mariés.
Quelle serait la première parole du mari ?
Quel serait le premier regard de la femme ?
Instinctivement elle détourna la tête et regarda à travers la glace fermée.
Il la tenait toujours par la main ; elle sentit qu’il l’attirait doucement, mais elle continua à regarder le paysage sans le voir.
Qu’avez-vous ? dit-il ; souffrez-vous de la chaleur ? voulez-vous que j’ouvre la glace ?
Je veux bien.
Et pendant assez longtemps elle resta la tête appuyée sur la portière.
Il avait repris sa main.
Ils ne pouvaient pas voyager ainsi pendant toute la nuit ; cette attitude était ridicule.
Elle se retourna et le regarda en face.
Il l’entoura de ses deux bras et voulut l’attirer contre lui, mais elle le repoussa doucement.
Ne sommes-nous pas seuls ? dit-il : nous n’avons pas de regards curieux à craindre.
Les vôtres, dit-elle.
Ne suis-je pas votre mari, chère Juliette ? car maintenant nous sommes bien l’un à l’autre.
Et se mettant à genoux devant elle, il lui prit les deux mains et la contempla longuement. Mais elle l’obligea à se relever.
Ne pouvons-nous pas voyager ensemble cette nuit comme nous aurions voyagé hier ? ditelle.
Mais aujourd’hui n’est pas hier.
Si vous vouliez qu’il le fût encore.
À son tour, elle lui prit la main, et, comme il voulait se pencher vers elle, elle le maintint doucement à sa place ; puis, regardant au dehors, elle se mit à lui parler de choses indifférentes, du paysage, de la Seine qu’on venait de traverser, de la forêt de Fontainebleau qu’on allait atteindre.
Pendant longtemps ils devisèrent ainsi ; tout d’abord il avait paru rêveur, mais bientôt il s’était abandonné au plaisir de cet entretien. N’étaientils pas seuls ensemble ? ne la tenait-il pas sous ses yeux ?
Il prit si bien son parti de la situation qui lui était faite, qu’il voulut obliger Juliette à dormir. Elle se défendit un moment, mais enfin elle se laissa convaincre : elle ferma les yeux ; seulement au lieu de dormir elle rêva.
Toute sa journée avait été si remplie, si troublée, qu’elle n’avait pas eu une minute pour être seule avec elle-même et réfléchir à ce qui se passait. L’église, les compliments, les embrassements, le déjeuner, les recommandations de sa mère, celles de sa belle-mère : elle avait été entraînée.
Maintenant elle pouvait revenir en arrière.
Ainsi elle était mariée. Jusque-là ce grand mot de mariage n’avait pas un sens bien précis pour elle. Elle s’était dit : « Je serai mariée tel jour » ; mais ce qui est au futur nous laisse toujours une indécision dans l’esprit et dans l’âme. À chaque instant on se dit : Je mourrai un jour, et pour cela on ne pense pas à la mort, de manière à sentir fortement ce qu’est cette mort.
Maintenant ce mariage n’était plus au futur, il était au présent, et déjà même quelques heures étaient au passé.
Pendant ses dernières journées de liberté, il y avait une question qui avait oppressé son esprit et qu’elle avait longuement agitée en la tournant sous toutes ses faces : « Aimerait-elle son mari ? »
Et, malgré la précision qu’elle s’efforçait de mettre dans ses interrogations, malgré la sévérité de l’examen qu’elle s’imposait, elle était toujours restée dans un certain vague.
Adolphe était d’une bonté inépuisable ; il était doux et patient, il était généreux, il était intelligent. Et pendant des heures elle énumérait ainsi les qualités dont il était doué. Sans peine elle les reconnaissait en lui, tant elles étaient évidentes ; mais cette énumération ne l’amenait pas à la conclusion qu’elle cherchait. On peut être un homme parfait et ne pas inspirer l’amour.
Aimerait-elle cet homme qui avait toutes les qualités ?
Maintenant la question qui se posait devant elle avait bien peu changé, et cependant elle était autrement sérieuse qu’elle ne l’avait jamais été.
« Aimait-elle son mari ? »
Il l’avait doucement attirée contre lui, et elle, reposait, la tête appuyée sur son épaule ; elle était déjà entre ses bras, et elle s’interrogeait encore.
Un frisson la fit tressaillir de la tête aux pieds.
Elle voulut se dégager dans un mouvement de honte, mais il la retint.
– Vous ne dormez donc pas ? dit-il d’une voix, qui se faisait tendre et caressante, comme pour parler à un enfant. N’ayez pas peur, chère Juliette : je suis près de vous, vous êtes dans mes bras, votre tête est sur mon épaule.
Elle ouvrit à demi les yeux. Les arbres noirs défilaient avec une rapidité vertigineuse et, de temps en temps, des nappes fulgurantes comme des éclairs étaient projetées contre les talus, qu’elles éclairaient de lueurs de feu fantastiques ; le train, lancé à toute vitesse sur une pente, faisait entendre un bruit infernal.
Elle ferma les yeux, et ne bougea plus : l’impression physique se mêlant à l’impression morale, il lui sembla qu’elle était entraînée par une force supérieure contre laquelle il n’y avait pas à résister.
Elle avait accepté ce voyage, elle avait accepté ce mariage. Maintenant il n’y avait qu’à aller jusqu’au bout.
Elle était dans la nuit ; mais le jour, qui se lèverait certainement pour la voyageuse dans quelques heures, se lèverait peut-être aussi pour la femme... plus tard. Alors, elle aussi, elle aurait un rayon de chaleur et de lumière.
Et puis fallait-il absolument aimer pour être heureuse ? La vie ne pouvait-elle s’écouler sans amour ? Elle avait de l’estime pour son mari, de l’amitié, de la tendresse, et n’est-ce pas assez ?
Ce sont les poètes et les romanciers qui ont mis la passion dans la vie. La réalité doit-elle s’inquiéter de ces vaines fictions de l’art, bonnes tout au plus pour occuper une imagination de vingt ans ?
Si elle n’aimait point son mari, elle aimerait ses enfants.
Elle serait assez forte sans doute pour imposer silence à ces désirs et à ces rêveries qui autrefois avaient gonflé son cœur et enflammé son esprit.
La vie ordinaire n’est pas faite de poésie et de rêverie ; et d’ailleurs n’y a-t-il pas quelque chose d’assez grand dans le dévouement pour emplir l’existence d’une femme ?
N’est-ce pas le bonheur que de rendre les autres heureux ? Ce besoin d’expansion, cette chaleur, cet enthousiasme qu’elle sentait vaguement en elle, elle les emploierait au profit de ceux à qui sa vie serait liée : cela vaudrait mieux, cela serait plus grand et plus généreux que les employer à son seul profit.
Une grande partie de la nuit s’écoula pour elle dans cette méditation, et peu à peu le calme se fit dans son cœur, tout d’abord agité.
Puis la fatigue la prit, et, sans en avoir conscience, elle s’endormit.
Quand elle se réveilla, la nuit était dissipée et le soleil se levait.
En ouvrant les yeux, elle rencontra ceux d’Adolphe fixés sur elle.
Dors encore, dit-il ; je suis si heureux de te voir dormir.
Mais elle se redressa vivement et, ouvrant la glace qui avait été fermée, elle resta assez longtemps à respirer l’air frais du matin.
Puis tout à coup, se retournant avec un sourire, elle prit la main d’Adolphe et la lui embrassant :
II
Il entrait dans le plan qu’Adolphe s’était tracé avant de quitter Paris, de rester quelques jours à Genève. De là ils partiraient chaque matin pour faire des excursions dans les environs, à Ferney, au Salève, aux Voirons, à Divonne. Il avait pioché les guides en Suisse, et il était ferré sur les divers itinéraires qu’ils devraient suivre.
Lorsque le train eut dépassé Bellegarde, il commença à expliquer ses projets à Juliette et à lui annoncer à l’avance les curiosités qu’ils verraient : le château habité par Voltaire à Ferney, la vue du mont Blanc au Salève, la table de travail de madame de Staël à Coppet.
Elle l’écouta sans faire d’objections : il avait arrangé ces promenades, elle les acceptait.
Mais lorsque après être sortie de wagon elle descendit en voiture la rue du Mont-Blanc, au milieu d’une ville régulièrement bâtie, aux rues larges et droites, bordées de grandes maisons ayant pour tout caractère de ressembler à toutes les maisons de produit que les architectes construisent depuis trente ans, elle se dit que ce n’était pas la peine de quitter Paris pour le retrouver au pied des Alpes. À quoi bon quitter une ville pour une autre ville, une foule pour une autre foule, la curiosité de ceux-ci pour la curiosité de ceux-là ?
Car cette curiosité qui l’avait fait rougir dans la gare de Paris l’avait poursuivie en voyage : à Mâcon, à Bourg, à Ambérieux, à Culoz, à
Bellegarde, partout où il y avait eu des arrêts de plusieurs minutes, deux ou trois de ceux qui l’avaient le plus effrontément regardée à Paris étaient venus passer et repasser devant leur coupé. L’écriteau « réservé » accroché à la portière les avait empêchés de monter ; mais qui pouvait arrêter leurs regards et leurs sourires ? Il y avait une mariée dans ce coupé : on venait voir comment elle avait passé la nuit ; pour un peu on lui eût demandé des nouvelles de sa santé. Et en s’en allant on riait en faisant des commentaires.
C’était évidemment fort drôle.
Au reste, il faut dire que le Français, né malin, n’est pas le seul peuple qui trouve à rire dans le mariage. C’est au génie de la France, il est vrai, que revient l’honneur d’avoir crééla Mariée du mardi gras; mais, cette supériorité artistique constatée, on doit reconnaître que, comme nous, les étrangers savent pratiquer et goûter toutes les plaisanteries que peut inspirer la vue d’une jeune mariée.
Juliette en fit l’expérience lorsqu’elle descendit de voiture pour entrer à l’hôtel des Bergues.
Il y avait là, sur les marches du porche et dans le vestibule, des touristes diversement groupés : des Anglais, des Américains, des Allemands. Sur les dalles sonores on entendait grincer les bâtons ferrés, et quand une porte ouverte établissait un courant d’air, on voyait les voiles des chapeaux de feutre voltiger au vent ; l’accent nasal des Yankee se mêlait au parler rauque et guttural des Prussiens.
Au bruit d’une voiture qui s’arrêtait sur le quai, chacun tourna la tête pour voir qui arrivait, et quand Juliette traversa le vestibule, elle eut à affronter vingt paires d’yeux braqués sur elle.
Le maître d’hôtel s’était avancé.
Une chambre à un lit ou à deux lits ? dit-il en s’adressant à Adolphe.
Juliette rougit jusqu’à la racine des cheveux : il lui semblait que toutes ces oreilles avaient entendu cette demande et que tous ces yeux la dévoraient.
Un salon et deux chambres, répondit Adolphe.
Communiquant entre elles, bien entendu ?
Oui.
Conduisez madame au 6, dit le maître d’hôtel en s’adressant à une fille de service.
En entrant dans le salon, Juliette alla à la fenêtre, qui était ouverte. À ses pieds coulait le Rhône aux eaux bleues ; devant elle se dressait la vieille ville avec ses hautes maisons et ses clochers. Mais ce qui surtout attira son regard, ce fut, à gauche, une grande coulée lumineuse qui allait s’élargissant jusqu’à l’horizon, – le lac, dont les rives bordées de verdure pâle se perdaient dans le lointain brumeux.
Par-dessus les arbres d’une petite île, on voyait la cheminée d’un bateau à vapeur qui déroulait dans l’air tranquille un gros câble de fumée noire : une cloche sonnait pour annoncer le départ.
N’est-ce pas que cela est beau ? dit Adolphe en s’approchant, pour la prendre dans ses bras ; nous pourrons passer quelques bonnes journées à Genève.
Sans doute.
Il fut frappé de la façon dont elle avait prononcé ces deux mots.
Est-ce que Genève ne vous plaît point ? ditil.
Elle le regarda en face.
Il faut être franche, n’est-ce pas ? dit-elle.
Assurément.
Eh bien ! ce qui me déplaît, ce n’est point Genève, c’est la ville, c’est la foule, c’est la curiosité. Savez-vous à quoi je pensais en regardant ce bateau à vapeur plutôt que le mont Blanc ? c’est qu’il va partir, et que là-bas, quelque part, je ne sais où, dans ces profondeurs bleues, il doit se trouver quelque village, quelque endroit désert, où l’on serait seul. Si nous partions ?
Adolphe n’était point habitué à l’imprévu ; à l’avance il arrêtait ce qu’il ferait, et quand il avait pris une décision, il l’exécutait de point en point. Mais il n’était plus dans des conditions ordinaires, et ce n’étaient plus ses habitudes qui le dirigeaient. En entendant Juliette manifester le désir de quitter Genève, il ne se rappela pas qu’il devait visiter Ferney, Coppet et Divonne. Mais, prenant son chapeau, qu’il avait jeté sur un meuble, il courut à l’embarcadère du bateau à vapeur pour savoir s’ils avaient encore le temps de partir. On lui répondit que le bateau ne quitterait le quai que dans vingt minutes ; et, toujours courant, il revint rapporter cette nouvelle à Juliette.
C’est plus de temps qu’il ne faut, s’écria celle-ci ; partons.
Et déjeuner ? objecta Alphonse, qui n’oubliait jamais les choses de la vie.
Nous déjeunerons sur le bateau, si l’on peut nous servir ; sinon nous déjeunerons demain.
Dix minutes après, ils étaient installés sous la tente duLéman, dont les soupapes en pression chantaient.
Celui qui m’aurait dit hier que ce serait là tout ce que nous verrions de Genève, fit Adolphe en riant, m’aurait bien surpris.
Cela vous contrarie ?
Ce qui m’eût contrarié, c’eût été de ne pas vous faire ce plaisir. Que m’importe Genève, la Suisse et le monde entier ! C’est à vous seule que je pense.
Elle lui serra la main ; puis, se penchant à son oreille :
Alors allons tout droit devant nous.
Le bateau à vapeur avait quitté l’embarcadère et, après avoir lentement remonté le courant du Rhône, il filait rapidement le long de la rive gauche du lac.
Et où irons-nous ? demanda Adolphe, qui, n’ayant plus son itinéraire à suivre, se trouvait désorienté.
Où vous voudrez.
À Lausanne ?
Mais Lausanne est une ville.
À Vevey alors ?
À Vevey, si vous voulez.
Jusque-là Juliette n’avait eu que les ennuis du voyage, elle commença à en goûter l’agrément. Si la femme avait souffert de la curiosité dont elle se croyait l’objet, et si plus d’une fois elle avait regretté de ne point passer les premières heures de son mariage à l’abri des regards fâcheux, en toute liberté et en toute sécurité, l’artiste éprouva une émotion de joie en se, trouvant au milieu de ce beau lac qu’elle ne connaissait pas. Son cœur se détendit. Elle ne pensa plus qu’au spectacle qui se déroulait sous ses yeux : aux riantes villas qui se montraient çà et là dans des bouquets d’arbres, aux rives verdoyantes qui glissaient à droite et à gauche ; aux hautes montagnes dont les sommets inégaux, blancs ici, noirs là, semblaient se perdre dans le ciel qu’ils cachaient.
Adolphe fit servir sa table sur le pont et, tout en déjeunant gaiement en face l’un de l’autre, ils suivirent le panorama mouvant qui passait devant eux.
C’était sans bien savoir ce qu’il disait qu’Adolphe avait proposé Vevey ; ce nom lui était venu sur les lèvres et il l’avait prononcé ; pour lui ce devait être un village au bord du lac, dans la partie la plus pittoresque du pays.
Mais lorsqu’on débarquant du bateau ils tombèrent au milieu d’une ville, où les étrangers étaient au moins aussi nombreux qu’à Genève, lorsqu’en arrivant à l’hôtel des Trois-Couronnes, ils trouvèrent les mêmes Anglais, les mêmes Américains, les mêmes Allemands, les mêmes voiles verts, les mêmes lorgnettes qu’à Genève, Juliette eut un mouvement de répulsion qu’Adolphe remarqua.
Sans rien dire, il laissa Juliette seule ; puis au bout de quinze ou vingt minutes il revint dans une calèche découverte attelée de deux chevaux.
Puisque Vevey vaut Genève, dit-il, allons plus loin ; nous finirons bien par trouver quelque village tranquille.
Mais cela était plus difficile qu’ils ne croyaient, car toute cette côte du lac ne forme guère qu’une longue rue où les villas se joignent aux villas et où les hôtels succèdent aux hôtels ; partout des murs, des maisons, des magasins, partout des Américains, des Anglais, des Allemands.
Ils traversèrent ainsi une série de villages qui se touchaient les uns les autres : la Tour, Clarens, Vernex, Montreux.
Nous irons jusqu’au Simplon, disait Juliette en riant.
Enfin la nuit était faite depuis longtemps déjà, lorsqu’au haut d’une petite côte et en sortant d’une enfilade de murs, ils arrivèrent à un endroit de la route qui était ombragé par de grands arbres : un hôtel entouré de jardins était bâti là.
Ils s’arrêtèrent et renvoyèrent leur voiture. Si ce n’était point le désert et la solitude, c’était au moins la tranquillité.
Une fille de service les conduisit à l’appartement qu’on pouvait leur donner ; les fenêtres de cet appartement ouvraient sur le lac, qui se trouvait à une centaine de mètres audessous de la véranda.
En face, de l’autre côté du lac, dit-elle, sont les rochers de Meillerie ; les bâtiments sombres que vous apercevez là, à gauche, dans l’eau, c’est le château de Chillon. Oh ! la vue est jolie ; vous en serez contents ; c’est dommage seulement qu’on n’ait pas pu vous donner l’appartement que vous demandiez, mais l’hôtel est plein. Nous avons beaucoup de mariés ; il paraît que c’est la saison : vous en avez pour voisins, à gauche.
Et elle se mit à faire les couvertures des lits, relevant le drap de dessus, dressant l’oreiller.
Juliette passa rapidement sous la véranda et, s’accoudant sur le balcon, elle regarda dans les profondeurs de la nuit le lac qui miroitait sous un rayon de lune.
Quand elle se retourna, la femme de chambre était sortie et les bougies étaient éteintes : à la clarté de la lune, elle vit Adolphe qui promenait ses deux mains sur la cloison et semblait regarder à travers le mur.
Que faites-vous donc là ? dit-elle, intriguée.
Il faut que vous sachiez, répondit-il, que les Allemands ne sont pas aussi naïfs qu’ils veulent le paraître. Quand ils arrivent dans une chambre, ils commencent par percer des trous dans les cloisons avec une vrille qu’ils portent toujours sur eux, et par ces trous ils regardent ce qui se passe chez leurs voisins. Comme notre femme de chambre peut être aussi bavarde avec nos voisins qu’elle l’a été avec nous, je n’ai pas envie d’être exposé à cet espionnage, et je prends mes précautions.
Si la clarté de la lune avait été plus vive, il eût vu le visage de Juliette s’empourprer.
Eh quoi ! il connaissait ces dangers des hôtels, et c’était un hôtel qu’il avait choisi pour sa nuit de noces !
Elle ne fit pas cette réflexion tout haut ; mais le prenant par la main et l’amenant sur la véranda, elle lui montra des lanternes qui se balançaient sur l’eau.
Il y a là des bateaux de promenade, dit-elle ; si vous vouliez, nous pourrions en prendre un et passer notre soirée sur le lac. Il fait si beau !
III
J.-J. Rousseau a rendu le nom de Clarens célèbre ; mais s’il a été exact dans la description du pays habité par Saint-Preux et Héloïse, il faut dire qu’aujourd’hui le Clarens de la réalité ne ressemble en rien à celui du romancier. Au XVIIIesiècle, il y avait sans doute des arbres, de la verdure et de l’ombrage sur ces pentes qui descendent jusqu’au lac ; aujourd’hui les arbres ont été remplacés par des échalas ; là où étaient des prairies sont des vignes, et, pour trouver de l’ombrage, il faut marcher le long des murs qui soutiennent les terres. La prospérité matérielle de la contrée s’est considérablement accrue, son aspect pittoresque et son agrément ont disparu. De Vevey à Veytaux, on marche dans des rues qui changent de nom suivant les villages qu’elles traversent, mais dont le caractère ne change jamais : des vignes et des maisons meublées, qu’on appelle dans le pays despensions,et toujours des pensions et des vignes. Le parfum des feuilles et des foins a été remplacé par l’odeur de la gargoterie, chère aux Anglais et aux Allemands.
Par bonheur pour ce beau pays, la nature a pris d’avance des précautions contre le travail de l’homme, et, à une certaine hauteur au-dessus du niveau du lac, elle a bouleversé le sol de telle sorte que les améliorations agricoles et les embellissements artistiques sont impossibles ; bon gré mal gré, il a fallu conserver les bois et les pâturages dans leur état primitif.
Avec son flair des choses de la nature et sans avoir lu aucun guide, Juliette avait deviné cette disposition topographique du pays dans lequel le hasard les avait amenés. Aussi à leur première sortie le lendemain matin, au lieu de s’en aller flâner par les rues, l’alpenstochà la main pour piétiner dans la poussière et s’arrêter devant un pharmacien après avoir fait une station devant un magasin de nouveautés, proposa-t-elle de monter tout droit dans la montagne par le premier sentier qu’ils trouveraient devant eux.
Adolphe n’avait aucune vocation pour les voyages de découverte, et la perspective de s’en aller au hasard, sans savoir où, n’avait aucun attrait pour lui. À quoi bon prendre la peine de marcher, pour ne rien voir de ce qu’on devait voir ? Élevé dans le respect de la tradition, il considérait les voyages comme une sorte de contrôle, et il tenait à pouvoir contredire ou approuver l’opinion de ses devanciers. De retour à Paris, que dirait-il de Genève et de Lausanne ? De Genève, qu’il n’avait vu que les arbres qui ombragent la statue de J.-J. Rousseau ; de Lausanne, qu’il n’avait aperçu que les tours de sa cathédrale. C’était vraiment peu, et sa mère bien certainement se moquerait de lui. En serait-il de même maintenant pour Montreux et Clarens ? Partiraient-ils sans connaître autre chose que l’hôtel des Alpes ?
Cependant il était si bien sous le charme, qu’il ne fit aucune objection au désir manifesté par Juliette.
Après une heure de montée à peine, ils se trouvèrent dans la région des pâturages et des bois. Plus de vignes, plus de maisons, plus de touristes en fonction, mais des pentes gazonnées d’une herbe fine, çà et là quelques chalets suspendus au flanc de la montagne, et dans les profondeurs des bois la musique des clochettes des vaches ; puis, de temps en temps, quand ils se retournaient, des échappées de vue sur le lac éblouissant de lumières et sur les Alpes de la Savoie.
Et où allons-nous ainsi ? demanda Adolphe, qui se sentait peu rassuré en voyant se dresser devant lui un cirque de montagnes dont les sommets dénudés se découpaient sur le ciel bleu.
Plus loin.
Et après ?
Plus loin encore, toujours plus loin.
Au bout du monde alors, chez les sauvages ?
Peut-être.
Elle marchait avant lui, les cheveux au vent, alerte et souriante. Il la suivit.
Il trouvait, il est vrai, que la montée était bien rapide, et que le soleil aussi qui les frappait dans le dos était brûlant ; mais elle paraissait si joyeuse, qu’il était heureux du bonheur qu’il voyait en elle. Elle courait sur les pentes herbues, elle embrassait le mufle rose des vaches qu’elle caressait ; elle cueillait les fleurs qui émergeaient au-dessus des herbes, et, quand ils traversaient un bois de sapins elle respirait à pleins poumons l’odeur de la résine, que la chaleur du jour rendait plus forte et plus pénétrante. Pour voir ses narines palpiter, pour voir ses yeux s’ouvrir, pour voir sa taille souple se cambrer quand elle sautait un ravin, il l’eût suivie au bout du monde.
Cependant ils n’allèrent point jusque-là.
Après trois heures de marche, tantôt dans des pâturages, tantôt dans des bois couverts, ils arrivèrent sur une sorte de plateau gazonné, au milieu duquel se montraient épars çà et là trois ou quatre chalets ; des petits ruisseaux écumants couraient à travers l’herbe fine et allaient se perdre dans un ravin qu’on entendait mugir au fond d’un lit encaissé. De toutes parts, excepté du côté par où ce ravin descendait, se dressaient de hautes montagnes aux pentes rapides : c’était une oasis de verdure et de fraîcheur perdue au milieu des rochers et des bois, un nid de mousse, une petite Arcadie, d’autant plus riante qu’elle était entourée de montagnes sévères.
Voilà le bout du monde, dit Juliette.
Et voici les sauvages demandés, dit Adolphe en apercevant un pâtre qui surveillait ses vaches.
Si nous le faisions causer, dit Juliette, si nous lui demandions le nom de cet endroit charmant ? Il est beau de découvrir des pays nouveaux, mais il est bon de savoir comment ils se nomment.
Elle s’approcha du vacher qui s’était arrêté et, souriant d’un sourire placide, les regardait monter vers lui sans faire un pas vers eux.
Comment nomme-t-on cet endroit ? demanda Juliette.
Les Avants.
Et cette montagne qui se dresse là derrière, en forme de cône ?
C’est la dent de Jaman.
Et celle-ci sur le côté ?
La dent de Naye.
Et ces chalets sont habités ?
C’est pour être habitées que les maisons sont construites.
Rien n’est plus vrai ; seulement ce que je demandais, c’était si ces chalets étaient habités en ce moment.
Non, ils le sont dans la saison par les propriétaires, qui viennent ici pour les bois ou les pâturages. Et puis il y a celui-là, le dernier là-bas, qu’on a construit et meublé pour le louer à des étrangers ; mais il ne s’en est pas encore présenté. L’endroit est trop triste ; pour s’y plaire, il faut y avoir ses vaches.
Le pâtre s’éloigna pour aller rejoindre ses vaches, et Juliette s’assit sur l’herbe.
Pendant assez longtemps elle resta sans rien dire, regardant les montagnes et regardant les chalets.
La voyant ainsi préoccupée, Adolphe lui demanda ce qui la rendait rêveuse et triste.
Pas triste, dit-elle, mais rêveuse, cela est vrai. Et ma rêverie vient d’une idée qui m’a traversé l’esprit.
Quelle idée ?
Une idée à me faire accuser de folie, si je la disais ; aussi ne la dirai-je point si vous voulez bien ne pas insister.
Mais au contraire il insista.
Eh bien ! dit-elle, asseyez-vous là près de moi et écoutez ; d’ailleurs il est bon de se connaître même par ses côtés fous. Savez-vous à quoi je pensais quand ce berger nous disait que ce chalet avait été construit pour le louer à des étrangers ? C’est que nous étions précisément ces étrangers.
Nous ?
Voilà que vous poussez déjà des cris de surprise. Et cependant quoi de plus charmant que de rester ici ?
Dans ce désert ?
C’est précisément le désert qui me charme.
Et manger et se faire servir ?
Cela n’est que la question secondaire ; partout on trouve à manger et aussi à se faire servir, pourvu qu’on ne soit pas trop difficile.
Mais encore ?
Je n’avais vu qu’une chose : la tranquillité et la solitude à deux. Pourquoi ne pas rester là ?
Et notre voyage ?
Pour qui l’avez-vous entrepris, ce voyage ?
Pour vous, chère Juliette.
Pour mon plaisir, n’est-ce pas ?
Assurément.
Eh bien ! si je vous disais que cette vie sur les grands chemins m’effraye et que ces chambres d’hôtel m’épouvantent ; si je vous disais que je vous en ai voulu, à vous qui connaissiez ces chambres, de m’avoir exposée aux hontes que vous m’expliquiez hier soir ?
Si des trous sont percés dans les cloisons, ce n’est pas ma faute.
Non assurément ; mais ce qui est votre faute,
c’est d’amener votre femme dans une de ces chambres.
Toutes sont pareilles, et dans tous les pays du monde nous aurions pu être exposés aux mêmes plaisanteries.
Vous appelez cela une plaisanterie ?
Alors il ne fallait pas quitter Paris.
Et pourquoi l’avons-nous quitté ? Assurément je vous suis reconnaissante de l’intention que vous avez eue, mais je vous avoue que si j’avais pu prévoir la curiosité qui nous a poursuivis, je vous aurais demandé de renoncer à ce voyage.
Adolphe ne répliqua point, mais son silence parla pour lui.
Vous me trouvez injuste et ingrate, continua Juliette ; il faut donc que je vous dise tout ce que j’ai sur le cœur et pourquoi je voudrais passer le temps de notre voyage ici avec vous. On ne peut pas garder l’impression des lieux où l’on vient à la vie ; selon moi, cela est triste et fâcheux. Mais il y a en nous deux existences : celle qui commence au berceau, dont nous ne pouvons nous rappeler les premiers jours, – et celle qui commence au mariage. Pourquoi ne pas garder pieusement dans notre cœur les premières impressions de celle-là, et pourquoi, si cela est possible, ne pas les placer dans un cadre splendide qui leur donne toute leur valeur ? Ce cadre, il me semble que le voici. Croyez-vous que les souvenirs que nous emporterons des chambres d’hôtel que nous traverserons, vaudront ceux de cette oasis ? Trouverons-nous nulle part cette fraîcheur, cette jeunesse, ce calme et cette sérénité ?
Le chalet était confortablement bâti et convenablement meublé ; tout était neuf et brillant de propreté.
Après l’avoir visité, ils redescendirent à Montreux, où il fut facile de s’entendre avec le propriétaire. À Montreux aussi ils trouvèrent les gens nécessaires à leur service : une femme pour la cuisine et un homme pour aller tous les jours chercher les provisions. La course était longue, mais elle n’était pas dure pour le solide montagnard qu’ils avaient pris, car il était habitué à courir chaque jour les pâturages pour faire la récolte des fromages, qu’il descendait au village sur sa tête – cent livres pesant.
Adolphe écrivit à sa mère de lui adresser ses lettres à Montreux poste restante ; mais il se garda bien de lui dire qu’il était installé dans un chalet au milieu des bois, à douze cents mètres au-dessus du niveau de la mer, loin des hommes et des villes, et qu’il comptait passer là sa lune de miel. Assurément elle l’eût cru fou et elle serait venue le chercher.
IV
S’assurer une lune de miel !
La tâche est délicate ; plus d’une femme intelligente n’a pas su ou n’a pas pu la mener à bien.
Juliette l’avait accomplie.
Il lui restait maintenant à voir quels seraient les résultats de ce tête-à-tête prolongé au milieu d’un pays désert.
Il faut dire cependant que lorsqu’elle fut installée dans le chalet des Avants, elle ne se posa point tout d’abord cette question avec cette netteté, et qu’elle ne se donna point pour but d’étudier son mari.
Heureuse d’avoir échappé aux ennuis d’un voyage dont les premiers pas lui avaient été pénibles, elle goûta le calme qu’elle avait pu s’assurer sans demander davantage.
Et puis ce pays qu’elle ne connaissait point parlait à son âme d’artiste, et lorsque, le matin qui suivit son arrivée au chalet, elle ouvrit sa fenêtre ; lorsqu’elle vit le soleil levant dorer de ses premiers rayons les sommets des montagnes qui l’environnaient, lorsqu’elle entendit dans les pâturages couverts d’un léger brouillard les clochettes des vaches tinter, tandis que çà et là retentissait d’échos en échos l’appel d’un berger, elle fut saisie au cœur par la poésie de cette vie pastorale qui allait être la sienne.
Ces sites sauvages, ces paysages grandioses ou gracieux, il fallait les visiter et les connaître.
Alors commencèrent des promenades et des excursions qui se renouvelèrent chaque jour : elle était vaillante, elle savait marcher, et ce n’était point Adolphe qui eût osé le premier parler de fatigue.
On partait au soleil levant, on allait droit devant soi, où le sentier qu’on rencontrait vous conduisait, et, quand on trouvait une fontaine ombragée par quelques arbres, on déjeunait sur l’herbe d’un morceau de pain et d’une tranche de viande froide, ou bien l’on entrait dans un chalet en bois quand on n’était qu’à une certaine hauteur de la montagne, – en pierres sèches, quand on était sur un sommet plus élevé, – et l’on se faisait traire une jatte de lait par leschaletiers. Puis, quand la chaleur était trop lourde, on dormait à l’abri d’un rocher ou sous l’épais couvert d’un sapin ; et quand le soleil s’abaissait, on redescendait au chalet des Avants pour dîner. Mais souvent la descente était aussi lente que l’avait été la montée, car Juliette s’arrêtait pour voir s’illuminer les sommets neigeux des montagnes, à mesure que le soleil baissait. C’était un spectacle dont elle n’était jamais lasse et qui, chaque jour, la laissait plus enthousiasmée que la veille. Ceux qui ont voyagé dans ces montagnes connaissent seuls la splendeur de ces illuminations, car ce n’est ni avec des mots ni avec des couleurs qu’on peut les peindre, et il faut avoir vu un coucher de soleil sur les neiges éternelles du mont Blanc et des chaînes environnantes pour comprendre la magie de ce phénomène.
Il y avait déjà plus de trois semaines qu’ils habitaient leur chalet, lorsqu’un matin, Juliette, qui d’ordinaire décidait elle-même l’itinéraire ou plus justement la direction de l’itinéraire, proposa de descendre à Montreux.
C’était la première fois qu’elle manifestait le désir de se rapprocher de la vie civilisée ; aussi Adolphe laissa-t-il paraître une certaine surprise.
Ce n’est pas seulement à Montreux que je voudrais aller, dit-elle.
À Paris alors ?
Oh ! non, mais seulement à Vevey pour acheter des crayons.
Dessiner ?
Et même peindre un peu, ah ! un tout petit peu, si tu ne le trouves pas mauvais.
Non seulement je ne trouve pas l’idée mauvaise, mais encore je la trouve excellente, par cette raison que la peinture est un art qui s’exerce avec tranquillité. Certainement la vue dont on jouit du haut de la dent de Jaman est magnifique.
Byron a dit qu’elle était belle comme un songe.
Je suis de l’avis de Byron, et je déclare en prose qu’une vue qui vous permet d’embrasser en même temps d’un côté le lac de Neuchâtel et les montagnes du canton de Fribourg, de l’autre le Léman et les montagnes de la Savoie, est une très belle vue ; seulement il faut y arriver, et la dernière partie de la montée est vraiment roide. En allant, ça a été assez bien ; mais en revenant, j’ai cru que je piquais une tête de dix-neuf cents mètres, c’est désagréable. Je ne m’en suis pas vanté, parce qu’un homme fort ne doit pas se plaindre quand une faible femme sourit ; mais j’avoue aujourd’hui que j’ai eu un moment d’émotion. C’est pour cela que la peinture me plaît. Pendant que la faible femme travaillera, le fort homme pourra se coucher sur le ventre dans l’herbe et la regarder.
Quelle honte !
Je proclame que pour moi, ce qu’il y a de plus beau au monde, c’est les yeux de ma femme.
Parce que la contemplation est, comme la peinture, un art qui s’exerce avec tranquillité, n’est-ce pas ? Eh bien ! monsieur, si vous trouvez la tranquillité du corps, vous ne trouverez pas la tranquillité de l’esprit. À chaque instant, dans nos excursions, je vous ai demandé le nom d’une plante ou l’explication d’un phénomène, et quelquefois vous n’avez pas pu répondre.
Tu peux dire presque toujours.
Il ne faut pas que cela soit. Un homme doit tout savoir.
Pour répondre à sa femme ?
Non, mais pour lui, pour qu’il soit supérieur à sa femme et pour que celle-ci ne demande pas à un autre ce que son mari ne peut pas dire. Aussi, en même temps que j’achèterai chez un marchand de couleurs ce qui m’est nécessaire pour travailler, tu achèteras chez un libraire les livres qui font connaître les Alpes et la Suisse. Nous rapporterons chacun nos acquisitions, et demain, pendant que je ferai un croquis, couché dans l’herbe, sur le ventre ou sur le dos à volonté, tu liras tes livres.
Ce fut une vie nouvelle qui commença pour eux – pour Juliette, pleine d’intérêt, puisqu’elle lui permettait de travailler, – pour Adolphe moins remplie, mais cependant agréable, puisque, pendant toutes les heures de la journée, il restait près de sa femme.
Ils ne faisaient plus de longues courses, mais ils s’en allaient aux alentours de leur chalet, et, pendant que Juliette faisait une étude, il se couchait près d’elle et il lisait.
Mais souvent il fermait son livre, et alors, se posant sur les deux coudes, la tête appuyée dans ses mains, il la regardait.
Eh bien ! disait-elle, où en sommes-nous des phénomènes erratiques ?’
Ce n’est pas aux phénomènes erratiques que je pense, c’est à toi ; je te regarde, je cherche à le connaître et je l’étudie.
Ah ! comme cela, en me regardant tout simplement à l’œil nu ?
Voilà le mal, c’est que je n’ai pas de puissants moyens d’observation pour pénétrer en toi et lire ce qu’il y a dans ton cœur et dans ton esprit, pour savoir ce qu’est la nature.
Alors tu n’es pas encore avancé dans ton étude, et je suis aussi difficile à comprendre que les phénomènes erratiques.
Tu es un phénomène toi-même. Quand je fixe mes yeux sur les liens et te regarde comme je te regardais tout à l’heure, il me semble que je me penche au-dessus d’un de ces étangs qu’on rencontre dans les bois. Le paysage environnant est adorable : de la verdure, du feuillage, des fleurs. L’eau est calme et limpide, elle reflète tout ce qui l’entoure. On tâche de voir ce qu’il y a sous cette nappe tranquille, mais on ne distingue rien : la profondeur est insondable. On recule effrayé.
La comparaison est poétique, mais il faut convenir qu’elle n’est guère aimable : perfide comme l’onde, n’est-ce pas ?
Je ne dis pas cela et je ne le pense pas ; je dis seulement que je suis un mauvais observateur et que je voudrais bien connaître celle que j’aime.
Ils se trouvaient si bien dans leur chalet qu’ils y seraient sans doute restés jusqu’à la saison des neiges, si madame Daliphare n’avait pas rappelé son fils à Paris.
En apprenant qu’ils s’étaient arrêtés dans leur voyage, elle avait écrit à son fils pour lui demander l’explication de cette fantaisie. Adolphe avait répondu que se trouvant bien à Montreux, il y restait. Pendant huit jours, madame Daliphare s’était contentée de cette réponse ; mais, fatiguée d’adresser toujours ses lettres poste restante à Montreux, elle était revenue à la charge.
Pourquoi restaient-ils toujours à la même place ? pourquoi ne voyaient-ils pas des pays nouveaux ? à quoi pouvaient-ils employer leur temps dans un village ?
Peu à peu elle avait compris que ce village se composait de l’unique chalet habité par son fils, et alors elle avait poussé des cris d’indignation..
Étaient-ils fous ? quel plaisir pouvaient-ils trouver à vivre parmi les vaches ?
Puis, comme le délai fixé pour le retour était passé depuis longtemps déjà, elle avait rappelé son fils à Paris.
« Si tu voyageais, lui disait-elle, je ne te parlerais pas de revenir, et si tu avais encore des villes curieuses à visiter, je trouverais tout naturel que tu voulusses les voir avant de rentrer : il faut profiter des dépenses faites. Mais vous restez en place comme des Termes. Autant être à Paris. »
Adolphe ne communiquait point ces lettres à sa femme, car madame Daliphare avait une orthographe fantaisiste qu’elle voulait que son fils fût seul à connaître. Mais s’il ne montrait point les autographes eux-mêmes, il était obligé de dire à peu près ce qu’ils contenaient.
Pendant assez longtemps il ne parla point de ces rappels ; à la fin cependant, il ne lui fut plus possible de les cacher.
Déjà ? dit Juliette.
Il y a trois mois que nous sommes ici.
Je n’ai pas compté.
Il faut bien rentrer à Paris.
Sans doute, il le faut.
Comme tu dis cela ! tu me fais peur. Que crains-tu ?
Tout et rien. Ici j’ai été heureuse, et je ne sais ce que Paris nous réserve : à Paris ce ne sera plus la vie à deux.
Il voulut lui expliquer qu’à Paris rien ne serait changé à leur intimité ; qu’elle ne devait pas s’effrayer d’habiter sous le même toit que madame Daliphare ; que celle-ci serait une mère pour elle et non une belle-mère.
Juliette, sans répliquer, secoua la tête et demanda pour toute grâce de rester encore quelques jours aux Avants, afin de pouvoir faire une étude un peu finie de leur chalet.
Et dès le lendemain elle se mit au travail.
Il lui fallut huit jours pour mener son œuvre à fin ; mais, à mesure qu’elle avançait, elle travaillait avec moins d’activité, comme si elle voulait faire durer le temps.
Adolphe était dans le ravissement.
Personne ne voudra croire que nous avons passé trois mois dans ce désert, dit-il.
Mais personne ne verra ce tableau ; c’est pour nous deux, pour nous seuls que je l’ai peint.
Enfin, un matin de septembre, des chevaux arrivèrent pour les emmener à Montreux.
Donnez-moi les clefs, dit Adolphe quand la porte fut fermée ; nous les remettrons au propriétaire, en lui disant que nous lui rendons son chalet en bon état
Moi je ne l’aurais pas rendu, dit Juliette en regardant tristement les volets clos.
Et qu’en aurais-tu fait ?
Elle se pencha à son oreille :
Je l’aurais brûlé.
V
Pendant que les jeunes mariés étaient en Suisse, madame Daliphare s’occupait de faire faire dans sa maison de Paris les changements nécessaires pour leur aménager un appartement convenable.
Dès le lendemain de leur départ elle avait convoqué son architecte, les entrepreneurs, le tapissier, et elle avait mis tout ce monde à l’œuvre, stipulant dans des marchés signés une prime pour le cas où les travaux seraient terminés avant un délai de deux mois, et un dédit pour le cas où ils ne le seraient qu’après ce délai.
Un moment elle avait hésité sur le plan à adopter pour ces travaux.
Abandonnerait-elle son appartement à ses enfants en prenant pour elle le logement de garçon de son fils ?
Ou bien conserverait-elle les dispositions de son appartement telles qu’elles avaient toujours été ?
C’était ce dernier parti qui l’avait emporté, et elle avait été décidée par cette considération qu’il fallait conserver à son fils un logement, où il fut libre. Sans doute il ne se servirait pas habituellement de ce logement, mais enfin il pouvait se présenter des circonstances où il serait heureux de le trouver, quand ce ne serait que pour recevoir ses amis.
Il est vrai qu’en conservant les anciennes dispositions de son appartement, elle se trouvait habiter avec ses enfants, tandis qu’en prenant le logement de son fils, elle avait un chez soi, mais il ne lui vint même pas à l’idée que ses enfants pouvaient avoir le désir d’être seuls et libres chez eux. En quoi les gênerait-elle ? Sa présence au contraire ne pouvait que leur être avantageuse. Elle surveillerait mieux les domestiques, et Juliette, peu apte à ce rôle de maîtresse de maison, serait assurément bien aise de se débarrasser sur elle des petits soins et des ennuis du ménage. Une artiste ! ce serait un beau gaspillage.
Elle abandonna donc son appartement aux ouvriers, et, pendant les travaux, elle habita le logement de son fils, auquel rien n’était changé.
En deux mois la maison de la rue des VieillesHaudriettes fut complètement transformée : peintures, teintures, tapis, il n’y eut rien qui ne passât par les mains des ouvriers.
Quelques jours avant l’arrivée de ses enfants, madame Daliphare fît écrire deux lignes à madame Nélis pour la prier de venir voir ces transformations, c’est-à-dire pour les approuver.
Mais si la belle-mère qui avait tout ordonné était en disposition de tout admirer, la belle-mère qui n’avait été consultée sur rien était par contre en disposition de tout critiquer.
Cet antagonisme se manifesta dès l’entrée.
J’ai voulu, dit madame Daliphare, que mes enfants eussent un appartement digne de leur jeunesse, et bien que celui-ci fût encore en excellent état...
De quelle époque datait-il ? interrompit madame Nélis.
De mon mariage.
C’est-à-dire de trente ans ?
Sans doute ; mais comme je n’avais alors économisé sur rien, et que j’avais choisi ce que j’avais trouvé de meilleur et de plus cher (je le pouvais puisque je payais tout de ma propre bourse), ce mobilier devait durer cent ans ; cependant je l’ai renouvelé. Voici le vestibule, comment trouvez-vous ce velours d’Utrecht ? Je l’ai acheté directement en fabrique à Amiens.
Ah ! mon Dieu ! s’écria madame Nélis en levant les bras au ciel.
Eh bien, quoi ?
Qu’est-ce que dira ma fille ?
Que voulez-vous qu’elle dise ?
C’est vrai. Elle ne dira rien, elle est trop discrète ; mais elle n’en souffrira pas moins et d’une douleur qui se réveillera chaque jour.
Pouvez-vous vous expliquer ?
Vous le voulez ?
Vous voyez bien que vous m’exaspérez. En quoi ce vestibule vous déplaît-il ? En quoi doit-il faire le malheur de votre fille ? Il n’est pas assez riche ? Si j’avais su que Juliette était habituée au drap d’or, j’en aurais fait tisser une pièce exprès pour elle.
Voilà que vous vous fâchez, et vous avez bien tort. Deux vieilles amies comme nous ne doivent-elles pas se parler franchement ?
Mais c’est là ce que je réclame.
Eh bien ! vous avez recouvert en velours d’Utrecht un meuble en acajou, ce qui est tout simplement une hérésie.
Laissez-moi tranquille avec votre hérésie.
Pour vous, je comprends que ce que vous avez fait là soit sans importance, et vous êtes excusable, puisque vous avez agi sans discernement ; mais pour un artiste, c’est un crime, un véritable crime, et ma fille est une artiste.
Madame Daliphare haussa les épaules et, sans répondre, passa dans la salle à manger, qui, elle aussi, avait été remise à neuf.
Que trouvez-vous encore à blâmer ? demanda-telle.
Mais madame Nélis fut tellement éblouie qu’elle ne trouva pas un mot de critique.
Madame Daliphare avait assurément la plus belle vaisselle d’or et d’argent de tout Paris, car toutes les fois, depuis trente ans, qu’une pièce extraordinaire lui avait été apportée, au lieu de l’envoyer à la fonte elle l’avait soigneusement conservée. Toutes ces pièces, exposées sur des dressoirs, faisaient de la salle à manger, un véritable musée, qui, au point de vue historique aussi bien qu’au point de vue artistique, avait une valeur considérable.
Mais dans le salon, madame Nélis, un moment réduite au silence, reprit ses avantages. Il y avait en effet dans l’ameublement des fautes de goût à faire crier un sauvage.
Ah ! vous avez choisi une étoffe de soie cerise ? dit-elle en se contenant.
Mon fils aime cette étoffe et cette nuance.
C’est fâcheux, car ma fille a la soie en horreur.
J’ai pensé au goût d’Adolphe ; j’espère que Juliette voudra bien lui sacrifier ses préjugés.
Ce n’est pas chez elle affaire de préjugé, mais affaire d’éducation.
Enfin les goûts de mon fils étaient à considérer.
Et ceux de ma fille ?
Mais toutes deux en même temps s’arrêtèrent, car la discussion ainsi commencée pouvait aller trop loin ; elles le sentirent, et d’un commun accord détournèrent le danger. Madame Nélis déclara même la pendule admirable et le piano magnifique.
Malheureusement, dans la chambre à coucher, la guerre recommença, et cette fois les coups partirent si vite qu’il ne fut pas possible de revenir en arrière.
C’est la chambre d’Adolphe ? demanda madame Nélis.
Celle d’Adolphe et celle de Juliette.
Comment ! vous croyez que ma fille partagera la chambre de votre fils ?
Et même son lit.
Ah ! cela, jamais !
Pourquoi se sont-ils mariés alors ?
Est-ce que vous partagiez la chambre de M. Daliphare ?
Moi, c’était bien différent.
En quoi ?
Ne me forcez pas à vous dire que ma situation n’était pas celle de votre fille.
Il y a des choses d’éducation contre lesquelles rien ne prévaut. Dans notre famille, on a toujours eu deux lits.
Dans la mienne, on n’en a jamais eu qu’un.
Vous exceptée.
Sans doute. Mais vous ne voulez pas, je pense, établir de comparaison entre Adolphe et son père.
Est-ce que, vous voulez me dire qu’Adolphe est le fils du Saint-Esprit ? s’écria madame Nélis exaspérée.
Je veux vous dire simplement que j’avais choisi mon mari dans des conditions à peu près semblables à celles où Adolphe a choisi sa femme, et j’ai imposé mes conditions comme mon fils impose les siennes. J’ai écrit à mon fils les dispositions que je prenais ; il ne m’a pas demandé de faire arranger deux chambres, je n’en ai donc fait arranger qu’une. Si votre fille, ne veut pas la partager avec son mari, elle s’en expliquera avec lui ; ce n’est pas mon affaire.