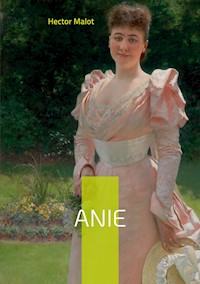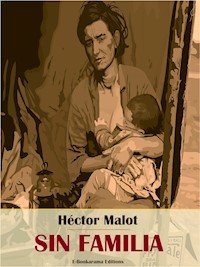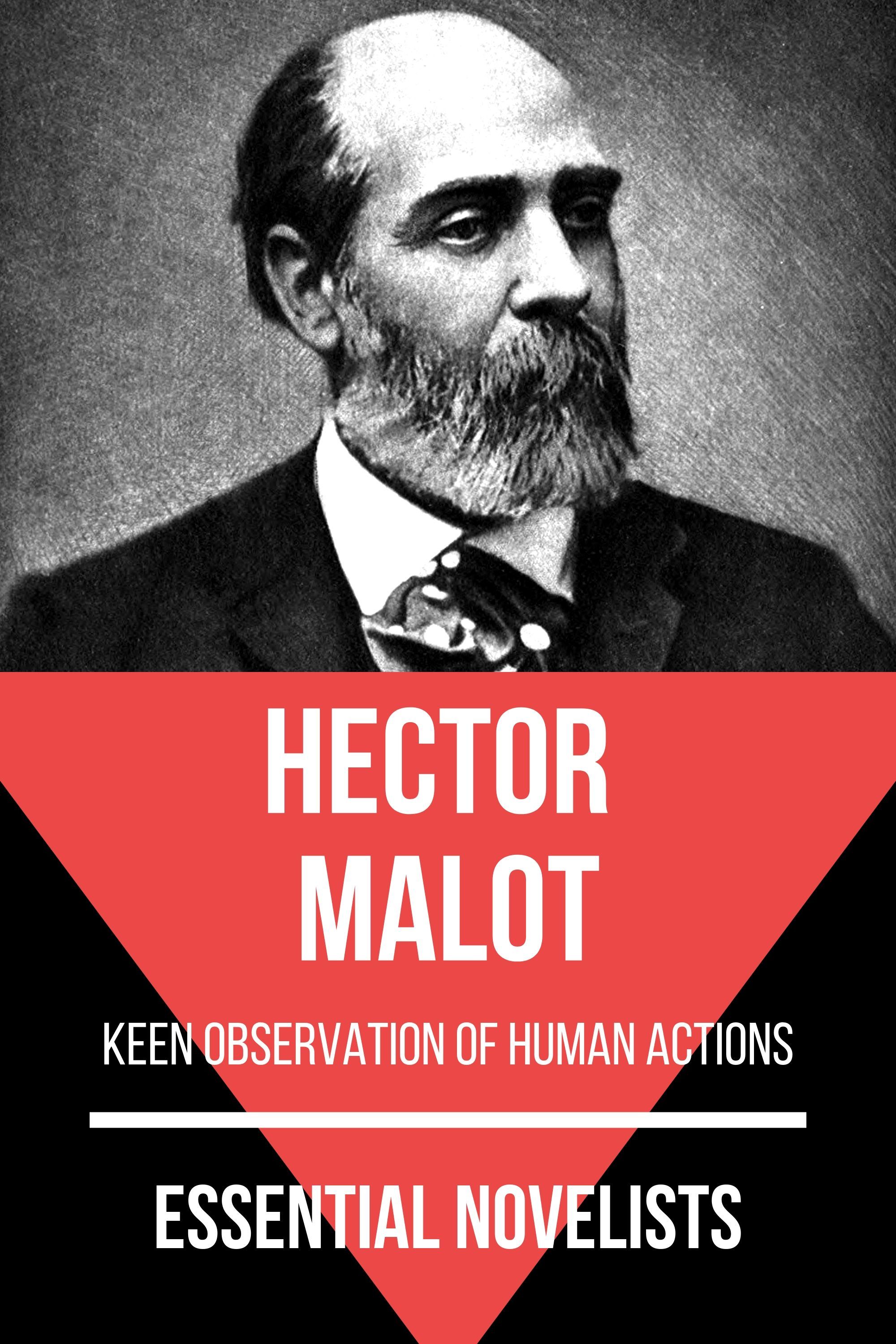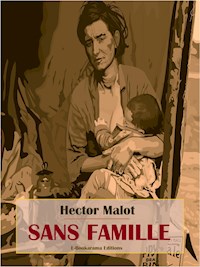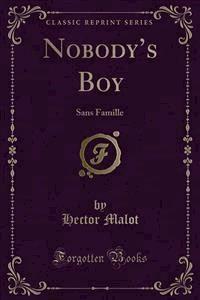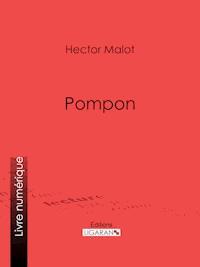2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dans ce roman, Hector Malot aborde le problème de la naissance d'un enfant hors mariage, dans le milieu de la noblesse. Ghislaine, Princesse de Chambrais, est violée et un enfant nait de ce viol.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ghislaine
Pages de titrePremière partieIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXDeuxième partieI - 1II - 1III - 1IV - 1V - 1VI - 1VII - 1VIII - 1IX - 1XTroisième partieI - 2II - 2III - 2IV - 2V - 2VI - 2VII - 2VIII - 2IX - 2X - 1Quatrième partieI - 3II - 3III - 3IV - 3V - 3VI - 3VII - 3VIII - 3IX - 3X - 2XIXIIXIIIXIVXVPage de copyrightHector Malot
Ghislaine
Première partie
I
Une file de voitures rangées devant le double portique de l’ancien hôtel de Brissac, devenu aujourd’hui la mairie du Palais-Bourbon, provoquait la curiosité des passants qui savaient lire les armoiries peintes sur leurs panneaux, ou simplement les couronnes estampées sur le cuivre et l’argent des harnais : – couronne diadémée et sommée du globe crucifère des princes du Saint-Empire, couronne rehaussée de fleurons des ducs, couronne des marquis et couronne des comtes.
– Un grand mariage.
Mais à regarder de près, rien n’annonçait ce grand mariage : ni fleurs dans la cour, ni plantes dans le vestibule, ni tapis dans les escaliers ; comme en temps ordinaire, le va-et-vient continuel des gens qui montaient aux bureaux de l’état-civil ou à la justice de paix, dont c’était le jour de conciliation sur billets d’avertissement et de conseils de famille.
Au haut de l’escalier, dans le grand vestibule du premier étage et dans les étroits corridors du greffe, ceux qui étaient appelés pour les conciliations et pour les conseils de famille attendaient pêle-mêle ; de temps en temps un secrétaire appelait des noms et des gens entraient tandis que d’autres sortaient dans l’escalier à double révolution. C’était un murmure de voix qui continuaient les discussions que la conciliation du juge de paix n’avait pas apaisées.
Le secrétaire cria :
– Les membres du conseil de famille de la princesse de Chambrais sont-ils tous arrivés ?
Alors il se fit un mouvement dans un groupe composé de six hommes, d’une dame et d’une jeune fille qui attendaient dans un coin, et qu’à leur tenue, autant qu’à leur air de n’être pas là, il était impossible de confondre avec les gens de toutes classes qui encombraient la salle.
– Oui, répondit une voix.
– Veuillez entrer.
– Mon oncle, dit la jeune fille en s’adressant à celui qui venait de répondre, lady Cappadoce demande si elle doit nous accompagner.
– Ma foi, je n’en sais rien.
– Puisque c’est le conseil de la famille, dit lady Cappadoce d’un air de regret et avec une intonation bizarre formée de l’accent anglais mêlé à l’accent marseillais, je suppose qu’il est mieux que je reste ici.
– Probablement. Veuillez donc nous attendre. Prends mon bras, mignonne.
Tandis que les membres du conseil de famille suivaient le secrétaire, lady Cappadoce, restée seule debout au milieu de la salle, regardait autour d’elle.
– Si madame veut en user, dit un tonnelier qui causait avec un croque-mort assis à côté de lui sur un banc, on peut lui faire une petite place.
– Merci.
– Où il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir. C’est de bon cœur.
Elle s’éloigna outragée dans sa dignité de lady que cet individu en tablier se permît cette familiarité, suffoquée dans sa pudibonderie anglaise qu’il lui proposât une pareille promiscuité ; et elle se mit à marcher d’un grand pas mécanique, les mains appliquées sur ses hanches plates, les yeux à quinze pas devant elle.
Pendant ce temps le conseil de famille était entré dans le cabinet du juge de paix.
– La ligne paternelle à droite de la cheminée, dit le secrétaire en indiquant des fauteuils, la ligne maternelle à gauche.
Prenant une feuille de papier, il appela à demi-voix :
– Ligne paternelle : M. le comte de Chambrais, oncle et tuteur ; M. le duc de Charmont, cousin ; M. le comte d’Ernauld, cousin. Et mademoiselle ? demanda-t-il en s’arrêtant.
– Mademoiselle Ghislaine de Chambrais, pour l’émancipation de laquelle nous sommes ici, dit M. de Chambrais.
– Très bien.
Puis se tournant vers la gauche, il continua :
– Ligne maternelle : M. le prince de Coye, M. le comte de La Roche-Odon, M. le marquis de Lucilière, amis.
Il vérifia sa liste :
– C’est bien cela. M. le juge de paix est à vous tout de suite.
Assis à son bureau, le juge de paix était pour le moment aux prises avec un boucher, dont le tablier blanc, retroussé dans la ceinture, laissait voir un fusil à aiguiser les couteaux, et avec une petite femme pâle, épuisée manifestement autant par le travail que par la misère.
– Contestez-vous le chiffre de la dette ? demandait le juge de paix à la femme.
– Non, monsieur.
– Alors nous disons dette reconnue, continua le juge de paix en écrivant quelques mots sur un bulletin imprimé. Quand paierez-vous ces vingt-sept francs soixante qui, avec les quatre-vingt-dix centimes pour avertissement, font vingt-huit francs cinquante ?
– Aussitôt que je pourrai, n’ayez crainte, nous sommes assez malheureux de devoir.
– Il faut une date ; quel délai demandez-vous ?
– La fin du mois, dit le boucher, il y a assez longtemps que j’attends.
– Nous voilà dans la morte saison. Mon homme est à l’hôpital, il n’y a que mon garçon et moi pour faire marcher notre boutique de reliure... S’il y avait de l’ouvrage !
– Croyez-vous pouvoir payer cinq francs par mois régulièrement ? demanda le juge de paix.
– Je tâcherai.
– Il faut promettre et tenir votre promesse, ou bien vous serez poursuivie.
– Je tâcherai ; la bonne volonté ne manquera pas.
– C’est entendu, cinq francs par mois, allez.
Le boucher paraissait furieux, et la femme était épouvantée d’avoir à trouver ces cinq francs tous les mois.
Mademoiselle de Chambrais, qui avait suivi cette scène sans en perdre un mot, se leva et se dirigea vers la femme qui sortait :
– Envoyez, demain, à l’hôtel de Chambrais, rue Monsieur, lui dit-elle vivement, on vous donnera une collection de musique à relier.
Et sans attendre une réponse, elle revint prendre sa place.
Libre enfin, le juge de paix s’excusait, en s’adressant à tous les membres du conseil de famille, de les avoir fait attendre.
– C’est sur la demande de M. le comte de Chambrais, dit-il, que vous êtes convoqués pour examiner la question de savoir s’il y a lieu d’émanciper sa pupille, mademoiselle Ghislaine de Chambrais, qui vient d’accomplir ses dix-huit ans, d’hier, si je ne me trompe ?
– Parfaitement, répondit le comte de Chambrais.
Un sourire passa sur le visage de tous les membres du conseil, mais le juge de paix garda sa gravité.
– C’est pour que vous voyiez vous-même que ma nièce est en état d’être émancipée, continua M. de Chambrais, que je l’ai amenée.
– Je ne vois pas que mademoiselle de Chambrais ait l’air d’une émancipée, dit le juge de paix en saluant.
C’était, en effet, une mignonne jeune fille, plutôt petite que grande, au type un peu singulier, en quelque sorte indécis, où se lisait un mélange de races, et dont le charme ne pouvait échapper même au premier coup d’œil. Ses cheveux, que la toque laissait passer en mèches sur le front, derrière en chignon tordu à l’anglaise sur la nuque, étaient d’un noir violent, mais leur ondulation et leurs frisures étaient si souples et si légères que cette chevelure profonde, coiffée à la diable, avait des douceurs veloutées qu’aucune teinte blonde n’aurait pu donner.
Bizarre aussi était le visage fin, enfantin et fier à la fois, à l’ovale allongé, au nez pur, au teint ambré éclairé par d’étranges yeux gris chatoyants, qui éveillaient la curiosité, tant ils étaient peu ceux qu’on pouvait demander à cette figure moitié sévère, moitié mélancolique qui ne riait que par le regard et d’un rire pétillant. Il n’y avait pas besoin de la voir longtemps pour sentir qu’elle était pétrie d’une pâte spéciale et pour se laisser pénétrer par la noblesse qui se dégageait d’elle. Sa bonne grâce, sa simplicité de tenue ne pouvaient avoir d’égales, et dans son costume en mousseline de laine gros bleu à pois blancs, avec son petit paletot de drap mastic démodé dont la modestie voulue montrait un mépris absolu pour la toilette, elle avait un air royal que l’être le plus grossier aurait reconnu, et qui forçait le respect ; et c’était précisément à cet air que le juge de paix avait voulu rendre hommage, en vieux galantin qu’il était.
– Au reste, c’est au conseil de se prononcer, dit-il.
– Nous sommes d’accord sur l’opportunité de cette émancipation, répondit M. de Chambrais.
Les cinq membres du conseil firent un même signe affirmatif.
– Alors, je n’ai qu’à déclarer l’émancipation, continua le juge de paix, et vous, messieurs, il ne vous reste plus qu’à nommer le curateur. Qui choisissez-vous pour curateur ?
Cinq bouches prononcèrent en même temps le même nom :
– Chambrais.
– Comment ! moi ! s’écria le comte, et pourquoi moi, je vous prie, pourquoi pas l’un de vous ?
– Parce que vous êtes l’oncle de Ghislaine.
– Parce que vous êtes son plus proche parent.
– Parce que vous avez été son tuteur.
– Parce que ses intérêts ne peuvent pas avoir un meilleur défenseur que vous.
Ces quatre répliques étaient parties en même temps. Il allait leur répondre, quand le vieux comte de La Roche-Odon, qui n’avait rien dit, plaça aussi son mot :
– Parce que, depuis huit ans, vous avez été le meilleur des tuteurs, parce que vous l’aimez comme une fille, parce qu’elle vous aime comme un père.
M. de Chambrais resta bouche ouverte, et son visage exprima l’émotion en même temps que la contrariété :
– Certainement, dit-il, j’aime Ghislaine, elle le sait, comme je sais qu’elle m’aime ; mais enfin, vous me permettrez bien de m’aimer aussi un peu, moi, et de penser à moi. C’est pour suivre ma fantaisie que je ne me suis pas marié. Quand mon aîné a pris femme, je suis resté auprès de notre mère aveugle, et pendant treize ans elle ne s’est pas un seul jour appuyée sur un autre bras que le mien pour monter à sa chambre. L’année même où nous l’avons perdue, cette enfant – il se tourna vers Ghislaine – est devenue orpheline, et j’ai dû veiller sur elle. Aujourd’hui, la voilà grande et, par le sérieux de l’esprit, la sagesse de la raison, la droiture du cœur, en état de conduire sa vie ; elle a dix huit ans, moi j’en ai cinquante... Il s’arrêta et se reprit – enfin j’en ai plus de cinquante, il me reste peut-être cinq ou six années pour vivre de la vie que j’ai toujours désirée... je vous demande de m’émanciper à mon tour ; il n’en est que temps.
– Je ferai remarquer à ces messieurs, dit le juge de paix, que M. le comte de Chambrais, ayant été tuteur et ayant, en cette qualité, un compte de tutelle à rendre, ne peut assister la mineure émancipée à la reddition de ce compte en qualité de curateur, puisqu’il se contrôlerait ainsi lui-même.
– Vous voyez, messieurs, s’écria M. de Chambrais triomphant.
– Mais, continua le juge de paix, si vous nommez un tuteur ad hoc à l’effet de recevoir le compte de tutelle, vous pouvez, si telle est votre intention, confier la curatelle à M. le comte de Chambrais.
– Vous voyez, s’écrièrent en même temps les cinq membres du conseil de famille.
– Je vois que c’est odieux, que c’est une tyrannie sans nom.
– La mission du curateur ne consiste pas à agir pour le mineur émancipé, dit le juge de paix d’un ton conciliant, mais seulement à l’assister pour la bonne administration de sa fortune et dans quelques autres actes.
– Mais comment voulez-vous que j’assiste utilement ma nièce dans l’administration de sa fortune, quand j’ai si mal administré la mienne ?
– En huit ans vous avez accru d’un quart celle de votre pupille.
Toutes les protestations de M. de Chambrais furent inutiles ; malgré lui et malgré tout, il fut nommé curateur.
Quand on sortit du cabinet du juge de paix, il resta en arrière avec le duc de Charmont.
– Que faites-vous ce soir ? demanda-t-il.
– Nous dînons avec des gueuses au café Anglais, et après nous allons à la première des Bouffes.
– Si Ghislaine ne me retient pas à dîner, j’irai vous rejoindre ; en tout cas, gardez-moi une place dans votre loge.
II
Un haut mur, une grande porte, des branches au-dessus, c’est tout ce qu’on voit de l’hôtel de Chambrais dans la rue Monsieur, où il a son entrée ; mais quand cette porte s’ouvre pour le passage d’une voiture, on l’aperçoit dans sa belle ordonnance, au milieu de pelouses vallonnées qui, entre des murailles garnies de lierres et masquées par des arbres à haute tige, se prolongent jusqu’au boulevard des Invalides. Enveloppée dans les jardins des couvents voisins, il semble que ce soit plutôt une habitation de campagne que de ville, et ses deux étages en pierre jaune, sans aucun ornement, élevés au-dessus d’un perron bas, ses persiennes blanches, son toit d’ardoises à lucarnes toutes simples accentuent encore ce caractère.
Évidemment, quand les Chambrais ont, au dix-huitième siècle, abandonné leur vieil hôtel du quartier du Temple pour faire bâtir celui-là, ils avaient en vue le confortable et l’agrément plus que la richesse de l’architecture ou de la décoration, et leur but a été atteint : il y a de plus belles, de plus somptueuses demeures dans ce quartier, il n’y en a pas de mieux ensoleillée l’hiver et de plus discrètement ombragée l’été, de plus agréable à habiter, avec de la lumière, de l’air, de l’espace, de plus tranquille, où l’on soit mieux chez soi.
Quand Ghislaine et son oncle revinrent de la justice de paix, ils n’entrèrent pas dans l’hôtel.
– Si nous faisions une promenade dans le jardin, proposa M. de Chambrais.
Ghislaine savait ce que cela voulait dire ; c’était le moyen que son oncle employait lorsqu’il voulait l’entretenir en particulier, en se tenant à distance de lady Cappadoce et de ses oreilles toujours aux aguets : le temps était doux, le ciel radieux, le jardin se montrait tout lumineux et tout parfumé des fleurs de mai avec les reflets rouges des rhododendrons épanouis qui éclairaient les murs, les oiseaux chantaient dans les massifs ; ce désir de promenade devait donc paraître tout naturel sans qu’on eût à lui chercher des explications de mystère ou de secret, mais précisément rien ne paraissait naturel à la curiosité de lady Cappadoce, et tout lui était mystères qu’elle voulait pénétrer.
Pourquoi se serait-on caché d’elle ? Ne devait-elle pas connaître tout ce qui touchait son élève ? Si à chaque instant elle affirmait bien haut « qu’elle n’était pas de la famille », en réalité, elle estimait que Ghislaine était sa fille. Ce n’est pas en gouvernante qu’elle l’avait élevée, c’était en mère. Une Cappadoce n’est pas gouvernante. Si le malheur des temps l’avait obligée, à la mort de son mari, officier dans l’armée anglaise, à accepter de diriger l’éducation de cette enfant, elle n’avait pas pour cela cessé d’être une lady, et c’était en lady qu’elle voulait être traitée, le malheur n’avait point abattu sa fierté, au contraire ; les Cappadoce valaient bien les Chambrais sans doute, et même, en remontant dans les âges, il était facile de prouver qu’ils valaient mieux.
Quand elle vit le comte et Ghislaine se diriger vers le jardin, elle fit quelques pas en avant pour se rattacher à eux :
– Que faisons-nous ce soir ? demanda-t-elle, restons-nous à Paris, ou partons-nous pour Chambrais ?
– Mon oncle, c’est à vous que la question s’adresse, dit Ghislaine ; si vous me faites le plaisir de rester à dîner je couche ici, sinon je retourne à Chambrais.
Le comte parut embarrassé. Il y avait tant de tendresse dans l’accent de ces quelques mots, qu’il comprit qu’il allait la peiner s’il n’acceptait pas cette invitation ; mais d’autre part il sentait que ce serait un si cruel désappointement pour lui de ne pas rejoindre le duc de Charmont, qu’il ne savait quel parti prendre.
– C’est que Charmont m’a demandé de dîner avec lui, dit-il enfin.
Le regard que sa nièce attacha sur lui l’arrêta.
– Je ne lui ai pas promis, reprit-il vivement, parce que je pensais bien que tu voudrais me garder ; et cependant il a beaucoup insisté, il s’agit pour lui d’une décision grave à prendre.
– Il faut y aller, mon oncle.
– Si tu le veux...
– Nous partirons pour Chambrais à cinq heures, dit Ghislaine en se tournant vers lady Cappadoce.
– Comme tu dois revenir à Paris très prochainement pour la reddition du compte de tutelle, nous dînerons ensemble ce jour-là, je te le promets.
Satisfait de cet arrangement qui, selon lui, conciliait tout, M. de Chambrais passa son bras sous celui de sa nièce, et l’emmena dans le jardin. Penché vers elle, en lui effleurant les cheveux de sa barbe à la Henri IV qui commençait à grisonner, il avait l’air d’un grand frère qui s’entretient avec sa petite sœur bien plus que d’un tuteur ou d’un oncle. Et en réalité, c’était un frère qu’il avait toujours été pour elle, en frère qu’il l’aimait, en frère qu’il l’avait toujours traitée sans pouvoir jamais s’élever à la dignité d’oncle ou de tuteur. Tuteur, pouvait-on l’être quand pour la jeunesse du corps, de l’esprit et du cœur on n’avait pas trente ans ? Il eût voulu jouer dans la vie les Bartolo, que pour son élégance et sa désinvolture, pour sa souplesse, son entrain, on eût bien plutôt vu en lui Almaviva, un peu marqué peut-être, mais à coup sûr un vainqueur.
– Et maintenant, mignonne, dit-il lorsqu’ils furent à l’abri des oreilles curieuses, que comptes-tu faire ?
– Comment cela, mon oncle ?
– Je veux dire : maintenant que tu es émancipée, comment veux-tu arranger ta vie ?
– Est-ce que cette émancipation m’a métamorphosée d’un coup de baguette magique ?
– Certainement.
– Je suis autre aujourd’hui que je n’étais hier, cet après-midi que je n’étais ce matin ?
– Sans doute.
– Je ne le sens pas du tout, même quand vous me le dites.
– Tu as la volonté, la liberté ; et je te demande comment tu veux en user.
– Mais simplement en continuant la semaine prochaine ce que j’ai fait la semaine dernière : demain, M. Lavalette viendra à Chambrais et me fera une conférence de littérature sur le Chatterton d’Alfred de Vigny ; après-demain, je viendrai à Paris et je travaillerai de une heure à trois, dans l’atelier de M. Casparis, à mon groupe de chiens qui avance ; vendredi, c’est le jour de M. Nicétas ; nous ferons de la musique d’accompagnement.
– C’est le grand jour, celui-là ; tu aimes mieux Mozart qu’Alfred de Vigny, et M. Nicétas que M. Lavalette.
– Je vous assure que M. Lavalette est très intéressant, il sait tout et il vous fait tout comprendre.
– Cependant tu préfères le jour de M. Nicétas.
– Je reconnais que la musique est ma grande joie.
– Pendant que j’ai encore une certaine autorité sur toi...
– Mais vous aurez toujours toute autorité sur moi, mon oncle.
– Enfin, laisse-moi te dire, ma chère enfant, que tu te donnes trop entièrement à la musique. Plusieurs fois, je t’ai adressé des observations à ce sujet. Aujourd’hui, j’y reviens et j’insiste, car tu m’inquiètes.
– Vous n’aimez pas la musique !
– Tu te trompes ; j’aime la musique comme distraction, je ne l’aime pas comme occupation, et ce que je te reproche, c’est de ne pas t’en tenir à la simple distraction. Il en est d’elle comme des parfums ; respirer un parfum par hasard, est agréable ; vivre dans une atmosphère chargée de parfums, est aussi désagréable que dangereux. Tandis que la pratique des autres arts fortifie, celle de la musique poussée à l’excès affaiblit. Quand tu as modelé pendant deux ou trois heures dans l’atelier de Casparis, tu sors de ce travail allègre et vaillante ; quand, pendant deux heures, tu as fait de la musique avec M. Nicétas, tu sors de cette séance les nerfs tendus, l’esprit alangui, le cœur troublé. On dit et l’on répète que la musique est le plus immatériel des arts ; c’est le contraire qui est vrai : il est le plus matériel de tous. Il semble qu’elle agisse à l’égard de certaines parties de notre organisme en frappant dessus, comme les marteaux dans un piano frappent sur les cordes. Nos cordes à nous, ce sont les nerfs. Sous ces vibrations répétées, nos nerfs commencent par se tendre, et quand ils ne cassent pas ils finissent par s’user. De là ces virtuoses dévastés, détraqués, déséquilibrés que je pourrais te nommer, si cela n’était inutile avec les exemples que tu as sous les yeux. Trouves-tu que Nicétas, avec ses mouvements de hanneton épileptique, ses yeux convulsionnés, ses grimaces, soit un être équilibré ? Cependant il est grand, fort, bien bâti, et a vingt-trois ans ; il pourrait passer pour un beau garçon, sans ces tics maladifs. Trouves-tu que son maître Soupert, qui n’est qu’un paquet de nerfs, ne soit pas plus inquiétant encore dans sa maigreur décharnée ?
– Est-ce que vraiment je suis menacée de tout cela ? demanda-t-elle avec un demi-sourire.
– Je parle sérieusement, ma mignonne, et c’est sérieusement que je te demande de comparer Soupert à Casparis, puisque ce sont les seuls artistes que tu connaisses. Vois le statuaire superbe dans sa belle santé physique et morale ; et, d’autre part, vois le musicien maladif et désordonné.
– Est-il donc certain que M. Casparis soit superbe par cela seul qu’il est statuaire, et que M. Soupert soit maladif par cela seul qu’il est musicien ; leur nature n’est-elle pour rien dans leur état ? En tout cas, comme vous n’avez pas à craindre que j’approche jamais du talent de M. Soupert, ni simplement de celui de M. Nicétas, j’échapperai sans doute à la maigreur de l’un comme aux tics épileptiques de l’autre. Je ne suis pas d’ailleurs la musicienne que vous imaginez, il s’en faut de beaucoup. Si j’ai fait trop de musique, c’est que j’étais dans des conditions particulières qui ont peut-être eu plus d’influence sur moi que mes dispositions propres. J’aurais eu des frères, des sœurs, des camarades pour jouer, que j’aurais probablement oublié mon piano bien souvent. Vous savez que mes seules lectures ont été celles que lady Cappadoce permettait, et ce que lady Cappadoce permet n’est pas très étendu. Je n’ai jamais été au théâtre. Dans la musique seule, j’ai eu et j’ai liberté complète. Voilà pourquoi je l’ai aimée ; non seulement pour les distractions présentes, pour les sensations qu’elle me donnait, mais encore pour les ailes qu’elle mettait à mes rêveries... quelquefois lourdes... et tristes.
Il lui prit la main et affectueusement, tendrement, il la lui serra :
– Pauvre enfant ! dit-il.
– Je ne me plains pas, mon oncle, et si j’avais des plaintes à former, je ne les adresserais certainement pas à vous, qui avez toujours été si bon pour moi.
– Ce que tu dis des tristesses de tes années d’enfance, je me le suis dit moi-même bien souvent, mais sans trouver le moyen de les adoucir. C’est le malheur de ta destinée que tu sois restée orpheline si jeune, sans frère, ni sœur, n’ayant pour proche parent qu’un oncle qui ne pouvait être ni un père ni une mère pour toi ! Heureusement ces tristesses vont s’évanouir puisque te voilà au moment de faire ta vie et de trouver dans celle que tu choisiras les affections et les tendresses qui ont manqué à ton enfance.
– Vous voulez me marier ? s’écria-t-elle.
– Non ; je veux que tu te maries toi-même, et pour cela je demande qu’à partir d’aujourd’hui, quand tu mettras comme tu dis des ailes à ta rêverie, ce ne soit pas pour te perdre dans les fantaisies que la musique pouvait suggérer à ton imagination enfantine, mais pour suivre les pensées sérieuses que le mariage fait naître dans l’esprit et le cœur d’une fille de dix-huit ans.
– Vous avez quelqu’un en vue ?
– Oui.
– Quelqu’un qui m’a demandée ?
– Non ; mais quelqu’un qui serait heureux de devenir ton mari, je le sais.
– Qui, mon oncle, qui ?
– Je ne veux pas prononcer de nom ; si je t’en dis un, tu partiras là-dessus, tu n’auras plus ta liberté ; cherche dans notre monde qui tu accepterais pour mari, et aussi qui peut prétendre à ta main ; quelqu’un que tu connais, au moins pour l’avoir vu ; quand tu auras fait cet examen, nous en reparlerons.
– Quel jour ? demain ?
– Non, non, pas demain ?
– Alors, après-demain ?
– Eh bien ! oui, après-demain ! tu viendras pour travailler avec Casparis, je dînerai avec toi, et tu te confesseras. Je suis heureux de voir à ton impatience que tu n’es pas rétive à l’idée de mariage.
III
Malgré le trouble que lui avaient causé les paroles de son oncle, Ghislaine n’oublia pas la femme de la justice de paix ; aussitôt que M. de Chambrais l’eut quittée, elle s’occupa à réunir tout ce qu’elle put trouver de musique non reliée.
Surprise de cet empressement, lady Cappadoce voulut savoir ce qu’elle faisait là, et Ghislaine le lui expliqua.
– Comment ! s’écria le gouvernante, vous allez donner votre musique à relier à des gens qui n’ont pas de travail ; mais s’ils n’ont pas de travail c’est qu’ils sont de mauvais ouvriers, et votre musique sera perdue. Croyez-moi, laissez une aumône si vous tenez à lui faire du bien.
– Elle ne demande pas l’aumône.
– Si elle est réduite à la misère que vous dites, comment voulez-vous qu’elle achète ce qui doit entrer dans ces reliures : la peau, le carton, le papier ?
– Vous avez raison, je vais lui laisser une avance pour qu’elle puisse faire ces achats.
– Et dans la note qu’elle écrivait pour indiquer comment elle voulait que ces reliures fussent faites, elle plia un billet de cent francs.
À cinq heures, un coupé attelé en poste vint se ranger devant le perron, car pour aller à Chambrais, qui se trouve entre Orsay et Montlhéry, ou pour venir de Chambrais à Paris, ce n’était point l’habitude qu’on prit le chemin de fer : quatre postiers étaient attachés à ce service, et en leur laissant un jour de repos sur deux, ils battaient les locomotives de Sceaux – ce qui d’ailleurs n’est pas bien difficile.
Quand lady Cappadoce s’était trouvée exclue du tête-à-tête que M. de Chambrais avait voulu se ménager avec Ghislaine, elle avait compté sur ce voyage pour apprendre ce qui s’était dit dans cette longue promenade autour du jardin. Et ce n’était pas une curiosité vaine qui la poussait, le seul désir de savoir pour savoir, c’était son intérêt.
Maintenant que Ghislaine était émancipée, qu’allait-il se passer ? Était-ce d’un projet de mariage que M. de Chambrais l’avait entretenue ? La question était pour elle capitale. Bien qu’elle montrât une navrante mortification d’en être réduite, elle, une lady, à vivre dans une position subalterne, en réalité, elle tenait à cette position qui n’était pas sans avantages. Et bien qu’elle affectât aussi de n’avoir que du dédain pour la France, le pays, ses mœurs et ses usages, en réalité elle tenait beaucoup à ne pas quitter cette France détestée pour retourner dans son Angleterre adorée. Superbe, l’Angleterre, admirable, incomparable pour tout... mais de loin. En somme, si malheureuse qu’elle fût, elle ne craignait rien tant que d’être obligée, par le mariage de Ghislaine, de renoncer à son malheur et à son humiliation.
À peine le coupé quittant la rue Oudinot roulait-il sur le boulevard des Invalides, qu’elle commença ses questions :
– Cette émancipation va-t-elle changer quelque chose dans nos habitudes ? dit-elle de son ton le plus affable.
– C’est justement ce que mon oncle vient de me demander.
– Et vous lui avez répondu ?
– Qu’étant aujourd’hui ce que j’étais hier, je ferais la semaine prochaine ce que j’avais fait la semaine dernière.
– Il est certain que l’émancipation ne confère pas tout d’un coup des grâces spéciales.
– Je ne sens pas qu’elle m’en ait conféré ; et, si vous le voulez bien, je vais préparer ma leçon pour M. Lavalette, en lisant Chatterton.
Ce que lady Cappadoce voulait, c’était continuer la conversation sur ce sujet, mais déjà Ghislaine avait pris le Théâtre d’Alfred de Vigny dans une poche de la voiture et sa lecture était commencée ; elle dut donc se contenter du peu qu’elle avait obtenu, ce qui d’ailleurs était rassurant : une enfant, qui pendant un certain temps encore ne serait qu’une enfant.
Mais quand elle remarqua les distractions avec lesquelles Ghislaine, ordinairement attentive et appliquée, faisait sa lecture, l’inquiétude prit la place de la confiance ; certainement il s’était dit, entre l’oncle et la nièce, autre chose que ce que Ghislaine lui avait répété, et cette lecture n’était qu’un prétexte pour penser librement à cette autre chose.
À un certain moment, mordue plus fort par la curiosité, elle la questionna de nouveau ; mais cette fois indirectement :
– Il me semble que Chatterton ne vous intéresse guère ?
– Je réfléchis.
– C’est précisément ma remarque.
– Vous m’avez toujours dit qu’il ne fallait pas dévorer ses lectures.
– Encore faut-il les suivre.
– C’est ce que je vais faire.
Elle se plongea dans son livre sans relever les yeux, sinon pour lire, au moins pour échapper à ces interrogations. Elle avait bien l’esprit à la lecture, vraiment ! aux amertumes de Chatterton ou aux gronderies du quaker ! Quel sens pouvaient avoir ces paroles vaines, quand dans ses oreilles et dans son cœur retentissaient encore celles de son oncle ?
Elle n’avait pas attendu le jour de son émancipation pour se dire qu’elle ne trouverait que dans le mariage les affections et les tendresses qui avaient si tristement manqué à sa première jeunesse ; mais les idées qui depuis longtemps flottaient dans son esprit venaient de prendre corps par la forme précise que son oncle leur avait données et elles la jetaient dans un trouble qui l’emportait.
Quel était ce mari ? Réaliserait-il les rêveries et les espérances dont son cœur se nourrissait depuis qu’elle avait commencé à juger la vie ?
Jusqu’à sa dixième année, il n’y avait pas eu d’enfance plus heureuse que la sienne, et les souvenirs qui lui restaient de ce temps étaient tous pleins de joies : un père, une mère qui l’adoraient, et dont l’unique souci semblait être son bonheur ; autour d’elle, une existence de fêtes qui lui avait laissé comme des visions de féeries : au château, dans les allées du parc, les brillantes cavalcades auxquelles elle était mêlée, galopant sur son poney à côté de sa mère ; à l’hôtel de la rue Monsieur, les splendeurs des bals qu’elle entrevoyait avant l’arrivée des invités, et la musique qui, la nuit, la berçait dans son lit, et toujours à Paris, à la campagne, un entourage d’amis, une sorte de cour.
Et tout à coup la nuit s’était faite : plus de père, plus de mère, plus de fêtes, plus d’amis, l’abandon, la solitude, le silence. Le père avait été tué dans un accident de chasse. Huit jours après, la mère était morte d’un accès de fièvre chaude.
Du côté de son père, il lui restait un oncle, le comte de Chambrais, dont on avait fait son tuteur, et de nombreux cousins qui la rattachaient aux grandes familles de l’aristocratie française ; du côté de sa mère, Espagnole de naissance, elle avait des oncles et tantes ; mais, fixés tous en Espagne, ils ne pouvaient guère s’acquitter de leurs devoirs de parenté envers cette petite Française qu’ils connaissaient à peine.
Plus de tendresse, plus de caresses, plus de chaude affection dans la maison déserte : seulement de temps en temps un mot amical, un baiser de son oncle quand il venait la voir au château ou à l’hôtel, et plus souvent à l’hôtel qui était à Paris qu’au château où l’on n’arrivait qu’après un petit voyage. Et toujours la parole grave, le geste solennel, la leçon à propos de tout, de lady Cappadoce, bonne femme dans le cœur, mais dans le caractère, les manières, l’attitude toujours gouvernante, et gouvernante anglaise, froide, impeccable, infatuée de sa naissance, exaspérée de sa pauvreté, et convaincue qu’elle grandissait sa situation par sa dignité.
À dix ans, à onze ans, jusqu’à quatorze ans, Ghislaine avait accepté cette vie monotone, soumise et résignée, sans échappée au dehors, n’imaginant pas dans son impuissance enfantine qu’elle pût être autre. Si enfant qu’elle fût, elle comprenait que c’était par scrupule et pour qu’on ne l’accusât point de s’être débarrassé d’un devoir difficile, que son oncle, au lieu de la mettre au couvent, avait voulu cette éducation. Et quand elle le voyait se faire jeune et affectueux pour lui en adoucir les sévérités ; quand elle voyait lady Cappadoce toujours attentive et toujours appliquée à sa tâche, ne pas dire un mot, ne pas faire une observation qui ne fussent dictés par la justice même, elle sentait qu’elle eût été ingrate de se plaindre. On était pour elle ce que les circonstances permettaient qu’on fût : un oncle n’est pas un père ; une gouvernante n’est pas une mère ; c’était là le malheur, la tristesse de sa situation qu’elle ne pouvait pas leur reprocher.
Mais la floraison de la quinzième année avait suscité en elle des échappées au dehors, qui étaient nées de ses souvenirs mêmes.
C’était en se rappelant les regards émus et les paroles de tendresse que sa mère et son père échangeaient en l’embrassant, qu’elle s’était dit que la morne solitude et les tristesses de son enfance ne se dissiperaient que le jour où elle se marierait. Pourquoi, alors, ne serait-elle pas heureuse comme sa mère l’avait été ? Pourquoi le babil d’un enfant n’amènerait-il pas sur ses lèvres ces sourires qu’elle avait vu le sien provoquer sur celles de sa mère ?
Et de même c’était en se rappelant les illuminations et les fleurs des grands appartements de l’hôtel aujourd’hui toujours fermés ; c’était en retrouvant dans sa mémoire l’aspect superbe de la cour d’honneur du château les jours des grandes chasses, ou celui de la salle de spectacle les soirs où l’on jouait la comédie, qu’elle avait compris que tout cela ressusciterait quand elle se marierait.
Et voilà que le mari qu’elle avait rêvé, sans lui donner un corps, l’être idéal qui flottait indécis dans les féeries de son imagination devenait un personnage réel ; il existait, il la connaissait ; tout au moins il l’avait vue.
Où ?
Elle n’était point de ces petites bourgeoises mondaines qui, à dix-huit ans, ont été partout ; en vraie fille du monde où les traditions sont une religion, elle n’avait été nulle part ! les offices à Saint-François-Xavier, quand parfois elle passait un dimanche à Paris ; quelques rares visites chez des parentes à qui elle avait des devoirs à rendre, en janvier ou à de certains anniversaires ; en mai, des séances d’étude au Salon depuis qu’elle travaillait la sculpture, et c’était tout ; il lui était donc facile de remonter dans ses souvenirs en se demandant où elle avait vu « l’homme de son monde qu’elle accepterait pour mari et qui pouvait prétendre à sa main ».
Évidemment, elle n’avait pas à chercher au Salon. Jamais personne n’y avait fait attention à elle. Tout d’abord, elle en avait été mortifiée, s’imaginant qu’elle valait bien un regard ; mais elle n’avait pas tardé à comprendre que ceux qui ne la connaissaient pas n’allaient pas accorder ce regard à une fille simplement habillée, que pour le costume on pouvait prendre pour une jeune femme de chambre accompagnant sa maîtresse, plutôt que pour une fille de grande maison accompagnée de sa gouvernante.
C’est donc seulement dans des visites qu’elle avait pu se rencontrer avec ce mari, et parmi les jeunes hommes qui semblaient réunir les qualités dont parlait son oncle, elle n’en trouvait qu’un, un seul qui les eût toutes, – celles-là et beaucoup d’autres qu’elle était disposée à lui reconnaître, – le comte d’Unières. En tout elle ne l’avait pas vu trois fois, et ils n’avaient pas échangé dix paroles ; mais certainement il était le seul qui fût l’incarnation vivante de l’être idéal dont elle avait si souvent rêvé.
Pourquoi ? En quoi ? Elle eût été bien embarrassée de le dire, ne sachant rien ou presque rien de lui, mais enfin elle sentait qu’il en était ainsi.
IV
C’était une règle établie que Ghislaine se coucha tous les soirs à neuf heures et demie. Mais ce jour-là, si elle entra dans sa chambre à l’heure réglementaire, ce ne fut pas pour se mettre au lit. Elle était trop agitée pour penser à dormir, et après avoir fait le voyage de Paris à Chambrais sous les regards curieux de lady Cappadoce qui ne la quittaient pas, elle avait besoin d’être libre pour réfléchir : sa porte close, elle l’était.
Jusqu’à quinze ans, elle avait habité sa chambre d’enfant, à côté de sa gouvernante, au premier étage. Mais alors son oncle avait voulu qu’elle prit l’appartement de sa mère, qui se composait de quatre pièces au rez-de-chaussée, dans l’aile droite du château : un petit salon, une chambre à coucher qui était immense avec six fenêtres, deux sur la cour d’honneur, deux sur l’avant-cour et deux sur les jardins ; un vaste cabinet de toilette avec salle de bain, et un autre cabinet où couchait une femme de chambre.
Lady Cappadoce s’était opposée à ce changement qui lui semblait amoindrir son autorité ; mais c’était justement en vue de cet affaiblissement d’autorité que M. de Chambrais avait imposé sa volonté. Ne fallait-il pas préparer l’enfant à l’émancipation ? Pour cela le mieux était de l’habituer à une certaine liberté. Chez elle, dans l’appartement qu’avaient toujours habité les princesses de Chambrais depuis deux cents ans, Ghislaine n’était plus une petite fille.
Une fois dans sa chambre, Ghislaine commença par éteindre sa lampe, puis ouvrant une des fenêtres qui donnent sur les jardins, elle resta à rêver en laissant sa pensée se perdre dans les profondeurs du parc qu’éclairait la pleine lune.
Respectueux de la tradition, les princes de Chambrais n’avaient apporté aucun changement aux dispositions primitives de leur château et de leur parc : tels ils les avaient reçus de leurs pères, tels il les avaient conservés. Chaque fois que les dégradations du temps l’avaient exigé, ils avaient fait réparer le château, mais sans jamais accepter des restaurations plus ou moins savantes qui auraient altéré son caractère. De même, pour le mobilier, ils avaient changé les étoffes toutes les fois qu’elles s’étaient trouvées usées, mais toujours en respectant l’harmonie de l’ensemble : ainsi, le meuble de la chambre de Ghislaine, qui dans son neuf, sous Louis XIV, était en velours de Gênes, avait été recouvert de velours à parterre sous Louis XVI et de nouveau en velours de Gênes lorsque plus tard celui-ci avait repris son ancien nom.
Dessinés par Le Nôtre, les jardins et le parc qui leur faisait suite n’avaient jamais subi les embellissements des paysagistes, et tandis qu’on voyait à Versailles le bassin de l’île d’Amour devenir le jardin du Roi, aux Tuileries les vieux parterres se moderniser, Chambrais restait ce qu’il avait toujours été avec ses avenues droites, ses arabesques de gazon et de buis, ses charmilles en portiques, ses ifs et ses cyprès taillés, ses pièces d’eau, ses bassins, ses escaliers, ses terrasses, ses balustres, ses vases de marbre et ses statues.
Bien souvent depuis trois ans, en entrant dans sa chambre, elle était ainsi venue s’asseoir à cette place. Certaine de n’être pas surprise par lady Cappadoce qui, habitant au-dessus d’elle, ne voyait pas cette fenêtre, elle pouvait rester là aussi longtemps qu’elle voulait. C’étaient les seuls moments de la journée où elle eût sa liberté d’esprit et ne fut pas exposée à entendre sa gouvernante, toujours aux aguets, lui dire de sa voix des rappels à l’ordre : « À quoi pensez-vous donc, mon enfant ? Ne vous abandonnez pas aux fantaisies de la rêverie, n’est-ce pas ? »
Quand on a sœurs, amis, camarades, confidents, on peut n’être pas bavard avec soi-même ; mais des confidents elle n’en avait pas d’autres que cette partie du jardin et du parc que de cette fenêtre son regard embrassait. Sans doute, de dedans son lit, elle eût pu bien tranquillement se confesser à quelque coin de sa chambre ou à quelque meuble, mais ils n’eussent été que de muets confesseurs, tandis que le jardin et le parc étaient des êtres vivants qui lui parlaient. Que la neige couvrit la terre de son drap blanc, qu’au contraire le parfum des orangers passât dans l’air tiède, pourvu que la lune brillât, c’étaient de longues conversations qu’elle engageait avec ces arbres et ces statues : elle leur disait ce qu’elle avait dans le cœur ou dans l’esprit, et ils lui répondaient ; et toujours elle les trouvait en accord avec ses sentiments : triste, ils étaient tristes aussi : « Tu te plains d’être abandonnée ; mais nous ? Tu te plains de ta solitude ; mais la nôtre ? Tu penses mélancoliquement au présent et à l’avenir en te rappelant le passé ; et nous ? »
Mais, ce soir-là, ce ne fut pas par des plaintes que ses confidents lui répondirent. Comme ils s’étaient associés à ses tristesses, ils s’associèrent à ses espérances : on allait donc revoir les fêtes d’autrefois ; les promenades des amis dans les allées ; les danses dans les charmilles illuminées ; les joyeuses cavalcades qui traverseraient le parc pour gagner le rendez-vous de chasse dans la forêt.
L’entretien se prolongea, et la nuit était si douce, éclairée par la pleine lune de mai, parfumée par les senteurs des roses et des chèvrefeuilles, qu’il était tard lorsqu’elle se décida à fermer doucement sa fenêtre et se mettre au lit. Mais le sommeil ne vint pas tout de suite, et quand à la fin elle s’endormit, ce fut pour continuer son rêve de la soirée.
Le temps avait marché : on célébrait son mariage avec le comte d’Unières, dans l’église Saint-François Xavier ; elle avait la toilette ordinaire des mariées, la robe de satin blanc et le voile en point d’Alençon. Mais le comte était en prince Charmant, celui de la Belle au Bois dormant, tel qu’elle l’avait vu dans les dessins de Doré : justaucorps de satin rose, toque à plumes, épée ; en même temps, par un dédoublement de personnalité tout naturel dans un songe, elle assistait au baptême de son premier né.
Ce n’était point l’habitude de Ghislaine d’être distraite pendant ses leçons ; mais le lendemain, quand M. Lavalette commença son explication de Chatterton, elle montra une inattention qui frappa lady Cappadoce : évidemment, il se passait quelque chose d’extraordinaire.
Quand, la leçon finie, M. Lavalette se retira, la gouvernante l’accompagna jusque dans la cour où attendait la voiture qui devait le reconduire à la station.
– Je suppose, dit-elle en marchant près de lui, que vous avez remarqué le trouble de votre élève ?
– Mon Dieu non, répondit le professeur qui n’était pas homme à remarquer quoi que ce fût quand il s’écoutait parler.
– C’est à peine si elle vous a entendu.
– Vraiment ?
– Son esprit était ailleurs, et il n’y a rien d’étonnant à cela avec un pareil sujet.
– Mais il est anglais, ce sujet.
– Non, monsieur ; dites que les personnages ont des noms anglais, je vous l’accorde, mais pour les sentiments, les idées, les mœurs, les actions, ces gens-là sont des Français, et voilà le mal, le danger : croyez-vous qu’un pareil sujet, traité comme il l’est, ne soit pas de nature à éveiller les idées d’une jeune fille ?
– Et comment voulez-vous que j’enseigne notre littérature contemporaine sans parler de ses œuvres typiques ?
– Eh bien ! monsieur, ne l’enseignez pas ; tenez-vous en à des modèles plus anciens ; pour moi, j’ai appris le français dans les Mémoires de Joinville, et je m’en suis bien trouvée.
– C’est un point de vue, dit le professeur, qui ne voulait pas engager une discussion inutile, je le soumettrai à M. le comte de Chambrais.
– Alors, je l’en entretiendrai moi-même demain, répliqua lady Cappadoce qui n’avait jamais admis qu’on lui répondit ironiquement.
Mais le lendemain elle ne put pas réaliser ce dessein, car lorsque M. de Chambrais arriva, il emmena Ghislaine dans le jardin comme il l’avait fait le jour de l’émancipation, et elle en fut réduite à les observer de derrière une persienne pour tâcher de comprendre à leur pantomime ce qu’ils se disaient ; malheureusement, elle était si discrète, cette pantomime, qu’elle ne laissait rien deviner : la pluie, le beau temps, un mariage, une affaire d’intérêts, il pouvait être aussi bien question de ceci que de cela.
– Eh bien ! mon enfant, as-tu pensé à ce que je t’ai dit avant-hier, avait commencé M. de Chambrais lorsqu’ils avaient été à une certaine distance de la maison ?
– Oh ! mon oncle, pouvez-vous le demander !
– Et tu as trouvé ?
– Comment voulez-vous que je sache ?
– En me disant le nom ou les noms qui te sont venus à l’esprit.
– Mais je vous assure que cela m’est tout à fait difficile ; je n’ose pas.
– Pourquoi ? Nos sentiments ne se décident-ils pas le plus souvent en vertu de certaines affinités mystérieuses dans lesquelles notre volonté ne joue aucun rôle ? Ce que je te demande, c’est uniquement si parmi les jeunes gens que tu as vus et qui peuvent être des maris pour toi, il en est un, ou plusieurs, pour qui tu te sentes de la sympathie. Cela, rien de plus.
– Il y en a un qu’une jeune fille dans ma position pourrait, il me semble, accepter pour mari.
– Un seul ?
– J’ai vu si peu de monde !
– C’est vrai. Eh bien ! quel est ce mari possible ?
Elle hésita un moment, détournant la tête pour cacher sa confusion, car il lui semblait que c’était là un aveu.
Son oncle lui prit le bras et, le passant sous le sien, il continua d’un ton tout plein d’une tendre affection :
– Crois-tu que je ne t’aime pas assez pour mériter d’être ton confident ?
– Ce n’est pas du confident que j’ai peur, c’est de la confidence. Mais j’ai tort, je le sais, et ne veux pas plus longtemps me défendre sottement : j’ai pensé à M. d’Unières.
Il poussa une exclamation de joie.
– Eh bien ! ma mignonne, c’est précisément de d’Unières qu’il s’agit. Tu vois maintenant combien j’ai eu raison de t’imposer cette épreuve... un peu aventureuse, j’en conviens. Elle est décisive, et me prouve que nous pouvons nous engager dans ce mariage avec la certitude qu’il sera heureux. Vous vous êtes vus quatre ou cinq fois...
– Trois.
– C’est encore mieux ; les affinités dont je parlais se manifestent plus franchement ; sans vous connaître, vous avez été l’un à l’autre attirés par une sympathie qui ne demande qu’à devenir un sentiment plus tendre, et qui le deviendra. Tu m’aurais demandé un mari que je ne t’en aurais pas choisi un autre que d’Unières ; tu as fait ce choix toi-même, c’est beaucoup mieux. De tous les jeunes gens que j’ai observés en pensant que j’aurais un jour la responsabilité de ton mariage, je n’en connais aucun qui soit comme lui digne de toi. Sa maison est ancienne ; si sa fortune n’est pas l’égale de la tienne, elle est cependant suffisante ; enfin c’est un homme d’intelligence supérieure et d’esprit sérieux. Au lieu de perdre sa jeunesse dans les frivolités à la mode, il a travaillé ; il a fait de bonnes études en droit ; il a voyagé, en séjournant dans les pays étrangers où il y a à apprendre, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, et avec le don de la parole qui est naturel chez lui, on peut être certain que, quand il entrera à la Chambre, il sera un des meilleurs députés de notre parti.
– Quel âge a-t-il donc ?
– Il aura juste vingt-cinq ans à son élection. C’est pour la préparer qu’il est en ce moment dans son département. Il en reviendra dans six semaines. Et alors nous déciderons le mariage. Tu seras comtesse d’Unières, ma mignonne ; et comme tu apporteras à ton mari la Grandesse d’Espagne, il pourra timbrer ses armes de la couronne ducale.
V
Si lady Cappadoce ne supportait que difficilement et à son corps défendant les leçons de littérature française contemporaine, par contre elle était passionnée pour celles de musique ; que cette musique fût allemande, italienne ou française, ancienne ou nouvelle, peu importait, pour elle il n’y avait ni nationalité, ni âge. Tout à craindre de Lamartine, Hugo, Musset, Balzac, qui ne sont, comme chacun le sait, que des corrupteurs. Rien à redouter de Beethoven, Rossini, Verdi, qui sont des charmeurs. Infâme le rapt de la fille de Triboulet par François Ier ; innocent, celui de la fille de Rigoletto par le duc de Mantoue.
Pour elle, il en était des professeurs comme de leur science ou de leur art ; c’était ce qu’ils enseignaient qui les faisait prendre en grippe ou en tendresse et qui leur donnait certaines qualités ou certains défauts : M. Lavalette, le professeur de littérature française, ne pouvait être qu’un sacripant, et Nicétas, le professeur d’accompagnement, qu’un charmant jeune homme. À la vérité, on lui avait dit et répété sur tous les tons que M. Lavalette était un critique de grand talent, un esprit distingué, une conscience droite, en tout le plus honnête homme du monde, mais son antipathie ne pouvait pas admettre cela : on ne savait pas, on se trompait. Au contraire, elle était disposée à voir un ange dans Nicétas : en pouvait-il être autrement avec l’âme et la verve qu’il mettait dans son exécution ?
Le supplice qu’elle éprouvait à écouter les leçons de l’un toujours trop longues, se changeait en ravissement à celles de l’autre toujours trop courtes. Installée dans un fauteuil vis-à-vis de Nicétas, elle ne le quittait pas des yeux, et tant que durait le morceau qu’il exécutait, elle restait plongée dans sa béatitude, dodelinant de la tête, battant la mesure avec ses deux pieds, et laissant de temps en temps échapper de petits cris que l’excès du plaisir lui arrachait.
Avec M. Lavalette, elle veillait de près à ce que l’heure de la leçon ne fût pas dépassée, et s’il se laissaient entraîner à des développements qui l’intéressait lui-même, ou s’il s’oubliait, elle avait une façon de tirer sa montre qui lui coupait net la parole ; mais avec Nicétas, elle n’avait jamais eu de montre, et tant qu’il voulait bien jouer, elle écoutait : un morceau de musique ne s’interrompt pas comme une scène de comédie ou comme une pièce de vers ; on va jusqu’au bout. Encore avait-elle d’ingénieuses ressources pour allonger la séance et même quelquefois pour la doubler.
Tout à coup, retrouvant sa montre oubliée, elle s’apercevait qu’il était trop tard pour que Nicétas pût prendre le train ; il partirait par le suivant. Ou bien il pleuvait trop ; ou bien il faisait trop chaud, ou bien trop froid : et, passant par dessus les règles de l’étiquette et des convenances, qui pourtant lui étaient si chères, elle le gardait à dîner au château. Que faire en attendant l’heure du dîner ? De la musique. Et comme il eût été indiscret de continuer le travail de la leçon, ce qui eût ressemblé à une sorte d’exploitation, elle demandait les morceaux qui lui plaisaient.
Aucun autre professeur n’eût été honoré par elle d’une pareille faveur, et le soleil eût pu dévorer la plaine, le verglas eût pu rendre la route impraticable sans qu’elle pensât à les retenir, mais Nicétas n’était pas un professeur comme les autres : d’abord il était musicien, et ce titre seul suffisait pour justifier toutes les faiblesses qui pour lui n’en étaient pas ; et puis il y avait dans sa vie, sa naissance, ses habitudes et même dans son attitude des côtés mystérieux dont on parlait tout bas, qui plaisaient à l’imagination romanesque et chevaleresque de lady Cappadoce.
Jusqu’à l’année précédente, le maître de musique de Ghislaine avait été le compositeur Soupert, qu’on avait choisi autant pour son nom que parce que c’était un voisin de campagne : habitant Palaiseau, il lui serait facile de venir à Chambrais, sans grand dérangement et sans perte de temps. Mais si Soupert était un musicien de talent, par contre c’était bien pour la régularité le plus détestable professeur qu’on pût trouver : il n’y avait pas de meilleures leçons que les siennes ; seulement, il fallait qu’il les donnât et surtout qu’il fût en état de les donner, ce qui n’arrivait que rarement.
Après une période d’éclat qui avait duré une vingtaine d’années, Soupert était redevenu dans sa vieillesse le bohème qu’il avait été dans sa jeunesse : rôdeur de brasserie de dix-huit à trente ans ; habitué des salons où il promenait de trente à cinquante une fille de grande naissance qu’il avait épousée ; à soixante, il vivait dans une masure du plateau de Palaiseau avec une blanchisseuse dont il avait fait sa seconde femme, sans avoir nettement conscience de la distance qui séparait celle-ci de celle-là.
Quand il avait été question de le donner pour professeur à Ghislaine, c’était à l’auteur du Croisé et des Abencerrages que M. de Chambrais avait pensé et non au vieux bohème de Palaiseau : de l’auteur du Croisé il se rappelait les succès au temps où il l’avait rencontré dans le monde, la réputation, le mariage extraordinaire ; du bohème, il ne savait rien, si ce n’est qu’il habitait à une assez courte distance de Chambrais pour qu’on eût l’idée de s’adresser à lui, plutôt qu’à un musicien qui viendrait de Paris.