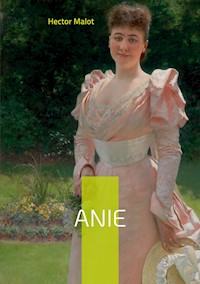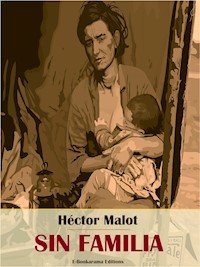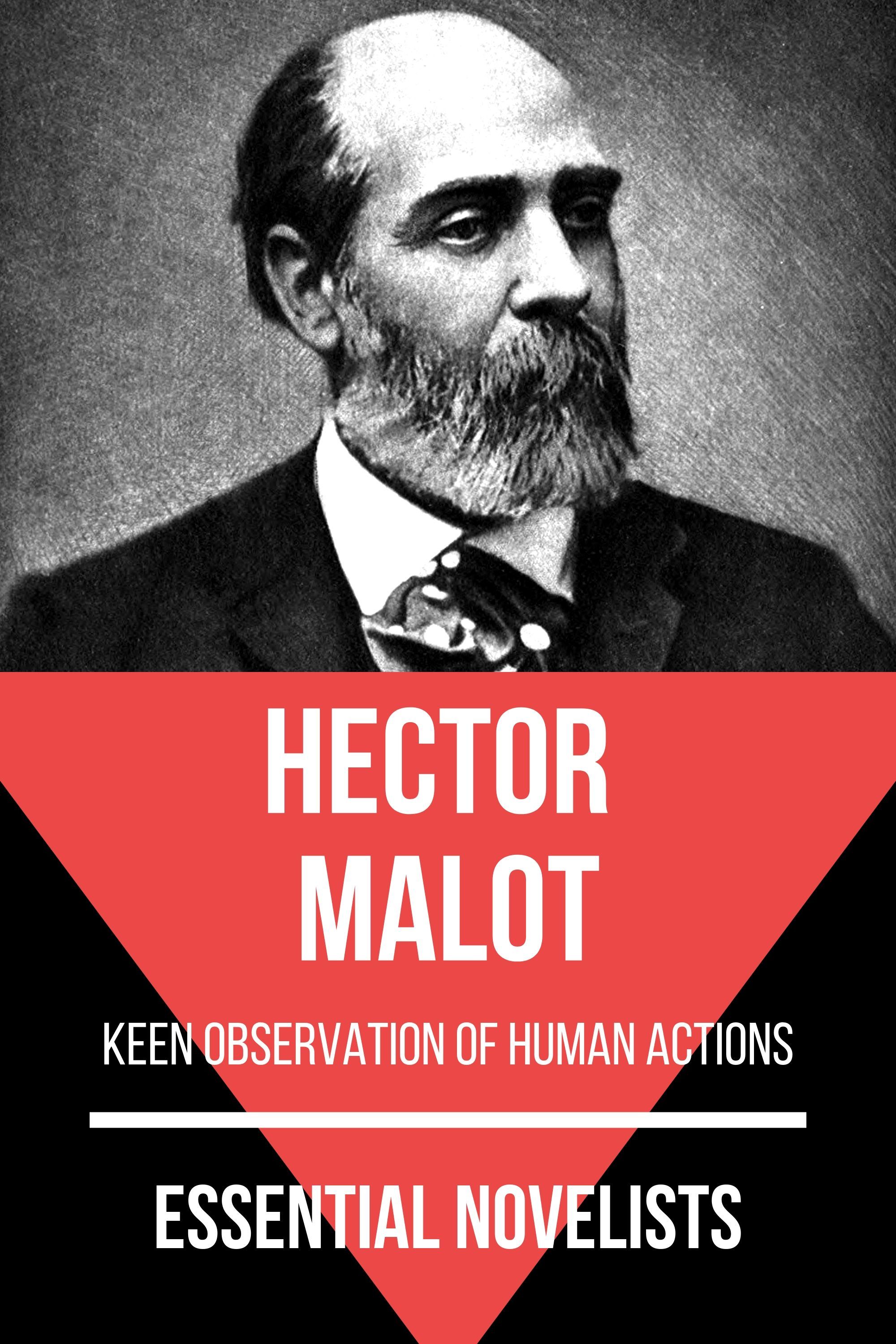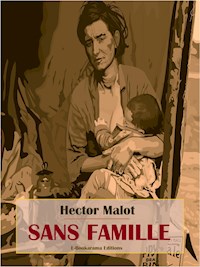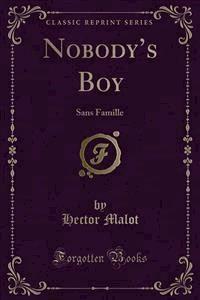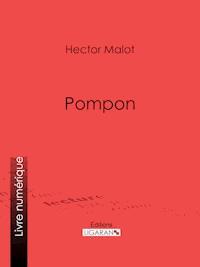Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
"""Sans famille"" est un chef-d'œuvre intemporel de la littérature française écrit par Hector Malot. Ce roman captivant nous plonge dans l'histoire émouvante de Rémi, un jeune garçon abandonné à l'âge de huit ans. Livré à lui-même, Rémi traverse la France en quête d'un foyer, d'une famille qui l'aimera et le protégera. Au fil de ses aventures, il rencontre des personnages hauts en couleur, certains bienveillants, d'autres cruels, mais tous contribuant à forger sa personnalité et à lui enseigner des leçons de vie inestimables. À travers les yeux innocents de Rémi, Malot explore les thèmes universels de l'amour, de l'amitié, de la loyauté et de la recherche d'identité. ""Sans famille"" est un récit poignant qui nous transporte dans un voyage émotionnel, nous faisant réfléchir sur la valeur de la famille et de l'appartenance. Un classique indémodable qui continue de toucher les cœurs de lecteurs de tous âges.
Extrait : ""En avant ! Le monde était ouvert devant moi, et je pouvais tourner mes pas du côté du nord ou du sud, de l'ouest ou de l'est, selon mon caprice. Je n'étais qu'un enfant, et j'étais mon maître !"""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En avant !
Le monde était ouvert devant moi, et je pouvais tourner mes pas du côté du nord ou du sud, de l’ouest ou de l’est, selon mon caprice.
Je n’étais qu’un enfant, et j’étais mon maître !
Hélas ! c’était précisément là ce qu’il y avait de triste dans ma position.
Combien d’enfants se disent tout bas : « Ah ! si je pouvais faire ce qui me plaît ; si j’étais libre ; si j’étais mon maître ! » Combien aspirent avec impatience au jour bienheureux où ils auront cette liberté… de faire des sottises !
Moi je me disais : « Ah ! si j’avais quelqu’un pour me conseiller, pour me diriger ! »
C’est qu’entre ces enfants et moi il y avait une différence… terrible.
Si ces enfants font des sottises, ils ont derrière eux quelqu’un pour leur tendre la main quand ils tombent, ou pour les ramasser quand ils sont à terre, tandis que moi, je n’avais personne ; si je tombais, je devais aller jusqu’au bas, et une fois là me ramasser tout seul, si je n’étais pas cassé.
Et j’avais assez d’expérience pour comprendre que je pouvais très bien me casser.
Malgré ma jeunesse, j’avais été assez éprouvé par le malheur pour être plus circonspect et plus prudent que ne le sont ordinairement les enfants de mon âge ; c’était un avantage que j’avais payé cher.
Aussi, avant de me lancer sur la route qui m’était ouverte, je voulus aller voir celui qui, en ces dernières années, avait été un père pour moi ; si la tante Catherine ne m’avait pas pris avec les enfants pour aller lui dire adieu, je pouvais bien, je devais bien tout seul aller l’embrasser.
Il y a des choses tristes en ce monde et dont la vue porte à des réflexions lugubres ; je n’en connais pas de plus laide et de plus triste qu’une porte de prison.
Je m’arrêtai un moment avant d’oser entrer dans la prison de Clichy, comme si j’avais peur qu’on ne m’y gardât et que la porte, cette affreuse porte, refermée sur moi, ne se rouvrît plus.
On me fit entrer dans un parloir où il n’y avait ni grilles ni barreaux, comme je croyais, et bientôt après le père arriva, sans être chargé de chaînes.
« Je t’attendais, mon petit Rémi, me dit-il, et j’ai grondé Catherine de ne pas t’avoir amené avec les enfants. »
Nous étions seuls dans le parloir, assis sur un banc à côté l’un de l’autre, je me jetai dans ses bras.
« Je ne te dirai plus qu’un mot, dit le père : à la garde de Dieu, mon cher garçon ! »
Et tous deux nous restâmes pendant quelques instants silencieux, mais le temps avait marché, et le moment de nous séparer était venu. Tout à coup le père fouilla dans la poche de son gilet et en retira une grosse montre en argent, qui était retenue dans une boutonnière par une petite lanière en cuir.
« Il ne sera pas dit que nous nous serons séparés sans que tu emportes un souvenir de moi. Voici ma montre, je te la donne. Elle n’a pas grande valeur, car tu comprends que si elle en avait, j’aurais été obligé de la vendre. Elle ne marche pas non plus très bien, et elle a besoin de temps en temps d’un bon coup de pouce.
Mais enfin, c’est tout ce que je possède présentement, et c’est pour cela que je te la donne. »
Disant cela, il me la mit dans la main ; puis, comme je voulais me défendre d’accepter un si beau cadeau, il ajouta tristement :
« Tu comprends que je n’ai pas besoin de savoir l’heure ici ; le temps n’est que trop long ; je mourrais à le compter. Adieu, mon petit Rémi ; embrasse-moi encore un coup ; tu es un brave garçon, souviens-toi qu’il faut l’être toujours. »
Et je crois qu’il me prit par la main pour me conduire à la porte de sortie ; mais ce qui se passa dans ce dernier moment, ce qui se dit entre nous, je n’en ai pas gardé souvenir, j’étais trop troublé, trop ému.
Quand je pense à cette séparation, ce que je retrouve dans ma mémoire, c’est le sentiment de stupidité et d’anéantissement qui me prit tout entier quand je fus dans la rue.
Je crois que je restai longtemps, très longtemps dans la rue devant la porte de la prison, sans pouvoir me décider à tourner mes pas à droite ou à gauche, et j’y serais peut-être demeuré jusqu’à la nuit, si ma main n’avait tout à coup, par hasard, rencontré dans ma poche un objet rond et dur.
Machinalement et sans trop savoir ce que je faisais, je le palpai : ma montre !
Capi me regarda, et, comme j’étais trop troublé pour le comprendre, après quelques secondes d’attente il se dressa contre moi et posa sa patte contre ma poche, celle où était ma montre.
Il voulait savoir l’heure « pour la dire à l’honorable société », comme au temps où il travaillait avec Vitalis.
Je la lui montrai ; il la regarda assez longtemps, comme s’il cherchait à se rappeler, puis, se mettant à frétiller de la queue, il aboya douze fois ; il n’avait pas oublié. Ah ! comme nous allions gagner de l’argent avec notre montre ! C’était un tour de plus sur lequel je n’avais pas compté.
Comme tout cela se passait dans la rue vis-à-vis de la porte de la prison, il y avait des gens qui nous regardaient curieusement et même qui s’arrêtaient.
Si j’avais osé, j’aurais donné une représentation tout de suite, mais la peur des sergents de ville m’en empêcha.
D’ailleurs il était midi, c’était le moment de me mettre en route.
« En avant ! »
Je donnai un dernier regard, un dernier adieu à la prison, derrière les murs de laquelle le pauvre père allait rester enfermé, tandis que moi j’irais librement où je voudrais, et nous partîmes.
L’objet qui m’était le plus utile pour mon métier, c’était une carte de France ; je savais qu’on en vendait sur les quais, et j’avais décidé que j’en achèterais une : je me dirigeai donc vers les quais.
Il me fallut longtemps pour trouver une carte, du moins comme j’en voulais une, c’est-à-dire collée sur toile, se pliant et ne coûtant pas plus de vingt sous, ce qui pour moi était une grosse somme ; enfin j’en trouvai une si jaunie que le marchand ne me la fit payer que soixante-quinze centimes.
Maintenant je pouvais sortir de Paris, – ce que je me décidai à faire au plus vite.
J’avais deux routes à prendre : celle de Fontainebleau par la barrière d’Italie, ou bien celle d’Orléans par Montrouge. En somme, l’une m’était tout aussi indifférente que l’autre, et le hasard fit que je choisis celle de Fontainebleau.
Comme je montais la rue Mouffetard dont le nom que je venais de lire sur une plaque bleue m’avait rappelé tout un monde de souvenirs : Garofoli, Mattia, Riccardo, la marmite avec son couvercle fermé au cadenas, le fouet aux lanières de cuir et enfin Vitalis, mon pauvre et bon maître, qui était mort pour ne pas m’avoir loué au padrone de la rue de Lourcine, il me sembla, en arrivant à l’église Saint-Médard, reconnaître dans un enfant appuyé contre le mur de l’église le petit Mattia : c’était bien la même grosse tête, les mêmes yeux mouillés, les mêmes lèvres parlantes, le même air doux et résigné, la même tournure comique ; mais, chose étrange, si c’était lui, il n’avait pas grandi.
Je m’approchai pour le mieux examiner ; il n’y avait pas à en douter, c’était lui ; il me reconnut aussi, car son pâle visage s’éclaira d’un sourire.
« C’est vous, dit-il, qui êtes venu chez Garofoli avec le vieux à barbe blanche avant que j’entre à l’hôpital ?
Ah ! comme j’avais mal à la tête, ce jour-là !
– Et Garofoli est toujours votre maître ? »
Il regarda autour de lui avant de répondre ; alors, baissant la voix :
« Garofoli est en prison ; on l’a arrêté parce qu’il a fait mourir Orlando pour l’avoir trop battu. »
Cela me fit plaisir de savoir Garofoli en prison, et pour la première fois j’eus la pensée que les prisons, qui m’inspiraient tant d’horreur, pouvaient être utiles.
« Et les enfants ? dis-je.
– Ah ! je ne sais pas, je n’étais pas là quand Garofoli a été arrêté. Quand je suis sorti de l’hôpital, Garofoli, voyant que je n’étais pas bon à battre sans que ça me rende malade, a voulu se débarrasser de moi, et il m’a loué pour deux ans, payés d’avance, au cirque Gassot.
Vous connaissez le cirque Gassot ? Non. Eh bien, ce n’est pas un grand, grand cirque, mais c’est pourtant un cirque. Ils avaient besoin d’un enfant pour la dislocation et Garofoli me loua au père Gassot. Je suis resté avec lui jusqu’à lundi dernier, et puis on m’a renvoyé parce que j’ai la tête trop grosse maintenant pour entrer dans la boîte, et aussi trop sensible. Alors je suis venu de Gisors où est le cirque pour rejoindre Garofoli, mais je n’ai trouvé personne, la maison était fermée, et un voisin m’a raconté ce que je viens de vous dire : Garofoli est en prison. Alors je suis venu là, ne sachant où aller, et ne sachant que faire.
– Pourquoi n’êtes-vous pas retourné à Gisors ?
– Parce que le jour où je partais de Gisors pour venir à Paris à pied, le cirque partait pour Rouen ; et comment voulez-vous que j’aille à Rouen ? C’est trop loin, et je n’ai pas d’argent ; je n’ai pas mangé depuis hier midi. »
Je n’étais pas riche, mais je l’étais assez pour ne pas laisser ce pauvre enfant mourir de faim ; comme j’aurais béni celui qui m’aurait tendu un morceau de pain quand j’errais aux environs de Toulouse, affamé comme Mattia l’était en ce moment !
« Restez là », lui dis-je.
Et je courus chez un boulanger dont la boutique faisait le coin de la rue ; bientôt je revins avec une miche de pain que je lui offris ; il se jeta dessus et la dévora.
« Et maintenant, lui dis-je, que voulez-vous faire ?
– Je ne sais pas.
– Il faut faire quelque chose.
– J’allais tâcher de vendre mon violon quand vous m’avez parlé, et je l’aurais déjà vendu, si cela ne me faisait pas chagrin de m’en séparer. Mon violon, c’est ma joie et ma consolation ; quand je suis trop triste, je cherche un endroit où je serai seul, et je joue pour moi ; alors je vois toutes sortes de belles choses dans le ciel ; c’est bien plus beau que dans les rêves, ça se suit.
– Alors pourquoi ne jouez-vous pas du violon dans les rues ?
– J’en ai joué, personne ne m’a donné. »
Je savais ce que c’était que de jouer sans que personne mît la main à la poche.
« Et vous ? demanda Mattia, que faites-vous maintenant ? » Je ne sais quel sentiment de vantardise enfantine m’inspira : « Mais je suis chef de troupe », dis-je.
En réalité cela était vrai puisque j’avais une troupe composée de Capi, mais cette vérité frisait de près la fausseté.
« Oh ! si vous vouliez ? dit Mattia.
– Quoi ?
– M’enrôler dans votre troupe. » Alors la sincérité me revint.
« Mais voilà toute ma troupe, dis-je en montrant Capi.
– Eh bien, qu’importe, nous serons deux. Ah ! je vous en prie, ne m’abandonnez pas ; que voulez-vous que je devienne ? il ne me reste qu’à mourir de faim. »
Mourir de faim ! Tous ceux qui entendent ce cri ne le comprennent pas de la même manière et ne le perçoivent pas à la même place. Moi, ce fut au cœur qu’il me résonna ; je savais ce que c’était que de mourir de faim.
« Venez avec moi, lui dis-je, mais pas comme domestique, comme camarade. »
Et remontant la bretelle de ma harpe sur mon épaule : « En avant ! » lui dis-je.
Au bout d’un quart d’heure, nous sortions de Paris.
Les hâles du mois de mars avaient séché la route, et sur la terre durcie on marchait facilement. L’air était doux, le soleil d’avril brillait dans un ciel bleu sans nuages.
Près de moi, Mattia marchait sans rien dire, réfléchissant sans doute, et moi je ne disais rien non plus pour ne pas le déranger et aussi parce que j’avais moi-même à réfléchir.
Où allions-nous ainsi de ce pas délibéré ?
À vrai dire, je ne le savais pas trop, et même je ne le savais pas du tout. Devant nous.
Mais après ?
J’avais promis à Lise de voir ses frères et Étiennette avant elle ; mais je n’avais pas pris d’engagement à propos de celui que je devais voir le premier :
Benjamin, Alexis ou Étiennette ? Je pouvais commencer par l’un ou par l’autre, à mon choix, c’est-à-dire par les Cévennes, la Charente ou la Picardie.
De ce que j’étais sorti par le sud de Paris, il résultait nécessairement que ce ne serait pas Benjamin qui aurait ma première visite ; mais il me restait le choix entre Alexis et Étiennette.
J’avais eu une raison qui m’avait décidé à me diriger tout d’abord vers le sud et non vers le nord : c’était le désir de voir mère Barberin.
Si depuis longtemps je n’ai pas parlé d’elle, il ne faut pas en conclure que je l’avais oubliée, comme un ingrat.
De même il ne faut pas conclure non plus que j’étais un ingrat, de ce que je ne lui avais pas écrit depuis que j’étais séparé d’elle.
Combien de fois j’avais eu cette pensée de lui écrire pour lui dire : « Je pense à toi et je t’aime toujours de tout mon cœur » ; mais d’une part elle ne savait pas lire, et de l’autre la peur de Barberin, et une peur horrible, m’avait retenu. Si Barberin me retrouvait au moyen de ma lettre, s’il me reprenait ; si de nouveau il me vendait à un autre Vitalis, qui ne serait pas Vitalis ?
Sans doute il avait le droit de faire tout cela. Et à cette pensée j’aimais mieux m’exposer à être accusé d’ingratitude par mère Barberin, plutôt que de courir la chance de retomber sous l’autorité de Barberin, soit qu’il usât de cette autorité pour me vendre, soit qu’il voulût me faire travailler sous ses ordres. J’aurais mieux aimé mourir, – mourir de faim, – plutôt que d’affronter un pareil danger.
Mais, si je n’avais pas osé écrire à mère Barberin, il me semblait qu’étant libre d’aller où je voulais, je pouvais tenter de la voir. Et même, depuis que j’avais engagé Mattia « dans ma troupe », je me disais que cela pouvait être assez facile. J’envoyais Mattia en avant, tandis que je restais prudemment en arrière ; il entrait chez mère Barberin et la faisait causer sous un prétexte quelconque ; si elle était seule, il lui racontait la vérité, venait m’avertir, et je rentrais dans la maison où s’était passée mon enfance pour me jeter dans les bras de ma mère nourrice ; si au contraire Barberin était au pays, Mattia demandait à mère Barberin de se rendre à un endroit désigné, et là, je l’embrassais.
C’était ce plan que je bâtissais tout en marchant, et cela me rendait silencieux, car ce n’était pas trop de toute mon attention, de toute mon application pour examiner une question d’une telle importance.
En effet, je n’avais pas seulement à voir si je pouvais aller embrasser mère Barberin, mais j’avais encore à chercher si, sur notre route, nous trouverions des villes ou des villages dans lesquels nous aurions chance de faire des recettes.
Pour cela le mieux était de consulter ma carte.
Justement, nous étions en ce moment en pleine campagne et nous pouvions très bien faire une halte sur un tas de cailloux, sans craindre d’être dérangés.
« Si vous voulez, dis-je à Mattia, nous allons nous reposer un peu.
– Voulez-vous que nous parlions ?
– Vous avez quelque chose à me dire ?
– Je voudrais vous prier de me dire tu.
– Je veux bien, nous nous dirons tu.
– Vous oui, mais moi non.
– Toi comme moi, je te l’ordonne, et si tu ne m’obéis pas, je tape.
– Bon, tape, mais pas sur la tête. »
Et il se mit à rire d’un bon rire franc et doux en montrant toutes ses dents, dont la blancheur éclatait au milieu de son visage hâlé.
Nous nous étions assis, et dans mon sac j’avais pris ma carte, que j’étalai sur l’herbe. Je fus assez longtemps à m’orienter ; mais, me souvenant de la façon dont s’y prenait Vitalis, je finis par tracer mon itinéraire : Corbeil, Fontainebleau, Montargis, Gien, Bourges, Saint-Amand, Montluçon. Il était donc possible d’aller à Chavanon, et si nous avions un peu de chance, il était possible de ne pas mourir de faim en route.
Comme j’avais débouclé mon sac, l’idée me vint de passer l’inspection de ce qu’il contenait, étant bien aise d’ailleurs de montrer mes richesses à Mattia, et j’étalai tout sur l’herbe.
J’avais trois chemises en toile, trois paires de bas, cinq mouchoirs, le tout en très bon état, et une paire de souliers un peu usés.
Mattia fut ébloui.
« Et toi, qu’as-tu ? lui demandai-je.
– J’ai mon violon, et ce que je porte sur moi. »
Depuis que j’avais repris ma peau de mouton et ma harpe, il y avait une chose qui me gênait beaucoup, – c’était mon pantalon. Il me semblait qu’un artiste ne devait pas porter un pantalon long ; pour paraître en public, il fallait des culottes courtes avec des bas sur lesquels s’entrecroisaient des rubans de couleur. Des pantalons, c’était bon pour un jardinier, mais maintenant j’étais un artiste !…
« Pendant que je vais arranger mon pantalon, dis-je à Mattia, tu devrais bien me montrer comment tu joues du violon.
– Oh ! je veux bien. »
Et prenant son violon il se mit à jouer.
Pendant ce temps, j’enfonçai bravement la pointe de mes ciseaux dans mon pantalon un peu au-dessous du genou et je me mis à couper le drap. Tout d’abord, j’avais écouté Mattia en coupant mon pantalon, mais bientôt je cessai de faire fonctionner mes ciseaux et je fus tout oreilles ; Mattia jouait presque aussi bien que Vitalis.
« Et qui donc t’a appris le violon ? lui dis-je en l’applaudissant.
– Personne, un peu tout le monde, et surtout moi seul en travaillant.
– Et qui t’a enseigné la musique ?
– Je ne la sais pas ; je joue ce que j’ai entendu jouer. »
On n’est pas artiste sans avoir un peu d’amour-propre ; je voulus montrer à Mattia que, moi aussi, j’étais musicien.
Je pris ma harpe et tout de suite, pour frapper un grand coup, je lui chantai ma fameuse chanson :
Fenesta vascia e patrona crudele…
Et alors, comme cela se devait entre artistes, Mattia me paya les compliments que je venais de lui adresser par ses applaudissements ; il avait un grand talent, j’avais un grand talent, nous étions dignes l’un de l’autre.
Mais nous ne pouvions pas rester ainsi à nous féliciter l’un l’autre ; il fallait, après avoir fait de la musique pour nous, pour notre plaisir, en faire pour notre souper et pour notre coucher.
Je bouclai mon sac, et Mattia à son tour le mit sur ses épaules.
En avant sur la route poudreuse ; maintenant il fallait s’arrêter au premier village qui se trouverait sur notre route et donner une représentation : « Débuts de la troupe Rémi. »
Comme nous arrivions à un village qui se trouve après Villejuif, nous préparant à chercher une place convenable pour notre représentation, nous passâmes devant la grande porte d’une ferme, dont la cour était pleine de gens endimanchés, qui portaient tous des bouquets noués avec des flots de rubans et attachés, pour les hommes, à la boutonnière de leur habit, pour les femmes, à leur corsage ; il ne fallait pas être bien habile pour deviner que c’était une noce.
L’idée me vint que ces gens seraient peut-être satisfaits d’avoir des musiciens pour les faire danser, et aussitôt j’entrai dans la cour suivi de Mattia et de Capi ; puis, mon feutre à la main, et avec un grand salut (le salut noble de Vitalis), je fis ma proposition à la première personne que je trouvai sur mon passage.
C’était un gros garçon dont la figure rouge comme brique était encadrée dans un grand col raide qui lui sciait les oreilles ; il avait l’air bon enfant et placide.
Il ne me répondit pas, mais, se tournant tout d’une pièce vers les gens de la noce, car sa redingote en beau drap luisant le gênait évidemment aux entournures, il fourra deux de ses doigts dans sa bouche et tira de cet instrument un si formidable coup de sifflet, que Capi en fut effrayé. « Ohé ! les autres, cria-t-il, quoi que vous pensez d’une petite air de musique ? v’là des artistes qui nous arrivent.
– Oui, oui, la musique ! la musique ! crièrent des voix d’hommes et de femmes.
– En place pour le quadrille ! »
Et, en quelques minutes, les groupes de danseurs se formèrent au milieu de la cour : ce qui fit fuir les volailles épouvantées.
« As-tu joué des quadrilles ? demandai-je à Mattia en italien et à voix basse, car j’étais assez inquiet.
– Oui. »
Et il m’en indiqua un sur son violon ; le hasard permit que je le connusse. Nous étions sauvés.
On avait sorti une charrette de dessous un hangar ; on la posa sur ses chambrières, et on nous fit monter dedans.
Bien que nous n’eussions jamais joué ensemble, Mattia et moi, nous ne nous tirâmes pas trop mal de notre quadrille. Il est vrai que nous jouions pour des oreilles qui n’étaient heureusement ni délicates, ni difficiles.
« Un de vous sait-il jouer du cornet à piston ? nous demanda le gros rougeaud.
– Oui, moi, dit Mattia, mais je n’en ai pas.
– Je vais aller vous en chercher un, parce que le violon, c’est joli, mais c’est fadasse.
– Tu joues donc aussi du cornet à piston ? demandai-je à Mattia en parlant toujours italien.
– Et de la trompette à coulisse et de la flûte, et de tout ce qui se joue. » Décidément il était précieux, Mattia.
Bientôt le cornet à piston fut apporté, et nous recommençâmes à jouer des quadrilles, des polkas, des valses, surtout des quadrilles.
Nous jouâmes ainsi jusqu’à la nuit sans que les danseurs nous laissassent respirer. Cela n’était pas bien grave pour moi, mais cela l’était beaucoup plus pour Mattia, chargé de la partie pénible, et fatigué d’ailleurs par son voyage et par les privations. Je le voyais de temps en temps pâlir comme s’il allait se trouver mal ; cependant il jouait toujours, soufflant tant qu’il pouvait dans son embouchure. Heureusement je ne fus pas seul à m’apercevoir de sa pâleur, la mariée la remarqua aussi.
« Assez, dit-elle, le petit n’en peut plus ; maintenant la main à la bourse pour les musiciens.
– Si vous vouliez, dis-je en sautant à bas de la voiture, je ferais faire la quête par notre caissier. »
Et je jetai mon chapeau à Capi, qui le prit dans sa gueule.
On applaudit beaucoup la grâce avec laquelle il savait saluer lorsqu’on lui avait donné ; mais, ce qui valait mieux pour nous, on lui donna beaucoup. Comme je le suivais, je voyais les pièces blanches tomber dans le chapeau ; le marié mit la dernière et ce fut une pièce de cinq francs.
Quelle fortune ! Ce ne fut pas tout. On nous invita à manger à la cuisine, et on nous donna à coucher dans une grange. Le lendemain, quand nous quittâmes cette maison hospitalière, nous avions un capital de vingt-huit francs.
« C’est à toi que nous les devons, mon petit Mattia, dis-je à mon camarade, tout seul je n’aurais pas formé un orchestre. »
Avec vingt-huit francs dans notre poche, nous étions des grands seigneurs, et, lorsque nous arrivâmes à Corbeil, je pus, sans trop d’imprudence, me livrer à quelques acquisitions que je jugeais indispensables : d’abord un cornet à piston qui me coûta trois francs chez un marchand de ferraille ; pour cette somme, il n’était ni neuf ni beau, mais enfin, récuré et soigné, il ferait notre affaire ; puis ensuite des rubans rouges pour nos bas, et enfin un vieux sac de soldat pour Mattia, car il était moins fatigant d’avoir toujours sur les épaules un sac léger que d’en avoir de temps en temps un lourd ; nous nous partagerions également ce que nous portions avec nous, et nous serions plus alertes.
Quand nous quittâmes Corbeil, nous étions vraiment en bon état ; nous avions, toutes nos acquisitions payées, trente francs dans notre bourse, car nos représentations avaient été fructueuses ; notre répertoire était réglé de telle sorte que nous pouvions rester plusieurs jours dans le même pays sans trop nous répéter ; enfin nous nous entendions si bien, Mattia et moi, que nous étions déjà ensemble comme deux frères.
Après avoir quitté Corbeil, nous nous étions dirigés sur Montargis, en route pour aller chez mère Barberin.
Aller chez mère Barberin pour l’embrasser, c’était m’acquitter de ma dette de reconnaissance envers elle ; mais c’était m’en acquitter bien petitement et à trop bon marché.
Si je lui portais quelque chose ?
Maintenant que j’étais riche, je lui devais un cadeau. Quel cadeau lui faire ?
Je ne cherchai pas longtemps. Il y en avait un qui plus que tout la rendrait heureuse, non seulement dans l’heure présente, mais pour toute sa vieillesse, – une vache, qui remplaçât la pauvre Roussette.
Quelle joie pour mère Barberin, si je pouvais lui donner une vache, et aussi quelle joie pour moi !
Avant d’arriver à Chavanon j’achetais une vache, et Mattia, la conduisant par la longe, la faisait entrer dans la cour de mère Barberin. Bien entendu, Barberin n’était pas là. « Mme Barberin, disait Mattia, voici une vache que je vous amène. – Une vache ! vous vous trompez, mon garçon (et elle soupirait). – Non, madame, vous êtes bien Mme Barberin, de Chavanon ?
Eh bien, c’est chez Mme Barberin que le prince (comme dans les contes de fées) m’a dit de conduire cette vache qu’il vous offre. – Quel prince ? » Alors je paraissais, je me jetais dans les bras de mère Barberin, et, après nous être bien embrassés, nous faisions des crêpes et des beignets, qui étaient mangés par nous trois et non par Barberin, comme en ce jour de Mardi Gras où il était revenu pour renverser notre poêle et mettre notre beurre dans sa soupe à l’oignon.
Quel beau rêve ! Seulement, pour le réaliser, il fallait pouvoir acheter une vache. Combien cela coûtait-il, une vache ? Je n’en avais aucune idée ; cher, sans doute, très cher ; mais encore ?
Ce que je voulais, ce n’était pas une trop grande, une trop grosse vache. D’abord, parce que plus les vaches sont grosses, plus leur prix est élevé ; puis, parce que, plus les vaches sont grandes, plus il leur faut de nourriture, et je ne voulais pas que mon cadeau devînt une cause d’embarras pour mère Barberin.
L’essentiel pour le moment, c’était donc de connaître le prix des vaches, ou plutôt d’une vache telle que j’en voulais une.
Heureusement, cela n’était pas difficile pour moi, et, dans notre vie sur les grands chemins, dans nos soirées à l’auberge, nous nous trouvions en relations avec des conducteurs et des marchands de bestiaux : il était donc bien simple de leur demander le prix des vaches. Mais la première fois que j’adressai ma question à un bouvier, dont l’air brave homme m’avait tout d’abord attiré, on me répondit en me riant au nez. Le bouvier se renversa ensuite sur sa chaise en donnant de temps en temps de formidables coups de poing sur la table ; puis il appela l’aubergiste.
« Savez-vous ce que me demande ce petit musicien ? Combien coûte une vache, pas trop grande, pas trop grosse, enfin une bonne vache. Faut-il qu’elle soit savante ? »
Après avoir épuisé toutes ses plaisanteries, déployé suffisamment son esprit, il voulut bien me répondre sérieusement et même entrer en discussion avec moi.
Il avait justement mon affaire, une vache douce, donnant beaucoup de lait, un lait qui était une crème, et ne mangeant presque pas ; si je voulais lui allonger quinze pistolets sur la table, autrement dit cinquante écus, la vache était à moi.
Quinze pistolets ou cinquante écus, cela faisait cent cinquante francs, et j’étais loin d’avoir une si grosse somme.
Était-il impossible de la gagner ? Il me sembla que non, et que, si la chance de nos premiers jours nous accompagnait, je pourrais, sou à sou, réunir ces cent cinquante francs. Seulement il faudrait du temps. Alors une nouvelle idée germa dans mon cerveau : si, au lieu d’aller tout de suite à Chavanon, nous allions d’abord à Varses, cela nous donnerait ce temps qui nous manquerait en suivant la route directe.
Il fallait donc aller à Varses tout d’abord et ne voir mère Barberin qu’au retour ; assurément alors j’aurais mes cent cinquante francs et nous pourrions jouer ma féerie : La Vache du prince.
Le matin, je fis part de mon idée à Mattia, qui ne manifesta aucune opposition.
« Allons à Varses, dit-il ; les mines, c’est peut-être curieux, je serai bien aise d’en voir une. »
La route est longue de Montargis à Varses, qui se trouve au milieu des Cévennes, sur le versant de la montagne incliné vers la Méditerranée : cinq ou six cents kilomètres en ligne droite ; plus de mille pour nous à cause des détours qui nous étaient imposés par notre genre de vie. Il fallait bien chercher des villes et des grosses bourgades pour donner des représentations fructueuses.
Nous mîmes près de trois mois à faire ces mille kilomètres, mais, quand nous arrivâmes aux environs de Varses, j’eus la joie, comptant mon argent, de constater que nous avions bien employé notre temps : dans ma bourse en cuir, j’avais cent vingt-huit francs d’économies ; il ne me manquait plus que vingt-deux francs pour acheter la vache de mère Barberin.
Mattia était presque aussi content que moi, et il n’était pas médiocrement fier d’avoir contribué pour sa part à gagner une pareille somme. Il est vrai que cette part était considérable et que sans lui, surtout sans son cornet à piston, nous n’aurions jamais amassé cent vingt-huit francs, Capi et moi.
De Varses à Chavanon nous gagnerions bien certainement les vingt-deux francs qui nous manquaient.
Ce qui fait et ce qui fera la fortune de Varses est ce qui se trouve sous la terre, et non ce qui est au-dessus.
À la surface, en effet, l’aspect est triste et désolé : des causses, des garrigues, c’est-à-dire la stérilité ; pas d’arbres, si ce n’est çà et là des châtaigniers, des mûriers et quelques oliviers chétifs ; pas de terre végétale, mais partout des pierres grises ou blanches ; là seulement où la terre ayant un peu de profondeur, se laisse pénétrer par l’humidité, surgit une végétation active qui tranche agréablement avec la désolation des montagnes.
De cette dénudation résultent de terribles inondations, car, lorsqu’il pleut, l’eau court sur les pentes dépouillées comme elle courrait sur une rue pavée, et les ruisseaux, ordinairement à sec, roulent alors des torrents qui gonflent instantanément les rivières des vallons et les font déborder : en quelques minutes on voit le niveau de l’eau monter dans le lit des rivières de trois, quatre, cinq mètres et même plus.
Varses est bâtie à cheval sur une de ces rivières nommée la Divonne, qui reçoit elle-même dans l’intérieur de la ville deux petits torrents : le ravin de la Truyère et celui de Saint-Andéol. Ce n’est point une belle ville, ni propre, ni régulière. Les wagons chargés de minerai de fer ou de houille qui circulent du matin au soir sur des rails au milieu des rues sèment continuellement une poussière rouge et noire qui, par les jours de pluie, forme une boue liquide et profonde comme la fange d’un marais ; par les jours de soleil et de vent, ce sont au contraire des tourbillons aveuglants qui roulent dans la rue et s’élèvent au-dessus de la ville.
Du haut en bas, les maisons sont noires, noires par la boue et la poussière, qui de la rue monte jusqu’à leurs toits ; noires par la fumée des fours et des fourneaux, qui de leurs toits descend jusqu’à la rue ; tout est noir, le sol, le ciel et jusqu’aux eaux que roule la Divonne. Et cependant les gens qui circulent dans les rues sont encore plus noirs que ce qui les entoure : les chevaux noirs, les voitures noires, les feuilles des arbres noires ; c’est à croire qu’un nuage de suie s’est abattu pendant une journée sur la ville ou qu’une inondation de bitume l’a recouverte jusqu’au sommet des toits.
Les rues n’ont point été faites pour les voitures ni pour les passants, mais pour les chemins de fer et les wagons des mines : partout sur le sol des rails et des plaques tournantes ; au-dessus de la tête des ponts volants, des courroies, des arbres de transmission qui tournent avec des ronflements assourdissants. Les vastes bâtiments près desquels on passe tremblent jusque dans leurs fondations, et, si l’on regarde par les portes ou les fenêtres, on voit des masses de fonte en fusion qui circulent comme d’immenses bolides, des marteaux-pilons qui lancent autour d’eux des pluies d’étincelles, et partout, toujours des pistons de machines à vapeur qui s’élèvent et s’abaissent régulièrement. Pas de monuments, pas de jardins, pas de statues sur les places ; tout se ressemble et a été bâti sur le même modèle, le cube : les églises, le tribunal, les écoles, des cubes percés de plus ou moins de fenêtres, selon les besoins.
Quand nous arrivâmes aux environs de Varses, il était deux ou trois heures de l’après-midi, et un soleil radieux brillait dans un ciel pur ; mais, à mesure que nous avancions, le jour s’obscurcit ; entre le ciel et la terre s’était interposé un épais nuage de fumée qui se traînait lourdement en se déchirant aux hautes cheminées. Depuis plus d’une heure, nous entendions de puissants ronflements, un mugissement semblable à celui de la mer avec des coups sourds, – les ronflements étaient produits par les ventilateurs, les coups sourds par les martinets et les pilons. Je savais que l’oncle d’Alexis était ouvrier mineur à Varses, qu’il travaillait à la mine de la Truyère, mais c’était tout. Demeurait-il à Varses même ou aux environs ? Je l’ignorais.
En entrant dans Varses, je demandai où se trouvait la mine de la Truyère, et l’on m’envoya sur la rive gauche de la Divonne, dans un petit vallon traversé par le ravin qui a donné son nom à la mine.
On nous indiqua l’adresse de l’oncle Gaspard ; il demeurait à une petite distance de la mine, dans une rue tortueuse et escarpée qui descendait de la colline à la rivière.
Quand je le demandai, une femme, qui était adossée à la porte, causant avec une de ses voisines, adossée à une autre porte, me répondit qu’il ne rentrerait qu’à six heures, après le travail.
« Qu’est-ce que vous lui voulez ? dit-elle.
– Je veux voir Alexis. »
Alors elle me regarda de la tête aux pieds, et elle regarda Capi.
« Vous êtes Rémi ? dit-elle. Alexis nous a parlé de vous ; il vous attendait. Quel est celui-ci ? »
Elle montrait Mattia.
« C’est mon camarade. »
C’était la tante d’Alexis. Je crus qu’elle allait nous engager à entrer et à nous reposer, car nos jambes poudreuses et nos figures hâlées par le soleil criaient haut notre fatigue ; mais elle n’en fit rien et me répéta simplement que si je voulais revenir à six heures, je trouverais Alexis, qui était à la mine.
Je n’avais pas le cœur à demander ce qu’on ne m’offrait pas ; je la remerciai de sa réponse, et nous allâmes par la ville, à la recherche d’un boulanger, car nous avions grand-faim, n’ayant pas mangé depuis le petit matin, et encore une simple croûte qui nous était restée sur notre dîner de la veille. J’étais honteux aussi de cette réception, car je sentais que Mattia se demandait ce qu’elle signifiait. À quoi bon faire tant de lieues ?
Il me sembla que Mattia allait avoir une mauvaise idée de mes amis, et, quand je lui parlerais de Lise, il ne m’écouterait plus avec la même sympathie. Et je tenais beaucoup à ce qu’il eût d’avance de la sympathie et de l’amitié pour Lise.
La façon dont nous avions été accueillis ne m’engageant pas à revenir à la maison, nous allâmes, un peu avant six heures, attendre Alexis à la sortie de la mine.
L’exploitation des mines de la Truyère se fait par trois puits qu’on nomme puits Saint-Julien, puits Sainte-Alphonsine et puits Saint-Pancrace, car c’est un usage dans les houillères de donner assez généralement un nom de saint aux puits d’extraction, d’aérage ou d’exhaure, c’est-à-dire d’épuisement ; ce saint, étant choisi sur le calendrier le jour où l’on commence le fonçage, sert non seulement à baptiser les puits, mais encore à rappeler les dates.
Prévenu que c’était par cette galerie que devaient sortir les ouvriers, je me postai avec Mattia et Capi devant son ouverture, et, quelques minutes après que six heures eurent sonné, je commençai à apercevoir vaciller, dans les profondeurs sombres de la galerie, des petits points lumineux qui grandirent rapidement.
C’étaient les mineurs qui, la lampe à la main, remontaient au jour, leur travail fini.