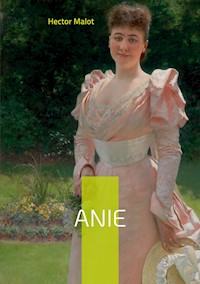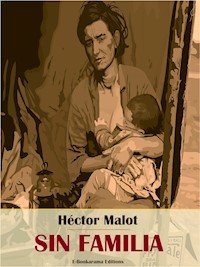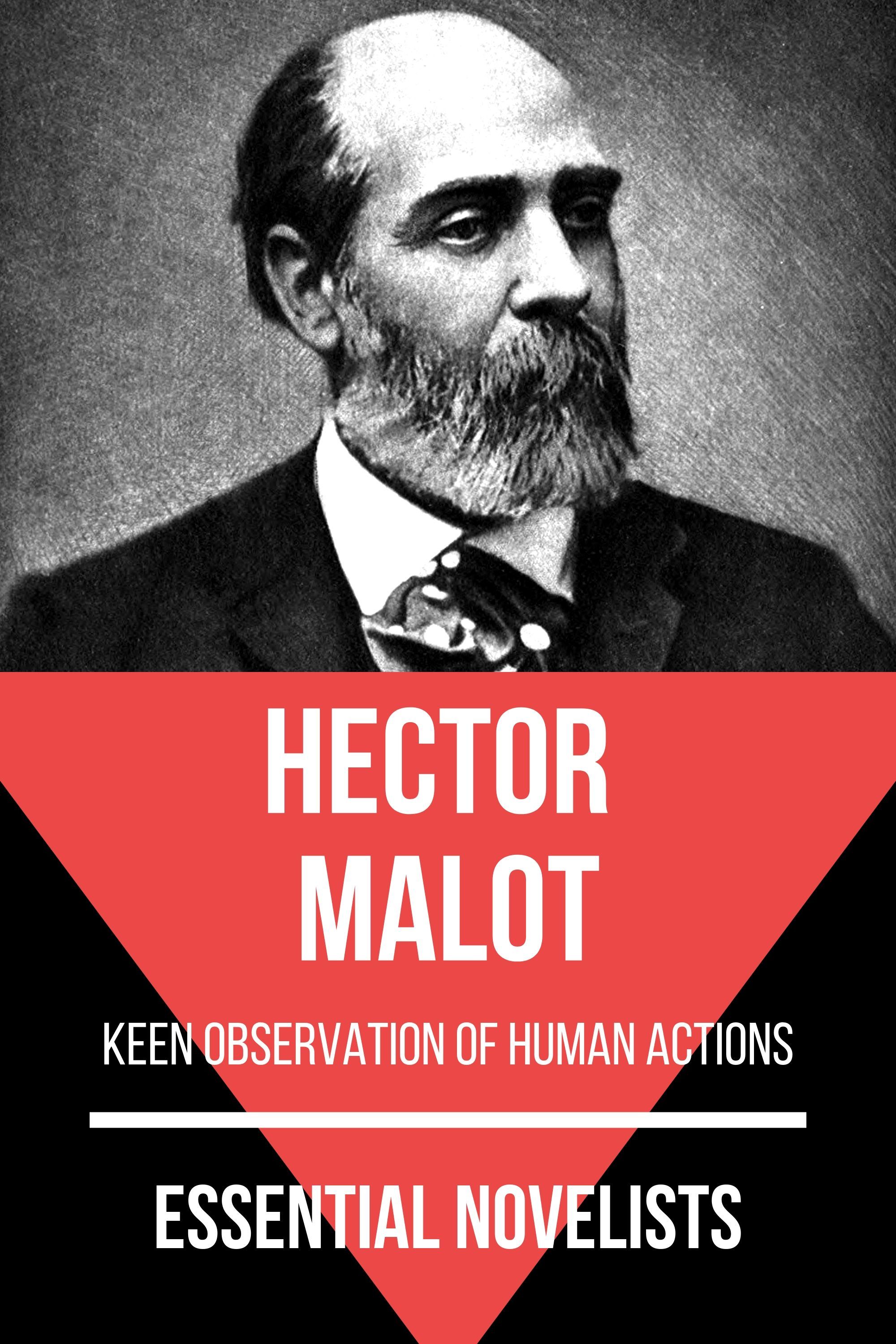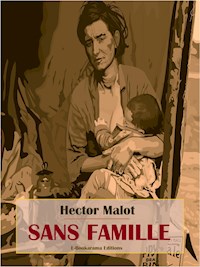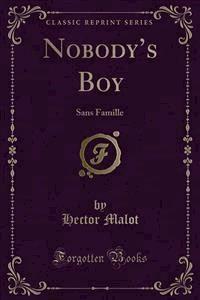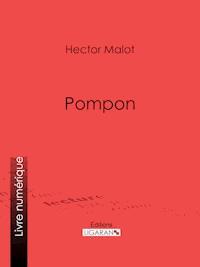2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: CARA
- Sprache: Französisch
A la mort de son oncle, Léon Hautpois-Daguillon, fils d'orfèvres parisiens, découvre qu'il aime sa cousine Madeleine. Mais ses parents s'opposent à son mariage car Madeleine n'a aucune fortune. Madeleine s'enfuit pour tâcher de gagner de quoi rembourser les dettes de son père et Léon tombe dans les filets d'une courtisane redoutablement habile.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cara
Pages de titreÀ Ferdinand FabrePremière partieIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIDeuxième partieI - 1II - 1III - 1IV - 1V - 1VI - 1VII - 1VIII - 1IX - 1X - 1XI - 1XII - 1XIII - 1XIV - 1XV - 1XVI - 1XVII - 1XVIII - 1XIX - 1XX - 1XXI - 1XXII - 1XXIII - 1XXIVXXVXXVIXXVIITroisième partieI - 2II - 2III - 2IV - 2V - 2VI - 2VII - 2VIII - 2IX - 2Page de copyrightHector Malot
Cara
À Ferdinand Fabre
Son ami
H. M.
Première partie
I
Haupois-Daguillon (Ch. P.), orfèvre fournisseur des cours d’Angleterre, d’Espagne, de Belgique, de Grèce, rue Royale, maisons à Londres, Regent street, et à Madrid, calle de la Montera. – (0) 1802-6-19-23-27-31-44-40. – (P.M.) Londres, 1851. – (A) New-York, 1853. – Hors concours, Londres 1862 et Paris 1867.
C’est ainsi que se trouve désignée dans le Bottin une maison d’orfèvrerie qui, par son ancienneté, – près d’un siècle d’existence, – par ses succès artistiques, – (0) (A) médailles d’or et d’argent à toutes les grandes expositions de la France et de l’étranger, – par sa solidité financière, par son honorabilité, est une des gloires de l’industrie parisienne.
Jusqu’en 1840, elle avait été connue sous le seul nom de Daguillon ; mais à cette époque l’héritier unique de cette vieille maison était une fille, et celle-ci, en se mariant, avait ajouté le nom de son mari à celui de ses pères : Haupois-Daguillon.
Ce Haupois (Ch. P.) était un Normand de Rouen venu, dans une heure d’enthousiasme juvénile, de sa province à Paris pour être statuaire, mais qui, après quelques années d’expérience, avait, en esprit avisé qu’il était, pratique et industrieux, abandonné l’art pour le commerce.
Il n’eût très probablement été qu’un médiocre sculpteur, il était devenu un excellent orfèvre, et sous sa direction, qui réunissait dans une juste mesure l’inspiration de l’artiste à l’intuition et à la prudence du marchand, les affaires de sa maison avaient pris un développement qui aurait bien étonné le premier des Daguillon si, revenant au monde, il avait pu voir, à partir de 1850, le chiffre des inventaires de ses héritiers.
Il est vrai que dans cette direction il avait été puissamment aidé par sa femme, personne de tête, intelligente, courageuse, résolue, âpre au gain, dure à la fatigue, en un mot, une de ces femmes de commerce qu’il n’était pas rare de rencontrer il y a quelques années dans la bourgeoisie parisienne, assises à leur comptoir ou derrière le grillage de leur caisse, ne sortant jamais, travaillant toujours, et n’entrant dans leur salon, quand elles en avaient un, que le dimanche soir.
En unissant ainsi leurs efforts, le mari et la femme n’avaient point eu pour but de quitter au plus vite les affaires, après fortune faite, pour vivre bourgeoisement de leurs rentes. Vivre de ses rentes, l’héritière des Daguillon l’eût pu, et même très largement, à l’époque à laquelle elle s’était mariée. Pour cela elle n’aurait eu qu’à vendre sa maison de commerce. Mais l’inaction n’était point son fait, pas plus que les loisirs d’une existence mondaine n’étaient pour lui plaire. C’était l’action au contraire qu’il lui fallait, c’était le travail qu’elle aimait, et ce qui la passionnait c’étaient les affaires, c’était le commerce pour les émotions et les orgueilleuses satisfactions qu’ils donnent avec le succès.
Il était venu ce succès, grand, complet, superbe, et à mesure qu’étaient arrivées les médailles et les décorations, à mesure qu’avait grossi le chiffre des inventaires, les satisfactions orgueilleuses étaient venues aussi, de sorte que d’années en années le mari et la femme, avaient été de plus en plus fiers de leur nom : Haupois-Daguillon, c’était tout dire.
Deux enfants étaient nés de leur mariage, une fille, l’aînée, et, par une grâce vraiment providentielle, un fils qui continuerait la dynastie des Daguillon.
Mais les rêves ou les projets des parents ne s’accordent pas toujours avec la réalité. Bien que ce fils eût été élevé en vue de diriger un jour la maison de la rue Royale et de devenir un vrai Daguillon, il n’avait montré aucune disposition à réaliser les espérances de ses parents, et la gloire de sa maison avait paru n’exercer aucune influence, aucun mirage sur lui.
Cette froideur s’était manifestée dès son enfance ; et alors qu’il suivait les cours du lycée Bonaparte et qu’il venait le jeudi ou pendant les vacances passer quelques heures dans les magasins, on ne l’avait jamais vu prendre intérêt à ce qui se faisait ni à ce qui se disait autour de lui. Combien était sensible la différence entre la mère et le fils, car les distractions les plus agréables de son enfance, c’était dans ce magasin que mademoiselle Daguillon les avait trouvées, écoutant, regardant curieusement les clients, admirant les pièces d’orfèvrerie exposées dans les vitrines, et la plus heureuse petite fille du monde lorsqu’on lui permettait d’en prendre quelques-unes (de celles qui n’étaient pas terminées bien entendu) pour jouer à la marchande avec ses camarades.
Mais était-il sage de s’inquiéter de l’apathie d’un enfant ? plus tard la raison viendrait, et, quand il comprendrait la vie, il ne resterait assurément pas insensible aux avantages que sa naissance lui donnait.
L’âge seul était venu, et lorsque, ses études finies, Léon était entré dans la maison paternelle, il avait gardé son apathie et son indifférence, restant de glace pour les joies commerciales, insensible aux bonnes aussi bien qu’aux mauvaises affaires.
Sans doute il n’avait pas nettement déclaré qu’il ne voulait point être commerçant, car il n’était point dans son caractère de procéder par des affirmations de ce genre. D’humeur douce, ayant l’horreur des discussions, aimant tendrement son père et sa mère, enfin étant habitué depuis son enfance à entendre les espérances de ses parents, il ne s’était pas senti le courage de dire franchement que la gloire d’être un Daguillon ne l’éblouissait pas, et qu’il ne sentait pas la vocation nécessaire pour remplir convenablement ce rôle.
Mais, ce qu’il n’avait pas dit, il l’avait laissé entendre, sinon en paroles, au moins en actions, par ses manières d’être avec les clients, avec les employés, les ouvriers, avec tous et dans toutes les circonstances.
Si M. et madame Haupois-Daguillon avaient exigé de leur fils le zèle et l’exactitude d’un commis ou d’un associé, ils auraient pu s’expliquer son apathie et son indifférence par la paresse ; mais cette explication n’était malheureusement pas possible.
Léon n’était pas paresseux ; collégien, il avait figuré parmi les lauréats du grand concours ; élève de l’École de droit, il avait passé tous ses examens régulièrement et avec de bonnes notes ; enfin, dans l’atelier où il avait appris le dessin, il avait acquis une habileté et une sûreté de main qu’une longue application peut seule donner.
Et puis, d’autre part, ce n’était pas du zèle, ce n’était même pas du travail qu’ils lui demandaient. Le jour où ils l’avaient fait entrer dans leur maison, ils ne lui avaient pas dit : « Tu travailleras depuis sept heures et demie du matin jusqu’à neuf heures du soir, et tu emploieras ton temps sans perdre une minute. » Loin de là. Car ce jour même ils lui avaient offert un appartement de garçon luxueusement aménagé, avec deux chevaux dans l’écurie, un pour la selle, l’autre pour l’attelage, voiture sous la remise, cocher, valet de chambre ; et un pareil cadeau, qui lui permettait de mener désormais l’existence d’un riche fils de famille, n’était pas compatible avec de rigoureuses exigences de travail. Aussi ces exigences n’existaient-elles ni dans l’esprit du père ni dans celui de la mère. Qu’il s’amusât. Qu’il prît dans le monde parisien la place qui selon eux appartenait à l’héritier de leur maison, cela était parfait ; ils en seraient heureux ; mais par contre cela n’empêchait pas (au moins ils le croyaient) qu’il s’intéressât aux affaires de cette maison, qui en réalité serait un jour, qui était déjà la sienne.
C’était là seulement ce qu’ils attendaient, ce qu’ils espéraient, ce qu’ils exigeaient de lui.
Cependant si peu que cela fût, ils ne l’obtinrent pas.
À quoi pouvait tenir son indifférence, d’où venait-elle ?
Ce furent les questions qu’ils agitèrent avec leurs amis et particulièrement avec le plus intime, un commerçant nommé Byasson, mais sans leur trouver une réponse satisfaisante, chacun ayant un avis différent.
Ils s’arrêtèrent donc à cette idée, que les choses changeraient si, comme l’avait soutenu leur ami Byasson, on donnait à Léon un rôle plus important dans la direction de la maison, plus d’initiative, plus de responsabilité, et, pour en arriver à cela, ils décidèrent de s’éloigner de Paris pendant quelque temps.
Depuis plusieurs années, les médecins conseillaient à M. Haupois d’aller faire une saison aux eaux de Balaruc, dans l’Hérault. Il avait toujours résisté aux médecins. Il céda. La femme accompagna le mari.
Léon, resté seul maître de la maison, serait bien forcé de prendre l’habitude de diriger tout et de commander à tous, même aux vieux employés, qui jusqu’à ce jour l’avaient traité un peu en petit garçon.
Cependant il ne dirigea rien et ne commanda à personne, ni aux jeunes ni aux vieux employés.
II
Le départ de son père et de sa mère lui avait imposé une obligation qu’il avait dû accepter, si désagréable qu’elle fût : c’était d’abandonner son appartement de la rue de Rivoli pour coucher rue Royale.
Lorsque le dernier des Daguillon, qui était le père de madame Haupois, avait quitté le quartier du Louvre, où sa maison avait été fondée, pour la transférer rue Royale, il avait installé son appartement à côté de ses magasins ; mais plus tard lorsque, sous la direction de M. Haupois, les affaires de la maison s’étaient développées et avaient atteint leur apogée, il avait fallu prendre cet appartement pour le transformer en salons d’exposition, en bureaux, en magasins. De ce qui jusqu’à ce jour avait servi à l’habitation particulière on n’avait conservé qu’une chambre avec une cuisine. Et pour loger la famille on avait dû louer un appartement rue de Rivoli, entre la rue de Luxembourg et la rue Saint-Florentin. C’était là que les enfants avaient grandi, en bon air, au soleil, les yeux égayés par la verdure des Tuileries. Mais cet appartement confortable, madame Haupois-Daguillon ne l’avait guère habité, car obligée de rester rue Royale, où l’œil du maître était nécessaire, elle avait conservé sa chambre auprès de ses magasins, la première levée, la dernière couchée, ne vivant de la vie de famille que le dimanche seulement.
Tant que durerait l’absence de ses parents, Léon devait habiter cette chambre, remplacer ainsi sa mère, et comme elle faire bonne garde sur toutes choses.
Mais pour coucher rue Royale Léon ne s’était pas trouvé obligé à s’occuper plus attentivement des affaires de la maison : il avait rempli le rôle de gardien, voilà tout, et encore en dormant sur les deux oreilles.
Pour le reste, il avait laissé les choses suivre leur cours, et quand le vieux caissier, le vénérable Savourdin, bonhomme à lunettes d’or et à cravate blanche le priait chaque soir de vérifier la caisse, il s’acquittait de cette besogne avec une nonchalance véritablement inexplicable. Quelle différence entre la mère et le fils ! et le bonhomme Savourdin, qui avait des lettres, s’écriait de temps en temps : O tempora, o mores ! en se demandant avec angoisse à quels abîmes courait la société.
Il y avait déjà douze jours que M. et madame Haupois-Daguillon étaient partis pour les eaux de Balaruc, lorsqu’un jeudi matin, en classant le courrier que le facteur venait d’apporter, le bonhomme Savourdin trouva une lettre adressée à M. Léon Haupois, avec la mention « personnelle et pressée » écrite au haut de sa large enveloppe.
Aussitôt il appela un garçon de bureau :
– Portez cette lettre à M. Léon.
– M. Léon n’est pas levé.
– Eh bien, remettez-la à son domestique en lui faisant remarquer qu’elle est pressée.
– Ce ne sera pas une raison pour que M. Joseph prenne sur lui d’éveiller son maître.
– Vous lui direz, ajouta le caissier en haussant doucement les épaules par un geste de pitié, que ce n’est pas une lettre d’affaires ; l’écriture de l’adresse est de la main de M. Armand Haupois, l’oncle de M. Léon, et le timbre est celui de Lion-sur-Mer, village auprès duquel M. l’avocat général habite ordinairement avec sa fille pendant les vacances pour prendre les bains. Cela décidera sans doute Joseph, ou comme vous dites « M. Joseph », à réveiller son maître.
Le garçon de bureau prit la lettre et, secouant la tête en homme bien convaincu qu’on lui fait faire une course inutile, il sortit du magasin et alla frapper à une petite porte bâtarde, – celle de la cuisine, – qui ouvrait directement sur l’escalier.
Une voix lui ayant répondu de l’intérieur, il entra : deux hommes se trouvaient dans cette cuisine ; l’un d’eux, en veste de velours bleu, évidemment un commissionnaire, était en train de cirer des bottines ; l’autre, en gilet à manches, assis sur deux chaises, les pieds en l’air, était occupé à lire le journal.
– Tiens ! monsieur Pierre, dit ce dernier en abandonnant sa lecture.
– Moi-même, monsieur Joseph, qui me fais le plaisir de vous apporter une lettre pour M. Léon.
– Monsieur n’est pas éveillé.
Et comme le commissionnaire qui cirait les bottines avait ralenti le mouvement de son bras droit :
– Frottez donc, père Manhac ; vous avez déjà batté les vêtements tout à l’heure, n’ayez pas peur d’appuyer sur le cuir, vous savez : ce n’est pas monsieur qui paye, c’est moi, donnez-m’en pour mon argent.
Puis se tournant vers le garçon de bureau :
– Ma parole d’honneur, c’est agaçant de ne pouvoir pas avoir une minute de tranquillité ; si vous vous relâchez de votre surveillance, rien ne va plus.
Pendant cette observation faite d’un ton rogue, le père Manhac avait achevé de cirer les bottines ; les ayant posées délicatement sur une table, il sortit le dos tendu en homme qui trouve plus sage de fuir les observations que de les affronter.
– Ne portez-vous pas ma lettre à M. Léon ? demanda le garçon de bureau.
– Non, bien sûr.
– Ce n’est pas une lettre d’affaires.
– Quand même ce serait une lettre d’amour, je ne le réveillerais pas.
– C’est une lettre de famille, le bonhomme Savourdin a reconnu l’écriture ; il dit qu’elle est de M. Armand Haupois, l’avocat général de Rouen, l’oncle de M. Léon ; ce qui est assez étonnant, car les deux frères ne se voient plus ; mais ils veulent peut-être se réconcilier ; M. Armand Haupois a une fille très jolie, mademoiselle Madeleine, que M. Léon aimait beaucoup.
– Elle n’a pas le sou, votre fille très jolie ; cela m’est donc bien égal que M. Léon l’ait aimée, car l’héritier de la maison Haupois-Daguillon n’épousera jamais une femme pauvre ; je suis tranquille de ce côté, les parents feront bonne garde, ils ont d’autres idées, que je partage d’ailleurs jusqu’à un certain point.
– Oh ! alors...
– Est-ce que vous vous imaginez, mon cher, qu’un homme comme moi aurait accepté M. Léon Haupois si j’avais admis la probabilité, la possibilité d’un mariage prochain ? Allons donc ! Ce qu’il me faut, c’est un garçon qui mène la vie de garçon ; c’est une règle de conduite. Voilà pourquoi je suis entré chez M. Léon ; c’était un fils de bourgeois enrichi et je m’étais imaginé qu’il irait bien : mais il m’a trompé.
– Il ne va donc pas ?
Joseph haussa les épaules.
– Pas de femmes, hein ? insista le garçon de bureau en clignant de l’œil.
– Mon cher, les hommes ne sont pas ruinés par les femmes, ils le sont par une ; plusieurs femmes se neutralisent ; une seule prend cette influence décisive qui conduit aux folies.
– Eh bien, vous m’étonnez, car, à l’époque où M. Léon n’était encore que collégien, je croyais qu’il irait bien, comme vous dites. Il venait souvent le jeudi au magasin avec un de ses camarades, le fils Clergeau, et, tout le temps qu’ils étaient là, ils restaient le nez écrasé contre les vitres à regarder le défilé des voitures qui vont au Bois ou qui en reviennent, et qui naturellement passent sous nos fenêtres. De ma place je les entendais chuchoter, et ils ne parlaient que des cocottes à la mode ; ils savaient leur nom, leur histoire, avec qui elles étaient, et, en les écoutant, je me disais à part moi : « Il faudra voir plus tard, ça promet. » Je suis joliment surpris de m’être trompé. En tout cas, si j’ai raisonné faux, pour le fils, j’ai tombé juste pour la fille.
– Mademoiselle Haupois-Daguillon s’occupait aussi des cocottes ?
– Quelle bêtise ! Comme son frère, mademoiselle Camille restait aussi le nez collé contre les vitres, mais le défilé qu’elle regardait, c’était celui des gens titrés. Tout ce qui avait un nom dans le grand monde parisien, elle le connaissait ; il n’y avait que ces gens-là qui l’intéressaient ; elle parlait de leur naissance ; elle savait sur le bout du doigt leur parenté ; elle annonçait leur mariage, et alors comme pour le frère je me disais : « Il faudra voir » ; j’ai vu ; elle a épousé un noble.
– Baronne Valentin, la belle affaire en vérité.
– Enfin elle a des armoiries, et la preuve c’est qu’on vient de lui finir à la fabrique une garniture de boutons en or pour un de ses paletots, avec sa couronne de baronne gravée sur chaque bouton ; c’est très joli.
– Ridicule de parvenu, mon cher, voilà tout ; on fait porter ses armes par ses valets, on ne les porte pas soi-même.
Un coup de sonnette interrompit cette conversation.
III
Lorsque Joseph entra dans la chambre de son maître, celui-ci était debout, le dos appuyé contre un des chambranles de la fenêtre, occupé à allumer une cigarette : les manches de la chemise de nuit retroussées, le col rejeté de chaque côté de la poitrine, les cheveux ébouriffés, il apparaissait, dans le cadre lumineux de la fenêtre, comme un grand et beau garçon, au torse vigoureux, avec une tête aux traits réguliers, harmonieux, aux yeux doux, à la physionomie ouverte et bienveillante.
– Une lettre pour monsieur, dit Joseph. L’adresse porte : « Personnelle et pressée. »
– Donnez, dit-il nonchalamment.
Mais aussitôt qu’il eut jeté les yeux sur l’adresse, l’intérêt remplaça l’indifférence.
– Vite une voiture, s’écria-t-il en jetant cette lettre sur la table, un cheval qui marche bien ; courez.
Comme Joseph se dirigeait vers la porte, son maître le rappela :
– Savez-vous à quelle heure part l’express pour Caen ?
– À neuf heures.
– Quelle heure est-il présentement ?
– Huit heures quarante.
– Allez vite ; trouvez-moi un bon cheval ; quand la voiture sera à la porte, courez rue de Rivoli et mettez-moi dans un sac à main du linge pour trois ou quatre jours, puis revenez en vous hâtant de manière à me remettre ce sac.
Tout en donnant ces ordres d’une voix précipitée, il s’était mis à sa toilette ; en quelques minutes il fut habillé et prêt à partir.
Alors, sortant vivement de sa chambre, il passa dans les magasins et se dirigea vers la caisse :
– Savourdin, je pars.
– C’est impossible. J’ai des signatures à vous demander.
– Vous vous arrangerez pour vous en passer.
Le vieux caissier leva au ciel ses deux bras par un geste désespéré, mais Léon lui avait déjà tourné le dos.
– Monsieur Léon, cria le bonhomme, monsieur Léon, je vous en prie, au nom du ciel...
Mais Léon avait gagné le vestibule et descendait l’escalier.
Au moment où il franchissait la porte cochère, une voiture, avec Joseph dedans, s’arrêtait devant le trottoir.
– À la gare Saint-Lazare ! dit Léon, montant brusquement dans la voiture, et aussi vite que vous pourrez !
Le cheval, enlevé par un vigoureux coup de fouet, partit au grand trot ; aussitôt Léon voulut reprendre la lecture de la lettre, dont les premières lignes l’avaient si profondément bouleversé.
Mais la voiture franchit en moins de cinq minutes la distance qui sépare la rue Royale de la rue Saint-Lazare : quand elle entra dans la cour de la gare, il n’avait pas encore tourné le premier feuillet ; l’horloge allait sonner neuf heures.
Il était temps : on ferma derrière lui le guichet de distribution des billets.
Ce fut seulement quand il se trouva installé dans son wagon, où il était seul, qu’il reprit sa lecture, non au point où il l’avait interrompue, mais à la première ligne :
« Mon cher Léon,
» Ma dépêche télégraphique d’hier, par laquelle je te demandais si tu serais à Paris libre de toute occupation pendant la fin de la semaine, a dû te surprendre jusqu’à un certain point.
» En voici l’explication :
» Je vais mourir, et tu es la seule personne au monde, mon cher neveu, qui puisse assister ma fille, ta cousine ; dans cette circonstance, il fallait donc que je fusse certain qu’aussitôt prévenu tu pourrais accourir près d’elle.
» Cette certitude, ta réponse me la donne, et, comme d’avance je suis sûr de ton cœur, je puis maintenant accomplir ma résolution.
» Tu connais ma position, je n’ai pas de fortune. Nés de parents pauvres, ton père et moi nous n’avons pas eu de patrimoine. Mais tandis que ton père, jetant un clair regard sur la vie, embrassait la carrière commerciale au lieu d’être artiste, comme il l’avait tout d’abord souhaité, j’entrais dans la magistrature. Et, d’autre part, tandis que ton père épousait une femme riche qui lui apportait des millions, j’en épousais une qui n’avait pour dot et pour tout avoir qu’une cinquantaine de mille francs.
» Cette dot avait été placée dans une affaire industrielle ; je ne changeai point ce placement, car il ne me convenait pas de défaire ce qui avait été fait par mon beau-père, et d’un autre côté j’étais bien aise de tirer de ces cinquante mille francs un revenu assez gros pour que ma femme et ma fille n’eussent point trop à souffrir de la médiocrité de mon traitement de substitut.
» C’est grâce à ce revenu qu’après avoir perdu ma femme au bout de quatre années de mariage, je pus garder ma fille près de moi, et qu’elle a été élevée sous mes yeux, sur mon cœur.
» En la mettant dans un pensionnat, j’aurais pu faire de sérieuses économies, car, lorsqu’on prend, pour instruire un enfant dans la maison paternelle, les meilleurs professeurs dans chaque branche d’instruction, pour la peinture un peintre de mérite, pour la musique des artistes de talent, cela coûte cher, très cher, et en employant utilement ces économies, soit à former un capital, soit à constituer une assurance sur la vie, payable entre les mains de ma fille le jour de son mariage, je serais arrivé à lui constituer une dot moitié plus forte que celle que sa mère avait reçue. Mais je n’ai point cru que c’était là le meilleur. Plusieurs raisons d’ordre différent me déterminèrent : j’aimais ma fille, et ce m’eût été un profond chagrin de me séparer d’elle ; je n’étais pas partisan de l’éducation en commun pour les filles ; jeune encore, je ne voulais pas m’exposer à la tentation de me remarier, ce qui eût pu arriver si je n’avais pas eu ma fille près de moi ; enfin je me disais que, si les hommes ne cherchent trop souvent qu’une dot dans le mariage, il en est cependant qui veulent une femme, et c’était une femme que je voulais élever ; toi qui connais Madeleine, ses qualités d’esprit et de cœur, tu sais si j’ai réussi.
» Tu as passé quelques-unes de tes vacances avec nous ; tu sais quelle était notre vie dans notre petite maison du quai des Curandiers et notre étroite intimité dans le travail comme dans le plaisir ; tu as assisté à nos soirées de lecture, à nos séances de musique, à nos réunions entre amis, je n’ai donc rien à te dire de tout cela ; à le faire je m’attendrirais dans ces souvenirs si doux, si charmants, et je ne veux pas m’attendrir.
» Cependant, en rappelant ainsi un passé que tu connais dans une certaine mesure, je dois relever un point que tu ignores peut-être, et qui a son importance : nos dépenses dépassèrent chaque année mes prévisions et m’entraînèrent dans des embarras d’argent qui furent les seuls tourments de ces années si heureuses ; mais ton père me vint en aide, et, grâce à son concours fraternel, je pus en sortir à mon honneur.
» Malgré ces embarras d’argent causés le plus souvent par des besoins imprévus, mais dans plus d’une circonstance aussi, je l’avoue, par une mauvaise administration, j’espérais pouvoir suivre jusqu’au bout le plan que je m’étais tracé pour l’éducation de Madeleine, quand un incident désastreux vint bouleverser toutes mes combinaisons : la maison dans laquelle notre capital était placé se trouva en mauvaises affaires, et de telle sorte que si nous n’apportions pas une nouvelle mise de fonds tout était perdu. Sans économies, sans ressources autres que celles provenant de mon traitement, il m’était difficile, pour ne pas dire impossible, de me procurer la somme nécessaire pour cet apport. J’aurais pu, il est vrai, la demander à ton père ; mais j’en étais empêché par des raisons, à mes yeux décisives : ton père m’ayant déjà aidé dans plusieurs circonstances, je ne pouvais m’adresser à lui sans augmenter les obligations que j’avais déjà contractées à son égard dans des proportions qui n’étaient nullement en rapport avec ma situation financière ; en un mot, je n’empruntais plus, je me faisais donner ; enfin, je ne voulais pas m’exposer à voir nos relations fraternelles gênées par des questions d’argent, et même à voir les liens d’amitié qui nous unissaient brisés par ces questions. Mais ce que je n’avais pas voulu faire, un de nos cousins le fit à mon insu, et ton père apprit les difficultés de ma situation ; il vint à Rouen et voulut régler cette affaire d’après certains principes de commerce qui n’étaient pas les miens. Une discussion s’ensuivit entre nous ; tu sais combien nos idées sont différentes sur presque tous les points ; cette discussion s’envenima et se termina par une rupture complète, telle que nos relations ont été brisées et que depuis ce jour nous ne nous sommes pas revus, malgré certaines avances que j’ai cru devoir faire, mais qui ont trouvé ton père implacable.
» Si difficile que fût ma position, je parvins cependant à me procurer la somme qu’il me fallait, mais ce fut au prix d’engagements très lourds que je ne contractai que parce que j’avais la conviction que notre affaire devait reprendre et bien marcher. Elle ne reprit point. Elle vient de s’effondrer, me laissant ruiné, et ce qui est plus terrible, endetté pour des sommes qu’il m’est impossible de payer.
» Si l’insolvabilité est grave pour tout le monde, combien plus encore l’est-elle pour un magistrat ! admets-tu que le chef d’un parquet poursuivi par les huissiers soit obligé de parlementer avec eux, d’user de finesses plus ou moins légales, de les abuser, de les prier d’attendre ? Les prier !
» Ce n’est pas tout.
» Il y a quatre mois je remarquai un affaiblissement dans ma vue, ou plus justement du trouble et de l’obscurité. Tout d’abord je ne m’en inquiétai pas. Mais bientôt les objets ne m’apparurent plus qu’entourés d’un nuage et avec des formes confuses ; en lisant, les lettres semblaient vaciller devant mes yeux, et se réunir toutes ensemble au point que je n’apercevais plus qu’une ligne noire uniforme.
» Je consultai le docteur La Roë, que tu connais bien ; il constata une amaurose qui dans un temps plus ou moins long devait me rendre aveugle.
» On ne reste pas impassible sous le coup d’une pareille menace. Cependant je ne me laissai pas accabler, je résolus d’employer ce que j’avais d’énergie et d’intelligence à lutter. Un de mes collègues et des plus éminents est aveugle ; ce qui ne l’empêche pas de remplir les devoirs de sa charge : j’espérai pouvoir suivre son exemple et remplir aussi les miens.
» Tu as fait ton droit, tu sais que notre travail est de deux espèces, celui du cabinet et celui de l’audience ; dans le cabinet on lit les dossiers, on prend des notes, c’est-à-dire qu’on fait usage des yeux ; à l’audience on conclut, c’est-à-dire qu’on fait surtout usage de la parole. Lorsque je sortis de chez mon médecin, je rentrai chez moi et aussitôt je révélai la vérité ou tout au moins une partie de la vérité à Madeleine, en lui expliquant d’autre part notre situation financière ; puis je lui demandai si elle voulait me servir de secrétaire et me lire les dossiers que j’avais à étudier, en un mot être, selon l’expression de Sophocle, « la fille dont les yeux voient pour elle et pour son père ».
» Elle non plus ne s’abandonna pas, et si un mouvement irrésistible de désespoir la fit jeter dans mes bras, elle réagit contre cette faiblesse, et tout de suite nous nous mîmes au travail.
» Ces doigts habitués à manier le pinceau et le crayon ou à courir sur les touches du piano tournèrent les feuillets poudreux des dossiers ; ces lèvres qui jusqu’à ce jour n’avaient prononcé que des phrases harmonieuses savamment arrangées par nos grands écrivains, prononcèrent les mots baroques du grimoire en usage chez les notaires et les avoués.
» Et moi, assis en face d’elle, je l’écoutais, mais sans pouvoir m’empêcher de la regarder de mes yeux obscurcis et de me laisser distraire par les pensées qui m’oppressaient ; plus d’une fois je détournai la tête et d’une main furtive j’essuyai les larmes qui roulaient sur mes joues ; pauvre Madeleine ! elle était charmante ainsi ! bientôt je ne la verrais plus ! entre elle et moi la nuit éternelle !
» Mes affaires préparées, je devais prendre mes conclusions à l’audience sans notes, sans pièces, même sans code et en parlant d’abondance. La tâche était d’autant plus difficile pour moi, que jusqu’alors j’avais eu l’habitude de me servir très peu de ma mémoire, parlant le plus souvent avec mon dossier sous les yeux, et, dans les circonstances importantes, m’aidant de notes manuscrites qui me servaient de canevas. Malgré mon application et mes efforts, j’échouai misérablement. Que cette impuissance fût le résultat de ma maladie, ce qui est possible, car l’amaurose est souvent une conséquence de certaines lésions du cerveau ; qu’elle fût due au contraire à l’absence de cette faculté que les phrénologues appellent la concentrativité, cela importait peu, ce qui était capital, c’était cette impuissance même ; et par malheur elle est absolue.
» Convaincu par cette déplorable expérience que bientôt je ne pourrais plus remplir mes fonctions d’avocat général, je fis faire des démarches à Paris pour voir s’il me serait possible d’obtenir un siège de conseiller ; je n’avais guère l’espérance de réussir, mais enfin je devais ne rien négliger et tenter même l’absurde. Tu trouveras ci-jointe la réponse que j’ai reçue : c’est la copie de mes notes individuelles et confidentielles qu’un de mes amis, un de mes camarades a pu prendre à la chancellerie. Tu la liras, et non seulement elle t’apprendra que je n’ai rien à espérer, rien à attendre, mais encore elle te montrera ce que je suis ; au moment d’exécuter la résolution que la fatalité m’impose, j’ai besoin de penser que lorsque tu parleras de moi avec ma fille, tu le feras en connaissance de cause.
» Voici donc ma situation : le magistrat et l’homme sont perdus, l’un par les dettes, l’autre par la maladie : si je n’offre pas ma démission, on me la demandera ; si je la refuse, on me destituera.
» Destitué, ruiné, aveugle, que puis-je ?
» Deux choses seules se présentent : mendier auprès de mes parents et de mes amis, ou bien me faire nourrir par ma fille qui travaillera pour moi à je ne sais quel travail, puisqu’elle n’a pas de métier.
» Je n’accepterai ni l’une ni l’autre ; ce n’est pas pour entraîner cette pauvre enfant dans ma chute et la perdre avec moi que je l’ai élevée.
» Tant que je serai vivant, Madeleine sera ma fille ; le jour où je serai mort elle deviendra la fille de ton père.
» Il faut donc qu’elle soit orpheline.
» Je n’ai pas besoin de te développer cette idée, qui s’imposera à ton esprit avec toutes ses conséquences ; c’est elle qui a déterminé ma résolution.
» Nos dissentiments et notre rupture n’ont point changé mes sentiments à l’égard de ton père ; je sais quelle est sa générosité, sa bonté, son affection pour les siens, et quant à toi, mon cher Léon, je connais ton cœur plein de tendresse et de dévouement ; Madeleine va perdre en moi un père qui lui serait un fardeau ; elle trouvera en vous une famille, en toi un frère.
» Je sais que je n’ai pas besoin de consulter ton père à l’avance et de lui demander son consentement ; il acceptera Madeleine, parce qu’elle est sa nièce ; mais à toi, mon cher Léon, je veux la confier par un acte solennel de dernière volonté.
» La pauvre enfant va éprouver la plus horrible douleur qu’elle ait encore ressentie ; je te demande d’être près d’elle à ce moment, afin que, lorsqu’elle sera frappée, elle trouve une main qui la soutienne, et un cœur dans lequel elle puisse pleurer.
» Demain tout sera fini pour moi.
» Je ne peux pas retarder davantage l’exécution de ma résolution : ma guérison est impossible, ma destitution est imminente, et la perte complète de la vue peut se produire d’un moment à l’autre ; j’ai pu encore écrire cette lettre tant bien que mal en enchevêtrant très probablement les lignes et les mots, dans huit jours je ne le pourrais peut-être plus ; dans huit jours je ne pourrais pas davantage me conduire, et Madeleine ne me laisserait pas sortir seul.
» Et précisément, pour accomplir ce que j’ai arrêté, il faut que je sorte seul ; nous sommes à la veille d’une grande marée, et demain la mer découvrira une immense étendue de rochers jusqu’à deux kilomètres au moins de la côte ; je partirai pour aller à la pêche ainsi que je l’ai fait souvent ; je n’en reviendrai point ; je serai tombé dans un trou, ou bien je me serai laissé surprendre par la marée montante ; ma mort sera le résultat d’un accident comme il en arrive trop souvent sur ces grèves ; toi seul sauras la vérité, et j’ai assez foi en ta discrétion pour être certain que personne, – je répète et je souligne personne, – personne au monde ne la connaîtra.
» Cette lettre reçue, quitte Paris, fais diligence, et quand tu arriveras à Saint-Aubin, Madeleine ne saura rien encore, je l’espère ; au moins j’aurai tout arrangé pour cela.
» Adieu, mon cher Léon, mon cher enfant, je t’embrasse tendrement.
» Armand Haupois. »
À cette longue lettre était attachée une feuille de papier portant un en-tête imprimé, – la copie des notes de la chancellerie ; – mais Léon n’en commença pas la lecture immédiatement, et ce fut seulement après être resté assez longtemps immobile, anéanti par ce qu’il venait d’apprendre, étourdi par la secousse qu’il avait reçue, qu’il revint à ces notes et qu’il se mit à lire machinalement.
Note individuelle.
Nom et prénoms du magistrat. – Haupois (Armand-Charles).
Lieu et département où il est né. – Rouen (Seine-Inférieure).
Son état ou profession avant d’être magistrat. – Avocat.
État ou profession de son père. – Officier retraité.
Dire s’il parle ou écrit quelque langue étrangère ou quelque idiome utile. – L’anglais, l’italien.
Quel est son revenu indépendamment de son traitement ? – Nul.
Demande-t-il quelque avancement ? – Il accepterait les fonctions de conseiller, mais il ne demande rien.
Dire s’il irait partout où il pourrait être envoyé en France. – Non.
Quel est le ressort où il désire être placé ? – Rouen.
Renseignements confidentiels.
Caractère. – Très ferme.
Conduite privée. – Irréprochable.
Conduite publique. – Légère.
Impartialité. – Incontestable.
Travail. – Suffisant.
Exactitude, assiduité. – Bonnes.
Zèle, activité. – Suffisants.
Fermeté. – Mal appliquée.
Santé. – Bonne ; menacé d’une maladie des yeux.
Rapports avec ses chefs. – Officiels et froids.
Rapports avec les autorités. – Officiels et froids.
Rapports avec le public. – Affables.
Habitudes sociales. – Homme de bonne compagnie, mais ses relations artistiques l’obligent à fréquenter des personnes qui ne sont pas dignes de lui.
Capacité. – Réelle.
Sagacité. – Grande.
Jugement. – Droit.
Style. – Simple, ferme.
Élocution. – Facile.
S’il est propre au service de l’audience civile. – Oui.
S’il est propre au service de l’audience correctionnelle. – Oui.
S’il est propre au service de la cour d’assises. – Oui.
S’il convient à la magistrature assise. – Non.
S’il se livre à des occupations étrangères à ses fonctions. – À la musique, à la poésie.
S’il jouit de l’estime publique. – Oui.
S’il a encouru des peines disciplinaires. – Non.
Si ses liens de parenté apportent quelque obstacle au service. – Non.
S’il a droit à quelque avancement. – Non, à cause de ses goûts artistiques qui le distraient de ses fonctions et l’entraînent dans la fréquentation de gens peu convenables.
Faits particuliers.
Ses goûts d’artiste lui font mener une vie difficile.
Embarras d’argent.
Dettes.
Magistrat intègre.
IV
Le train marchant à grande vitesse avait dépassé Poissy et ces stations qui sont sans nom pour les express ; Léon, le front appuyé contre la vitre, regardait machinalement et sans les voir les coteaux boisés devant lesquels il défilait.
La lecture entière de cette lettre ne l’avait pas tiré de la stupéfaction dans laquelle l’avaient jeté ses premières lignes ; et son esprit était emporté dans un tourbillon comme il était emporté lui-même dans l’espace.
Mais si extraordinaire, si inimaginable que fût cette résolution de suicide chez un homme tel que son oncle, il fallait bien cependant s’habituer à la considérer comme réelle : – « Demain tout sera fini pour moi. »
Le seul point sur lequel l’espérance était encore possible était celui qui avait rapport au moment où ce suicide s’accomplirait ; à l’heure présente, neuf heures quarante minutes, était-il ou n’était-il pas accompli ? Tout était là ?
Après quelques instants de douloureuse réflexion, il se dit que dans dix minutes, le train allait s’arrêter à Mantes, où se trouve un bureau télégraphique, et qu’il fallait saisir cette occasion pour envoyer une dépêche à Madeleine.
Il avait dans son sac papier, plume et encre ; sans perdre une minute, il se mit aussitôt à rédiger sa dépêche :
Mademoiselle Madeleine Haupois,
maison Exupère Héroult.
Saint-Aubin-sur-Mer, par Bernières.
(Avec exprès).
« Je viens de voir un médecin de Rouen qui me dit qu’il est dangereux de laisser mon oncle sortir seul ; veille sur lui ; ne le quitte pas ; je serai près de vous vers quatre heures de soir.
» Léon Haupois. »
Il eût fallu être plus précis, mais cela n’était possible qu’en disant la vérité entière ; or, cette vérité, il ne pouvait la dire qu’en commettant un abus de confiance.
De là cette dépêche étrange.
C’était cette étrangeté même qui faisait précisément son mérite ; – si elle arrivait à Saint-Aubin avant que son oncle sortit de chez lui, elle était assez claire pour que Madeleine ne le laissât point partir, ou tout au moins pour qu’elle l’accompagnât ; si au contraire, elle arrivait trop tard, elle était assez obscure pour ne pas révéler le suicide et permettre des explications telles quelles.
D’ailleurs les minutes s’écoulaient, et il n’avait pas le loisir de prendre le meilleur ; il fallait prendre ce qui se présentait à son esprit ; cette première dépêche terminée, il en écrivit une seconde adressée au chef de la gare de Caen pour le prier de lui retenir une voiture attelée de deux bons chevaux, qui devrait l’attendre au train de deux heures dix-huit minutes, et le conduire aussi vite que possible à Saint-Aubin.
Il écrivait ces derniers mots lorsque le sifflet de la machine annonça l’arrivée à Mantes : avant l’arrêt complet du train, Léon sauta sur le quai et courut au télégraphe ; il n’avait que trois minutes.
En sortant du bureau, ses dépêches expédiées, il passa devant la bibliothèque des chemins de fer, et ses yeux tombèrent par hasard sur un paquet de journaux parmi lesquels se trouvait le Journal de Rouen. Instantanément le souvenir lui revint qu’au temps où il passait une partie de ses vacances chez son oncle, il lisait dans ce journal un bulletin météorologique donnant l’heure des marées sur la côte. Il acheta un numéro et, remonté dans son compartiment, il chercha vivement ce bulletin ; l’heure de la pleine mer allait lui dire si son oncle pouvait être ou ne pas être sauvé par sa dépêche : la pleine mer était annoncée pour six heures au Havre ; par conséquent, c’était à midi qu’avait lieu la basse mer, et c’était entre onze heures et une heure que son oncle devait accomplir son suicide.
La dépêche arriverait-elle à temps ?
Si elle arrivait avant que M. Haupois fût sorti, il était sauvé ; si elle arrivait après, il était perdu ; sa vie dépendait donc du hasard.
Comme la plupart de ceux qui n’ont point eu encore le cœur brisé par la perte d’une personne aimée, Léon repoussait l’idée de la mort pour les siens ; que ceux qui nous sont indifférents meurent, cela nous paraît tout naturel, non ceux que nous aimons.
Et il aimait son oncle, bien qu’en ces derniers temps, par suite de la rupture survenue entre les deux frères, il eût cessé de le voir. Pourquoi son oncle et son père s’étaient-ils fâchés ? Il le savait à peine. Ils avaient eu de sérieuses raisons sans doute, aussi bonnes probablement pour l’un que pour l’autre ; mais pour lui il n’avait jamais voulu prendre parti dans cette rupture, qui n’avait changé en rien les sentiments d’affectueuse tendresse et de respect qu’il avait, dès son enfance, conçus pour cet oncle si bon, si jeune de cœur, si prévenant, si indulgent pour les jeunes gens dont il savait se faire le camarade et l’ami avec tant de bonne grâce.
Et, entraîné par les souvenirs que la lecture de cette lettre venait de réveiller en lui, il revint à ce temps de sa jeunesse.
Il retourna à Rouen et se retrouva dans cette petite maison du quai des Curandiers où il avait eu tant de journées de gaieté et de liberté. Il la revit avec sa parure de plantes grimpantes dont le feuillage jauni par les premiers brouillards de septembre produisait de si curieux effets dans la Seine, quand le soleil couchant les frappait de ses rayons obliques. Devant ses yeux passa tout une flotte de grands navires arrivant de la mer avec le flot ; ceux-ci carguant leurs voiles et jetant l’ancre devant l’île du Petit-Gay ; ceux-là continuant leur route pour aller s’amarrer au quai de la Bourse.
À son oreille retentit la voix claire de Madeleine comme au moment où surprise par le sifflet d’un remorqueur ou du bateau de La Bouille, elle appelait son cousin pour qu’il vînt avec elle au bord de la rivière ; sans l’attendre, elle courait jusqu’à l’extrémité de la berge, et quand le remous des eaux soulevé par les roues du vapeur arrivait frangé d’écume, elle se sauvait devant cette vague en poussant des petits cris joyeux, ses cheveux dorés flottant au vent.
Le soir, quelques amis sonnaient à la porte verte ; quand tous ceux qu’on attendait étaient venus, le père prenait son violon, la fille s’asseyait au piano et l’on faisait de la musique. Bien que Madeleine ne fût encore qu’une enfant, elle chantait, parfois seule, parfois tenant sa partie dans un ensemble où se trouvaient de véritables artistes auprès desquels elle savait se faire applaudir ; car elle était déjà très bonne musicienne et sa voix était charmante. Vers dix heures, ces amis s’en allaient, on les reconduisait en suivant la rivière dont le courant miroitait sous les reflets de la lune ou du gaz, et on ne les quittait que quand ils s’embarquaient dans un de ces lourds bachots recouverts d’un carrosse à peu près comme les gondoles de Venise, mais qui, pour le reste, ne ressemblent pas plus aux barques légères de la lagune que le ciel bleu de la reine de l’Adriatique ne ressemble au ciel brumeux de la capitale de la Normandie.
Cette existence modeste et tranquille, dans laquelle les plaisirs intellectuels occupaient une juste place, n’avait rien de la vie affairée que ses parents menaient à Paris, et c’était justement pour cela qu’elle avait eu tant de charmes pour lui : elle avait été une révélation et, par suite, un sujet de rêverie et de comparaison ; il n’y avait donc pas que l’argent et les affaires en ce monde ; on pouvait donc causer d’autre chose que d’échéances et de recouvrements ; il y avait donc des pères qui faisaient passer avant tout l’éducation de leurs enfants !
De souvenir en souvenir, il en revint aux discussions qui tant de fois s’étaient engagées entre sa sœur et lui, alors qu’elle l’accompagnait à Rouen.
Autant il avait de plaisir à passer quelques semaines dans la maison du quai des Curandiers, autant Camille avait d’ennui ; elle la trouvait misérablement bourgeoise, cette maisonnette ; son mobilier était démodé ; les gens qui la fréquentaient étaient vulgaires, communs, sans nom ; Madeleine s’habillait mesquinement, le blond de ses cheveux était fade, ses manières ne seraient jamais nobles. Que le mobilier fût démodé, il avouait cela ; mais les tableaux, les dessins, les gravures, les objets d’art, sculptures, faïences, antiquités, curiosités qui couvraient les murs, n’étaient-ils pas d’une tout autre importance que des fauteuils ou des tables ? Que Madeleine s’habillât sans coquetterie, il le concédait encore, mais non que ses manières ne fussent pas nobles. Pas noble, Madeleine ! Mais en vérité elle était la noblesse même, ayant reçu sa distinction de race de sa mère, qui descendait des conquérants normands, ainsi que le prouvait d’ailleurs son nom de Valletot, venant du mot germain tot, qui signifie demeure. De sa mère aussi elle avait reçu ce type de beauté scandinave qui lui donnait un cachet si particulier : la tête ovale avec des pommettes un peu saillantes, le front moyennement développé, le nez droit, le teint rosé, les yeux d’un bleu clair limpide, au regard doux et pensif, les cheveux blond doré, la figure suave avec une expression candide, la taille svelte, les mains fines et allongées, le pied petit et cambré.
Comme elle avait dû grandir, embellir depuis qu’il ne l’avait vue ! Ce n’était plus une petite fille, mais une jeune fille de dix-neuf ans.
V
À deux heures dix-huit minutes, le train entrait dans la gare de Caen ; à deux heures vingt minutes, Léon montait dans la voiture qui l’attendait.
– Nous allons à Saint-Aubin, dit le conducteur.
– Oui, et grand train.
Le conducteur cingla ses chevaux de deux coups de fouet vigoureusement appliqués.
– Combien vous faut-il de temps ? demanda Léon.
– Nous avons vingt kilomètres.
– Faites votre compte.
– Il y a la traversée de la ville.
Cette manière normande de se dérober au lieu de répondre exaspéra Léon :
– Combien de temps ? répéta-t-il.
– Si nous disions une heure et demie ?
– Ne soyez qu’une heure en route, et il y a vingt francs pour vous.
Le cocher ne répondit pas, mais à la façon dont il empoigna son fouet, il fut évident qu’il ferait tout pour gagner ces vingt francs. Epron, Cambes, Mathieu furent promptement atteints et dépassés ; étendant son fouet en avant, le cocher se retourna vers son voyageur :
– Voilà le clocher de la chapelle de la Délivrande, dit-il.
En sortant de la Délivrande, Léon se trouva en face de la mer, qui développait son immensité jusqu’aux limites confuses de l’horizon ; une plaine nue sans arbres, sans haies, descendant en pente douce au rivage bordé d’une ligne de maisons, puis les eaux se dressant comme un mur azuré et le ciel abaissant dessus sa coupole nuageuse.
À l’entrée de Saint-Aubin, le cocher arrêta pour demander à une femme qui faisait de la dentelle, assise sur le seuil de sa porte, où se trouvait la maison Exupère Héroult ; puis, aussitôt qu’il eut obtenu ce renseignement, il repartit grand train ; la voiture roula encore pendant une minute ou deux, puis elle s’arrêta devant une maison de chétive apparence contre les murs de laquelle étaient accrochés des filets tannés au cachou.
Au même moment une jeune femme parut sur la porte.
– Mon cousin ! s’écria-t-elle.
Mais, avant de descendre, Léon l’enveloppa d’un rapide coup d’œil : aucune trace de chagrin ne se montrait sur son visage souriant.
Il sauta vivement à bas de la voiture, et prenant dans ses deux mains celles que Madeleine lui tendait :
– Mon oncle ? demanda-t-il.
– Il est à la pêche.
Léon resta un moment sans trouver une parole : il arrivait donc trop tard.
– Tu n’as pas reçu ma dépêche ? demanda-t-il enfin ; car sous peine de se trahir il fallait bien parler.
– Si, mais papa était déjà parti ; je l’avais conduit jusqu’à la porte d’un de nos amis, M. Soullier, et c’est en revenant le long de la grève que l’homme du sémaphore, m’ayant rejointe, me remis ta dépêche ; j’ai été pour retourner sur mes pas, mais j’ai réfléchi que papa ne courait aucun danger, puisque M. Soullier l’accompagne.
– Ah ! ce monsieur l’accompagne ?
– Comme tu me dis cela.
– C’est que, ne connaissant pas ce M. Soullier, je m’étonne qu’il accompagne mon oncle.
– M. Soullier est un magistrat de la cour de Caen qui habite Bernières pendant les vacances ; papa et lui se voient presque tous les jours et bien souvent ils vont à la pêche ensemble ; il va ramener papa tout à l’heure et tu feras sa connaissance ; je suis même surprise qu’ils ne soient pas encore arrivés. Mais entre donc ; donne-moi ton sac ; on le portera à l’hôtel, où je t’ai retenu une chambre, car nous n’en avons pas à te donner dans cette maison qui n’est pas grande, tu le vois.
Pendant que Madeleine lui donnait ces explications, Léon eut le temps de se remettre et de composer son visage.
La vérité n’était que trop évidente : l’irréparable était à cette heure accompli, et les dispositions prises par son oncle s’étaient réalisées : « Quand tu arriveras à Saint-Aubin, Madeleine ne saura rien, au moins j’aurai tout arrangé pour cela. » Ils étaient faciles à deviner ces arrangements, et certainement cette visite à ce M. Soullier avait été une tromperie inventée par le père pour abuser la fille. Maintenant il n’y avait plus qu’à attendre que cette tromperie se révélât ; il n’y avait plus qu’à se conformer aux désirs de la lettre : « Au moment où elle sera frappée, qu’elle trouve une main qui la soutienne et un cœur dans lequel elle puisse pleurer. » S’il arrivait trop tard pour sauver son oncle, au moins arrivait-il assez tôt pour tendre la main à sa cousine. Cependant telles étaient les circonstances, qu’il ne devait pas devancer les événements, mais au contraire n’intervenir qu’après qu’ils auraient parlé.
– Es-tu fatigué ? demanda Madeleine.
– Pas du tout.
– Je te demande cela pour savoir si tu veux attendre papa ici, ou bien si tu veux que nous allions dans notre cabine au bord de la mer.
– Je ferai ce que tu voudras, dit-il.
– Eh bien ! allons sur la plage, c’est le mieux pour voir papa plus tôt.
Ayant mis vivement un chapeau et un manteau, elle tendit la main à son cousin.
– M’offres-tu ton bras ? dit-elle.
Avant de prendre le chemin qui conduit à la plage, Madeleine frappa doucement au carreau d’une fenêtre.
– Madame Exupère, dit-elle à la femme qui ouvrit cette fenêtre, voulez-vous avoir la complaisance de dire à papa, si par hasard il revenait par la grande route, que je suis dans la cabine avec mon cousin Léon ; vous n’oublierez pas, n’est-ce pas, mon cousin Léon ?
La pauvre enfant, comme elle était loin de prévoir le coup épouvantable qui allait la frapper dans quelques instants, dans quelques secondes peut-être ! Et Léon se demanda s’il n’était pas possible d’amortir la violence de ce coup en la préparant à le recevoir. Mais comment ? Que dire ? Lorsque la vérité serait connue, n’éclairerait-elle pas d’une lueur sinistre ce qu’il aurait tenté en ce moment ? Toute parole n’était-elle pas imprudente ?
Madeleine ne lui laissa pas le temps de réfléchir.
– Sais-tu, dit-elle, que ta dépêche m’a causé autant de surprise que de joie ? Te souviens-tu du dernier jour où nous nous sommes vus ?
– Il y a environ deux ans.
– Il y a deux ans, trois mois et onze jours.
– J’ai dû par respect et par convenance ne pas donner un démenti à mon père.
– Qu’allons-nous inventer pour expliquer ton voyage, il ne faut pas l’effrayer, et il s’inquiète tant du danger qui le menace que ce serait lui porter un coup pénible, que de lui dire que tu as été averti de ce danger par... par qui ? Est-ce par le docteur La Roë ?
Léon avait préparé sa réponse à cette question, car il avait bien prévu qu’elle lui serait posée : il raconta donc l’histoire qu’il avait inventée à l’avance.
– Ne peux-tu pas dire que tu faisais une excursion de plaisir sur le littoral ?
– Précisément, et comme mon oncle me parlera sans doute de sa maladie, je pourrai tout naturellement lui demander si je peux lui être utile à quelque chose.
Ils étaient arrivés sur la plage.
VI
La mer calme, que frappaient les rayons obliques du soleil, arrivait menaçante comme une inondation, et sur la grève plate, déjà aux trois quarts recouverte, les pointes verdâtres des rochers qui émergeaient encore de l’eau semblaient sombrer tout à coup au milieu des vagues clapoteuses, exactement comme une barque qui aurait coulé à pic ; là où quelques secondes auparavant on avait vu des amas de pierres et de goémons, ou des sables jaunes, on ne voyait plus qu’une ligne d’écume blanche qui se rapprochait d’instants en instants.
Et devant la marée montante, tous ceux qui avaient profité de la basse mer pour aller au loin, sur les roches qui ne se découvrent que rarement, pêcher des coquillages ou ramasser des varechs, se hâtaient vers le rivage ; à l’entrée des chemins qui du village ou des champs aboutissent à la grève, c’était un long défilé de voitures chargées d’étoiles de mer, de moules, de fucus, d’algues, de goémons que les cultivateurs des environs rapportaient pour fumer leurs champs, et aussi toute une procession de pêcheurs et de pêcheuses, le filet à crevette sur l’épaule ou le crochet à la main, qui, mouillés jusqu’aux épaules, s’en revenaient gaiement.
– Tout le monde rentre, dit Madeleine, nous ne devons pas tarder maintenant à voir mon père arriver avec M. Soullier.
Et guidant Léon elle le conduisit à leur cabine, dont elle ouvrit les deux portes vitrées, puis l’ayant fait asseoir et s’étant elle-même installée en se tournant du côté de Bernières :
– Ainsi placée, dit-elle, je verrai mon père arriver de loin et je te préviendrai.
C’était toujours la même idée qui revenait comme si Madeleine eut été sous l’oppression d’un funeste pressentiment. Il eut voulu l’en distraire, mais comment ? Ne valait-il pas mieux après tout qu’elle fût jusqu’à un certain point préparée à recevoir le coup suspendu au-dessus de sa tête, et qui d’un moment à l’autre, dans quelques minutes, peut-être, allait la frapper ; n’en serait-il pas moins dangereux, s’il n’en était pas moins rude ?
– Qu’as-tu donc ? lui demanda-t-elle après un moment de silence.
– Je pense à mon oncle.
– Tu es inquiet, n’est-ce pas ?
– Inquiet, pourquoi ? Je pense à sa maladie.
– Si tu savais comme il en souffre, non par le mal lui-même, mais par l’angoisse qu’il lui cause pour le présent et plus encore pour l’avenir, car tu comprends que sa position se trouve compromise. Aussi voudrait-il cacher à tous le danger qui le menace. S’il se doute que quelqu’un de Rouen t’a parlé de sa maladie, cela le tourmentera beaucoup.
– N’est-il pas convenu que je suis arrivé ici en me promenant ?
– Enfin, fais le possible pour qu’il n’ait pas cette pensée, et fais le possible aussi pour le rassurer. Pour moi, c’est là ma grande préoccupation, et c’est pour qu’il ne s’inquiète pas que je ne l’accompagne pas toujours comme je le voudrais ; il me semble que quand il est seul, comme il ne peut pas douter de ma sollicitude ni de ma tendresse, il en arrive parfois à douter de la gravité de son mal, et à se faire illusion sur le danger qui le menace. Je voudrais tant lui rendre un peu de tranquillité !
Tandis qu’elle parlait, Léon regardait ce qui se passait sur la grève et remarquait un mouvement parmi les baigneurs qui n’existait pas lorsqu’il était arrivé avec Madeleine.
Des groupes s’étaient formés, çà et là, dans lesquels on paraissait s’entretenir avec animation : ceux qui parlaient gesticulaient avec de grands mouvements de bras, ceux qui écoutaient prenaient des attitudes affligées ou consternées.
En face de la cabine dans laquelle ils étaient assis, mais à une certaine distance sur la plage se trouvaient de grandes jeunes filles qui jouaient au croquet : bien qu’elles fussent trop éloignées pour qu’on entendît ce qu’elles disaient, il était évident, à leurs exclamations et à la façon dont elles accompagnaient, dont elles poussaient leur boule lancée de la tête, des épaules ou du maillet qu’elles apportaient un très vif intérêt à leur partie. Tout à coup, une personne étant venue parler à l’une d’elles, toutes cessèrent instantanément de jouer et formèrent le cercle autour de la nouvelle arrivante ; et alors, ce que Léon avait déjà remarqué pour les groupes se reproduisit : même animation dans celle qui parlait, même consternation dans celles qui écoutaient ; puis l’une de ces jeunes filles s’étant tournée vers la cabine de Madeleine en levant les bras au ciel, on lui abaissa vivement les mains, et aussitôt elle reprit sa place dans le cercle.
Près de ces jeunes filles des enfants s’amusaient à construire des fortifications en sable pour les opposer à la marée montante ; l’un d’eux abandonna ce travail pour aller écouter ce que disaient les joueuses de croquet ; puis étant revenu près de ses camarades, ceux-ci l’entourèrent et les fortifications furent abandonnées sans défenseurs à l’assaut des vagues.
Il était impossible de ne pas reconnaître que tout cela était significatif. Quelque chose d’extraordinaire venait de se passer.
Tout à coup Madeleine s’arrêta, et se levant vivement :
– Veux-tu venir avec moi ? s’écria-t-elle. J’ai peur. Cette animation n’est pas naturelle. On nous regarde et comme si l’on osait pas nous regarder. Il faut que je sache. Je vais interroger ceux qui paraissent savoir quelque chose.
Comme elle venait de faire quelques pas en avant pour se diriger vers les joueuses de croquet, elle s’arrêta brusquement.
– M. Soullier s’écria-t-elle en désignant de la main un monsieur qui s’avançait marchant à grands pas.
Et elle se mit à courir, sans plus s’inquiéter de Léon, qui la suivit.
Ils arrivèrent ainsi tous deux ensemble près de M. Soullier.
– Mon père ! s’écria Madeleine.
– Mais je ne l’ai pas vu.
– Mon Dieu !
Léon posa un doigt sur ses lèvres en regardant M. Soullier, mais celui-ci, qui ne le connaissait pas, ne fit pas attention à ce signe ; d’ailleurs, il était tout à Madeleine.
– Avez-vous eu de mauvaises nouvelles de mon oncle ? demanda Léon.
La question avait l’avantage de permettre à M. Soullier de ne pas répondre directement à Madeleine ; celui-ci le sentit, et se tournant aussitôt vers Léon :
– On m’a parlé de monsieur votre oncle, dit-il, ou tout au moins j’ai cru que c’était de lui qu’il s’agissait.
Léon s’était rapproché de Madeleine et il lui avait pris la main.
– Que vous a-t-on dit ? demanda-t-elle, qu’avez-vous appris ? Où est mon père ? Courons près de lui.
Sans lui répondre directement, M. Soullier s’adressa à Léon :
– Ne voyant pas monsieur votre oncle venir, je restai chez moi, tout d’abord l’attendant, ensuite me disant qu’il avait sans doute renoncé à son projet de pêche. Il y a une heure environ, un de mes voisins, qui avait profité de la grande marée pour aller pêcher sur les roches qu’on appelle îles de Bernières, vient de me dire qu’un... accident... un malheur était arrivé.
– Mon Dieu ! s’écria Madeleine.
Sans s’adresser à elle, M. Soullier continua vivement, en homme qui a hâte d’achever ce qu’il doit dire :
– Une personne restée en arrière, quand déjà tout le monde revenait vers le rivage, avait été surprise par la marée montante. Cette personne se trouvait alors sur un îlot, et c’est là ce qui explique comment elle n’avait pas senti la mer monter. Mais entre cet îlot et la terre se trouvait une large fosse qu’il fallait traverser avant qu’elle fût remplie. Ceux qui virent la situation périlleuse de ce pêcheur attardé poussèrent des cris pour lui signaler le danger qu’il courait. Aussitôt le pêcheur se dirigea vers cette fosse, mais soit qu’il se fût laissé tomber dans un trou, soit que la fosse fût déjà remplie, il disparut sans qu’il fût possible de lui porter secours.
– Mon père, mon père ! s’écria Madeleine.
– Mon enfant, il n’est nullement prouvé que cette personne fût votre père... on ne m’a pas affirmé que c’était lui. Il est vrai que le signalement qu’on m’a donné se rapportait jusqu’à un certain point à votre père ; c’est là ce qui m’a inquiété, c’est ce qui m’a fait accourir ici pour voir...
– Et vous voyez qu’il n’est pas là ; oh ! mon Dieu !
Elle resta un moment éperdue, affolée ; puis, son regard se dégageant des larmes qui emplissaient ses yeux, elle vit devant elle son cousin qui lui tendait les bras, et elle s’abattit sur son épaule.
VII
Lorsqu’elle sortit enfin de sa longue crise nerveuse, sa première parole fut une prière adressée à son cousin :
– La marée basse aura lieu cette nuit à une heure, dit-elle ; tu m’accompagneras, n’est-ce pas ?
Elle ne dit point où elle voulait aller ni ce qu’elle voulait faire, mais il n’était pas nécessaire qu’elle s’expliquât plus clairement pour être comprise de Léon.
– Nous irons ensemble, répondit-il.
Mais ce n’était pas seuls qu’ils pouvaient tenter la recherche que Madeleine demandait ; qu’eussent-ils pu faire sur la grève, au milieu des rochers, en pleine nuit ?