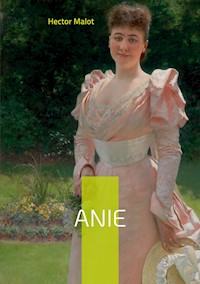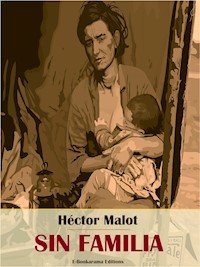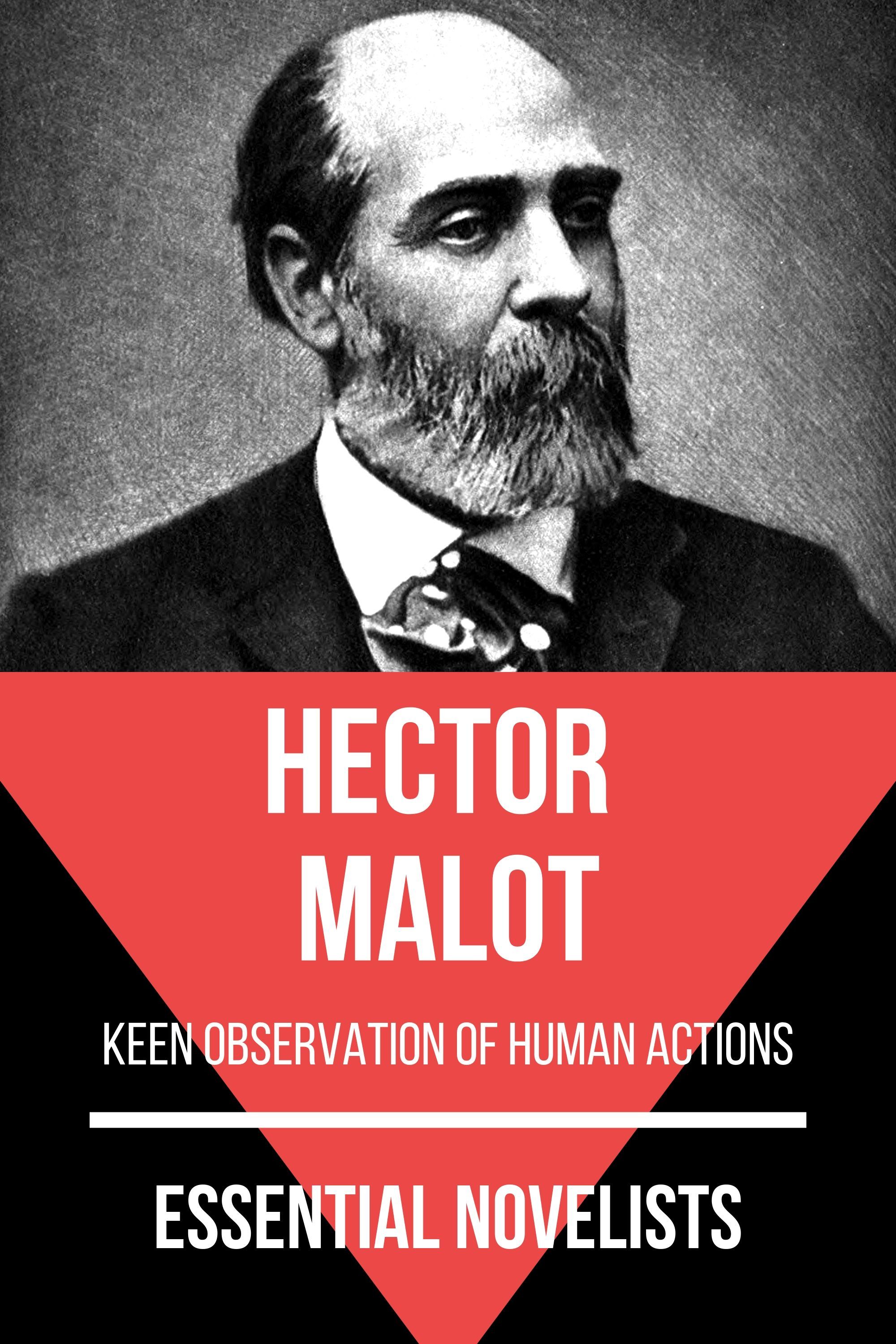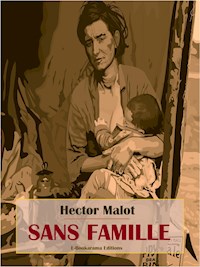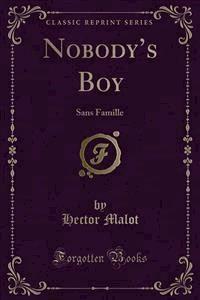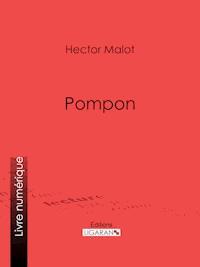2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
À la fin du XIXe siècle à Paris, Amédée dirige la banque Charlemont. Il se repose sur son secrétaire, Fourcy. Fourcy découvre que Robert, 19 ans, fils d'Amédée, est très endetté et lui dit que sa maitresse est une coquine. Il ne sait pas qu'il s'agit de Geneviève, c'est-à-dire de Mme Fourcy, sa propre femme ! Robert découvre qu'elle doit 300 000 francs à La Parisière, courtier, et elle lui demande de les emprunter. Amédée refuse. Robert trouve le cahier de mandats blancs de la banque, en signe un de 300 000 francs au nom de Fourcy, va le retirer à la banque sous le nom de Mariott et le porte à Geneviève. Elle les donne à La Parisière. Fourcy découvre le vol du mandat. Amédée porte plainte puis accuse Robert qui nie. Fourcy découvre que c'est Robert l'amant. Geneviève est arrêtée. Fourcy dit la vérité à Amédée.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Une femme d'argent
Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIPage de copyrightHector Malot
Une femme d’argent
I
Après avoir occupé une des premières places à la tête de la banque parisienne pendant la Restauration et sous le règne de Louis-Philippe, la maison Charlemont avait vu son importance s’amoindrir assez vite lorsque, de la direction de Hyacinthe Charlemont, elle était passée sous celle d’Amédée Charlemont, fils de son fondateur.
C’était toujours la même maison cependant, le même nom, mais ce n’était plus du tout le même homme, et si le fils succédait au père en vertu du droit d’héritage, il ne le remplaçait pas.
Né dans une famille de pauvres gens des Ardennes, Hyacinthe Charlemont était arrivé à Paris avec trois francs en poche pour commencer l’apprentissage de la vie dans une boutique de la rue aux Ours, et c’était de là qu’il était parti pour devenir successivement petit commis dans une maison de banque, caissier, puis directeur de cette maison, régent de la Banque de France, président de la Chambre de commerce de Paris, député, ministre et pair de France. Et partout à sa place, toujours au-dessus de la position qu’il avait conquise à force de travail, de volonté, d’application, d’intelligence, de hardiesse, et aussi, jusqu’à un certain point, par des qualités naturelles qui avaient aidé ses efforts : un caractère facile, une humeur gaie, des manières liantes. Mais ce qui plus que tout encore avait fait sa fortune, ç’avait été la façon dont il avait compris le rôle que les circonstances lui permettaient de remplir : à une époque où le crédit public existait à peine, il avait largement mis ses capitaux, ceux de sa maison aussi bien que les siens propres, au service de ses idées et de son parti ; et si son parti ne les lui avait pas toujours rendus, il lui en avait au moins payé les intérêts en renommée, si bien que dix journaux, vingt journaux dont il payait les amendes ou dont il faisait le cautionnement avaient tous les jours célébré ses mérites et chanté sa gloire. « Notre grand financier Charlemont, notre grand citoyen Charlemont », était une phrase qu’on aurait pu clicher dans les imprimeries des journaux libéraux. Comme avec cela ses rivaux ou ses ennemis étaient obligés de rendre justice à la supériorité en même temps qu’à la droiture avec laquelle il traitait les affaires, cette renommée avait été universellement acceptée, et Charlemont était devenu populaire autant pour ses opinions qui étaient celles de la partie la plus remuante du pays, que pour ses richesses dont il faisait réellement un noble usage, secourant toutes les infortunes, soutenant tout ce qui méritait d’être encouragé, même chez ses adversaires, pour le plaisir de bien faire et sans arrière-pensée d’intérêt personnel. Chose rare, le succès ne l’avait point grisé et quand Louis-Philippe, à qui il avait rendu des services de toutes sortes, avait voulu les lui payer économiquement en le faisant baron, il avait refusé : « Je mets mon orgueil dans mon humble origine », avait-il répondu à son roi. En effet, bourgeois il avait été toute sa vie, bourgeois il voulait rester ; c’était chez lui affaire de coquetterie et de vanité ; le mot « bourgeois » était celui qu’il répétait à tout propos, il ne voyait rien au-dessus ni au delà ; ses idées, ses opinions, ses ambitions, son existence avaient été bourgeoises, rien que bourgeoises, et dans son vaste cabinet de travail il avait pour toute œuvre d’art un grand dessin, splendidement encadré, qui résumait bien ses goûts et ses idées : c’était une copie qu’il avait fait faire par un homme de talent du Banquet de la garde civique, ce tableau célèbre du musée d’Amsterdam dans lequel Van der Helst a peint de grandeur nature une trentaine de bourgeois à table, où les différents types du bourgeois sont fidèlement représentés avec toute leur vigueur et aussi toute leur vulgarité : grands, solides, bien nourris, contents de la vie et d’eux-mêmes, au caractère énergique, laborieux, avisé, audacieux et prudent, aventureux et timide, aussi dur à soi-même qu’à autrui. Pour lui c’étaient là des ancêtres dans lesquels il se retrouvait avec un sentiment non avoué qu’il leur était supérieur.
Quand le fils avait remplacé le père à la tête de la maison de banque en ce moment à son apogée, les choses avaient rapidement changé et la prospérité de la maison qui, sous le père, avait été toujours en grandissant, sous le fils avait toujours marché en diminuant.
Le vieux Charlemont avait été un homme de travail, le jeune était un homme de plaisir. Tout enfant, Amédée Charlemont avait eu horreur de tout ce qui pouvait lui donner de la peine, et cette répulsion naturelle n’avait fait que se développer avec les années. Ce n’était point défaut d’intelligence, loin de là, car son esprit était vif et délié, apte à tout comprendre ; mais tout effort l’ennuyait, surtout toute application, et laissé maître de soi par un père qui avait autre chose en tête que de le surveiller, il avait pris l’habitude de ne faire que ce qui lui plaisait. Et ce qui lui plaisait, c’était la vie facile, brillante et bruyante. Pourquoi se fût-il donné de la peine ou de l’ennui ? Puisque son père avait assez travaillé pour plusieurs générations, lui, son fils, n’avait qu’à marcher gaiement dans les chemins bordés de fleurs qu’il lui avait ouverts et à cueillir, quand l’envie lui en prendrait, les fruits mûrs qui s’offraient à sa main. Sa sœur était duchesse... de l’Empire, il est vrai, lui serait roi du monde où l’on s’amuse ; n’était-il pas beau garçon, grand, bien fait, d’allure et de manières distinguées, habile à tous les exercices du corps, assez riche pour ne reculer devant aucune fantaisie, aucune folie ? S’il n’avait point conquis cette royauté visée par son ambition de vingt ans, il avait au moins pris place parmi les quelques jeunes hommes qui menaient alors le monde parisien et qui s’efforçaient d’échapper, n’importe comment, à la vie calme et monotone de cette époque bourgeoise.
Avec eux il avait été un des fondateurs du sport, en France, et ses couleurs avaient brillé sur les hippodromes de Chantilly et du Champ-de-Mars, aussi bien que dans les terres labourées de la Croix-de-Berny. Mais les succès du turf ne lui avaient pas suffi, et il en avait obtenu d’autres dans le monde de la galanterie où ses aventures avaient bien des fois soulevé de retentissants tapages.
Cette existence longtemps continuée était une assez mauvaise préparation à la direction d’une maison de l’importance de celle que Hyacinthe Charlemont laissait en mourant à son fils ; aussi l’administration de celui-ci avait-elle été déplorable.
Libre de faire ce qu’il voulait, il n’aurait pas hésité à procéder immédiatement à la liquidation de la maison paternelle, mais cette liquidation eût été un désastre dans lequel eût sombré la meilleure part de sa fortune et, bon gré, mal gré, avec un profond dégoût qu’il ne prenait pas la peine de cacher, il avait dû continuer les affaires commencées par son père ou plus justement les laisser aller toutes seules.
Elles allèrent tout d’abord à peu près comme si le chef de la maison avait été encore de ce monde, en état de les diriger de sa main sûre ; puis, au bout d’un certain temps, elles s’étaient dévoyées ou ralenties et, malgré la force d’impulsion qui leur avait été imprimée, elles auraient fini par s’arrêter entièrement, si un employé, un simple commis, nommé Fourcy, ne s’était trouvé là à point pour les remettre en chemin et suppléer, par son zèle, son activité, son intelligence, son dévouement, à l’incurie et à l’impuissance du chef de sa maison.
Ce Fourcy, qu’on avait longtemps appelé le petit Jacques parce qu’il était né dans la maison Charlemont et qu’il y avait grandi, était le fils d’un garçon de recettes qui n’avait eu d’autres visées pour son fils que de le voir hériter un jour de sa sacoche et de son portefeuille à chaînette de cuivre. Mais le fils avait eu plus d’ambition que le père. Au lieu de se contenter de l’instruction de l’école primaire que ses parents trouvaient plus que suffisante pour lui, il avait voulu davantage, et prenant sur ses heures de sommeil pour travailler, économisant les sous de son déjeuner pour acheter des livres, partout où il y avait des cours gratuits il les avait suivis : mathématiques, comptabilité, histoire, langues française, anglaise, allemande, tout avait été bon pour sa soif d’apprendre ; c’étaient des provisions qu’il emmagasinait dans sa tête sans s’inquiéter de savoir à quoi il les emploierait plus tard, convaincu seulement qu’à un moment donné elles lui serviraient.
Et de fait elles lui avaient si bien servi que celui qui ne devait être que garçon de recettes était devenu le chef de la maison Charlemont, le continuateur du grand Charlemont, le petit Jacques, M. Fourcy ; – et M. Fourcy, pour tout le monde, aussi bien pour ses anciens camarades ou ses anciens chefs forcés de subir sa supériorité que pour les personnages les plus importants de la finance et du commerce qui le traitaient en égal.
II
Débarrassé de tout souci d’affaires et ayant pleine confiance dans son fidèle Fourcy, M. Charlemont ne passait guère qu’une heure par jour dans ses bureaux, et encore restait-il quelquefois des séries de jours, même des semaines, sans s’y montrer, occupé qu’il était ailleurs.
L’âge en effet avait glissé sur lui sans modifier en rien ses habitudes, et à soixante ans il était aussi jeune qu’à vingt, à vrai dire même plus jeune, plus brillant encore, plus gai d’humeur, plus fringant d’allure, plus coquet de tenue, plus insouciant de caractère, plus tendre de complexion, plus passionné de tempérament.
La rareté de ses visites faisait qu’elles étaient toujours une sorte de petit événement pour beaucoup de ses employés et que, lorsqu’on entendait son phaéton entrer dans la cour de l’hôtel du faubourg Saint-Honoré au trot rapide des deux chevaux superbes qu’il conduisait lui-même avec autant d’élégance que de correction, plus d’une tête curieuse se levait pour le suivre des yeux et plus d’une réflexion s’engageait, car il y avait toujours quelque histoire à raconter sur son compte à propos de ses chevaux de course qu’il faisait courir avec le plus parfait mépris du public, de façon à dérouter bien souvent le ring, ou à le ruiner quelquefois, ou bien à propos de ses maîtresses, ou bien à propos de ses gains et de ses pertes au jeu.
Et pendant ce temps, il montait le bel escalier de pierre qui du rez-de-chaussée conduisait à son cabinet, marchant allègrement, le chapeau légèrement incliné, la tête haute relevée par une large cravate en satin, les épaules effacées, la poitrine bombée, ne s’arrêtant point, ne ralentissant point le pas pour respirer, laissant flotter derrière lui les pans de sa longue redingote serrée à la taille, se balançant légèrement tantôt sur une jambe, tantôt sur l’autre, en faisant résonner les marches de ses bottes vernies prises dans un pantalon à sous-pied ; – en tout pour le costume, aussi bien que pour la tenue, la reproduction vivante d’un fashionnable de Gavarni qui aurait vieilli de trente ans, mais bravement, sans artifices, sans cosmétiques, sans bricoles, sans teintures, en homme convaincu qu’un vieillard vaut un jeune homme, s’il ne vaut pas mieux ; ne le savait-il pas bien, ne le lui disait-on pas tous les jours, et des lèvres roses charmantes qu’il ne pouvait pas ne pas croire ?
Ce cabinet était celui que son père avait occupé pendant si longtemps et où se trouvait la fameuse copie du Van der Helst, mais bien que rien n’y eût été changé et que l’ameublement fût resté le même, il ne ressemblait guère sous le fils à ce qu’il avait été sous le père ; plus d’entassement, plus d’encombrement de pièces, de livres, de plans sur les tables, les fauteuils et le tapis ; au contraire un ordre parfait qui dans sa froide nudité faisait paraître immense cette vaste pièce ; on sentait que chaque matin le plumeau d’un domestique soigneux pouvait se promener partout sans craindre de rien déranger, puisqu’il n’y avait rien.
Jamais M. Charlemont ne s’asseyait devant son bureau : « C’est l’instrument qui me fait la plus grande peur avec la guillotine », disait-il ; mais après avoir tiré un cordon de sonnette, il prenait place devant le feu pendant l’hiver, et en été devant une fenêtre ouverte sur le jardin, dans un fauteuil, tout simplement en visiteur ; et au garçon qui répondait vivement à cet appel, il commandait qu’on allât prévenir M. Fourcy qu’il était arrivé.
Celui-ci paraissait aussitôt portant des papiers sur ses bras et suivi d’un commis, son secrétaire, chargé d’autres liasses.
– Bonjour, Jacques, disait M. Charlemont en lui tendant la main, mais sans se lever, comment vas-tu ?
– Très bien, monsieur, je vous remercie, et vous ?
– Tu vois.
Et il levait la tête d’un air superbe pour bien se montrer, sachant qu’il n’avait rien à craindre d’un examen en plein jour.
– Assieds-toi donc, disait-il de nouveau.
Et Fourcy s’asseyait, mais non pas dans un fauteuil devant la cheminée ou la fenêtre ; pendant qu’ils se serraient la main en échangeant ces quelques mots de politesse affectueuse, le secrétaire avait déposé sur le bureau la charge qu’il portait sur ses bras, et c’était à ce bureau, – celui du vieux, du grand Charlemont, – que Fourcy prenait place, le monceau de papiers, de livres, de portefeuilles devant lui et à portée de la main.
Alors lentement, méthodiquement, en quelques mots clairs et précis, il expliquait ce qu’il y avait de nouveau.
C’était un curieux contraste que celui qu’offraient alors ces deux hommes.
L’un adossé commodément dans son fauteuil, une jambe jetée par-dessus l’autre, la tête inclinée sur l’épaule, tournant ses pouces en écoutant d’un air indifférent comme s’il s’agissait d’affaires qui ne le touchaient pas, ou en tous cas de peu d’importance.
L’autre, penché sur les papiers qu’il feuilletait d’une main attentive, tout à sa besogne corps et âme, comme si sa fortune personnelle était en jeu et qu’une seconde de distraction dût le compromettre.
Au reste, ces différences dans les attitudes se retrouvaient dans les natures et les caractères des deux personnages.
Au lieu d’être grand, élancé, dégagé comme son patron, Fourcy était de taille moyenne, trapu et carré, ce qu’on appelle un homme solide, rien de brillant ni d’élégant en lui, mais une charpente à supporter le travail si pénible, si dur, si prolongé qu’il fût, et un tempérament à défier toute fatigue, celle du corps et celle de l’esprit ; avec cela réservé et jusqu’à un certain point timide dans ses mouvements, comme s’il se défiait de lui-même, de ses manières et de son éducation. Au lieu de parler légèrement, rapidement, avec un sourire railleur qui se moquait toujours de quelque chose ou de quelqu’un, il s’exprimait posément, en pesant ses mots, d’un accent convaincu, en homme qui ne parle que pour dire ce qui est utile.
Mais ce qui, plus que tout encore, les rendait si différents l’un de l’autre, c’était la physionomie ; tandis que celle de M. Charlemont respirait un parfait contentement de soi-même et une complète indifférence pour tout ce qui ne devait pas s’appliquer immédiatement ou tout au moins dans un temps rapproché à son intérêt ou à son plaisir, sur celle de Fourcy, au contraire, se montraient tous les bons sentiments ; lorsqu’on le connaissait et qu’on parlait de lui, on manquait rarement de dire : « C’est un honnête homme » ; mais lorsque, sans le connaître, on se trouvait en face de lui, on ne pouvait pas ne pas penser que c’était un brave homme.
Et de fait, il était l’un et l’autre, honnête homme et brave homme.
Sa probité, sa droiture, il les prouvait chaque jour dans les affaires, et c’était parce que M. Charlemont avait eu les oreilles rebattues d’un mot qu’on lui avait répété sur tous les tons : « Je vous envie un honnête homme comme Fourcy », qu’il s’était décidé à faire de son commis le chef de sa maison, pour cela bien plus que pour les autres mérites de ce commis ; en effet, il était commode pour sa paresse de mettre à sa place quelqu’un en qui il pouvait avoir pleine confiance et qu’il n’avait pas besoin de surveiller ni de contrôler.
Sa bonté et son dévouement, il les affirmait à chaque instant dans sa famille composée d’une femme qu’il adorait et de deux enfants, un fils et une fille, pour lesquels il était le meilleur des pères, le plus tendre, mais cependant sans mauvaise sensiblerie et sans faiblesse égoïste, pensant toujours à eux avant de penser à sa propre satisfaction paternelle ; pour lui, toute la joie en ce monde était dans le bonheur des siens, et il répétait ce mot si souvent que M. Charlemont, qui trouvait dans tout matière à raillerie, l’appelait parfois : « M. le bonheur des siens » ; puis il ajoutait en riant : « Sais-tu que si tu avais une histoire, mon brave Jacques, cela lui ferait un titre excellent : Le bonheur des siens ; cela vous a quelque chose de vague et de mystérieux qui plaît à l’imagination ; il est vrai qu’il y aurait peut-être des gens qui diraient : Le bonheur des chiens ; mais ceux-là seraient d’infâmes blagueurs qui ne respectent rien. »
D’histoire, Fourcy en avait une cependant : celle de son mariage.
Cette femme qu’il adorait après vingt ans de ménage exactement comme s’il était encore en pleine lune de miel (et de fait pour lui il y était toujours), – cette femme, d’une beauté et d’une intelligence remarquables, était sa cousine. À dix ans elle s’était trouvée orpheline de père et de mère sans autres parents que son oncle le père Fourcy, le garçon de recettes de la maison Charlemont, et son cousin Jacques Fourcy, qui, sans que rien en lui pût faire prévoir ce qu’il deviendrait plus tard, était déjà mieux qu’un simple garçon de recettes. Le père Fourcy qui n’était pas tendre, n’avait aucune envie de se charger de l’orpheline, mais Jacques n’avait pas voulut abandonner la petite Geneviève et il l’avait placée à ses frais dans une petite pension des environs de Paris, à Gonesse, où les prix étaient modérés et en rapport avec l’exiguïté de ses ressources. C’était par bonté, par devoir, qu’il s’était imposé cette charge, car alors il la connaissait à peine, n’ayant jamais eu de relations avec les parents de la petite, qui étaient d’assez mauvaises gens. Mais il avait été la voir quelquefois à son pensionnat, dans le commencement, toujours par devoir, pour qu’elle ne fût par trop malheureuse de son isolement, et peu à peu il s’était attaché à elle à mesure qu’elle avait grandi, qu’elle avait embelli et qu’il l’avait mieux connue, si bien que ses visites, plus fréquentes, n’avaient plus été inspirées par le simple devoir ; mais par le plaisir, puis enfin par l’amour, et que, quand elle avait eu seize ans, il lui avait demandé si elle voulait devenir sa femme : il avait, lui, trente-six ans, mais il venait d’être nommé caissier en chef de la maison Charlemont. Elle avait accepté.
III
Il y avait près d’un mois que M. Charlemont n’était venu à sa maison de banque, lorsqu’un matin on le vit descendre de son phaéton et tous les yeux qui pouvaient l’apercevoir se tournèrent d’un même mouvement vers la cour.
Il arrivait d’Angleterre, où il avait été pour voir courir ses chevaux, disaient les uns, pour accompagner sa maîtresse la comédienne Céline Faravel, qui donnait des représentations à Londres, disaient les autres.
Aussi s’éleva-t-il une rumeur dans les bureaux lorsque courut ce mot, répété de bouche en bouche : « Voilà le patron » ; et plus d’un curieux se mit-il à la fenêtre.
– Voyons donc s’il est changé.
– Et pourquoi voulez-vous qu’il soit changé ?
– Dame, un mois de Céline Faravel !
– Eh bien, après ?
– À son âge.
– Il est plus jeune que vous qui avez trente ans ; et puis ce n’est pas pour Céline Faravel qu’il a été à Londres, c’est pour ses chevaux.
– Mettons que c’est pour ses chevaux et pour sa maîtresse.
– Pour ses chevaux seulement, et il a joliment tiré profit de son voyage, il a vendu une part de son écurie de course à Naïma-Effendi pour cinq cent mille francs et il en garde la direction ; si le Turc gagne quelque chose, je connais quelqu’un qui sera bien étonné.
– Pas maladroit, le patron, quand il veut s’en donner la peine.
– Le malheur est qu’il ne se donne de la peine que pour ce qui n’en vaut pas la peine ; ah ! s’il voulait employer son habileté au profit de la maison !
– Enfin, le trouvez-vous changé ?
– Pas du tout ; aussi vert, aussi fringant, aussi vainqueur que toujours, il ne changera jamais.
Pendant ce temps, il avait monté l’escalier et, arrivé dans son cabinet, il avait tiré un cordon de sonnette, puis, quand il avait été installé dans un fauteuil en face de la fenêtre ouverte, il avait jeté sa jambe droite par dessus sa jambe gauche, et au domestique qui s’était empressé d’accourir, il avait adressé sa phrase habituelle :
– Prévenez M. Fourcy que je suis arrivé.
Fourcy s’était présenté presque aussitôt, suivi de son secrétaire chargé de papiers et M. Charlemont lui avait dit, comme d’ordinaire, sans se lever et en lui tendant la main :
– Bonjour, Jacques, comment vas-tu ?
– C’est à vous, monsieur, qu’il faut adresser cette demande.
– Bien, très bien, comme tu vois ; quoi de nouveau ?
– Mes lettres, dit Fourcy, en s’asseyant au bureau, ont dû vous tenir au courant.
– Elles ont dû, cela est vrai, seulement je t’avoue que je n’ai pas eu le temps de les lire toutes ; j’ai été entraîné dans un tourbillon ; c’était la fin de la saison, à peine ai-je trouvé le temps de faire ma toilette ; sais-tu qu’à Londres, dans ce pays de la suie, il faut, pour être à peu près propre, changer de chemise trois ou quatre fois par jour ; alors, tu comprends, n’est-ce pas ?
Fourcy comprit d’autant mieux qu’il était habitué à ces façons de son chef, l’homme de Paris assurément qui avait la plus vive répugnance pour la lecture manuscrite aussi bien qu’imprimée, et, tout de suite, sans perdre son temps en plaintes ou en remontrances vaines, il se mit à exposer, pièces en mains, ce qu’il avait déjà raconté par ses lettres, c’est-à-dire ce qui s’était passé pendant l’absence de M. Charlemont.
Tout d’abord celui-ci écouta assez attentivement, décidant d’un mot les cas qui étaient soumis à son appréciation et qui exigeaient une solution ; mais bientôt il donna des signes manifestes de fatigue et d’ennui ; il s’agita sur son fauteuil, se pencha en avant, se rejeta en arrière, alluma un cigare, le lança dans le jardin après quelques bouffées ; enfin, n’y tenant plus, il interrompit Fourcy :
– Assez d’affaires pour aujourd’hui, dit-il, autre chose si tu veux bien.
– Mais...
– Autre chose que tu me pardonneras en ta qualité de père de famille, de bon père : donne-moi des nouvelles de Robert ; rentré de cette nuit, je l’ai fait appeler ce matin, mais monsieur mon fils n’a pas couché chez lui ; comment va-t-il ?
– Très bien et les nouvelles que je vous donne sont toutes fraîches, de ce matin même, car il a couché chez moi à Nogent ; rassurez-vous donc.
– Ce n’était pas de savoir où mon fils avait couché que j’étais préoccupé, mon brave Jacques, je ne suis pas un père bien sévère, d’ailleurs Robert a dix-neuf ans, et il est assez grand garçon pour coucher où bon lui semble ; ces exigences sont bonnes pour un père tel que toi et non pour un père tel que moi, car si j’adressais cette question à mon fils : « Où as-tu couché ? » il pourrait très bien me répondre : « Et toi ? » ce qui serait quelquefois gênant.
– Il ne se permettrait pas une pareille question.
– Heu, heu ; enfin je voulais tout simplement savoir comment il allait, car pendant cette absence, il ne m’a pas accablé de ses lettres... Il est vrai que de mon côté je ne l’ai pas non plus accablé des miennes ; pour tout dire, il me semble qu’il ne m’a pas écrit.
– Dites que vous n’avez pas reçu ses lettres.
– C’est possible ; enfin, tu l’as vu pendant cette absence ?
– Très souvent, surtout en ces derniers temps, car je vous avoue que j’ai cherché à l’attirer à Nogent, et, grâce à sa camaraderie avec Lucien, j’ai réussi ; depuis huit jours, il est à la maison et, comme j’ai donné un congé de quinze jours à Lucien, ils restent tous les deux à se promener aux environs, à pêcher, à faire du canotage.
– Je suis enchanté de cela, Robert a tout à gagner avec Lucien, car ton fils est un brave garçon, il est digne de toi.
La figure de Fourcy s’épanouit, non pour le compliment qui lui était adressé, mais pour celui qui était fait à son fils, dont il était fier ; mais ce sourire de bonheur et d’orgueil paternel ne fut qu’un éclair, son front se contracta et son regard s’obscurcit ; évidemment il était sous le coup d’une préoccupation pénible.
– Je dois vous expliquer, dit-il, pourquoi j’ai tenu si vivement à attirer Robert dans mon intérieur et à l’y retenir.
– N’est-ce pas tout naturel ? ton fils et le mien ont fait leurs classes ensemble, ils sont camarades.
– Cette raison ne m’eût pas déterminé si je n’en avais pas eu d’autres d’un ordre plus élevé, car, par sa position, son nom, sa fortune, Robert doit vivre dans un autre monde que le nôtre.
– Quelles raisons ? Tu m’inquiètes, parle.
Mais, avant de parler, Fourcy chercha un dossier, et, l’ayant trouvé, il prit une feuille de papier dont un des côtés était occupé par une colonne de chiffres et il la présenta à M. Charlemont :
– Voici le relevé des sommes qui ont été payées depuis trois mois pour le compte de Robert ; vous voyez le total.
– Bigre !
– Ce n’est pas seulement le total qui est grave, c’est aussi le détail des sommes payées : Haupois-Daguillon, orfèvre, 5400 francs ; Damain, joaillier, 17 000 francs, et les autres, que vous pouvez voir en suivant ; évidemment ce ne sont pas là des dépenses excusables ou tout au moins justifiables chez un jeune homme de dix-neuf ans.
– D’autant mieux qu’on ne lui connaît pas de maîtresse en titre.
– J’ai dû croire cependant qu’il en avait une, car il n’est pas probable qu’il achète des bijoux pour lui-même, et il n’est pas probable non plus que ce soit pour ses dépenses personnelles qu’il ait eu recours aux usuriers et particulièrement à Carbans qui a ruiné tant de jeunes gens : Carbans a d’autant plus facilement prêté qu’il sait que dans deux ans Robert sera mis en possession de son héritage maternel.
– Et que doit-il à Carbans ?
– Je n’en sais rien, mais le certain, c’est qu’il est entre les mains de ce coquin ; ce sera à voir au moment de le tirer de là ; pour le présent, en vous attendant, j’ai fait le possible pour l’arracher à la vie de Paris et l’attirer à Nogent.
– Et tu dis qu’il est resté chez toi ?
– Depuis huit jours.
– Sans venir à Paris ?
– Sans venir à Paris.
– Voilà vraiment qui ne s’explique que si sa maîtresse est elle-même absente de Paris en ce moment ; car il est évident que c’est cette maîtresse qui lui fait faire ces dépenses et ces dettes. Maintenant, quelle est cette femme, voilà l’inquiétant. Il est certain que si c’était une femme en vue, une femme de théâtre ou une cocotte, on connaîtrait leur liaison : une de ces femmes n’a pas Robert Charlemont, unique héritier de la maison Charlemont, pour amant, même en second ou en troisième, sans que cela se sache. S’il en était ainsi, il n’y aurait pas à s’en tourmenter, même quand elle l’entraînerait à quelque folie, c’est-à-dire à de grosses dépenses ; on guérit de cette folie-là ou tout au moins on en change, ce qui est un genre de guérison. Non, ce qui m’inquiète, c’est de penser que la femme que nous cherchons est une femme du monde, ce qu’on appelle une honnête femme. Et ce compte d’argent dépensé par Robert, montre comment elle entend et pratique l’honnêteté.
– C’est impossible.
– Impossible à admettre pour toi, mais non pas impossible dans la réalité ; ce genre de femme se rencontre, je ne dis point à chaque pas, mais encore très souvent, crois-en l’expérience d’un homme qui connaît le monde et la vie ; c’est là la femme que je crains, car, avec une nature comme Robert, elle peut exercer une influence désastreuse. Il ne faut pas s’y tromper, Robert est une nature féminine, capable de grandes choses ou de très vilaines choses, selon qu’il sera poussé dans un sens ou dans un autre. Par certains côtés, il tient de sa mère ; mais sa mère a été la meilleure des femmes, la plus tendre et la plus digne ; tandis que je ne sais pas ce qu’il sera ; il y a en lui des coins sombres et mystérieux qui ne m’ont jamais rien dit de bon. Ah ! si j’avais pu m’occuper de son enfance ! Mais était-ce possible avec ma vie ? Si j’avais pu surveiller sa jeunesse ! En tous cas, il faut, pour le moment, que nous cherchions quelle est cette femme, sa maîtresse, et que nous ne le laissions pas aller plus loin dans la voie où elle l’a amené et où elle le pousse. Tu m’aideras.
Ce n’était point l’habitude de M. Charlemont de parler si longuement et sur ce ton ; il fallait vraiment que ce que Fourcy lui avait dit et le compte qu’il lui avait montré l’eût ému plus profondément qu’il ne se laissait ordinairement toucher.
Mais il ne resta pas sous cette impression, car il avait horreur de ce qui le troublait ou l’affectait péniblement, et il cherchait toujours à s’en débarrasser aussi vite que possible.
– Et chez toi comment vont les choses ? dit-il en homme qui veut changer le sujet de l’entretien ; tu es toujours content de Lucien et de Marcelle ?
– Aussi content que peut l’être le père le plus exigeant. Pour le travail et pour tout, Lucien m’a satisfait pleinement ; depuis un an bientôt qu’il est dans cette maison, on n’a pas eu un reproche à lui adresser ; et je ne l’ai pas traité avec l’indulgence d’un père faible, croyez-le bien.
– Tu vois donc que j’ai eu bien raison de combattre ton idée d’École polytechnique.
– Ce n’était pas mon idée, c’était celle de Lucien, et c’était parce que je voyais en lui une sorte de vocation pour la science que j’avais scrupule de la contrarier.
– La vocation de ne rien faire, je comprends cela, mais la vocation du travail, du travail ingrat, du travail pour le travail lui-même, c’est trop naïf ; où l’École polytechnique aurait-elle conduit Lucien ? à mourir de faim dans quelque fonction honorable. Je le veux bien, mais misérable ; heureusement que madame Fourcy, qui est un esprit pratique, a compris cela et tandis que je te faisais de l’opposition de mon côté, elle t’en faisait du sien, de sorte que nous l’avons emporté ; voilà Lucien dans la maison : il y fera son chemin comme tu y as fait le tien, et il sera pour Robert ce que tu as été pour moi : nous y trouverons tous notre compte. Lucien ne se plaint pas ?
– Certes non.
– Voilà ce que c’est que la vocation ; à douze ans, on a la vocation de la marine pour Robinson ; à quinze ans on a celle de l’École polytechnique pour le manteau et l’épée ; mais à vingt, un peu plus tôt, un peu plus tard, on commence à comprendre qu’il n’y a qu’une chose dans la vie : gagner de l’argent, et que la plus belle profession est celle qui nous en fait gagner davantage et le plus vite possible.
– Ce n’est pas à ce point de vue que Lucien se place.
– Je pense bien, mais il est en bon chemin, il y arrivera ; je suis tranquille pour lui ; et Marcelle ? son mariage ?
– Les choses en sont toujours au même point.
– C’est étrange ; comment votre marquis italien ne met-il pas plus d’empressement à épouser une belle fille telle que la tienne ?
– Rien ne presse, Marcelle n’a que dix-huit ans, et sa mère aussi bien que moi nous désirons ne pas la marier trop jeune ; pour mon compte, j’aurais voulu ne pas la marier avant qu’elle eût atteint la vingtième année ; c’était une date que je m’étais fixée, non par égoïsme paternel, non pour l’avoir plus longtemps à moi, bien que je l’aime tendrement, vous le savez, et que la pensée d’une séparation me soit cruelle, mais pour elle, dans son intérêt ; aussi ai-je vu avec chagrin le marquis Collio la rechercher, en même temps que j’ai vu avec regret Marcelle se montrer sensible aux attentions du marquis. Maintenant le marquis ne parle pas de mariage et ne m’adresse point une demande formelle, c’est tant mieux ; ma femme et moi nous sommes heureux de gagner du temps ; nous ne voyons aucun inconvénient à ce que le marquis fasse longuement sa cour ; nous apprenons ainsi à le mieux connaître ; c’est un charmant garçon ; chevaleresque, plein de délicatesse, aussi noble par les sentiments et le caractère que par la naissance.
– Riche ?
– En biens fonds, oui, je le crois, mais ses biens sont grevés de dettes, c’est cette situation embarrassée qui lui a été léguée par sa famille, mais qu’il n’a pas faite, qui l’a décidé à embrasser la carrière militaire.
– Capitaine et attaché militaire à l’ambassade d’Italie, ce n’est peut-être pas un moyen pratique de payer ces dettes.
– En ce moment non, mais plus tard ; et puis en tous cas cela vaut mieux que de traîner une vie inoccupée dans un château du Milanais ; on lui reconnaît un bel avenir.
– Enfin il vous plaît.
– Il plaît beaucoup à ma femme, et il ne déplaît point à Marcelle ; pour moi, j’avoue que j’aimerais mieux pour gendre un Français qui ne serait pas soldat, mais je ne contrarierai pas le goût de ma fille, si je vois qu’elle doit être malheureuse en ne devenant pas la femme d’Évangelista.
– Ah ! il se nomme Évangelista ?
– Évangelista marchese Collio ; il est le dernier représentant d’une grande famille du Milanais ; mais vous pensez bien que ce n’est pas là ce qui me touche, je n’ai pas d’ambition nobiliaire ; je ne veux que le bonheur de ma fille.
– Le bonheur des siens, parbleu !
– Mon Dieu oui, est-il rien de plus doux que de rendre heureux ceux qu’on aime ? À ce propos, je dois vous prévenir que je ne viendrai pas demain à Paris, de façon à ce que nous nous entendions aujourd’hui sur les recommandations que vous pouvez avoir à me faire.
– Moi des recommandations à te faire, mon cher Fourcy, vraiment ce serait bien drôle.
– C’est l’anniversaire de notre mariage, et pour nous c’est la grande fête de la famille ; nous célébrerons demain cette fête après vingt ans de mariage, avec autant de joie que nous l’avons célébrée après notre première année, et même avec un bonheur plus complet encore, puisque nos enfants s’associeront à nous.
– Sais-tu que tu es un homme unique au monde, mon brave Jacques ; ce que je n’ai jamais rencontré : pleinement heureux et digne de son bonheur ; je t’admire encore plus que je ne t’envie ; j’admire ton existence entre une femme que tu aimes comme si tu avais vingt ans et des enfants qui sont aussi bons que charmants ; j’admire la sagesse de ta vie et la modération de ton caractère ; et cela je peux dire que je l’envie autant que je l’admire.
Puis tout à coup, changeant de ton, comme s’il obéissait à une pensée qui venait de se présenter à son esprit :
– Et en quoi consiste cette fête d’anniversaire ? demanda-t-il.
– Le matin un landau viendra nous prendre à Nogent et nous conduira au restaurant Gillet, à l’entrée du bois de Boulogne ; c’est là que s’est fait notre dîner de noces quand je n’étais encore que caissier, et nous allons y déjeuner une fois tous les ans, ma femme, nos deux enfants et moi, ce jour même de notre anniversaire ; c’est par là que commence notre fête, puis ensuite nous faisons une promenade en voiture dans le bois et autour du lac comme nous en avons fait une le jour de notre mariage, nous passons aux endroits où nous avons passé ; c’est un pèlerinage. « Te souviens-tu ? » et nous remontons de vingt ans en arrière.
– Si on pouvait y rester.
– Nous n’y tenons pas ; notre présent est aussi heureux que l’a été notre passé et pour moi ma femme a toujours les seize ans qu’elle avait à l’époque de notre mariage. Notre promenade faite, nous rentrons grand train à la maison pour recevoir nos amis qui viennent nous apporter leurs compliments et dîner avec nous.
– Alors, la table est complète ?
– Avec toutes ses rallonges, oui, cependant nous n’avons que nos amis intimes auxquels se joindront cette année votre fils puisqu’il est notre hôte, et aussi le marquis Collio.
– De sorte que si je te demandais une place à cette table, il serait impossible de me la trouver.
– Vous, monsieur Amédée !
– Et pourquoi pas ?
Fourcy était manifestement sous le coup d’une profonde émotion, d’un trouble de joie ; il attendit quelques secondes avant de répondre :
– Parce qu’il est des faveurs qu’on désire vivement, dit-il enfin d’une voix vibrante, mais que précisément pour cela on n’ose pas solliciter.
– Laisse-moi te dire, mon bon Jacques, que tu me traites beaucoup trop cérémonieusement. Pourquoi ne m’as-tu jamais invité chez toi ? Tu vas me répondre : « Pourquoi n’êtes-vous jamais venu ? » Et tu auras raison, au moins jusqu’à un certain point. Mais comment veux-tu que dans le tourbillon qui m’emporte j’aie le temps de faire ce que je désire ? Je vais où la fantaisie de l’heure présente m’entraîne et jamais où j’avais décidé la veille d’aller. Voilà comment jusqu’à présent je n’ai jamais pu te faire ma visite à Nogent. Maintenant qu’une bonne occasion se présente, je la saisis au passage, et si tu veux de moi, demain je serai ton convive, avec tes autres amis.
Fourcy se leva vivement et venant à M. Charlemont, il lui prit les deux mains qu’il serra avec effusion.
– Ne suis-je pas ton plus vieil ami, dit M. Charlemont, et ne devrais-tu pas agir avec moi sans cette réserve et cette discrétion que tu apportes dans nos relations, comme si tu étais encore le petit Jacques ; ne sommes-nous pas associés ?
Puis, s’arrêtant sur ce mot, mais pour reprendre aussitôt :
– Puisque ce mot est prononcé entre nous, je te préviens que mon intention est que désormais il soit une réalité ; si cette maison a repris un peu de son ancienne prospérité, c’est à toi qu’elle le doit, car entre mes mains elle aurait fini par s’effondrer. Il est juste que celui qui l’a relevée et qui la soutient participe aux bénéfices qu’elle donne. À partir du 1er janvier prochain tu auras donc une part dans les bénéfices qu’elle produit, et cela dans une proportion que nous discuterons et que nous arrêterons ensemble. Pour aujourd’hui je n’ai voulu que poser le principe.
L’émotion de Fourcy était si vive qu’elle l’empêcha de trouver des paroles pour traduire ce qui se passait en lui : l’associé de la maison Charlemont, lui le petit Jacques, le fils du garçon de bureau !
M. Charlemont s’était levé et au moment où Fourcy allait enfin pouvoir exprimer ses sentiments de reconnaissance et de joie il lui coupa la parole :
– À demain, dit-il.
– Mais, monsieur, vous me laisserez bien...
– Rien, dit-il, à demain, je suis pressé.
Et il partit sans rien vouloir entendre, marchant gaillardement en chantonnant.
IV
C’était après la guerre que Fourcy avait acheté sa maison de Nogent.
En se promenant un dimanche avec sa femme et ses deux jeunes enfants, pour visiter les positions occupées par les armées et se rendre compte par les yeux des combats dont ils avaient lu ou entendu les récits, ils étaient entrés dans une propriété où l’on avait établi une batterie.
C’était dans la grande rue : au milieu des maisons, ils avaient trouvé une allée ouverte entre deux murs garnis de lierre du haut en bas, et en la suivant, ils étaient arrivés sur une pelouse qui s’étalait entre des communs et une grande maison de belle apparence, sans trop savoir où ils allaient, et surtout sans se douter de la vue qu’ils allaient rencontrer là : à leurs pieds, ils avaient la Marne, dont le cours, gracieusement arrondi, était dessiné par une double ligne d’arbres, qui, çà et là, au caprice des branches et du feuillage, ouvrait des perspectives changeantes sur les eaux miroitantes de la rivière : à leur gauche le viaduc du chemin de fer passant à travers les cimes des peupliers ; à leur droite, le village de Joinville se profilant nettement sur le ciel : enfin en face d’eux, au delà des prairies, les coteaux qui montent doucement pour aller finir d’un côté à Noisy et de l’autre à Chennevières, se perdant dans des profondeurs vaporeuses.
On était au printemps et il faisait une de ces journées de bonne chaleur et de lumière gaie où l’on se sent heureux de vivre ; après être restés enfermés pendant huit mois privés d’air et de verdure, cette sortie dans la campagne avec un horizon où les yeux s’enfonçaient librement, était une griserie pour eux.
Tandis que le mari et la femme, assis sur un arbre abattu dans les herbes, regardaient le panorama qui se déroulait devant leurs yeux, les enfants jouaient dans le jardin à escalader à quatre pattes les épaulements de la batterie ou à courir à travers les gazons coupés d’ornières, creusées par les caissons et les prolonges.
Élevée au milieu d’une pelouse à l’un des angles de la maison, celui-là même d’où la vue s’étendait librement sur les coteaux opposés, cette batterie avait naturellement attiré les obus prussiens, dont quelques-uns avaient atteint la pauvre maison, éventrant la toiture et déchirant sa façade.
Comme il n’y avait rien à prendre dans cette maison abandonnée et pillée plusieurs fois, elle était ouverte à tous venants sans qu’il y eût là un jardinier ou un concierge pour la garder ; cependant elle était à l’intérieur moins dévastée que bien d’autres, et cela précisément parce qu’elle avait été exposée au bombardement, les obus allemands lui ayant été plus cléments que ne l’eussent été les francs tireurs ou les mobiles s’ils l’avaient occupée. Ainsi, les portes, les lambris, les parquets n’étaient point brûlés, les marbres des cheminées n’étaient point tailladés à coups de sabre, les glaces n’étaient point percées de trous de balles et les pièces où n’avaient point pénétré les éclats d’obus étaient à peu près intactes.
Justement ces lambris et ces cheminées étaient fort jolis, car la maison datait de la fin du dix-huitième siècle, et tout ce qui était décoration avait été traité dans le goût de l’époque ; il y avait là des chambranles, des moulures, des dessus de porte en marbre et en bois qui étaient des œuvres d’art charmantes.
La visite de M. et madame Fourcy avait été longue, non pas que Fourcy prêtât grande attention à ces sculptures, – il ne connaissait rien aux œuvres d’art ; non pas que madame Fourcy se donnât la peine de les admirer – elle ne s’intéressait ordinairement qu’aux choses qui lui appartenaient ou dont elle pouvait tirer parti, mais parce que la maison était vaste, distribuée en pièces nombreuses avec de petits cabinets, des coins et des recoins, et aussi parce qu’ils éprouvaient un certain plaisir, dont ils ne se rendaient pas bien compte, à se promener dans ces appartements sonores où retentissait le bruit de leurs pas et de leurs voix.
Enfin, ils étaient sortis ; alors l’idée leur était venue de parcourir les jardins dont ils n’avaient vu que l’ensemble ; ils étaient assez étendus, ces jardins, et divisés en deux parties : l’une, la plus voisine de la maison, dessinée en pelouse et en bosquets, avec des allées de vieux arbres ; l’autre, inclinée vers la rivière, partagée en carrés réguliers et en plates-bandes de potager avec des arbres fruitiers en ce moment blancs de fleurs.
Lorsqu’ils étaient arrivés à l’extrémité de ce potager ils avaient trouvé une vieille femme à genoux dans un carré et coupant avec une faucille un gros paquet d’herbes, et cela non pour nettoyer ce jardin abandonné, mais pour en nourrir sa vache.
– C’est-y que vous voudriez acheter la propriété ? avait demandé la vieille en les regardant curieusement.
– Elle est donc à vendre ?
– Elle y est et elle n’y est pas ; c’est-à-dire que la propriétaire voudrait bien la garder, mais elle n’aura jamais les moyens de la remettre en état ; pour lors il faudra bien qu’elle la vende.
Ils n’avaient pas continué la conversation et quittant le village ils étaient descendus au bord de la rivière qu’ils avaient longée ; Fourcy ne parlant pas et paraissant réfléchir.
Tout à coup il s’était arrêté et se tournant vers sa femme :
– Si nous l’achetions.
– Acheter quoi ?
– La maison.
Et montrant la façade qu’on apercevait à travers les branches :
– Regarde donc comme elle a bon air et dans quelle admirable situation elle se trouve.
– Acheter une maison à Nogent, quelle idée !
– Et pourquoi acheter une maison à Nogent est-il une plus mauvaise idée qu’en acheter une à Saint-Cloud ?
– Parce que Saint-Cloud est autrement habité.
Il n’avait point répliqué, mais le lendemain soir au dîner il avait raconté qu’il était revenu à Nogent et que décidément la maison lui plaisait tout à fait ; elle était à vendre et on pourrait l’avoir pour un bon prix : sans doute, il y aurait des réparations, mais elles ne seraient pas ce qu’on pouvait croire après un premier examen ; il avait amené avec lui un architecte qui lui avait donné un devis approximatif ; enfin, toutes les raisons justificatives qu’on trouve aisément et qui abondent lorsqu’on est sous le coup d’un violent désir.
– Si tu voulais la revoir, tu me ferais plaisir.
– Alors, je la verrai demain.
Le lendemain, en effet, elle l’avait visitée de nouveau, mais cette fois dans des dispositions autres que la première ; par le fait que ces marbres et ces boiseries pour lesquels elle n’avait eu qu’un coup d’œil indifférent, pouvaient lui appartenir, ils avaient pris le mardi une importance qu’ils n’avaient pas eue le dimanche et elle leur avait trouvé des mérites qu’elle n’avait pas tout d’abord aperçus ; le point de vue aussi lui avait révélé des beautés qui lui avaient échappé, et Nogent n’avait plus été trop inférieur à Saint-Cloud.
Évidemment on pouvait tirer parti de cette vaste maison construite à une époque où le prix des matériaux et de la main-d’œuvre permettait des développements que de nos jours des millionnaires seuls peuvent se payer : elle avait grand air.
En rentrant le soir et en retrouvant son mari qui l’attendait impatiemment, madame Fourcy n’avait rien dit de cette dernière considération, mais elle avait reconnu que les objections qui s’étaient présentées le dimanche contre cette maison de Nogent n’existaient plus : pour les enfants il était bien certain qu’elle avait des avantages.
– Et pour nous n’en a-t-elle pas ? crois-tu que ce n’est pas pour moi un vif, un très vif chagrin de n’avoir pas encore pu t’offrir une maison de campagne digne de toi : sans doute depuis quelques années déjà nous aurions pu acheter quelque maisonnette, mais je ne veux pas que tu demeures dans une maisonnette, où tu serais à l’étroit et qui ne serait pas un cadre convenable pour ta beauté ; celle de Nogent est ce qu’il te faut ; je te vois venir au devant de moi sous l’allée de tilleuls quand je rentrerai, et je te vois aussi avec ton ombrelle, assise comme une châtelaine sur la terrasse en face de la Marne ; tu seras là à ta place ; tu sais bien que si j’ai jamais souhaité la fortune, ça été pour toi, pour te faire une niche qui ne soit pas indigne de ma divinité.
– Bon Jacques !
– Est-ce qu’il y a une plus grande joie au monde que de travailler pour sa femme et ses enfants ? Voilà une satisfaction dont les riches sont privés.