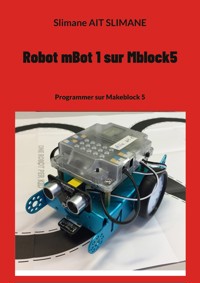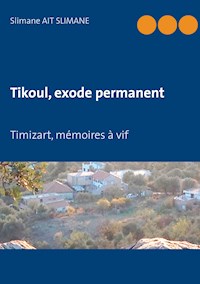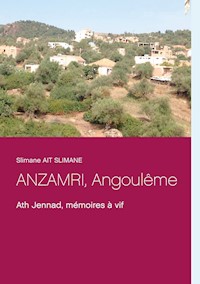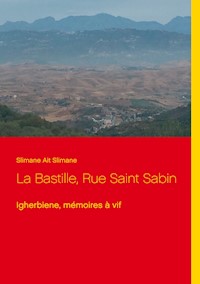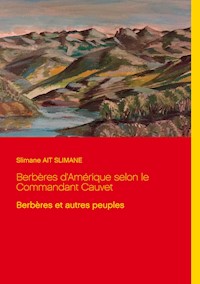
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ce livre explique l'évolution de la nomenclature ethnique, géographique et anthropologique des peuples à travers les différents continents. Il borde entre autres; le début de l'humanité, les migrations humaines, le peuplement du monde, alternance des invasions et contre invasions, les noms des tribus, des croyances et des héros. La place de la Kabylie et l'Afrique du nord dans les mouvements des noms et des peuples. Peuplement de l'Amérique; tribus venues de l'ouest et données ethnographiques. Peuplement de l'Afrique; la Berbérie, les noirs, indiens, Caucasiens et Européens. Migrations européennes parallèles.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Table Des Matieres
Avant-propos
Introduction
But de cet ouvrage.
Méthode employée.
Importance des noms ethniques pour suivre les migrations humaines.
Sources employées.
Chapitre I. Le peuplement du monde en général
Point de départ. Débuts de l’humanité.
Centres secondaires de dispersion.
Alternance des invasions et contre-invasions.
Transformation des noms de tribus en noms de dieux, de héros et d’hommes.
Progrès de l’humanité
Chapitre II. Le peuplement de l’Amérique
Tribus venues de l’Ouest et de l’Est.
Données ethnographiques les plus caractéristiques.
Chapitre III. Le peuplement de l’Afrique et en particulier de la Berbérie : Négrilles, nègres, Indiens, Caucasiens, Européens
Chapitre IV. Nomenclature alphabétique et examen des noms de tribus communs à la Berbérie et à l’Amérique
Chapitre V — Conclusions
Époque probable des migrations berbères
Rôle hypothétique de l'Atlantide
Migrations européennes parallèles
Importance minime des migrations berbères étudiées
AVANT- PROPOS
Quelques années avant la conquête de la Gaule transalpine par Jules César, Quintus Coecilius Metellus Celer, propréteur, qui gouvernait la Cisalpine, reçut, dit-on, en cadeau d’un chef germain des hommes noirs d’une race inconnue que la mer avait jetés sur les cotes de la Germanie.
Ce fait attira l'attention des savants romains. Pline, prenant ces sauvages étranges pour des Indiens, y vit une preuve éclatante de la continuité de l’Océan autour de l’Afrique. En réalité, c’étaient des Indiens d’Amérique que la tempête et les courants avaient porté sur les cotes européennes. Mais on ignorait alors la sphéricité de la terre et l’existence du continent américain.
Jusqu’a la découverte de D’Amérique, on compte au moins quatre autres faits authentiques du même genre et Beuchat les a enregistres dans son Manuel d’Archéologie Américaine (p. →).
Si l’on considère que les courants équatoriaux, qui balaient les rivages de l’Europe et de l’Afrique, aboutissent bien plus surement à la mer des Antilles ou au Brésil que ne le font, en ce qui concerne le vieux monde, ceux qui, suivent une direction inverse, on se rendra compte que, certainement, des faits analogues se sont produits en plus grand nombre de l’Est vers l’Ouest. Songeons, d’ailleurs, à l’état de perfection ou les marines anciennes étaient parvenues à une époque fort-reculée, au cabotage qu’elles faisaient sur la cote océanienne, entre les colonies phéniciennes, et a leurs courses aventureuses au Nord et au Sud.
Le retard considérable des civilisations anciennes d’Amérique, la perte à peu près complète de toutes leurs traditions, expliquent que nous ne sachions rien à ce sujet. Il faut convenir, du reste, qu’aucune tentative bien sérieuse n’a été entreprise pour étudier cette question.
J’ai pense qu’a la lueur des noms ethniques, si importants pour suivre les migrations des peuplés anciens, il serait possible de commencer des recherches fructueuses. C’est cette étude que je livre au public à l’occasion du centenaire de cette Algérie ou je vis depuis bientôt un demi-siècle et ou m’avaient précédé mon père et un grand oncle aux temps héroïques de notre installation.
Commandant G. Cauvet.
Birmandreïs, janvier 1930
INTRODUCTION
But de cet ouvrage. Méthode employée. Importance des noms ethniques pour suivre les migrations humaines. Sources utilisées.
En recherchant les origines des Touareg, (1) j’ai constaté que certains noms de peuplés Berbères étaient portes par des tribus indiennes d'Amérique de sorte que j’ai du examiner dans quelles conditions ce fait intéressant avait pas se produire. Y a t-il eu des migrations d’Afrique en Amérique ou est-ce l’inverse? Ou bien y a-t-il eu arrivée simultanée des deux cotes de peuplés provenant de l’Asie ?
C’est le résultat de cette étude, de nature à intéresser les personnes qui s’inquiètent de ces questions, que je veux donner sommairement dans ce livre.
Comme mes recherches sont surtout effectuées au moyen des noms ethniques, que je poursuis dans le temps et dans l’espace, dans les nomenclatures anciennes et modernes et sur les cartes géographiques, il convient qu’au préalable je justifie de cette méthode et que je prenne la défense ces noms forts mal vus de la science moderne.
«Ils sont la peste de l'anthropologie» a dit un de nos contemporains, généralement approuvé, (Boule. Hommes fossiles 322. note).
(1) Mes recherches ont paru clans le Bulletin de la Société de Géographie d’Alger : Les noms des tribus Touareg. IIIe trimestre 1924.
Les origines caucasiennes des Touareg. IVe Trimestre 1924 et 1er1925.
La formation celtique d e la nation Targuie IV e trimestre 1925, Ier et IIème 1926.
Les origines orientales des Berbères, IIe trimestre 1927. Antée, héros africain, IIe trimestre 1928.
Je ne partage pas cette opinion. Elle ne tient aucun compte d’un des besoins humains primordiaux qui est de donner un nom, voire un surnom à ce que nous cherchons à connaitre. Aussi qu’arrive-t-il? Nous inventons maintenant des désignations factices qui ne valent pas mieux, hommes des dolmens, peuple des gobelets, paréens, virôs, nésiotes, prospecteurs ! On peut voir jusqu’ou va cette nécessite en consultant le livre d’Haddon sur les races humaines récemment traduit par M.Van Gennep. Il est préférable à mon sens de se mettre avec courage à rechercher les identifications des noms ethniques que nous connaissons historiquement. Elles doivent nous donner des résultats, tout au moins pour nos néolithiques.
Les diverses branches de la science qui a trait a la connaissance de l’homme se doivent un mutuel appui, ce qu’elles ne font pas actuellement.
Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner les classifications multiples données non seulement par chacune d’elles, mais même par chaque savant dans un même ordre de connaissances. Naturalistes, géologues, paléontologues, archéologues, linguistes ne cessent de modifier les appellations, chacun d’une manière différente, suivant les théories qui sont a l’ordre du jour.
L’onomastique tribale et géographique seule ne change pas au gré de la fantaisie individuelle ; si celle-ci s’en empare pour un temps, ses effets ne tardent pas à disparaitre tandis que les noms restent. Les modifications qu’ils peuvent subir n'empêchent pas de les suivre. Ils font partie du bagage des peuplés émigrants au même titre que leurs coutumes, leur conformation physique, leur langue, leur religion.
Que tous les noms ethniques aient eu, au début, un sens propre, cela parait probable, mais, depuis des siècles, parfois des millénaires qu’ils trainent au travers du monde, on l'a perdu de vue. Des changements d’habitat, de langue, de culture et les altérations qu’ils ont entrainées dans ces mots eux-mêmes les rendent méconnaissables. Il parait, en tout cas bien difficile de les retrouver sur place dans la plupart des cas. Beaucoup de noms primitifs paraissent avoir été tires des qualités physiques ou des particularités de l’habitat des peuplés qui ont pris ces désignations ou qui les ont reçues de leurs voisins. Guerriers, hommes, montagnards, rouges, blancs, noirs, gens d’en haut, d’en bas, du Nord, de l’Ouest, gens de l’ombre, les milliers etc. Parfois des noms totémiques d’animaux ou d'objets désignent des fractions ou clans. Plus simplement, ce sont les noms du pays habité par la tribu, région, ville, montagne et surtout vallée d’un fleuve. Ce dernier cas était habituel chez les Touraniens. Parfois on rencontre des surnoms péjoratifs comme Vara-Vara, d’où est venu le nom Berbère, Zanaga, d’ou est venu le nom de Sanhadja qui « ont » tous deux la signification de bredouilleurs. Certaines tribus, et c’est le cas général pour les Sémites, prennent le nom patronymique de leur aieul, de leur chef du moment ou de leur chef le plus ancien, de leur dieu ou d’un personnage particulièrement vénéré. Ils en fabriquent au besoin en transformant leurs anciens noms en patronymes. Leur fureur généalogique a été partagée par certains peuplés notamment les Grecs et les Arméniens, ce qui joint a d’autres détails, montre combien ils sont près du sang sémite.
J’admets fort bien que les noms ethniques ne Nous renseignent pas toujours exactement sur les caractères moraux et physiques de la race qui les porte. Pouchet dans son étude sur la pluralité des races humaines, (p. →) fait remarquer avec raison qu’ils survivent à la disparition de leurs premiers possesseurs en passant à des populations nouvelles qui leur ont succédé.
M. Vacher de Lapouge a décrit cette transformation, lorsqu’elle s’effectue lentement, sous le nom de sélection interstitielle. Il en donné comme exemple remarquable l’action des musulmans qui se livrent a la traite des nègres dans l’Est de l’Afrique et qui par le jeu de leur polygamie introduisent de plus en plus leur sang au milieu des populations noires qu’ils exploitent.
Il ne faut donc pas demander aux noms ethniques plus qu’ils ne peuvent nous donner et on doit tenir compte de toutes les causes qui altèrent l’exactitude des renseignements qu’ils nous apportent. Mais pouvons-nous attendre davantage des autres sciences anthropologiques ? Prenons l’anthropologie pure, la somatologie humaine. Elle semblerait devoir nous donner les témoignages les plus solides et les plus convaincants.
Il n’en est rien, car elle nous apporte des données souvent fragiles et contradictoires.
C’est ainsi que la forme du squelette et du crane principalement, est regardée comme un indice des plus surs pour distinguer les races. Or Darwin dans ses études sur la Variation des animaux et des plantes (I chap III) nous donné un exemple célèbre du contraire. Il s’agit du bétail dit «Gnato» qui est devenu incontestablement brachycéphale, spontanément et sans croisements possibles, depuis son importation en Amérique, c’est-a-dire en quelques siècles. L’espèce canine nous donne des exemples non moins remarquables de variations bien qu’elles n’aient pu être suivies aussi nettement dans le temps. Il est clair que des transformations aussi brusques peuvent se produire dans les races humaines.
Une seule loi, comme l’a montre Broca, parait se dégager assez clairement de toutes les controverses engagées sur cette matière, c’est que dans les mélanges de peuples, déjà diversifiés sous l’emprise des causes extérieures de toute nature, c’est le plus nombreux qui finit par l’emporter et qui imprime à l’ensemble ses principaux caractères. Sans cela on ne s’expliquerait pas, par exemple, que la nation française soit composée principalement de brachycéphales alors que son territoire a été traversé a maintes reprises par de nombreux dolichoïdes et que les peuplés qui l’entourent, Espagnols et Anglais sont encore de ce type. De même l’Inde semble avoir été subjuguée a maintes reprises par des multitudes brachycéphales venues du Nord.
Elle n’en est pas moins restée un bloc dolichocéphale (Pittard. Les races et l’histoire. 491.) De même la Berberie, fille de l’Inde, ne nous montre guère que des cranes allonges, bien que de nombreux Touraniens au crane arrondi soient venus a toute époque se fondre dans sa population.
Les indices somatologiques ne peuvent donc entrer seuls en ligne de compte pour déterminer les origines d’un peuple. Cela ne veut pas dire toutefois qu’ils ne puissent donner, le cas échéant, de fort utiles indications.
Il en est de même de la linguistique. Certains peuples changent de langue avec la facilite la plus grande. Avant de parvenir a l’emplacement ou nous les trouvons de nos jours, ils ont peut être déjà parle trois ou quatre langues différentes de celle qu’ils utilisent a présent. J’en trouve un exemple récent et très frappant dans l’étude que M. J.Deny consacre aux langues de l’Asie septentrionale (Langues du monde, 187) Il cite, en effet, une peuplade de langue Samoyede, les Kamassi, qui ont changé d’idiome deux fois, et ont, par la suite, parlé trois langues différentes au cours d'un demi-siècle, et cela sans migration, par le seul effet de l’influence des races voisines prépondérantes.
J’aurais plus de confiance dans la phonétique expérimentale. Quand cette nouvelle science aura réellement pris corps, elle permettra sans doute de rattacher aux modifications héréditaires des organes vocaux de certains peuplés, les altérations phonétiques qu’ils font subir a la langue parlée par eux; parce moyen elle fera peut-être connaitre leur filiation véritable.
Je n’en dirai pas autant de la science étymologique. Il est certain qu’elle a rendu et peut rendre encore de gros services, mais d’une manière générale on en a abuse. En cherchant exclusivement dans les langues locales, ou même parfois dans les langues anciennes, comme le sanscrit, l’origine et la signification de noms ethniques qui, depuis longtemps, n’ont plus aucune signification, je crois qu’on perd inutilement sa peine. Pour mon compte je m'abstiendrai autant que possible d’en donner.
L’ethnographie proprement dite, c’est-à-dire l’étude des coutumes des tribus, et l’archéologie préhistorique fournissent une importante et excellente contribution a la recherche des origines, mais j’aurai déjà assez à faire pour traiter congrument mon sujet, limite a l’étude des noms ethniques.
Je me contenterai donc de m’appuyer à l’occasion sur des faits bien connus, mais sans m’astreindre à faire la moindre recherche dans cet ordre d’idées.
La paléontologie humaine, malgré l’intérêt qu’elle présente, ne peut me fournir beaucoup de données utilisables. Les matériaux qu’elle met en œuvre sont encore trop peu nombreux, trop localises en de rares points da nos régions, alors que nous ignorons encore à peu près tout des régions où ont du se former les races humaines primitives.
Les sources auxquelles je puiserai ma documentation sont assez restreintes.
Du coté de l’Amérique, j’aurai uniquement pour me guider le Diccionario ethnografico américano de M. Gabriel Maria Vergara Martin (Madrid 1322). Je me conformerai scrupuleusement a son orthographe (1) et je suivrai le même ordre alphabétique. Je m’abstiendrai, habituellement, de chercher ailleurs d’autres noms et des transcriptions différentes, bien que je puisse en trouver dans d’autres ouvrages récents, comme le Manuel d’Archéologie américaine de Beuchat, les Races et les Peuples de la Terre de Deniker (édition de 1926) et les Langues du Monde de Meillet et Cohen.
Dans ce dernier ouvrage, M.P. Rivet en faisant l’inventaire des idiomes américains, a été amené à donner beaucoup de noms de tribus, transcrits très différemment de ceux de M. G.M.V. Martin. Mais j’estime qu’il est préférable de n’avoir qu’un guide unique et, par suite, de s’adresser au plus complet.
Eu outre, il offre l’avantage inappréciable d’être alphabétique. Les transcriptions de M. Rivet conformes aux principes de la linguistique moderne, sont susceptibles de dérouter ceux qui ne sont pas initiés à la beauté des accentuations de toute espèce, qui servent à rendre plus correctement les mots des langues étrangères. J’ajouterai que la langue espagnole me parait se prêter mieux que toute autre a transcrire les noms berbères il convient, a ce sujet, de remarquer que les lettres espagnoles n’ont pas toujours la même valeur que chez nous. Toutes se prononcent: le E équivaut toujours à notre E ferme. L’U comme dans toutes les langues autres que le français se prononce OU ; le J se tend par une aspiration très gutturale.
En ce qui concerne l’Afrique, j’aurai principalement recours au Répertoire alphabétique des tribus et douars-communes de l’Algérie, (édition 1900) pour l’Algérie. Ce document précieux, du a la sollicitude de des gouverneurs généraux, parait fort négligé, bien a tort d’ailleurs, par les savants. C’est sans doute en raison de son caractère administratif. On doit en outre reconnaitre que son rédacteur a eu l'idée singulière de grouper ensemble toutes les appellations commençant par Ahl (gens de), Ait (fils de, en berbère), Azib (établissement), Beni ou Banou (fils de), Djebel (montagne), Doui (descendant de) El (article arabe). Oulad (enfants de), Zaouia, etc.
(1) C’est ainsi que je conserve le pluriel en S de ses noms de tribus bien que j’en reprouve personnellement l’emploi.
En réalité c’est une bonne dizaine de répertoires distincts qu’il faut compulser et non un seul. Sans ce defaut ce recueil serait extrêmement pratique.
La Tunisie qui a imite avec raison l’Algérie, possède une Nomenclature et Répartition des Tribus de Tunisie (1900) non moins utile, pourvue d’un index alphabétique.
Au Maroc, bien que l’organisation ne soit pas encore bien complètement assise, il existe aussi une nomenclature intitulée Organisation territoriale du Maroc et Commandement indigène (1er Novembre 1921). Pour le Maroc espagnol qui n’y est pas compris, on peut s’adresser au livre de M. V. Piquet,
Le Peuple Marocain, le bloc berbère (1925) et a celui du Commandant Bernard. Les tribus du Nord et du Nord-Ouest du Maroc (1926).
Lorsqu’on étudie ces répertoires, on est frappe de cette vitalité des noms ethniques que je signalais plus haut. Partout on constate la répétition des mêmes appellations, diversement altérées, mais cependant reconnaissables dans les diverses parties de la Berberie. Ce fait, appuyé des quelques notions que nous donnent les historiens de toutes les époques, permet de constater une fragmentation et un éparpillement extraordinaires des anciennes tribus, dus aux invasions qui ont bouleversé le pays. En même temps il décèle une direction générale bien marquée, une sorte de glissement de tous les éléments humains de la Berberie de l'Est vers l'Ouest ; les exceptions à cette règle paraissent fort rares. C’est surtout sur cette persistance des dénominations ethniques que je veux attirer l’attention. Je n’hésite pas a croire qu’elle est au moins égale, sinon supérieure, a celle des caractères somatiques, qui peuvent varier brusquement, surtout sous l’influence des croisements répétés, et a celle des survivances linguistiques.
Une autre observation doit encore être faite a propos des nomenclatures ethniques de la Berberie. Très souvent, les noms des collectivités ne sont accompagnes d’aucun des termes arabes ou berbères qni indiquent la descendance patronymique comme Ahl, Ait, Beni ou Banou, Doui, Ida ou, Oulad. Ils ne sont même pas arabises ou berbérisés, la plupart du temps, et présentent des formes complètement étrangères. Ce détail significatif permet de comprendre qu’on puisse les rechercher et les trouver dans d'autres régions.
Comme chez tous les peuples primitifs, privés d’écriture phonétique, les ancêtres des Berbères inter-changeaient librement les voyelles. Les consonnes elles mêmes sont très souvent modifiées et se remplacent entre elles avec une facilité étonnante, sans autre raison que la fantaisie individuelle.
Ces habitudes se sont conservées chez leurs descendants peu lettrés jusqu’à l'arrivée des Arabes.
Les consonnes P.V.Q.X. n’existent pas en berbère.
Les deux premiers sont remplacés par B et la troisième par K. On aura intérêt à consulter sur ces détails les Études sur les dialectes berbères et les autres travaux similaires de M. Rene Basset, ainsi que ceux du Père de Foucauld sur l’idiome des Touareg. Dans les pages qui vont suivre on trouvera une application fréquente de ces principes.
D’ailleurs, la nomenclature des tribus américaines de M. G.M.V. Martin nous montre que la plupart de ces mêmes observations peuvent être faites en ce qui les concerne; mais les consonnes qui manquent en berbère et dont l’absence parait due surtout a une influence chamitique exclusive existent, au contraire dans bon nombre de langues américaines.
Aux ouvrages modernes que je viens de citer j’ajouterai les auteurs anciens, surtout Ptolémée, bien que les Grecs aient fortement estropie tous les noms berbères. Enfin un appoint capital, et des plus intéressants, nous est fourni par les listes des généalogistes berbères musulmans, que l’on trouve en particulier dans l'Histoire des Berbères d’Ibn Khaldoun (Traduction de Slone) et dans ses divers commentateurs.
Mes recherches ne se sont pas bornées à la Berberie. Le plus souvent j’ai du enjamber l’Afrique, ou beaucoup de noms anciens ont disparu de nos jours, pour aller les rechercher a leur point de départ ou tout au moins le plus près possible de ce point. Bien des tribus berbères sont venues de la Haute Asie, de l’Inde, du Caucase.
Pallas est mon guide principal pour la haute Asie.
Pour l’Inde les ouvrages de Vivien de Saint-Martin, qui s’est occupe spécialement de cette région, et du Major Rennell constituent le fond de ma documentation. Le chapitre de la Géographie de Ptolémée sur l’Inde récemment traduit par M.Louis Renou est venu fort à propos faciliter mes recherches, avec l’Inde d’Arrien de l’édition Guillaume Bude.
Pour le Caucase, l’excellent petit guide de Mourier, avec les ouvrages de Klaproth et de Bodenstedt, m’ont rendu les plus grands services.
En ce qui concerne Klaproth je suis oblige à faire quelques réserves. Le Prince N. Troubetzkoi, dans son étude sur les langues caucasiques septentrionales (Les langues du monde p. →), nous prévient que les travaux de Klaproth «sont pleins de fautes et ne peuvent qu’induire en erreur celui qui voudra les consulter» Je veux bien croire que Klaproth qui n’a pu étudier aussi complètement que ses successeurs, un pays qu’il a simplement traverse, leur soit inferieur, et d'ailleurs il n’est plus la pour défendre ses écrits. Néanmoins, comme il ne s’agit pas ici de linguistique pure, mais surtout d’ethnographie des peuples de cette région de leur somatologie, de leurs noms et de leurs subdivisions, renseignements que je ne puis guère trouver ailleurs, aussi complets que chez Klaproth, je serai bien oblige de m’en servir. J’ajouterai d’ailleurs que je ne trouve pas de différences essentielles entre ses descriptions et celles de ses successeurs, et je préfère utiliser ses transcriptions des noms caucasiens, plus accessibles au commun des mortels que celles des linguistes modernes, dans mon expose qui n’a pas de prétentions scientifiques.
Je ne dois pas oublier de mentionner les ouvrages de géographie pure, comme celui d’Elisée Reclus et le grand Dictionnaire de géographie de Vivien de Saint-Martin, le petit Lexique de géographie ancienne de Besnier, bien qu'il soit fort sommaire, et surtout les grands atlas modernes qui m’ont rendu les plus grands services. En raison de la nature même de tous ces ouvrages, je me trouve dispense d’encombrer cette étude de références, puisqu'il s’agit de nomenclatures alphabétiques et d’index à consulter.
Sur certains points de détail seulement j’ai du consulter d'autres auteurs que j’indiquerai au fur et a mesure de mon expose. De ce nombre est la collection des publications du Bureau Américain d’ethnologie, mise si libéralement à la disposition des Sociétés Savantes par la Smithsonian Institution.
Mais là on se heurte à un autre ordre d’inconvénients ; on risque de se perdre dans l’extrême multiplicité et la minutie des détails. C'est pourquoi j’y ai eu recours fort sobrement malgré l’intérêt qu’elles présentent.
On ne trouve malheureusement pas pour toutes les contrées du monde des répertoires aussi commodes que ceux qui existent pour l’Amérique. J’ai été par suite oblige, pour faciliter mon travail et remédier aux défaillances et a l’infirmité d’une mémoire par trop infidèle, d’établir, pour mon usage personnel, différents index alphabétiques qui m’ont rendu les plus grands services, bien qu’ils ne soient pas fort complets : Berbères anciens, Tribus berbères du Maroc, Tribus arabes d’Arabie, Peuplés d’Afrique, Peuplés du Caucase, Peuplés de l’Inde, ancienne et moderne, Réseau hydrographique de l’Asie septentrionale, Tribus des Touaregs etc..
La transcription des noms propres est, comme on le sait, une chose particulièrement ardue. Ils varient considérablement suivant l’époque considérée, le pays ou ils ont été transportés et surtout suivant la nationalité et l’individualité des auteurs qui les ont recueillis. On conçoit qu’il est impossible de ne pas en tenir compte bon gré malgré. On pourra donc relever de ce chef dans cette étude, outre les altérations et déformations locales bien caractérisées, toutes sortes de variations dans l’orthographe des mêmes noms ethniques. J’espère qu’elles ne seront pas de nature à trop dérouter le lecteur.
J’ai du faire aussi un véritable abus de petites nomenclatures partielles. Dans une étude de ce genre ce n’est que la multiplicité des rapprochements qui peut offrir la somme de probabilité suffisante pour conférer quelque valeur a des conjectures qui ne sont pas appuyées sur des faits historiquement connus.
J’ai laissé à peu près entièrement de cote la question de chronologie, malgré l’importance qu’elle offre pour toutes ces migrations antéhistoriques.
Les chiffres ne sont pas mon fort; j'aurais été oblige de m’en remettre a d’autres auteurs que mes lecteurs auront avantage a consulter directement. J’aurais été pour mon compte fort embarrasse de faire un choix entre les divers systèmes de chronologie en présence, tant est grand le désaccord que l’on constate entre eux. Tandis que les préhistoriens allongent et étirent indéfiniment les époques qu’ils étudient, jonglent avec les millénaires et ne connaissent plus de limites a leur fantaisie, les historiens ont une tendance marquée à resserrer au contraire les périodes historiquement connues et a les ramener de plus en plus a des dates proches de nous.
En Égypte on raccourcit d’un bon tiers les données admises par les anciens: 3.000 ans au lieu de 5. C’est ce qu’on appelle la chronologie courte.
Dans l’Inde aussi, on réduit à rien les époques calculées astronomiquement par les anciens savants de ces pays. Il y a surement une exagération dans ce sens, mais il est bien difficile lorsqu’on ne veut pas et qu’on ne peut pas reprendre soi même les calculs astronomiques nécessaires de se faire une opinion précise sur la chronologie de ces époques reculées. Je me contenterai donc de donner, lorsque ce sera nécessaire quelques indications sur la chronologie relative des migrations des peuplés en citant, s’il y a lieu, les auteurs qui s’en sont occupés.
Pour plus de simplicité je donne le résultat de mes investigations sous la forme d’une nomenclature alphabétique des noms des tribus indiennes d’Amérique dont les noms se retrouvent en Berberie, dans le présent ou dans le passe en les accompagnant des éclaircissements, indispensables sur chacune d’elle.
Au préalable, il me parait utile de résumer d’une façon très sommaire :
1° la manière dont s’est effectue le peuplement du monde en général.
2° le peuplement de l’Amérique.
3° le peuplement de l’Afrique prise a part et en particulier de la Berberie.
C’est seulement après cela que j’aborderai l’étude des tribus indiennes d’Amérique, vivantes ou disparues, dont le nom a transité par l’Afrique et s’y trouve souvent encore. Je soulèverai, chemin faisant, beaucoup de questions que je laisserai sans solution notamment en ce qui concerne la manière dont les Africains ont pu s’y prendre pour passer en Amérique. J’espère que le fait seul de les poser contribuera à les faire résoudre dans un avenir plus ou moins proche. D’autres chercheurs disposant de plus de science, de moyens et surtout de temps que moi y arriveront sans doute plus facilement.
On trouvera peut-être qu’il est fort ambitieux de ma part d’embrasser comme je le fais, la presque totalité du monde connu pour y rechercher la possibilité du voyage de quelques émigrants de l'Afrique du Nord, alors que nous ne savons encore presque rien de sérieux et d’authentique sur toutes les migrations des peuples et que le plus souvent nous nous bornons a des hypothèses le plus souvent tendancieuses et intéressées. Le fait est incontestable ; mes recherches m’ont entrainé fort loin et comme le temps dont j’ai disposé et mes connaissances, voire même les connaissances de mes contemporains en ces matières, sont fort limitées, je me suis trouvé exposé à de bien grossières erreurs. Il est vraisemblable que j’ai du prendre plus d’une fois le Pirée pour un nom d’homme ou commettre d’autres graves confusions du même genre. Si j’avais eu la prétention d’effectuer une étude absolument impeccable, plusieurs vies d’homme et de nombreux volumes n’auraient pas suffi à cette tache. Je me console de mes méprises probables en pensant que je ne suis pas le seul à en commettre.
Au surplus il est bon quelquefois de chercher des vues d’ensemble sur ces questions. Les recherches anthropologiques ont ce grave inconvénient que le plus souvent elles se localisent trop; elles absorbent à tel point les travailleurs concentrent leur attention sur une si petite superficie du globe, qu’ils n’ont plus le loisir de jeter un coup d’œil autour d’eux, il est bon cependant de profiter de toutes ces moissons locales pour les verser dans un ensemble de vues plus générales.
Le présent travail n’échappe pas dans une certaine mesure à cette critique, car bien qu’entrainant le lecteur dans des régions souvent fort distantes les unes des autres, il ne tient guère compte que d’une seule donnée des problèmes anthropologiques.
Ce qui manque surtout a mes recherches, comme on s’en apercevra facilement, c’est d’être mieux raccordées aux autres branches de la connaissance des hommes et des peuples. Il aurait fallu pour cela un travail considérable dont je me suis senti incapable et que je laisse a d’autres.
Les noms des tribus indiennes d’Amérique seront transcrits en caractères gras pour être distingués plus facilement de ceux des peuples correspondants des autres parties du monde.
CHAPITRE I
LE PEUPLEMENT DU MONDE
Point de départ et débuts de l’humanité. Centres secondaires de dispersion. Alternance des invasions et contre invasions. Transformation des noms de tribus en noms de dieux, de héros et d’hommes. Progrès de l’humanité.
L'opinion la plus généralement admise de nos jours est que l’espèce humaine apparut dans le nord de l’Asie. (1) Ce fut a une époque fort reculée, ou le climat de cette région était très favorable, croit on, a son développement. Des tribus, de plus en plus perfectionnées, sortirent de là successivement chassées par des alternances de froids glaciaires et de hautes températures. La science moderne travaille avec ardeur cette question dont je n’ai à envisager ici que les résultats. Il est très possible que la sécheresse croissante de certaines régions, la surabondance de population, les famines, les luttes intestines aient contribue avec les vagues de chaleur et de froid a déterminer ces exodes.
Se poussant, se bousculant, se détruisant même les unes les autres, les tribus issues de la Haute Asie s’épandirent dans toutes les directions qui leur offraient un passage. Il est à remarquer à ce propos que l’état du globe terrestre était alors bien différent de ce qu’il est maintenant.
(1) Suivant toute vraisemblance, l'origine de la vie doit être placée dans les régions polaires (Tristam. The polar origine of life), mais l’état actuel de ces contrées inhabitables, empêche pratiquement de vérifier cette donnée que confirment la paléontologie et la paléobotanique. On connait l’hypothèse moins vraisemblable d’Hceckel sur l’origine Canarienne du genre humain.
Bien des routes s’ouvrirent devant les migrations humaines qui ont disparu aujourd’hui. D’autres au contraire leur restèrent inconnues. C’est ainsi que le chemin direct de l’Europe, ou se trouvait alors le pôle du froid, leur fut longtemps fermé, tant par d’énormes glaciers que par le développement du bassin Aralo-Caspien, (1) (de Morgan : L’Humanité préhistorique, La Préhistoire orientale). Ceci expliquerait que les races les plus primitives n’aient pu y pénétrer : les tribus plus affinées qui partirent plus tard et parvinrent dans l’Europe dégagée de ses glaciers, ne les trouvèrent pas devant elles, sauf peut-être de faibles essaims arrivés par l’Afrique.
Elles ne purent donc s’y mélanger avec ces éléments arriérés et conservèrent toujours leur supériorité et leurs caractères natifs. L’anthropologie permet de reconnaitre que les premières tribus qui peuplèrent l’Europe avaient dû y arriver en passant par l’Afrique et en longeant les cotes méditerranéennes de ce continent. (Sergi. Europa. Africa. Gli Arii in Europae in Africa)
Par la suite, il se forma des centres secondaires de dispersion : Inde, Mésopotamie, Chine, Malaisie, puis un peu plus tard, Caucase, Ethiopie, Égypte, Egée, etc… La Sibérie serait restée longtemps isolée, n’ayant plus de communication qu’avec la Chine et l’Amérique, et c’est la que se seraient développés les peuplés brachycéphales qui entrèrent en scène les derniers.
Cette règle posée par de Morgan est peut-être trop absolue et je ne serais pas surpris qu’on arrive a reconnaitre que certaines tribus sibériennes, voisines du glacier Scandinave aient pu se glisser en Europe beaucoup plus tôt qu’on ne le pense.
Le mélange des peuples formes à des époques différentes et dans des conditions fort variables, allant ou revenant dans des directions opposées, en se mélangeant entre elles, a formé, des le début des races de plus en plus diversifiées. Habitant des régions de climat et de production variés, elles sont allées de plus en plus en divergeant sous l’action de ces causes extérieures nouvelles (1).
A cette conception des débuts de l’humanité en est opposée une autre suivant laquelle l’homme se serait montré, non pas sur un seul point du globe, mais en plusieurs, en Asie, en Afrique, en Amérique.
(1) Je me permets de renvoyer le lecteur pour l’exposé de ces faits a un résumé fort intéressant publie il y a quelques années par la Revue de Géographie de New-York (Griffith Taylor : Climatic cycles and Evolution, décembre 1919 et The Evolution and distribution of race, culture and langage, janvier 1921). Il place l’apparition du genre humain à 8.000 siècles avant notre ère. Les grandes migrations humaines correspondent aux poussées glaciaires connues. 11 admet la succession suivante pour les grandes familles humaines : Negritos (négrilles) 800.000 ans avant notre ère ; nègres proprement dits 600.000 ; moustériens parmi lesquels il classe les bantous 500.000 ; aurignaciens (Ibères, Chamites) Hottentots, Iroquois, etc.) 250.000; peuplés aryens 100.000 ; race alpine et protomongole (Aziliens. derniers indiens d ’Amérique) 40.000 ; Tibéto-chinois et autres brachycéphales, a l’aube de l’histoire. „
Sur bien des points de détail, chronologie, importance de l’index céphalique, nomenclature des peuplés qui ont forme les vagues humaines successives, etc, on peut avoir des conceptions différentes, mais l’essentiel ici est d’avoir une idée générale sur ce qui s’est passé.
En admettant que cette hypothèse fut absolument vérifiée, ce qui n’est pas encore, il ne peut s’agir que de races tout à fait inferieures, qui disparurent devant les envahisseurs venus d’Asie, car on n’en retrouve pas de traces.
Seule l’hypothèse que je rappelais plus haut permet de comprendre la distribution actuelle des grandes races humaines, blanche, jaune, noire, le refoulement des races inferieures a l’extrémité des divers continents ou dans des forets, inhabitables pour des peuplés plus perfectionnés et plus délicats.
Seule elle explique la répartition des civilisations des langues, des coutumes différentes et des noms ethniques à la surface du globe.
Ces mouvements ont d’ailleurs été beaucoup plus complexes que je ne viens de l’indiquer. Il est notamment divers ordres de faits sur lesquels j’insisterai encore un peu, car ils ont contribué à compliquer les migrations humaines à un point qui explique, toutes les discussions, toutes les hypothèses contradictoires et même les constatations opposées qui empêchent et empêcheront toujours les savants de se mettre d’accord sur la genèse de l’humanité. L’un d’eux est la formation des centres secondaires de dispersion des races humaines ; un autre consiste dans l’alternance des invasions et contre invasions qui se sont produites de tout temps.
Une nouvelle théorie, celle de l'ologénisme, développée par le docteur G. Montandon dans son récent ouvrage de l'Ologenèse humaine, paru alors que le présent travail était déjà livré à l’imprimeur, veut concilier le monogénisme et le polygénisme. Je n’ai pu mettre à contribution bien des renseignements utiles de cette savante étude, qui m’auraient grandement servi, bien que j’aboutisse sur bien des points à des conclusions forts différentes.
Voir notamment sur cette question le récent ouvrage de M.Boule, Les Hommes fossiles, p. →. Comme j’aurai a maintes reprises à exposer des faits qui sont du ressort de ces grandes données, je crois nécessaire d’en dire quelques mots des a présent pour ne plus avoir à y revenir.
De même, que les poissons en bande, remontent invariablement le courant des rivières, les migrations des animaux, ou des hommes, en marche, tendent normalement à se faire en sens, contraire du mouvement de rotation de la terre.
La constatation de cette impulsion instinctive, qu’on appelle Anticinèsie a une grande importance pour déterminer les directions suivies par les tribus primitives, mais elle est sujette d’autre part, surtout en ce qui concerne l’homme, à de multiples dérogations qu’il importe de connaitre, car elles ont lieu souvent dans un sens diamétralement oppose. C’est ainsi que toute l'Asie orientale, barrée du coté de l’ouest à certaines époques par des glaces infranchissables, s’est, portée en Amérique.
Centres secondaires de dispersion : Des les premières migrations, les familles ou les tribus en marche ont trouve sur leurs routes des obstacles qui ont subitement arrêté leur essor ; mers, montagnes ou glaciers infranchissables, peuples hostiles, forets impénétrables, régions peuplées de fauves etc. Elles ont été forcées de chercher d’autres voies et fort souvent de s’arrêter au préalable, de se reformer et de vivre dans des conditions différentes de celles ou elles avaient vécu précédemment.
Souvent elles se sont heurtées ou au contraire réunies à des populations qui les avaient précédées.
De ces stationnements et du contact de tribus différentes sont sortis des peuplés nouveaux, mais portant souvent le nom de l’un des composants, alors qu’ils en différent parfois complètement. Ainsi, le nom ethnique indique bien la migration d'une race sans attester son identité à toutes les époques avec celle qui a primitivement porté ce nom. De notables exemples de semblables transformations nous sont fournis en Afrique par la prompte mélanisation des familles blanches qui s’installent dans un milieu peuplé de noirs et défavorable a la sante des blancs. L’inverse se produit également.
L’Afrique, peuplée des le début par des races noires, absorbe rapidement les apports de sang blanc qui sont venus s’y fondre depuis une haute antiquité. On ne se doute pas de la quantité d’envahisseurs venus du Nord qui ont déjà passé sur ce continent, sans apporter de modifications bien apparentes à ces races. C’est l’onomastique qui nous le révèle. De tels faits montrent bien l’impuissance de l’anthropologie somatologique à établir, à elle seule l’histoire des races humaines.
Noms des tribus touraniennes :
J’ai signalé précédemment l’habitude bien caractérisée qu’avaient les tribus Touraniennes d’adopter comme nom ethnique, celui de la vallée dans laquelle elles s’étaient formées. Je serai amené à en donner de multiples exemples tout au long de mon étude. Elles ont conservé ces noms avec une ténacité remarquable et c’est une de leurs caractéristiques les plus accentuées. En raison de l’importance considérable que présente cette particularité qui permet de suivre facilement leurs migrations, je vais des à présent m’étendre un peu plus longuement sur ce fait qui n’est pas assez connu.
D’abord je dois préciser que j’entends par Touraniens, terme évidemment un peu vague, mais fort commode, tous les peuplés de l’Asie septentrionale.
Introduction, page →. — (2) Voir a ce sujet Cahun : Introduction a l’histoire de l’Asie, pages → et →.
Je pense que les Iraniens les appelaient ainsi parce qu’ils avaient eu la Tour a, affluent du Tobol-Obi, comme principal débouché lors de leur apparition dans les Plaines du Sud-ouest. Il y avait d’ailleurs à l’extrémité opposée de la Sibérie, dans le bassin de l’Amour, une autre Tour à qui a pu contribuer à leur assurer cette appellation. Naturellement les étymologistes ne se sont pas contentes d'une explication aussi simple et nous avons nombre d’autres gloses qu’on trouvera dans les divers auteurs qui s’en sont occupes. (G.Capus, Pallas, E.Reclus, Rousselet, Toubin, Ujfalvy, etc.).
Les généalogistes arabes et les sémitisants connaissent, eux, un ancêtre Tour qui a laissé son nom à ces peuples, avec une généalogie bien en règle.
D’ailleurs la Toura de l’Ouest, outre cette appellation générale et conventionnelle que lui doivent tous les peuplés du Nord de l’Asie, parait avoir donné son nom en particulier a une peuplade qui l’habitait et qui s’est éparpillée en Occident dans ses migrations, comme en témoignent des noms de tribus secondaires comme les Tauri de Crimée, les Taurini d’Italie, les Taurisci, les Turones, et des noms de villes comme Tours, Tournciy, Tournons, Tourny, Tournus, Tournon etc.
Tous les Touraniens étaient-ils des brachoides jaunes lorsqu’ils ont quitté leurs vallées pour se répandre dans le monde? La question est fort discutée et il serait fort intéressant d’être bien fixe à cet égard (1) ; mais au fond, elle n’a pour l'objet que je poursuis, qu’une importance secondaire, étant donnés les innombrables mélanges qui s’étaient produits avant et qui se produisirent après leur exode.
Quoiqu’il en soit, toutes les tribus du nord de l’Asie, car je comprends parmi les Touraniens, le nord de la Chine, les Turkestan et le Tibet ont colporté dans toutes les parties du monde les noms hydrographiques de leur pays.
Je vais indiquer à titre d’exemple deux tribus célèbres et que je ne retrouverai plus guère sur ma route, car elles ne semblent pas avoir envoyé de représentants de leur nom en Amérique : les Celtes et les Pelasges.
Les Celtes tirent leur nom de la Kalet affluent de droite de l’estuaire de l’Obi. Ils furent sans doute des premiers atteints par les modifications climatiques et topographiques de la Sibérie, et par suite des premiers à émigrer en Europe. Ils y ont sans doute, grâce à un armement supérieur, subjugue les peuplades, venues autrefois de l’Inde en suivant la Méditerranée, comme je le montrerai plus loin et qui étaient devenues les nordiques blancs à la suite d’un habitat millénaire au milieu des brouillards de ces régions. En retour ils ont été absorbés par elles en prenant une partie de leurs caractères, ce qui a tant dérouté les anthropologues purs.
(1) Certains auteurs pensent que les tribus qui habitaient au pied des hautes montagnes dont descendent les fleuves sineriens étaient blanches comme celles qui vivaient au voisinage des glaciers Scandinaves. Elles en furent chassees par les modifications climatiques et le pullulement des hordes jaunes. Les traditions chinoises signalent dans cette région des hommes aux cheveux roux et aux yeux clairs. Suivant le docteur Montandon, les Ainou seraient un débris de ces peuplés, isole vers l’Est.
Pour le docteur Legendre ; il n’existe pas de race jaune et les peuplés que l’on considère comme tels sont des brachycéphales blancs et de negroïdes asiatiques, opinion qui ne parait pas tenir suffisamment compte de la nature du cheveu-crin de ce type humain et d’autres particularités somatiques.
En outre, la tradition européenne, a donné leur nom à un tas d’autres tribus confédérées ou sujettes venues à leur suite et qui portaient d’autres noms moins connus. Leur propre nom se retrouve dans les suivants : Caledonii des Iles Britanniques, Keleti ou Calètes du pays de Caux en Gaule et du lac Nouba en Afrique, Skolotes des Grecs (avec prothese d’un S) qui étaient a la tête de la confédération des Scythes (Tchoud des Russes), Scotii d'Ecosse (le même nom avec syncope d’une syllabe) venus sans doute plus tard que les Caledonii, Galla de Gaule, du pays de Galles (Wales) et d’Abyssinie, Galoeci d’Espagne, Galates d ’Asie Mineure.
En France, l’ethnique se retrouve encore, sauf meilleure etymologie, dans les villes de Calais, Calan, Callac, Calés, Callian, Cellé, Celles, etc.
Les Pélasges ont eu une ère de dispersion encore plus considérable. Leur nom parait venir d’un autre affluent de l'Obi, la Belalcova. Ils se sont répandus, dans toute la Sibérie, ou on trouve le Mont Blagodat, le lac Belakofskoi, des rivières Belac, Pelovaïa, Belaïa, Belogolovskoie et deux villes de Blagovetschenk ; au Caucase : Belagori, Belakani, Blagodarnoï, Bala,djari, ; en Grèce ou leur nom s’est transformé en Pelasges et Pélagones par la mutation du B en P ; en Berberie où on en trouve des fractions de Beladja, Belaaza, en Tunisie, des Belagoun, Belahdja, Belasga en Algérie ; en Belgique (lue et en Angleterre ou ils sont devenus les Belca (Belges) : les Fire Bolg des légendes irlandaises; en Gaule ou la trace de leur nom se lit dans Pelagia, nom primitif d’Ouessant, et; de nombreuses localités comme Belarga, Beauvais, Blagnac, Blagny, Blégiers, Valcanville, Velleches, Volognat, Volse etc… C’est sans doute à d’autres migrations venues postérieurement de la Sibérie, car ce mouvement dura sans doute plusieurs siècles, que l’on doit attribuer les Volsques de l’Europe Méridionale, les Vainques, les noms du fleuve Volga et des Bulgares.
On pourrait se demander si ce sont les tribus touraniennes qui ont donné leur nom aux vallées ou si l’inverse s’est produit. J'opine d’une manière générale pour la première hypothèse bien que certains faits puissent faire croire à la seconde. Je fais allusion à ce que l’on constate pour le Volga et pour le Sgr Daria.
Le premier de ces fleuves avant de porter son nom actuel s’appelait Athel ou Eitel, puis Bha ou Bhéa. Je ne saurais dire en l’absence de témoignages bien probants si ces deux appellations étaient simultanées ou consécutives, afférentes à des parties distinctes de la vallée ou à son ensemble, mais je pense que c’est de la première que sont venus les noms des Italiotes et de l’Italie, de l’Oued Itel en Berberie (1) et d’ldelès a la tête de l’Igharghar et de la seconde ceux des Beii des Basses Alpes, des Roetii de la Suisse orientale, de l’ile de Ré (Ratis) du pays de Retz (Ratialum) etc, des Routouls du Caucase, et d’Italie, peut-être des fleuves Rhenus (Rhin) Rhodanus (Rhone) etc.. Quant au nom même de Volga j’ai donné plus haut des renseignements à son égard.
(1) J’ai ailleurs attribué l’origine de ce nom a un calembour des Arabes de la dernière invasion sur le nom des Gétules, mais de nouvelles recherches me font préférer cette étymologie.
La Syra, du bassin de l'Obi, qui me parait avoir donné son nom aux Sirieni ou Zirienes de Sibérie et à la Syrie, l'a donné également au Syr Daria. Ce dernier fleuve s’appelait antérieurement Araxes ou laxartes. Ce nom transporte au Caucase en est reparti avec les Ibères dans leurs migrations mondiales : en Fiance Aracone, Araca, Aragon, Arara, peuplé des Arrevasci, Arréau etc ; en Espagne Aragon, Alagon, peuplé des Arevaci, etc. (C’est je crois d’Espagne que le nom a été transporté dans l’Amérique du Sud, Araucans et Arrawaks). En Asie Mineure Araxa, en Afrique Arara, El Harrar, El Harrache, Larache, Harrar, Haracta, Rarraga, Haraka, etc. ; en Birmanie Mont Arakan.
On remarquera dans ces deux cas qu’il s'agit de rivières qui se trouvent à la limite de la zone touranienne ou les peuples venus de l’intérieur ont pu se trouver arreter dans leur marche et obliges à stationner. A l’intérieur, les autres fleuves et rivières semblent avoir conservé leurs noms primitifs.
Tout bien considéré, je crois donc que les tribus, après avoir pris leurs noms dans les vallées touraniennes ou elles s’étaient formées, les ont emportés avec elles et transférés par la suite dans leurs migrations aux autres cours d’eau sur lesquelles elles vinrent s’installer.
Ce n’est que plus tard, lorsqu’elles se furent longuement mélangées avec les tribus, venues de l’Inde, qui les avaient précédées et qui les suivirent, lorsqu’elles se furent modifiées dans leur type somatique et intellectuel, qu’elles adoptèrent en se dédoublant, et en se démembrant, par essaimage ou pour toute autre cause, des noms d’une autre formation dont nous ne retrouvons l’origine ni dans le Nord de l’Asie ni dans l’Inde.
C’est ainsi que se forgèrent en Europe de nombreux noms de peuplés nouveaux, comme Alamans Normands, Lombards, Burgondes, Slaves etc, dont l’étymologie se retrouve le plus souvent dans les langues parlées à l’époque quasi historique ou ils ont apparu.
La particularité onomastique que présentent les tribus touraniennes, véhiculant le nom des rivières sur lesquelles elles ont vécu en Sibérie, est tellement caractéristique que j’en suis arrivé à croire, que tout peuple qui porte un nom ethnique tire du réseau hydrographique de son pays est sinon d'origine touranienne, tout au moins fortement mélangé ou influencé par ce sang. C’est ainsi que je puis déceler le passage par l'Inde de nombreux peuplés touraniens qui y étaient arrives sans doute avant l’époque où leur furent ouvertes les plaines d’Occident.
Les races établies depuis longtemps dans l’Inde quoique venant sans doute elles aussi des mêmes régions septentrionales, s’y étaient sensiblement modifiées sous l’effet du climat et du contact avec les peuples noirs qui les avaient précédés. Elles avaient notamment adopté des habitudes différentes en ce qui concerne la dénomination de leurs subdivisions.
Importance considérable des migrations indiennes : Parmi les centres secondaires de dispersion de l’humanité, l’Inde a été incontestablement un des plus importants. Cela se conçoit a priori; se trouvant droit au Sud des régions ou se sont formées les premières tribus, c’est là qu’elles devaient tout d'abord chercher à se refugier en fuyant les vagues de froid. Certains savants croient même que c’est là que se sont formées les races noires ; les blancs et les jaunes auraient eu comme habitat primitif les contrées situées au Nord-Ouest et au Nord- Est. Mais il semble que cette hypothèse tient trop compte de l’état actuel de ces différentes régions.
J’estime que les trois quarts au moins des peuples primitifs ont du passer par là, d’après les constatations que j’ai pu faire au moyen des noms ethniques. Mais la contenance de l’Inde n’est pas illimitée, même en admettant que sa forme ait considérablement varié et qu’elle ait eu autrefois une plus grande superficie. Pressées les unes contre les autres au fur et à mesure des nouveaux arrivages, tourbillonnant en tous sens, les populations finissaient par en sortir après avoir subi de profondes modifications physiques et morales.
Des quantités de noms venus de l’Inde, se retrouvent sur toute la surface du monde habitable. J’ai déjà dit plus haut que l’Inde est restée dolichocéphale alors que les peuples qui l'entourent encore sont brachycéphales. Des multitudes de ces tribus brachoïdes, qui font traversée après y avoir séjourné un temps plus ou moins long, parfois des millénaires, en sont ressorties transformées, notamment au point de vue de leur conformation physique, de leur langue, de leurs coutumes.
Cette opinion sur l’importance du rôle joué par l’Inde résulte de toutes mes recherches sur les noms de l’Afrique et de l’Europe. Sur ce point, mais sur ce point seulement, je suis entièrement d'accord avec Hoeckel qui écrit ce qui suit dans son Histoire de la création (traduction Letourneau p. 618) : « La grande masse des Euplocamiens, l’espèce méditerranéenne, partit de sa patrie originelle, (l’Hindoustan peut-être) vers l’Ouest et alla peupler les cotes de la Méditerranée, le Sud-ouest de l’Asie, le nord de l’Afrique et l’Europe. » Mais je les vois sortir primitivement de la Sibérie et non de la Lemurie, pour venir achever leur formation dans la péninsule indienne.
Dans les pages qui suivent on trouvera, éparses un peu partout, les vérifications de mon opinion.
Malheureusement la préhistoire et même l’histoire de l’Inde sont peu connues. Les savants qui s’occupent de ce pays se laissent accaparer par l’étude passionnante des philosophies, des littératures et surtout des religions de ses peuplés, et ne cherchent pas à reconstituer leur histoire fort confuse.
En outre la plupart sont des auteurs anglais dont les ouvrages me restent inaccessibles surtout à l’heure actuelle. Dans le tome III de l’Histoire du Monde publiée par Mr. E. Gavaignac, Mr.L. de Lavallée-Poussin, étudiant les Indo-Européens et les Indo-iraniens jusque vers 300 avant notre ère, reconnait que le manque de chronologie, cette grande plaie de l’Indianisme, entrave tous les efforts des historiens même aux époques relativement récentes. On a cherché à interpréter les données astronomiques des traditions indiennes, mais ces essais donnent des résultats douteux et qui n’ont pas emporté l’adhésion des spécialistes, de sorte que tout ce qui concerne l’histoire de l’Inde reste vague et incertain. Je n’y trouve en tout cas aucune donnée sur laquelle je puisse m’appuyer pour interpréter les résultats fournis par l’onomastique. Ce n'est que dans les ouvrages de Jacolliotque je lis l’exposé de traditions indiennes qui cadrent si bien avec mes constatations personnelles, relatives aux migrations sorties de l’Inde, que je ne puis me dispenser de les rappeler sommairement ici, bien qu’elles n’aient pas reçu, je crois, l’approbation des savants compétents. Ce sont les brahmes des pagodes de Villenour et de Chillambaran qui les ont exposées a Mr. Jaeolbot (Les Fils de Dieu et autres ouvrages, passim). Malheureusement cet indianiste, au lieu de chercher à reconnaitre le bien fonde de leurs récits, les a noyés dans une telle avalanche de déclamations contre les diverses religions et les ministres des cultes, y compris ceux-là même qui lui fournissaient ces renseignements, qu’il leur enlève quelque autorité. En voici néanmoins le résumé.
Huit mille ans avant notre ère, les Xchatryas, c’est-a-dire les guerriers hindous de noble race, se révoltèrent contre leur chef, Pratichta. Ils appelèrent à leur secours tous les montagnards de l’Himalaya et du Thibet qui descendirent alors pour la première fois, (ce détail parait manifestement inexact) dans les plaines de l’Inde. Le Brahme Paraçoura les vainquit et les dispersa. (Je remarque que les traditions indiennes qualifient ces Xchatryas révoltés du nom d'Aryas, mais ce nom parait un anachronisme. Il ne semble pas qu’à cette époque il ait pu avoir le sens ethnique qu’on lui a prêté depuis. On croit d’ailleurs que la conquête de l’Inde par les Aryens n’aurait eu lieu que dans le second millénaire avant notre ère. Il est probable que ces rebelles étaient en réalité, ainsi que leurs chefs, des Kouchites, ou des Dravidiens déjà parvenus a un haut degré de civilisation) Ce fut peu de temps après, que le célèbre prince Rama que l’on dit fils du roi de Koçala conquit l’Ile de Ceylan. Cet exploit aurait eu lieu vers 7500.
Mille ans plus tard, un autre chef, Manou-Vena, se révolta à son tour contre les Brahmes ; battu lui aussi, il s’enfuit en Perse et de la alla coloniser l’Égypte. Les anciens Minnéens d’Arabie, le Menés roi d’Égypte, et le dieu de Chemnis Minou, le Minos des Crétois, le Minouischer des Perses, les Minyens de Béotie, le Mannus des Germains lui devraient leur nom et seraient ses successeurs, ou ses descendants, ou encore des personnifications de sa race. Le nom de Manou qui désigne encore certaines tribus africaines était sans doute un simple ethnique.
Cinq mille ans avant notre ère, se produisit une deuxième invasion des peuplés du Nord, conduits parles chefs lodah, qui serait l’Odin de la mythologie Scandinave, et Scandah, qui donna son nom à la Scandinavie. Battus et chassés, ils allèrent coloniser le Nord de l’Europe, tandis qu’un autre chef rebelle, Hara Kalat qui serait le type de l’Herakles des anciens, se séparait d’eux pour aller conquérir la Perse, l’Asie Mineure, et sans doute aussi la Grèce et l’Europe.
(Je suppose que c’est de cette époque que daterait l’arrivée au Caucase des peuplades indiennes, dont je reconnais le passage en ce point).
Cinq cents ans plus tard, d’autres migrations indiennes allèrent coloniser le Thibet, la Chine, le Japon, la Corée, Java, Borneo, les iles de la Sonde et de la Polynésie ou se parle le Maori.
La liste des rois de la mer eu Babylonie comprend un prince appelé Ekurulana qui régna environ 1880 avant notre ère.
En mettant de cote la question de chronologie, avec laquelle les données historiques que nous possédons s’accordent assez imparfaitement, j’arrive à reconnaitre au moyen des noms ethniques, que des émigrants partis de l’Inde sont réellement allés en Mésopotamie, de la en Asie Mineure et au Caucase et par la suite dans toute l’Europe. Une autre branche de ce courant humain est passée en Afrique en traversant le détroit d’Ormuz qui fut sans doute exonde a certaines époques (1), puis la Mer Rouge par l’une ou l’autre de ses extrémités ; il a envahi l'Abyssinie et s’est répandu sur tout le continent africain où il avait été précédé par des populations noires inferieures. Ce sont des tribus appartenant à cette migration, mélangées par la suite à des émigrants venus d’Europe, qui ont formé la race dite Berbère, qui ont réussi à gagner l’Amérique ou elles se sont trouvées aussi en présence de nombreuses peuplades arrivées avant elles directement par le détroit de Behring Étant plus civilisées que ces dernières, elles les firent bénéficier de certaines de leurs connaissances. Ce fut l’origine ou plutôt l’une des origines des civilisations américaines, disparues plus tard devant les nouvelles invasions européennes. J’aurai à revenir sur ce point par la suite.
Avant de quitter l’Inde je dois dire un mot de sa partie Sud et de Ceylan qui paraissent avoir joué un rôle capital dans les migrations humaines si on en juge par l’importance des noms ethniques qui en viennent.
On remarquera à ce propos que dans sa Géographie, Ptolémée mentionne aux abords de la grande ile de Geylan un certain nombre d’autres petites iles telles qu’Alciba, Avance, Balaca, Goumara, Irena, Zabci etc qu’on ne peut plus identifier.
Faut-il y voir un écho de traditions fort anciennes recueillies dans le pays ? Ou bien faut-il y voir une description inexacte des Archipels éloignés comme ceux des Andaman, des Nicobaretc? L’erreur serait bien forte. Ne peut-on encore supposer que toute cette région aurait subi, depuis l’époque où écrivait Ptolémée, de fortes modifications ? Les traditions indiennes relatives à l’affaissement du Pont d’Adam entre Ceylan et le Dekkan, les constatations des géologues et leurs hypothèses relatives à l’existence possible des terres de la Lémurie, cadrent avec la disparition mystérieuse de ces iles.
Il était nécessaire de signaler ici ce fait car j'aurai à rappeler le nom de plusieurs d’entre-elles. Il n’est d’ailleurs pas impossible que ces modifications de l’écorce terrestre et les cataclysmes qui ont pu les accompagner, soient à compter parmi les causes qui ont déterminé à certaines époques les exodes de populations qui se répandirent dans le reste du monde.
Sur la question des changements de niveau de la Méditerranée et des autres mers, on consultera M. A. SoulejTe : Les oscillations océaniques et les oscillations climatiques, 1923.
L’arrivée jusqu’en Europe, de migrations de l’Extrême-Orient, est d’autre part confirmée, par une découverte des plus importantes, qui vient a l’appui des preuves onomastiques. Dans la grotte du Prince, a Grimaldi, on a trouvé des débris de Cassis Rufa. Ce coquillage, qui ne se rencontre ni dans la Méditerranée ni dans la Mer Rouge, est une espèce de Casque propre a l’Océan Indien, ou il habite à partir de l’ile de Socotora vers l’Est et vers le Sud. Il n’a pu venir tout seul sur la cote du golfe de Genes comme le fait remarquer fort justement M. Mai nage (Les Religions de la Préhistoire p.→) et on est bien obligé d’admettre qu’il a été apporte par des hommes habitant au-delà de Socotora, qui ne saurait être considérée en elle-même comme un centre de dispersion. Ce fait qui est en connexion manifeste avec la présence de tribus négroïdes au Nord de la Méditerranée montre bien l’importance de ces exodes des peuples orientaux (Voir a ce sujet. Boule : Hommes fossiles. 467)
Un point très important qui mérite d’être mis en lumière, c’est que la circoncision a été importée par les Indiens en Égypte et dans toute l’Afrique orientale, ou elle existait, comme on le sait bien avant la conquête musulmane. M. Jacolliot l’établit assez nettement Tout d’abord il en est fait mention par Manou dans ses Dliarma-Sastra (Livre III p. →). M. Loiseleur Deslongchamps dans sa traduction française des lois de Manou rend ce passage ainsi qu’il suit : «....un homme né sans prépuce ». On pourrait croire d’après cela qu’il s’agit d’une particularité tératologique individuelle. M.Jacolliot en donne une version toute différente et dit nettement « ceux qui ont été circoncis... ». Il est possible que la première interprétation se rapproche davantage de la lettre même du texte original, mais la seconde parait plus conforme à la réalité. M. Jacolliot, qui a pu sur les lieux s’enquérir auprès des Brahmanes du sens à attribuer a ce passage, spécifié en outre que ces indiens circoncis appartiennent a la race impure des Tchandala ou Chandals dont il existe encore des débris dans l’Inde (Risley. Peuples de l'Inde p. →. 260 etc.) Il cite divers passages de l’Avadana Sastra d’après lesquels le roi Agastya, qui vivait plusieurs milliers d’années avant notre ère aurait, entres autres mesures prises contre cette population hors caste, rendu un édit l’astreignant a la circoncision et à l’excision. Il est vraisemblable que pour pouvoir se soustraire aux humiliations et aux persécutions dont on les abreuvait et pour pouvoir s’élever subrepticement et se glisser dans les rangs des castes reconnues, les Tchandala avaient peu la peu perdu ou négligé cet usage de leur race qui servait sans doute a les faire reconnaitre. Il y a tout lieu de croire en effet qu’ils appartenaient primitivement à une race sans doute inferieure qui fut accrue et modifiée peu à peu par toutes sortes d'éléments rejetés hors de leur caste naturelle. Les lois de Manou qui les disent issus du mariage d’un homme de la caste des Soudra avec des femmes des castes supérieures, masquent sans doute sous cette singulière explication qui n’en est pas une, une origine ethnique primitive différente. Les migrations indiennes auraient commence longtemps avant l’apparition des conquérants Aryens dans la péninsule. Je suis amené à croire que les Tchandala étaient un de ces peuples Kouchites qui transportèrent la circoncision non seulement en Afrique mais aussi au Caucase chez les Cloches de la Colchide. Je montrerai au § Kutchines, ou je m’occupe des Kouchites, que les Colchi de l’Inde des auteurs anciens sont les mêmes que les précédents et que leur nom est purement et simplement une altération de celui des Kouchites. Par la suite ceux qui étaient restés dans l’Inde perdirent pour la plupart cette coutume qui les mettait en état d’infériorité raciale vis-a-vis des Aryens et Dravidiens de l’Inde, tandis que les Égyptiens et les Sémites s’en faisaient au contraire un titre de gloire.