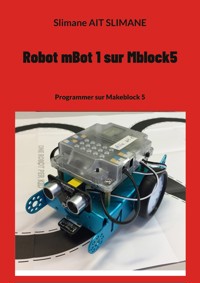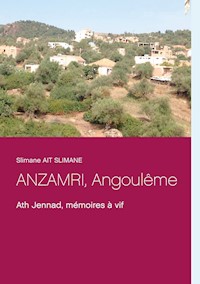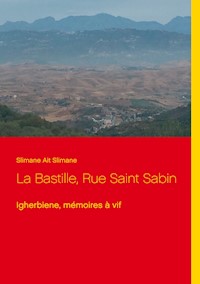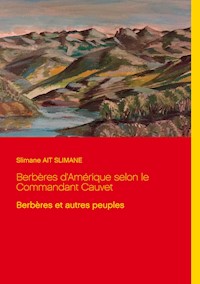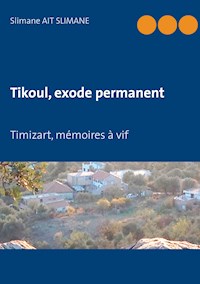
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Le livre retrace des bribes de vie de modestes gens, mêlés à des événements fondateurs pour un peuple. Igherbiene Ath Jennad est le village pivot de l'histoire, mais beaucoup d'autres lieux et de figures plus ou moins connues de la région, sont évoqués et racontés avec beaucoup d'intérêt, de familiarité et peu de concession. Les personnages vivent des péripéties typiques du kabyle de l'époque. Les années 1950 occupent le clair du récit, mais le siècle précédent et celui d'avant sont relatés, de façon plutôt ciblée. Certains personnages font eux même la narration. L'auteur se garde d'apporter son point de vue, il se satisfait seulement de dérouler les faits.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sommaire
Hend Agharvi
Ait Kaci
1750
1790
1835
1857
1862
1868
1871
1873
1876
1882
1885
1895
1898
1899
1900
1903
1908
1910
1912
1913
1915
1918
1920
1924
1929
Jejiga 1932
1933
1934
1935
1938
1939
1940
1942
1944
Sadia
1945
1946
1946
1946
1946
1947
1947
Ighervien 1947
Printemps 1947
Wrida 1947
Jeudi 30 octobre 1947
1948
1948
Dahvia - 1948
1949
1951
Sadia 1952
Automne 1952
Fin décembre 1952
Sadia
Dahvia -Printemps 1953
Fin mai 1953
Eté 1953
Octobre 1953
Novembre 1953
Wrida
Sadia
Dahvia - Mai 1954
Wrida - 10 juillet 1954
Saida- Juillet 1954
30 juillet 1954
20 Aout 1954
30 Aout 1954
Début septembre 1954
Fin Septembre 1954
Novembre 1954
Décembre 1954
Sadia
Janvier 1955
Février 1955
Sadia - 8 mars 1955
9 Mars 1955
Paris 10 mars 1955
Sadia- Début mai 1955
Début juin 1955
Fatima
Sadia- Lundi 1er Aout 1955
3 aout 1955
Eté 1955
Paris- fin d’été 1955
Fin d’été 1955
Fin aout 1955
Sadia Avril 1956
Avril 1956
Juillet 1955
Début 1956
Paris- Printemps 1956
Ighil- Printemps 1956
Eté 1956
Wrida
Fin d’été 1956
Moh Amchiche 1956
Wrida
Aout 1956
Sadia - Septembre 1956
Automne 1956
Amar Ou- Saâ
Debut 1957
Février 1957
Mhend ou Slimane
17 Mars 1957
Dahvia - 22 mars 1957
23 mars
23 mars 1957
Dahvia
Fin mars 1957
Printemps 1957
Eté 1957
Automne 1957
Sadia Automne 1957
Wrida fin 1957
Wrida
Dahvia - Décembre 1957
Sadia fin janvier 1958
Mohand Igherviene - Début 1958
Le 4 février 1958
5 février 1958
6 février 1958
Slimane- 7 Mars 1958
Début mars 1958
Dahvia - 7 Mars 1958
Sadia
8 Mars 1958
Dahvia
Sadia
Dahvia 8 mars 1959
9 mars 1958
Dahvia - 11 mars 1958
Sadia - Fin Mars 1958
Dahvia
11 mars 1958
Sadia
12 mars 1958
Mi-Mars 1958
Slimane - 20 Mars 1958
Wrida
Sadia 20 mars 1958
Dahvia 20 Mars 1958
Wrida
Dahvia
21 Mars 1958
26 mars 1958
Sadia - Début Avril 1958
Dahvia - Avril 1958
Chaâra - avril 1958.
Dahvia - 20 Avril 1958
21 Avril 1958
22 Avril 1958
Jejiga - 10 Mai 1958
Dahvia
Zehra n’boukejir - Mai 1958
Wrida
Début juin 1958
Belkacem Moh el-haj Début d’été 1958
Dahvia
Wrida mi-juin 1958
Sadia
Wrida
Eté 1958
Fin Juillet 1958
Sadia été 1958
Epuration été 1958
Wrida 10 Aout 1958
Amr ou-Saâ- Mira été 1958
El Horane mi-Aout 1958
Amr ou-Saâ
Jejiga - Fin- Aout 1958
Mi-Septembre 1958
Jejiga - Mi-octobre 1958
Dahvia
Paris Automne 1958
Rue Saint Sabin
Sadia - Fin octobre 1958
Mi-octobre 1958
Mohand Igherviene fin 1958
Dahvia - Mi- Janvier 1959
Wrida - Fin Février 1959
Fadma tameziant
Le soir
Wrida
Printemps 1959
Sadia mars 1959
Mohand Igherviene
Sadia
Avril 1959
Mercredi 29 avril 1959 Amr ou-Saâ
Akli
Amr ou-Saâ
Akli
Amr ou-Saâ
Akli
Amr ou-Saâ
Sadia
Paris mai 1959
Oumira
Avant novembre 1959
Été 1959
Amr ou Saâ - Aout 1959
Sadia
Fin d’Eté 1959
Angoulême été 1959
Mohand Igherviene
Amr ou-Saâ
Slimane Mi Aout 1959
Dahvia Aout 1959
Fin 1959
Hadj Mohand-Saïd Mansour Tachivount 8 octobre 1959
Angoulême - Octobre 1959
Sadia - fin Octobre 1959
Novembre 1959
Dahvia - 22 Novembre 1959
Sadia
8 décembre 1959
Sadia
Dahvia
9 décembre 1959
Sadia
Témoins
Dahvia
Témoins
Sadia
Fatima
Sadia
10 décembre 1959 Dahvia
Sadia
Dahvia
Sadia - fin décembre 1959
Dahvia
Janvier 1960
Wrida
Dahvia
Hivers 1960
Sadia
Bounaâmane début 1960
Sadia
Avril 1960
Fatima
Lancez
Ighil
Sadia 1960
Creux de la vague
Mi-janvier 1961 Sadia
Fatima
Hivers 1961
Dahvia Titem début mars 1961
Wrida
Slimane
Sadia
Printemps 1961 Fatima
Wrida
Sadia
17 Mai 1961.
18 mai 1961
Eté 1961
Eté 1961
Slimane
Juillet 1961
Dahvia
Amr ou-Saâ
Dahvia
Slimane
Amr ou-Saâ
Dahvia
Slimane
Amr ou-Saâ
Dahvia
Slimane
Les harkis et les autres
Janvier 1962
5 février 1962
Amr ou-Saâ
Sadia début Mars 1962
Bonn 19 mars 1962
Krim Belkacem
Fin mars 1962
1962
Larvi
Dahvia
Sadia
Fatima
Dahvia- Fin 1962
Fatima
Sadia
Wrida
Juillet 1962
1964
1964
Sadia 1965
Sadia 1967
Fatima 1967
Mostaganem 1968
Wrida 1969
1971
1973
1974
1975
1976
1978
1985
1988
2002
Aout 2010
2012 Achour
2020
2021
Bibliographie
Hend Agharvi
Les Ulhasa forment une branche tribale qui serait issue de la grande tribu berbère nomade des Inefzawen. Des représentants de cette branche vivent dans les environs de Tafna, à l'ouest du pays, dans la région de Beni Saff. Tariq Ibn Ziyad est issu de cette tribu selon Ibn Khaldoun.
Ahmed est né au sein de la tribu d’Ulhassa, en 886 Hégire, coïncidant avec l’année 1481 après la naissance du christ.
De son vrai nom, Sidi Ahmed Agharbi ben Sidi Muhammad ben Yekhlef ben Ali ben Yahya ben Rachid ben Farqan. C’est le cadet d’une fratrie de quatre garçons.
Jusqu'à la naissance d’Ahmed, son père étudiait les sciences et l'écriture. Il s’occupait dans une industrie sidérurgique artisanale, d’inspiration Andalouse. Cette activité favorisera l’intégration de la communauté berbère revenue d’Andalousie et de Grenade, dans la région, avant la fin du siècle.
Comme la plupart de ses semblables, Ahmed fait ses premiers apprentissages auprès des familles de nobles, dont certains érudits de la région entre autres. Il y étudie les principes de la lecture, de l’écriture et la grammaire. Son génie est démontré dans sa vitesse en mémorisation et sa maîtrise du Coran. Il est réputé également pour sa grande lucidité.
Son environnement familial a un sérieux impact sur la formation de sa personnalité.
A la fin de son adolescence, le jeune cheikh découvre un certain goût pour le tourisme, c’est sa nouvelle passion. Il se contente désormais de contempler et de penser au Créateur avant la création. Il commence à errer en progressant vers les territoires de l’est du pays. Un mode d’émigration courant à cette période. Les berbères qui revenaient d’Espagne, ont fait des études pour beaucoup d’entre eux. Ils se dispersent dans les régions pour profiter de leurs sciences aux habitants. Cette évolution achemine Ahmed jusqu’à Ath Jennad en Kabylie.
Ahmed descend au village Timizart Sidi Mensour à Ath Jennad, avec le projet d’emprunter la voie du soufisme. C’est une pratique qui l’oblige à abandonner l’apprentissage régulier de la langue arabe pour laquelle son père avait déployé d’énormes d’efforts.
Il y rencontre des soufis, devient l'un de leurs disciples et apprend sur eux les secrets du droit chemin.
Il y étudie quelques années jusqu'à ce que les premiers signes de son génie apparaissent, et son don en poésie se manifeste aisément dans ses interventions. Les cheikhs de la région finissent rapidement par le célébrer et l’adouber.
Installé à la Zawia de sidi Mansour depuis quelques années, avec une parfaite intégration. Il se lève tôt régulièrement pour la lecture et la récitation du Coran. Il profite aussi de fréquenter de nombreux cheikhs de renoms ; Mufti de la Malikiyah Abu Abd Allah Al-Masdali, Musa Al-Abdusi Al-Walhasi, Sulaiman Al-Hasnawi Al-Baï et Muhammad bin Ahmed Tlemceni. Ahmed termine ses 23 ans.
Il y accomplit un apprentissage théologique, acquiert une certaine science, et atteint une telle aura, que les étudiants commencent à affluer vers lui de toutes les régions du pays.
Il dispense un enseignement et forme une grande génération de savants en théologie et des hommes de lettres qui n’existaient pas encore dans la région.
Certains vont s’installer à Akbou, une région montagneuse qui regorge de saints célèbres, à l’image de Sharif Al-Husseini et Sidi Ahmed ben Yahya. Un autre groupe d’étudiants s’installe dans la tribu Mozaya, une montagne près de Bejaia.
Heureux dans ce haut et beau pays, où fluctuent pour lui la grâce, le contentement et la condition de vie facile et pleine d’espoir. Mais ce bonheur s’alterne avec l'amertume et la nostalgie pour sa ville natale à chaque instant. Il commence à aspirer de nouveau à sa famille et à toute sa tribu de welhassa qui l’a vu naitre.
Hend Agharvi quitte la Zawia Sidi Mansour, et cherche un lieu moins habité sans quitter l’arch ath Jennad auquel il a un attachement. Il s’installe à Tizi Bounwal. Il s’intègre aux habitants d’Iajmad auprès desquels il officie désormais comme Imam, tout en gardant son statut de marabout régulièrement visité.
Ath Moussa et Alma bwaman forment encore un seul Village, ath Adas. Ahmed, dit Hend Agharvi, épouse une femme d’Alma Bwaman de la famille Odaïfen. Il achète une parcelle de terrain sur le village de ses beaux parents, au lieu dit Tikoul, où il s’établit avec son épouse. Tikoul devient son village et scelle son ancrage dans la région. Son statut d’érudit en théologie, lui donne une certaine autorité et un pouvoir qui lui permettent d’acheter les terrains voisins sur Ath Adas.
Il construit une mosquée à Tikoul où il finit avec une nombreuse progéniture, dont les propriétés s’étendent d’abord dans le village en achetant des terrains sur les voisins situés au sud de la maison du père fondateur. Ce dernier interdit toute construction au nord de sa demeure qui se profile en mausolée. Il oblige ainsi sa descendance à pousser l’expansion vers le sud, en acquérant des terrains sur les habitants, en évitant de se rapprocher de la forêt déserte d’Ighil nath-Jennad, pour y préserver les terres apparemment plus fertiles. L’esprit de conquête pacifique n’est probablement pas loin, mais l’idée de se rapprocher des populations locales est au moins aussi manifeste.
Il repense à toutes ces nuits passés à étudier et à prier, qu’il regarde avec un mélange de joie et de tristesse, sachant que la fin de sa promenade est dans la région d'Ath Jennad.
Hend agharvi décède le mercredi matin du 3 Rajib 969 coïncidant avec le 19 mars en 1562, à l’âge de 81 ans, plongeant ainsi toute la région dans une grande affliction, sur la perte d’un monument théologique et une grande sagesse, laissant derrière lui des garçons et des filles, et des petits-enfants qui héritent de lui une terre et des traditions. Enterré à l’est du village, au lieu dit akwir oudarar près d’imezlay.
Le processus d’achat de territoires sur les villages voisins, se prolonge sur plusieurs siècles. Le village s’agrandit, prend le nom du fondateur, et devient Igherviene.
Ainsi la population descendante de Hend Agharvi, devient héritière, parmi d’autres, de la civilisation berbère connue sous le nom des Almoravides, dont la puissance arrivait à son déclin au douzième siècle.
Ait Kaci
Respectée et redoutée dans toute la Kabylie, Ait Kaci est une famille de riches propriétaires fonciers, constituée d'une armée de cavaliers bien entraînés dans l’art militaire. Les turcs leur cèdent un certain pouvoir local. Ils ont le commandement sur la vallée du Sebaou et la Haute-Kabylie.
Les plaines d’Azaghar sont l’objet de discorde entre les Ait Kaci et Ait Jennad. Ils sont parfois en conflit, sur un fond d’une rivalité permanente. Ainsi, Ath Kaci reçoivent souvent des fugitifs provenant des Ait Jennad.
1750
La tradition concerne également les autres régions. Ali, était un fugitif venu d’ath Wacif. Célibataire, il est recueilli par un habitant d’Ighervien. Il épouse une fille d’Ikejiwen qui avait pratiquement déjà rompu ses liens avec les siens. En échange d’une protection, ses terrains d’Azaghar sont cédés en partie aux habitants du village. S’installe d’abord à Tikoul, avant d’évacuer vers le milieu du village, et devient Ali Agharvi.
1790
Le jour de l’Aïd Tamokrant, à Igherviene, quelques villageois se retrouvent à Imezlay, à l’Est du village, comme à leur habitude, pour des préparatifs rituels, après la prière. Pendant l’abattage des moutons, un litige en suspens, se retrouve dans le fil de la conversation. Il opposait deux grandes familles d’Ikejiwen, plutôt voisines, voir cousines.
La tension débouche sur un affrontement physique à couteaux tirés bien aiguisés, sur le petit terrain dégagé au milieu d’une dense broussaille, sous le regard du rocher Ouzaya. On dénombre alors plusieurs morts, 7 victimes de la famille du cheikh, et six autres morts parmi Ath Gherbi. Seuls deux hommes survivent à la tuerie, Hocine et son cousin Taakas de la famille Ath Gharbi.
La tragédie qui arrivait à son paroxysme, connait soudain un répit suite à l’apparent équilibre dans les dégâts causés. Les villageois supposent alors et espèrent un calme après la tempête. Mais la différence en nombre de morts, laisse planer la menace d’une vengeance éminente. Une des deux familles se confine pendant près de deux mois pour parer aux représailles.
Les sages du village interviennent pour intercéder entre les deux belligérants. Ils se résolvent à pousser à l’éxil les deux camps. L’un des deux groupes s’exile vers Tamda, capitale des Ait Kaci. L’autre groupe, part en direction de la côte, et s’installe à Ait Réhouna.
Les Ait Kaci reçoivent les exilés partis vers le sud, afin de leur éviter la vengeance. On disait à l’époque de leur propension à offrir asile aux réfugiés et autres fugitifs : tout meurtrier peut trouver asile à Tamda.
Chez les Ait Kaci, lorsque l’homme est de bonne constitution physique, il devient systématiquement cavalier, mais s’il est d’une santé précaire, sa fonction peut se limiter au pâturage. Ils engagent alors les deux hommes, Hocine et Taakas, de la famille d’Iqajiwen, récemment accueillie, comme cavaliers.
Taakas vit assez longtemps et a beaucoup de descendance. Hocine, quant à lui, est tué au combat, alors qu’il était encore jeune et célibataire. En référence et en hommage à sa mémoire, la famille Ikejiwen en exil se rebaptise Ait el Hocine.
1835
Yahia et Slimane, descendants de Hend Agharbi, habitent une zone jonchée de cactus au bord de la rivière Tikoul, au nord ouest du village, voila quelques générations. Slimane, l’ainé de la fratrie, est arrivé à un âge certain. C’était un homme solitaire, qui ne faisait qu’à sa tête. Yahia est père de beaucoup de garçons, dont certains ont déjà quitté pour ath Zellal. Amar, un homme d’une grande taille, c’est le fils cadet de la fratrie, né de la dernière épouse. Mhidine quant à lui s’est maintenu autour de la mosquée du cheikh. Il est réputé être un homme très sociable et chaleureux qui affectionne et entretient au quotidien les liens de parenté et de voisinage. Il vous interpelle de loin sur un ton familier et très souriant.
Les pluies d’hiver s’acharnent, et la rivière Tikoul commence à déborder et devient menaçante pour les habitants riverains. Les Habitants quittent progressivement la zone. Yahia et Slimane vont s’installer dans un espace très broussailleux, rempli essentiellement de myrte commun et de pistachier lentisque, entre Imezlay et Anar à l’est du village. Ils se répartissent les parcelles de terrain, et commencent à construire et travailler la terre. Amar, quant à lui, évacue mais sans aller si loin. Il s’établit à quelques arbres au sud du rocher Nat Ali.
1857
Après la bataille d’Icheriden en juin, la déportation d’ath kaci a commencé, sans même la défaite de toute la vallée de Sebaou. Les français recherchent les ait kaci, qui pour fuir la persécution, vont se réfugier et se fondre dans la masse, à Alger, à Constantine, et dans certains villages kabyles.
1862
Abderrahmane, fils de Slimane, construit une maison près d’un frêne, un arbre centenaire. Elle devient la première maison ancestrale de la famille, héritée plus tard par son fils Saïd. Les enfants de Yahia construisent leur maison à Anar, un terrain de labeur. Ath Lkhodja leur avaient cédé du terrain, entre Anar et imezlay pour Slimane, et entre Anar et Awin el-haj pour Yahia.
Installé voila plusieurs années au sud du rocher Ath Ali, Amar se marie, et sa femme met au monde deux garçons, Mhend Ath Amar né peu avant 1840 et Ali N’Amar né vers 1855. L’épouse d’Amar décède peu de temps après. Il se remarie avec une autre femme qui lui donne un garçon, Hend Ath Amar.
Mhend Ath Amar prend pour épouse une femme d’ath Slimane, Tassadit, fille de Mhend ou-Belkacem. C’est une femme d’une grande beauté. Elle lui donne deux garçons, Moh-Amechtoh vers le début des années 1860 puis Moh ou-Mhend près de 20 ans plus tard. On dit de Tassadit nath Slimane, qu’elle a l’âme d’une lionne. Ses quatre grossesses sont toutes espacées de sept ans. Mohand est recueilli par ses grands parents maternels, afin de lui permettre de se forger un caractère et une vigueur auprès de son grand père, Mhend ou-Belkacem.
1868
Slimane, fils de Mhend ou-Belkacem, travaille comme maçon au village Abizar chez la famille Adour. Au fil des jours, il commence à avoir des vues sur leur fille ainée, Ferroudja. Un jour, au bout d’une longue période d’impatience, il demande sa main auprès de ses parents.
La passion est réciproque, et la femme est prompte à honorer la demande, mais c’est sans compter sur ses parents dont le choix se porte déjà sur un autre homme, habitant d’Abizar même. Ils déclinent alors la demande de Slimane, qui de dépit, cesse le travail chez eux et se fait oublier. Elle est fiancée comme prévu, avec l’homme promis.
Le jour du mariage est fixé, et Slimane a vent des évènements qui se profilent. Le jour des noces de Ferroudja Tadourt, Slimane échafaude un plan, avec six autres jeunes du village, Yahia, futur père d’Amar ou-Yahia, un certain Mohand Arezki d’Igherbiene Bwada, …et Slimane entre autres. Ils désirent tous une jolie jeune femme, pour s’établir avec. Ils s’introduisent dans sa couche au milieu de la nuit, ils capturent la mariée, et galopent à cheval à toute allure. Ils arrivent au nord du village, et font une halte à Ikhervan pour se concerter, c’est déjà l’aurore. Ils finissent par s’entendre, et lui laissent le choix ;
- Nous te désirons tous, lui lance Yahia, alors tu as le droit de choisir l’un d’entre nous.
Son choix se porte sans sourciller sur Slimane et devient son épouse. Ferroudja intercède auprès de ses parents et leurs proches qui viennent la chercher le lendemain, pour calmer les esprits et accepter la fatalité, foncièrement désirée par la captive. Ils repartent sans elle et sans victime.
1871
En plus des déportations, Ath Kaci ont perdu beaucoup de terrain. Ils se sont dispersés parmi les archs voisins. L’instauration de l’administration civile, et la soumission de la Kabylie aux autorités françaises, donne une occasion à Ath Kaci de se reconstruire. Ils reprennent alors de la force et retrouvent leur capitale Tamda en guise d’autorité locale, qui facilite la gestion administrative pour les français. Les militaires français construisent une grande maison pour le bachagha Belkacem Oukaci et ses frères et Mohand Oukaci, sur ordre du gouverneur Randon, et devient la maison du caïd Ali.
Au mois de juin 1871, la tension est très électrique dans toute la Kabylie et les français commencent à s’inquiéter. Ils dépêchent une compagnie de fantassins auprès des caïds Ahmed et Ali fils du célèbre bachagha Moh Ait-Kaci, pour les amener à se dresser contre les insurgés, qui commençaient à recruter dans la région de l’Arbaa Nath Irathen.
Le caïd Ali entouré de ses hommes, reçoit l’unité française dans l’immense cour de sa résidence à Tamda. La conversation s’engage immédiatement entre le Caïd et le capitaine, debout entourés des leurs. Le caïd tente d’apaiser le capitaine en détresse, celui-ci vociférait, hautain et peu respectueux envers son interlocuteur hôte, plus âgé que lui. Révulsé par cette irrévérence, un jeune des Ait-Kaci, ne se retient pas plus longtemps, brise l’ambiance et tire sur le capitaine à bout portant d’un coup de fusil en plein ventre et l’homme s’écroule.
Une violente bagarre accroche rapidement les Ait Kaci et les français. Elle tourne à l’avantage des Ait Kaci. Plusieurs morts et blessés sont déplorés du côté français, dont sont faits une vingtaine de prisonniers. D’autres soldats réussissent à s’enfuir. L’irréparable est fait.
Dans la hâte, les Ait Kaci sellent les chevaux et chargent sur les mulets armes, munitions, vivres et tout ce qu’ils jugent nécessaire pour la survie en campagne. Ils emmènent les prisonniers et se dirigent vers Akfadou, pour rallier les insurgés. La maison du Caïd Ali, devient le quartier général des résistants. Après la mort du Caïd Ali, et son frère Belkacem, la maison est récupérée par l'Etat français avant d'être cédée à la municipalité.
Moh Amechtoh, est encore enfant, lorsqu’a lieu le premier affrontement contre les français, pour la conquête d’Ath Jennad, Tizi Bounoual, en 1871. Chaque famille envoie un jeune en capacité de se battre. Mahmoud, fils de M’hend ou Belkacem, est l’un des deux morts enregistrés pour la famille Ath Slimane. Le deuxième est de la famille de Bnamar. Les deux martyrs, ont été ramenés par Amar Ouyahia, réputé pour être un colosse, portés sur ses épaules. Ils sont inhumés tous les deux dans la même tombe, à Annar.
1873
Belkacem, petit fils de Yahia premier, habite Anar, depuis plusieurs années. Il est père d’un petit garçon, Kaci. Un jour d’automne, il part pour le pèlerinage à la Mecque.
Quelques semaines après son départ, au milieu de l’hiver, la femme de Belkacem décède et son petit garçon, désormais seul, cherche protection hors de la maison de ses parents. L’absence du pèlerin se prolonge anormalement, et les habitants finissent par se persuader de sa mort dans un pays lointain. Des funérailles par contumace sont organisées.
1876
Plus de deux ans plus tard, un jour de printemps, le désormais Hadj Belkacem se pointe au village, et découvre en arrivant qu’il n’a plus de chez-lui. Son enfant est confié à des cousins et les frontières ont changé. Les parcelles de terrain sont redéfinies, et chacun a déjà pris sa part, sans lui.
Il paie d’abord à la mosquée du village les frais de ses funérailles à venir. Il se procure une épée et revient vers ses cousins, plus menaçant. Ils se résignent à répondre à sa requête à la limite du quartier qui commence à se profiler, agglutinant des chaumières pour la plupart. Il se rassure d’abord sur sa place dans le village, conscient de la famine et des maladies qui ravagent la Kabylie voila quelques années, il projette de partir loin. Il emporte alors son garçon pour aller le confier aux pères blancs, installés à Larbaa nat irathen, depuis quelques années seulement.
Darwich, fils Ali Agharvi, apprend à temps sur les visées de son beau frère. Il se précipite, l’intercepte et lui propose l’adoption de l’enfant. Le nouveau Hadj cède à l’offre et lui confie son fils unique. La famille d’Ali Agharbi récupère Kaci. Hadj Belkacem quant à lui se ravise et s’installe dans le village. Quelques années plus tard, sa santé physique commence à décliner, avant de perdre ses moyens mentaux. Comme pour le cas de beaucoup dans la région à cette époque, une épidémie l’emporte vers 1979.
1882
Le recensement commence en Kabylie. L’état civil est instauré, et les autorités attribuent désormais des noms de familles en fonction des groupes généalogiques, et des quartiers d’habitation, dans la région. Moh Amechtoh s’occupe d’un troupeau de vaches et de chèvres. C’est maintenant un homme bien constitué.
1885
Le phénomène d’exil ou d’émigration prend de l’ampleur avec l’extinction progressive de la dynastie des Ath Kaci. Recherchés par les français, les rescapés abandonnent leurs territoires, en échange de leur protection. Ces plaines fertiles, sont partagées en grande partie entre l’arch Ath Jennad, l’arch Larbaa Nath Irathen et ath irouvah.
Il y a cinq ans, une famille d’Iqejiwen quittait le village Igherviene, pour s’installer à Tamda. Le père, était encore jeune, mais il avait déjà une fille mariée à un homme du village, de la puissante famille Ath Khodja. Un garçon, Marzouk, était né depuis peu. A Tamda, la famille s’agrandit et Yahia est l’un des nouveaux nés, il vient au monde en l’année 1886. Ils rejoignent ainsi leurs cousins exilés depuis quelques générations, et deviennent à leur tour Ath El Hocine.
Vers la fin du siècle, les territoires d’Ait Kaci commencent à être rognés par l’envahisseur Français. Ath el-El Hocine se résignent à quitter Tamda, pour s’installer à Nezla. Pendant le déménagement, Yahia est encore un très jeune garçon. Il transportait une balayette artisanale comme effet de voyage, et son ainé Marzouk portait dans ses mains une louche en bois, manifestement plus lourde.
1895
Hlima, une poétesse, est sœur de Yahia, père d’une petite fille Fadma g-Yahia. C’est une belle femme, d’une grande de taille, aux yeux bleus et aux cheveux châtains et lisses. Très jeune, Fadma aidait sa tante à moudre le blé, au broyeur d’Anar, en fredonnant un chant ancestral. Vers ses 18 ans, Hlima est mariée à un habitant de Waânenas.
De cette union nait un garçon. Ce dernier tombe malade décède, bien avant l’adolescence. Leur vie de couple n’était pas une joie de tous les instants. Le mari violentait sa femme et la rabaissait devant les voisins, bien avant le décès leur fils, et encore davantage après sa perte du seul réconfort moral qu’elle avait dans la maison. Elle est âgée de 25 ans.
Yahia lui rend visite un jour, à cheval. Dans le cours de la conversation, il prend connaissance et conscience de la misère morale qu’elle endurait. Il se résout alors à la ramener définitivement auprès des siens. Elle amasse quelques effets personnels légers et grimpe le cheval. Le cheval n’a pas encore fait un pas, que les frères, les cousins du mari, et lui-même, s’empressent d’empêcher l’épouse de s’en aller.
Yahia met pieds à terre, pose sa main sur la gaine de son épée et lance …. Akchich ghi cherken yemut, argaz degwen aydiqaraâ mara yawigh weltma. « L’enfant qui nous unissait n’est plus, alors j’emmène ma sœur, et que le brave m’entrave le passage». Ils restent ébahis et passifs devant le spectacle de l’épouse libérée et son frère, sur le dos du cheval qui s’éloigne et disparait dans la brume nocturne.
1898
Slimane n-Mhend et Ferroudja Tadourt, avaient vécu de longues années seuls, sans enfants. Arrivée à un âge certain, Ferroudja commence à se soucier de la progéniture et de l’héritage pour son mari. Elle met un point d’honneur à ne pas faire trop de vague sur ses projets, et regarde dans l’entourage proche. Durant l’été de l’année 1898, elle lui ramène sa nièce Fatima, encore très jeune, comme seconde épouse.
Slimane, Ferroudja et Fatima, trouvent ensemble un compromis qui n’alimente pas les mauvaises langues, et s’établissent dans la modeste maison en bois d’Aznik teslent. Au bout de quelques semaines, la jeun épouse est enceinte de son premier enfant. Mahmoud est né au printemps de l’année 1899. Fatima devient Tadourt.
1899
Un terrain, de la taille d’agouni fergan, appartenant au village Ighil Tazert, de Larvâa Nat Irathen, était sous convoitise du village voisin qui commence à planter une clôture. Les victimes de cette expropriation, demandent de l’aide à Moh Amechtoh et ses amis, Slimane n-Mhend et Amar ou Yahia entre autres. Moh Amechtoh suggère à ses amis de Larvâa ;
- J’irai les croiser à Djemâa n-Saharidj, à l’occasion du marché hebdomadaire, et nous aurons des explications, comme il faudra.
Les hommes de Tazert restent réticents à la proposition et expliquent ;
- Ça ne se fait pas qu’un étranger vienne réclamer un terrain. Ça serait plus judicieux de commencer par créer un lien de parenté. Vous auriez peut-être une fille qu’on puisse marier à l’un des nôtres.
- Non, mais j’ai un petit frère, d’un jeune âge, il pourrait bien épouser l’une de vos filles.
- Nous avons une petite fille, elle est encore très jeune…
Comme convenu, Moh ou-Mhend épouse Dahbia el-hanafi de la famille Hanachi. Dahvia n’avait pas fini de refaire ses dents. Le mariage est célébré, Moh Amechtoh à maintenant l’habitude de rendre visite aux beaux parents de son petit frère. Il allonge à chaque fois le trajet pour traverser le terrain discuté. Les convoiteurs comptent désormais avec sa présence, et se ravisent sur leurs projets fonciers.
1900
Kaci grandit au sein de la famille d’ath ouacif, et reprend par abus de langage le titre de pèlerin sur son père Haj Belkacem, et devient Haj kaci à son tour. Haj-Kaci épouse Fetouma, une femme originaire d’ath Lhocine, une blonde aux yeux verts, petite fille du cavalier d’Ath Kaci, Taakas, vers 1900. Ils s’installent à Awin El Hadj à l’est du village. En 1901, ils ont un premier garçon, Mokrane.
1903
Jusque là, les célébrations de mariage étaient mixtes, homme et femmes. Il y avait souvent des joutes verbales, accompagnant des chants lyriques. L’heure d’Asvoughar et de la poésie est toujours très attendue, tant les hommes y participent avec les femmes, en alternant les voix. Haj Kaci lance en regardant la jeune mariée Fatima Tadourt ;
A teffahs Ou mellakou.
Itsebwan ur irekou.
Tin youghen tizyas techfou
Tadsa ger meden ats tetsou
Les gens comprennent qu’il faisait bien allusion à la différence d’âge entre elle et son mari. Fatima Tadourt lui donne une réplique plus vive, faisant référence au titre de pèlerin usurpé. L’ambiance devient gênante pour les uns, risible pour les autres, et le malaise pour les familles concernées est tel que les sages du village se résolvent à mettre un terme cette grande mixité dans les fêtes.
Fetouma talhocint décède alors que Mokrane n’a pas encore ses 2 ans révolus. Kaci retrouve le lien de parenté qui l’avait vu grandir, chez el hara nali-agharvi et épouse une femme des leurs, Fadma Namar. Elle est sœur de Mohand Wamar Ouacif. De cette seconde union, nait un garçon, Larbi, en 1904, suivi d’une fille, Malha, vers la fin 1907.
1908
Hlima demeure célibataire pendant quelques années, puis un homme d’un âge certain, habitant Veliès, demande sa main. L’homme, frappé de malédiction disait-on, entre accidents et maladies, ses sept épouses, sont toutes décédées chez lui, l’une après l’autre. Il veut conjurer le sort et forcer son destin, et cherche à se marier loin de sa région.
Il demande à voir la jeune divorcée, indiquée par ses proches, mais ça n’est pas dans la tradition du village. Il vient à Igherviene accompagné. Sur recommandation, il attend discrètement,