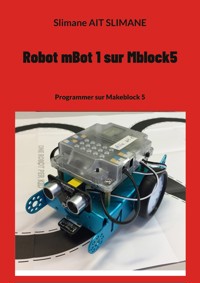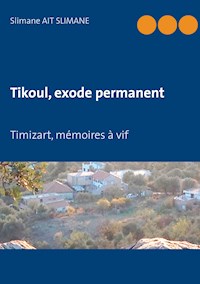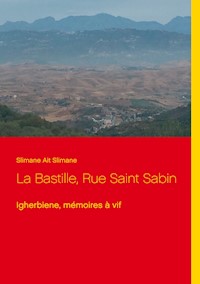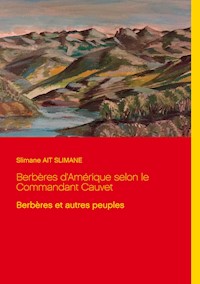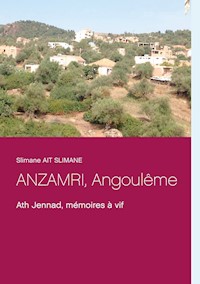
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Le livre retrace des évènements qui ont trait à la guerre, essentiellement dans la région d'Ath Jennad, en Kabylie, entre les 40 et les années 60. Les évènements se succèdent ou se passent simultanément, ils sont racontés dans une chronologie régie aussi souvent par la mort que par la vie des personnages. Le Village Igherbiene prend une place centrale dans les récits, qui sont basés sur des témoignages.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sommaire
At Jennad
Ath Kaci
Ath Lhocine
Ath Amar
Mixité
Abderrahmane
Lounès
Yahia
Wrida
Ahmed Moh Amechtoh
Ali Nath Amar
Hemd ou Umallul
Messali
Chara
Ouamrane
Mhend ou Slimane
Sadia
Mohand ou-Idir
La faim
Le paysan
Arezki ou-Yahia
Sadia
Moh el-haj
Sadia
Wrida
9 Mars 1955
La Bastille
MNA-FLN
Malha
Wardia
Wrida
Vriruch
Sadia
Commandant Moh Ouali
Wrida
Fédération de France
Ouacel
Moh el-haj
Wrida
Igufaf
Achour
Sadia
Abderrahmane
Sadia
Wrida
Les bleus
Les disparitions forcées
Titem
Jejiga G-Yahia
Fatima Moh Lhaj
Bounaâmane
Moh ou-Rezki
Sadia
Amirouche
Mohand Igherviene
Wrida
Ath Si Yahia
Couvre-feu
Agent parallèle
Sadia
Wrida
Sadia
Mohand Igherviene
Sadia
Mohand Igherviene
Sadia
Convocations
Sadia
Angoulême
Challes
Jumelles
Mohand Igherviene
La traversée
Sadia
Allemagne
Mokrane
Tachivount
Jedjiga G Yahia fin 59
Abri vendu
Wrida
Fatima
Wrida
Fernan
Malha
Sadia
Fatima
Moh Ourezki
Wrida
Réorganisation
Sadia
Titem
Wrida
Sadia
Moh El Haj
Taboudoucht
Sadia
Mars 1962
Fatima
Zerouali et Mazouzi
Fatima
Sadia
1962.
Wrida
Agent de Cologne
Wardia
Ouamrane
Wrida
Ouamrane
Ancien chef
Kaci n’Amara
Lectures
Bibliographie
At Jennad
At Jennad, est une confédération composée de quatre grandes tribus kabyles qui occupent la partie septentrionale de la Kabylie dont une bonne partie de la chaîne maritime de la grande Kabylie, région située précisément entre Djemâa-Saharidj et Taqsebet.
Le territoire des Aït Djennad est délimité à l'ouest par la confédération des Aït Ouaguenoun, au nord-ouest par celle des Iflissen lebhar. Il s'étend au nord-est jusque la mer Méditerranée et trouve à l'est une frontière avec les tribus de Tiguerim, Yazzouzen et Aït Flik. Au sud-ouest, la ville d'Azazga marque la frontière avec la tribu des Aït Ghobri, tandis qu'au sud-est la vallée du Sebaou constitue une frontière naturelle qui sépare les Aït Djennad des Aït Fraoussen.
La formation de cette confédération, est située dix siècles après la chute de la domination romaine, soit vers le 15ème siècle.
Djennad, l'ancêtre de la confédération, est venu de la ville de Dellys. Apparemment au IVe siècle de l'hégire soit au XIe siècle après la naissance du Christ. La prospérité des Djennad jouissait en Kabylie d'une certaine réputation. Djennad était déjà connu et même reconnu en tant que chef. La famille Djennad ne s'est pas fixée tout de suite dans la dite région comme étant la leur. Elle serait passée par Mers-Eddadjadj, puis sur la montagne à l'Est de l'embouchure de l'oued Isser et enfin au-delà du Sebaou. D'abord à Dellys et ensuite au pied de Tamgout où la géographie a permis d'assurer plus de sécurité.
L'arrivée de Sidi Mansour chez les Aït Djennad a été un événement déterminant. C'est sous son impulsion que les Aït Djennad se sont rendu compte de leur nombre et de leur force. Rapidement organisés autour du marabout, les Aït Djennad s'étaient soulevés contre l'oppression d'Amar Ou El Kadhi et du royaume de Koukou, pour devenir une confédération libre.
Conscientes de la force des Aït Djennad, les confédérations voisines des Aït Ouaguenoun et des Iflissen lebhar, exposées aux attaques des Ottomans, devinrent les alliées privilégiées des Aït Djennad, à qui elles demandèrent de l'aide.
Un peu plus tard les tribus des Aït Ghobri et des Yazzouzen, ainsi que la confédération des Aït Idjer rejoindront le collectif formé autour des Aït Djennad et de leur marabout Sidi Mansour pour devenir l'une des armées les plus puissantes de Kabylie. C'est ainsi que pendant plus d'un siècle, les tribus de la Kabylie maritime, sous le commandement des Aït Djennad, affronteront sans relâche les Turcs qui ne réussiront jamais à asseoir leur domination sur les tribus qui entourent le sommet de Tamgout.
Ath Kaci
Originaires de Baghlia, en basse Kabylie, les Ait Kaci s’installèrent d’abord à Chaïb, puis finirent à par adopter Tamda comme chef lieu de leur puissance. Les grands parents d’Ait Kaci furent pour la plupart, inhumés dans le cimetière Amzawrou, à Chaïb.
Les membres de cette famille, étaient depuis le protectorat turc, soit bachaghas, soit aghas, soit caïds ou soldats de métier au service de leur propre autorité. Les turcs leur cédèrent un certain pouvoir local. Ils avaient le commandement sur la vallée du Sebaou et la Haute-Kabylie. A l’arrivée des français, ils reprirent le même statut.
C’était une famille riche et propriétaire foncier, respectée et redoutée dans toute la Kabylie. Elle était constituée d'une armée de cavaliers bien entraînés dans l’art militaire.
La cavalerie des Ait-Kaci est connue aux alentours par ses raids éclair afin de percevoir les impôts, auprès des populations réfractaires à cette obligation.
Au mois de juin 1871, la tension est très électrique dans toute la Kabylie. Les français commencèrent à s’inquiéter, dépêchèrent une compagnie de fantassins auprès des caïds Ahmed et Ali fils du célèbre bachagha Moh Ait-Kaci, pour les amener à se dresser contre les insurgés, qui commençaient à recruter dans la région de l’Arbaa Nath Irathen.
Le caïd Ali entouré de ses hommes, reçut l’unité française dans l’immense cour de sa résidence à Tamda. La conversation s’engagea immédiatement entre le Caïd et le capitaine, debout entourés des leurs.
Le caïd tentait d’apaiser le capitaine en détresse, celui-ci vociférait, hautain et peu respectueux envers son interlocuteur hôte, plus âgé que lui et toujours calme. Révulsé par cette irrévérence, un jeune des Ait-Kaci, ne se retint pas plus longtemps, brisa l’ambiance et tira sur le capitaine à bout portant d’un coup de fusil en plein ventre et l’homme s’écroula raide mort.
Une violente bagarre accrocha les Ait Kaci et les français, rapide et meurtrière, elle tourna à l’avantage des Ait Kaci. On déplora plusieurs morts et blessés du côté français, dont furent fait une vingtaine de prisonniers. D’autres rescapés réussirent à s’enfuir. L’irréparable fut fait.
Dans la hâte, les Ait Kaci sellèrent les chevaux et chargèrent sur les mulets armes, munitions, vivres et tous ce qu’ils jugeaient nécessaire pour la survie en en campagne. Ils emmenèrent les prisonniers et se dirigèrent vers Akfadou, pour rallier les insurgés.
Ath Lhocine
A cause des plaines d’Azaghar, les Ait Kaci et Ait Jennad étaient parfois en conflit, sur un fond d’une rivalité permanente. Ainsi, Ath Kaci recevaient souvent des fugitifs provenant des Ait Jennad.
Dans le village Igherviene, un litige s’engagea entre deux grandes familles, plutôt voisines, voir cousines, probablement vers l’année 1880. La tension déboucha sur un affrontement physique armé, dans la broussaille d’Imezlay, à l’Est du village, sous le regard du rocher Ouzaya. On dénombra alors plusieurs morts, 7 victimes du côté des futurs Ben Saïd, et 6 victimes du côté du groupe qui deviendra les Ait Gherbi.
Cette tragédie qui arrivait à son paroxysme, connut soudain un répit suite à l’apparent équilibre dans les dégâts causés. Les villageois supposaient alors et espéraient un calme après la tempête. Mais la différence en nombre de morts, laissait planer la menace d’une vengeance eminente. Une des deux familles dut se confiner pendant près de deux mois pour parer aux représailles.
Les sages du village intervinrent alors pour intercéder entre les deux belligérants. Ils se résolurent à faire déménager les deux camps, et les firent quitter définitivement le village.
L’un des deux groupes, s’exila vers Tamda. A l’époque il y avait encore les Ait Kaci. L’autre groupe, dut partir dans la direction opposée, vers la côte, Ait Réhouna.
Les Ait Kaci reçurent les exilés vers le sud, afin de leur éviter la vengeance. On disait à l’époque de leur propension à offrir asile aux réfugiés et autres fugitifs :
‘Celui qui a tué, doit habiter Tamda’. En Kabyle, ‘Win inghan izdegh Tamda’.
Chez Ait Kaci, si l’homme était fort, il devenait systématiquement cavalier, mais s’il était d’une santé précaire, il faisait du pâturage. Ils engagèrent alors deux hommes de la famille d’Iqajiwen nouvellement reçue.
L’un d’entre eux, vécut assez longtemps et eut des enfants. L’autre, Hocine, fut tué au combat, alors qu’il était encore très jeune et célibataire. En référence et en hommage à sa mémoire, la famille en exil devint Ait el Hocine.
Vers la fin du siècle, les territoires d’Ait Kaci commencèrent à être rognés par l’envahisseur Français. Ils proposèrent alors à Ait el Hocine de quitter Tamda, en leur laissant le choix de la terre où s’installer. Ils avaient mérité leur récompense pour avoir donné des martyrs. Les Ait Hocine demandèrent alors un champ près d’Ait Jennad. Ainsi ils choisirent Nezla.
Les Ben Saïd, étaient une famille de Cheikhs, le dernier d’entre eux, était cheikh Arezki. Au sein du village Ait Rehouna, ils exerçaient leur vocation d’Imam de père en fils. Lorsque le père de Cheikh Arezki, revint d’Ait Rehouna, pour instituer comme Imam dans le village Igherbiene, il n’avait plus de terre pour construire et s’y installer. Les Ait Hocine leur cédèrent alors des parcelles de leurs terrains abandonnés.
Ath Amar
Moh Amechtoh, naquit vers le début des années 1860, d’une mère originaire d’Ath Slimane, une certaine Tassadit Nat Slimane. C’était une femme qu’on disait d’un charme rare.
A l’époque, la tradition requérait que les garçons, dans la mesure du possible, soient envoyés dans les familles puissantes, pour qu’ils s’inspirent des hommes forts. Ainsi, Mohand fut recueilli par ses grands parents maternels, afin de lui permettre de se forger un caractère et une vigueur auprès de son grand père, Mhend ou belkacem, qui deviendrait aussi le grand père paternel de Mhend Ouslimane. De part son vécu, il devenait la mémoire du village.
Moh Amechtoh, se souvenait de la première bataille de l’arrivée des français à Ath Jennad. Elle s’engagea à Tizi Bounoual, il était encore enfant. C’était l’insurrection d’el Mokrani et Cheikh Ahedad. Chaque famille qui avait un jeune en capacité de se battre, devait l’envoyer au front pour résister aux français.
Pour Ath Slimane, il y eut deux morts, dont l’un s’appelait Mahmoud. Il était de la famille de M’hend ou Belkacem. Les deux martyrs, furent ramenés par Amar Ouyahia, portés sur ses épaules. C’était un colosse. Ils furent inhumés tous les deux au cimetière d’Annar, dans une même tombe. La seule encore visible.
Moh Amechtoh avait connu l’époque où il y avait encore des lions au rocher at-Ali, au dessus du village. Lorsque l’état civil commençait à être établi et les familles se faisaient attribuer des noms administratifs, dans la région d’Ait Jennad, il faisait du pâturage, mais il était déjà un homme assez bien constitué. Le recensement se déroula entre 1982 et 1991.
Il racontait que Hend Agharbi, ancêtre du village Igherbiene, vécut entre le 7ème et le 8ème siècle hégire, qui coïncidait avec la période où les berbères revenaient d’Espagne à la chute de Grenade. Beaucoup d’entre eux avaient fait des études et se dispersaient dans les villages et en profitaient aux habitants.
Mixité
Vers l’année 1900, Haj kaci et et Taadourt, que tout le monde appellerait bien plus tard Yema Tamghart, se retrouvèrent dans une fête de mariage dans le village.
Jusque là, les célébrations de mariage étaient mixtes, homme et femmes. Il y avait souvent des joutes verbales, accompagnant des chants lyriques. L’heure de la poésie était toujours le moment le plus attendu, tant les Kabyles accordaient une place centrale au choix des mots.
Malha, fille de Haj kaci, se rappelait de quelques mots prononcés par son père en direction de Taadourt, tels qu’ils furent rapportés par des témoins.
A teffahs Ou mellakou.
Itsebwan ur irekou.
Tin youghen tizyas techfou
Tadsa ger meden ats tetsou
Ô pomme de Mellakou. Une région de l’ouest Algérien.
Qui murit et ne pourrit jamais.
Celle qui épouse un congénère
Elle oublie le rire en public.
Taadourt lui donna une réplique plus vive, disait Malha. Le malaise et le rire se mélangeaient tel qu’à partir de ce jour, les sages du village se résignèrent à abolir la mixité dans toutes les fêtes de mariage.
Haj Kaci décéda vers l’année 1919, alors que son fils ainé Mokrane était déjà un adolescent. Malha se rappelait qu’à la mort de son père, « Les Kabyles mobilisés, revenaient de la grande guerre. Son fils cadet Moh El Haj, était né depuis quelques mois seulement ».
Abderrahmane
Peu après le milieu des années trente, Abderrahmane-N-hend, était déjà un quadragénaire bien assumé. Très matinal, peu avant l’aube, il se dirigeait régulièrement à la mosquée mitoyenne, et n’en ressortait qu’à l’aurore. Son chemin piéton étroit, Tacherchourt, passait tout près de la maison de Hend Ouamar.
Le fils de ce dernier, Ali Hend Ouamar, naquit en 1895, voila plusieurs années qu’il était marié, probablement bien avant l’année 1930. Mais le syndrome de la stérilité semblait le guetter, et hanter son épouse, Fadma Taaliths.
Cette dernière, se résolut un jour à forcer la main à son destin, et se leva assez longtemps avant l’aube. Elle alluma le feu et prépara une galette molle, pour la quelle la levure était nécessairement laissée monter et fermenter depuis la veille. Elle attendit sur le chemin, près de la maison, juste à l’heure de la prière et intercepta Abderrahmane qui revenait de la mosquée, couvert dans son burnous blanc, et son visage pratiquement caché par la capuche. Elle mit entre ses mains les galettes encore fumantes, et prit congé. Ce dernier lui psalmodia alors des prières comme il savait les faire. On dit qu’il était un expert dans la prière oralisée et lyrique. C’était vers la fin de l’été. Fadma rentra à la maison avec la certitude de pouvoir espérer des jours meilleurs. Elle n’attendra pas au delà de quelques semaines avant d’être enceinte de son premier enfant. Ce n’était pas encore l’hiver.
Lounès
Fernan El Hanafi, était l’un des précurseurs les plus actifs du Mouvement national. Il fut mortellement blessé le 18 mai 1955 au cours d’un accrochage avec la police coloniale de Belcourt, au chemin Vauban à Alger.
Il succomba à ses blessures deux jours plus tard à Chebli, où il fut clandestinement enterré. Il avait un neveu qui était militant du FLN, installé en Allemagne durant les années de la guerre de libération.
« Un jour, en Allemagne, je discutais avec le neveu de Fernan. Nous ne nous connaissions pas encore. Alors, Fernan me demanda le nom de mon village d’origine. Je répondis « Igherbiene Nat Jennad ».
Fernan fit un bon en arrière, le visage devint blême, il me regardait hébété, pendant un moment d’hésitation et d’appréhension, et il reprit ses esprits et le fil de la conversation, avant de me demander ;
- Alors tu connais un homme au nom de Lwennas Igherbienne ?
- Oui, il est de mon village.
- Il a commis beaucoup de dégâts dans mon patelin !
Lounès devait être né vers 1900. Lui, son frère cadet et son ainé Arezki, étaient encore enfants lorsque leur mère décida de quitter le village.
Elle apprit de la part de son mari, qui venait de rentrer un soir à la maison, qu’il avait fini de vendre toutes ses terres, au profit de ses cousins, Amokrane et Hend Ouamar entre autres. L’épouse, qui était originaire de Mira, prise d’une crise de nerf à cause de cette grave naïveté de son époux, s’en alla sur le champ, laissant le mari seul à la maison. Elle marcha toute la nuit, emportant avec elle ses petits. Ce fut aux environs de 1910.
Elle se dirigea d’abord vers son village natal où elle confia ses enfants à ses cousins entres autres, pour les recueillir et les garder pour un temps indéfini. Ils se mirent à travailler la terre et le pâturage pour le plus jeune. Arezki avait 11 ans.
La mère esseulée se retrouva plus tard près de Tawint ou Lekhrif. Il y avait déjà sur place une famille immigrée d’Imesunen.
Arezki et le frère cadet, continuèrent à travailler sérieusement. Le plus jeune finit par acheter un terrain à Tawint ou Lekhrif. Arezki, s’installa à Guendoul.
Lounes, quant à lui, progressivement, il glissait vers le banditisme.
Il vivait le clair de son temps à Larbaa Nath Irathen. Il marchait beaucoup, il aidait les gens comme chasseur de prime, l’un est agressé, l’autre a été volé, il devait alors intervenir. Et toute action avait un prix. Mais il revenait au village parfois, surtout pour se rappeler ses terres.
Plus tard, Lounès voulut se voir restituer les terres de ses parents. Il les réclama alors auprès d’Ali Hend Wamar, qu’il menaça de mort s’il ne daignait pas satisfaire à la demande du cousin devenu étranger. Il lui fixa un délai pour signer le document de cession.
Dans la semaine où le délai fixé devait expirer, les gendarmes qui l’avaient auparavant blessé se mirent à sa poursuite. Ils le rattrapèrent après un long parcours sur son chemin vers vers Azazga. Capturé, Lounes resta près d’un mois en prison.
Des témoignages affirment qu’Ali Hend Wamar, lui avait promis la restitution de ses terres.
Emprisonné à Tizi Ouzou. Sa mère lui rendait visite régulièrement. Mais il avait déjà beaucoup d’ennemis. Près d’un mois après, empoisonné par des habitants de Larbaa, manifestement, il mourut en prison de Tizi Ouzou vers l’année 1948.
A sa mort, le commissariat prit contact avec sa mère, qui se dépêcha sur place aussitôt. A son arrivée, les policiers, le commissaire, se levèrent et enlevèrent leur chapeau en signe de respect pour saluer la dame endeuillée.
Il y eut des funérailles protocolaires, en présence de sa mère et ses frères. Il fut enterré au cimetière de M’douha. Sa mère vécut jusque 1962. Jegiga g-Yahia, belle-fille d’Arezki, connaissait la mère de Lounès. ’Elle était déjà centenaire’ se rappelle-t-elle encore.
Yahia
Cheikh Salah, un imam d’une grande notoriété dans la région d’ath Jennad, instituait à la Zawia de Timizart N Sidi Mensour. Il apprit un jour qu’il était menacé de mort et sa tête était mise à prix. Un tueur à gage connu était déjà prévu pour accomplir la besogne. Le Cheikh était informé qu’il s’agissait d’un habitant du village Tifra, dans la région d’Iflissen Lebhar près de Tigzirt. Le cheikh, depuis, ne sortait plus de chez lui. Seul son frère s’occupait de ses communications extérieures et autres besoins en tout genre.
Le frère du cheikh rendit visite alors à Moh Amechtoh, un notable du village Igherbienne ou fella. Ce dernier intervint et fit appel à un certain Yahia. Convaincu que ce dernier serait pour cette affaire, tout à fait dans son élément.
Yahia naquit à Nezla, devenu plus tard village Igherbienne Bwada, vers 1890. Son père, était encore jeune quand il quitta le village. Il faisait partie de la grande famille exilée, devenue Ath el Hocine, chez les Ath Kaci. Yahia vécut adulte comme chasseur de prime et hors la loi. Il était connu en Kabylie, en particulier par ses pairs, et autres commanditaires, potentiels et habitués ou victimes de basses œuvres.
Yahia monta sur son cheval. Galopa à toute allure, jusqu’à la devanture de la maison du fameux tueur à gage à Tifra. Il trouva sa fille devant la maison et l’interpela.
- Ou est ton père ?
- Il n’est pas là.
- Dis-lui quand même de venir me voir.
La fille, après courte hésitation, rentra à la maison, et décrit à son père l’homme menaçant qui le réclamait.
Le concerné était pris de d’un stress palpable. Hésita un instant, et il finit par se montrer, même s’il était persuadé qu’il serait menacé de mort à son tour. Un influent personnage l’avait déjà payé pour la tête du cheikh Salah. Les deux hommes se mirent à part loin de la petite fille, et échangèrent quelques mots, sur un ton viril et cordial.
- As-tu l’intention de tuer Cheikh Salah ?
- Tout à fait.
- Alors tu ne le feras pas !
- Mais si, j’ai déjà dépensé la moitié de la somme perçue.
- Tu vas aller voir le commanditaire, et tu lui diras ‘nous avons déjà dépensé tout l’argent, et le cheikh ne sera pas tué. C’est de la part de Yahia Nat Jennad’.
- Comment ça ?
- S’il arrive un problème à Cheikh Salah, tu seras mort.
- Ça ne va pas être facile.
- Si tu es menacé par ton commanditaire, je serai à tes côtés. s’engagea Yahia.
- Alors le cheikh ne sera pas tué. Promit le tueur à gage.
Ayant atteint l’objectif pour lequel il y était venu, Yahia repartit sur son cheval, galopant. Il retrouva le frère du cheikh et annonça la nouvelle.
- Ton frère peut maintenant sortir. Il n’est plus menacé. Le tueur l’a promis.
Le cheikh fit venir alors Yahia à la Zawia de Sidi Mansour et lui proposa :
- Comment pourrais-je te remercier ?
- ‘De la prière pour mes filles’. souhaita Yahia, qui ne souffla pas un mot sur ses garçons.
- Elles vont alors toutes s’épanouir, même la non-voyante. Promit le cheikh.
Plus tard, le fils de Moh Amechtoh, Ahmed, par sa deuxième épouse Tagemount, épousera Wrida, la fille cadette du chasseur. Wrida, se rappelle encore un peu de son père.
Wrida
Je suis mariée 3 ans avant la guerre. Je n’avais pas suffisamment connu mon père.
C’était un agriculteur. Il s’occupait de la terre au début. Il payait un ouvrier pour travailler son exploitation. Lorsque ses enfants étaient plus grands, c’était eux qui s’occupaient de la paire de bœufs pour retourner la terre.