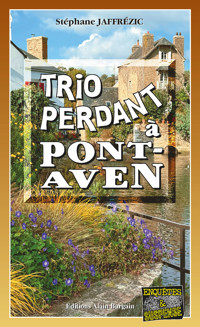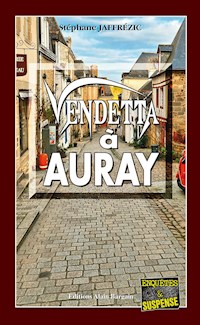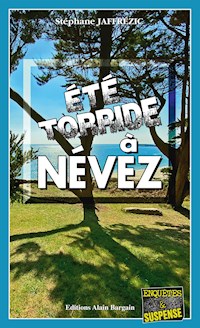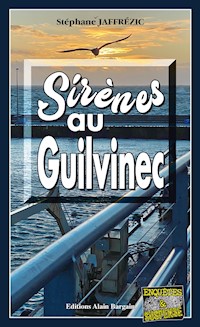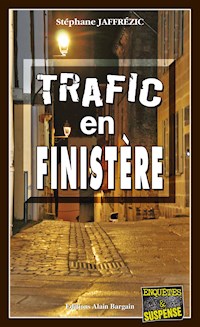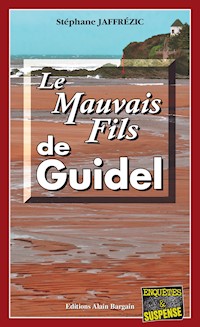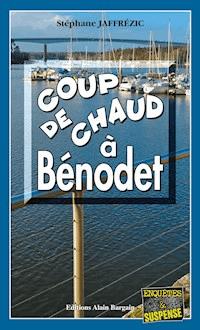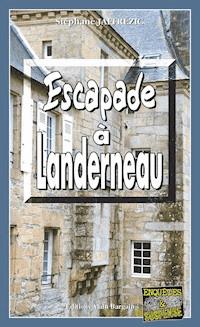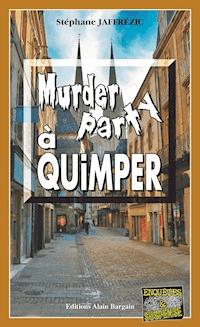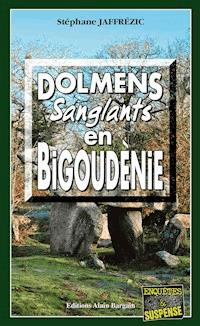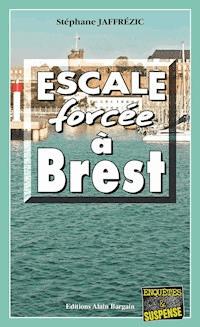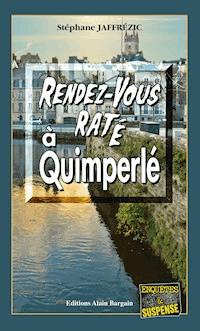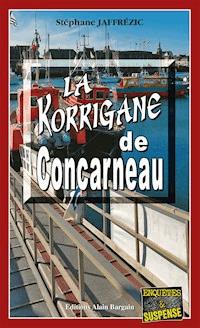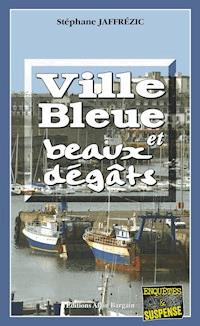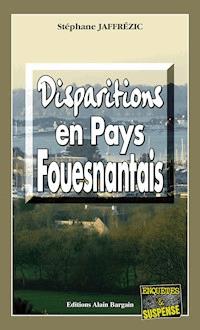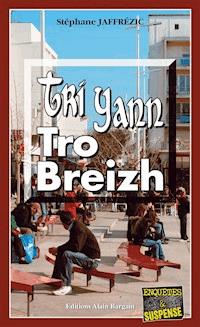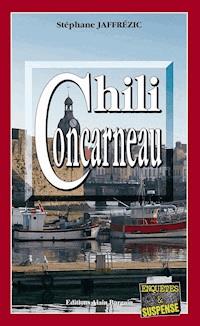
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Maxime Moreau
- Sprache: Französisch
Cauchemar dans un petit port de pêche breton...
Un matin de mai, les pompiers repêchent un noyé à Concarneau. Il s’avère rapidement qu’il s’agit d’un meurtre. Le capitaine Maxime Moreau va se plonger dans la vie nocturne du port de pêche pour tenter d’élucider l’affaire. Mais, alors que l’enquête piétine, un second crime va réorienter les investigations vers un milieu dans lequel une vie humaine pèse bien peu face à la cupidité et à la perversité…
Un polar surprenant, des intrigues croisées, le tout saupoudré d'une pointe d'humour, voici le premier tome des enquêtes de Maxime Moreau !
EXTRAIT
"— Quel est votre nom ?
— Vieux Pierrot.
— Ce n’est pas un nom, ça, c’est un surnom ! Comment vous appelez-vous ?
J’ai marqué un point et nul doute que l’autre va se ruer à l’attaque pour tenter d’égaliser.
— Mon identité n’a aucun rapport avec le décès de Marc et je…
— Donnez-moi vos papiers.
Non seulement il n’est pas revenu au score, mais voilà que je fais le break. Je lis de la contrariété sur le visage de mon vis-à-vis. Il me présente un superbe portefeuille en crocodile. J’admire l’objet, le tourne et le retourne dans mes mains avant de l’ouvrir. Il renferme tout un tas de papiers, de la carte de groupe sanguin au permis de conduire en passant par des coupures de journaux. Il y a également des photos, mais j’ai suffisamment de savoir-vivre pour ne pas m’y attarder."
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Éditions Bargain, le succès du polar breton." -
Ouest France
"Ce roman se lit facilement, l'intrigue est bien ficelée et on passe un bon moment." -
Houbbabzh, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1964 à Concarneau,
Stéphane Jaffrézic habite Quimper. Après le succès de son premier roman,
Toiles de fond à Concarneau, il se lance maintenant dans le genre policier. Ce
Chili Concarneau, épicé à souhait, est à consommer sans modération.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À tous les miens.
Au commandant Vincent Martin,avec tous mes remerciements.Au major Dominique Charbonnier,et à mon copain Philippe L’Excellent.
I
Dans une semi-conscience, je me dis que je dois ressembler à un bébé. Comme un marmot serrerait contre son petit corps sa peluche préférée, son mouchoir ou que sais-je encore, j’ai refermé ma main sur le réveil après en avoir stoppé le mécanisme et le presse puérilement contre ma poitrine. Près de moi, j’entends la respiration lente et régulière de Murielle et tente d’imaginer sa position. Il me semble qu’elle est allongée sur le ventre, le visage tourné dans ma direction. Je resterais ainsi des heures durant, à l’écouter dormir et à réfléchir. Sur tout, sur rien, uniquement pour le plaisir de savourer le calme de l’instant.
Quand j’ai ouvert les yeux, je me suis relevé sur un coude pour lire l’heure : 6 heures 29. La sonnerie étant programmée pour un quart d’heure plus tard, je l’ai arrêtée. Combien de temps s’est-il écoulé depuis ? Tant qu’à bouger pour le savoir, autant me lever.
Je souffre, le mot est fort, d’un trouble obsessionnel du comportement. Ce n’est pas douloureux, ne nécessite pas de traitement et se manifeste de différentes manières. Ainsi, lorsque je monte ou descends un escalier, je compte les marches ; dans la rue, parfois, je compte mes pas. Ou alors, je vérifie à plusieurs reprises si j’ai bel et bien éteint la télévision ou la lumière et fermé le gaz. Ou encore, j’ouvre une seconde fois ma boîte à lettres après le passage du facteur pour être certain qu’elle est vide. Dans le cas présent, je m’assure pour la troisième ou quatrième fois que le poussoir du réveil est enfoncé. Dans le noir, mes pieds trouvent les chaussons et je sors de la chambre, silencieux comme un chat. Tandis que je m’habille dans la salle de bain, je me félicite de ne pas avoir troublé le sommeil de mon amie.
Alors que j’achève de boutonner ma chemise, le téléphone se met à hurler. Cela n’était pas prévu au programme et je peste intérieurement contre l’imbécile qui appelle si tôt. En une fraction de seconde, je me doute de son identité et, pour le coup, ne lui en veux plus du tout.
— Allô, dis-je d’une voix à peine éveillée.
— Capitaine Moreau ?
— Oui.
— Ici le poste. Un monsieur a vu un corps dans le port. Je viens de prévenir les pompiers.
— Vous avez bien fait. C’est à quel endroit ?
— A la cale aux Voleurs.1
— J’arrive.
Je sais que, dans la cuisine, la casserole de café n’attend qu’une allumette pour se mettre à chauffer et répandre le délicat arôme. Mais ce n’est pas pour maintenant. Il y a plus urgent. Ignorant la chambre, alors que je suppose que les deux sonneries ont réveillé Murielle, j’attrape mon blouson et mes chaussures et sors de la maison.
En ce début avril, le jour est à peine levé et je dois allumer mes phares. Les pompiers passent devant moi comme je marque le stop au haut de la rue Saint-Jacques ; tout d’abord un C 25, dans lequel vraisemblablement les hommes revêtent leur tenue de plongée, puis un VSAB (véhicule de secours aux asphyxiés et blessés). Je démarre à leur suite et, tout comme eux, grille le feu au bas de l’avenue de la Gare, à vingt mètres du commissariat. Il en va de même un peu plus loin pour tourner à gauche. La patrouille est déjà sur place. Son gyrophare teinte de bleu le paysage et je trouve cela plutôt agréable à l’œil.
Le VPL (véhicule des plongeurs) s’arrête pour permettre à deux hommes d’en descendre avec leur matériel et poursuit sa route. Je connais leur manière de procéder et sais que le chauffeur va chercher le zodiac au port de plaisance. Le temps de me garer sans risquer de gêner les éventuelles manœuvres à venir, d’éteindre le moteur et de m’extraire de la voiture, ce qui représente une poignée de secondes, et déjà les pompiers ont endossé les bouteilles et chaussé les palmes. Masque et tuba à la main, ils avancent en levant haut les genoux et scrutent la surface.
Le brigadier Vernet et un autre homme s’approchent et désignent un point à une dizaine de mètres du quai. Les plongeurs acquiescent et empruntent la cale. Après avoir craché sur le verre de leur masque et l’avoir rincé, ils se glissent à l’eau.
Attirés par les gyrophares, des badauds arrivent déjà et les agents de la patrouille les maintiennent à distance. De leur côté, les trois pompiers du VSAB préparent une bouteille d’oxygène et un brancard.
— Bonjour, capitaine. Le corps a dû couler…
— Bonjour. C’est Monsieur, le témoin ?
Vernet opine et je me dirige vers l’homme en question : petit, frêle, une barbe inégale sur des joues couperosées, portant des vêtements plus de première fraîcheur, on peut lui donner soixante-dix ans bien qu’il soit certain qu’il ne les a pas.
— Expliquez-moi les circonstances de votre découverte, voulez-vous…
Se sentant subitement important, il redresse les épaules et rejette la tête en arrière.
— Je m’appelle Yves Audrin. Tous les matins, de bonne heure, je fais mon tour sur le quai. Je suis un ancien marin et je connais des gars sur pratiquement tous les bateaux. Alors, quand j’en vois un, il me file une godaille.
Il semble décidé à fournir la version longue. Tout en l’écoutant, j’observe les plongeurs qui nagent vers la zone indiquée. Le bruit d’un moteur grossit et le zodiac arrive en provenance du chenal. Piloté de main de maître, la rapide embarcation rejoint le périmètre des plongeurs en un temps record.
— D’un seul coup, qu’est-ce que je vois : un noyé ! Je me dis : « merde, c’est pas vrai ! » et je m’avance. Juste, je le vois couler. J’ai regardé autour de moi, mais y avait personne. Et moi, je sais pas nager, autrement j’aurais sauté l’aider. Je regarde à nouveau, et tiens, y avait plus rien ! Il était plus là ! Alors, je suis parti en courant jusqu’à chez les flics, enfin… jusqu’à chez vous, quoi. Et voilà.
Le brigadier Vernet m’adresse discrètement un geste sans équivoque quant à l’intérêt qu’il apporte à ce témoignage. Je ne suis pas loin de partager son sentiment mais préfère attendre la fin des recherches.
— Ne vous éloignez pas, monsieur Audrin. J’aurai peut-être encore besoin de vous.
J’ignore si ce qu’il raconte est vrai ou non mais, dans le doute, je photographie mentalement les lieux, les faits et gestes de chacun.
Par expérience, je connais l’importance de ces premiers relevés. Je n’aperçois nulle trace de gleure2, nulle pellicule de gas-oil sur le sol mouillé. A supposer qu’il y ait effectivement une victime, rien n’explique une éventuelle glissade. J’en viens ensuite à penser à un suicide mais note l’absence de véhicule à proximité immédiate du quai m’étonne. Au cours de ma carrière, j’ai enquêté en de nombreuses occasions sur des décès suspects, avant que l’autopsie ou un quelconque élément ne prouve le suicide et autorise à classer l’affaire. A chaque fois, il est apparu que l’individu, lorsqu’il n’a pas commis son acte dans son habitation, avait agi au plus simple. Jamais, ou en tout cas très rarement, il n’avait parcouru une longue distance à pied avant le passage à l’acte. Il y a, certes, une dizaine de voitures sur le parking de l’Office du Tourisme, mais je serais surpris que l’une d’entre elles appartienne à la victime, car les places les plus proches du quai sont disponibles. Mais la psychologie d’un individu se préparant à en terminer avec la vie est tellement étrange… De plus, il ou elle a très bien pu se jeter à l’eau à l’autre bout du port et être amené ici par le courant.
Le pilote du zodiac observe la surface tandis que ses collègues examinent le fond. Ils ont agrandi le cercle de leur exploration et un bouillonnement atteste de leurs déplacements. Il fait maintenant totalement jour et l’atmosphère en devient moins oppressante. Au fond de moi, j’accorde de moins en moins de crédit au témoignage de l’ancien marin. L’idée d’un canular ou d’une hallucination a fait son chemin dans l’esprit de bon nombre de curieux. Surprenant des sourires en coin et des rires moqueurs, Audrin entre soudainement en colère et prend à témoin la foule de plus en plus nombreuse :
— J’vous dis qu’j’l’ai vu ! Vous savez bien que j’suis pas fou ! C’est quand même terrible, ça ! Où il est passé, nom de Dieu ?
Juste à ce moment, soutenant effectivement un corps, les hommes-grenouilles crèvent la surface du port et nagent rapidement vers la cale. Sur le quai, l’équipe du VSAB se tient prête : ça va être à elle de jouer. La foule, comme un seul homme, s’est avancée et a gagné plusieurs mètres. Vernet et les agents ont bien tenté d’endiguer cette progression mais n’ont pu résister à la formidable poussée.
Parvenus à la cale, les plongeurs marchent à reculons en tirant le noyé puis le confient à l’équipe du VSAB. Conscients de l’importance de chaque seconde, ceux-ci courent l’allonger sur le quai. Ignorant le temps d’immersion mais partant du principe que la circulation sanguine ralentit dans l’eau fraîche, ils s’empressent. Un pompier prend le pouls de la victime à la carotide alors qu’un second, équipé d’une paire de ciseaux, coupe le pull-over et le tee-shirt dans le sens de la longueur.
D’un regard, ils se sont compris : le cœur ne bat plus, ils vont choquer la victime. Le courant électrique et l’eau ne faisant pas bon ménage, le troisième intervient pour sécher le corps avec un drap avant la pose des patchs.
Pendant qu’ils s’affairent, j’attrape dans ma poche l’appareil photo que j’ai pris soin d’apporter et que je laisse en permanence dans la boîte à gants de ma voiture. Je tiens cette habitude d’un prof que j’ai eu à l’École Nationale Supérieure des Inspecteurs de Police. C’était un vieux de la vieille, ce prof, il avait du métier et faisait profiter les jeunes recrues de sa grande expérience. En dehors des cours, il prodiguait des conseils qui, j’ai pu le constater par la suite, se sont révélés efficaces et pleins de bon sens. Exemple, l’appareil photo. Hormis la caméra, il n’existe rien de mieux qu’une série de clichés pour rendre compte d’une situation. S’il m’arrive d’oublier un détail, anodin en début d’enquête mais finalement primordial pour coincer le coupable d’un méfait, il me suffit de consulter les épreuves, éventuellement de les faire agrandir.
Je suis occupé à photographier le port, le zodiac et les plongeurs qui regagnent le port de plaisance, leur devoir terminé, quand Vernet me hèle. Il semble paniqué et son air ne me dit rien qui vaille.
— Regardez, capitaine !
Un pompier a soulevé le buste du noyé dans le but de lui assécher le dos et on voit alors sous l’omoplate droite un trou d’environ un centimètre de diamètre, d’où du sang s’est échappé. Je vais pour effleurer la blessure quand le chef de l’équipe de réanimation, un sergent, m’apostrophe :
— On verra ça plus tard. Le DSA (défibrillateur semi-automatique) d’abord.
Ils rallongent le corps et le sous-officier pose deux patchs reliés au DSA, l’un à droite en haut de la poitrine, l’autre sous le cœur. Dans l’immédiat, je n’ai d’autre choix que de les laisser tout tenter pour ramener à la vie le malheureux. Perplexe, je m’éloigne pour réfléchir. En découvrant la blessure, j’ai compris à son aspect qu’elle a été causée peu avant le contact avec l’eau salée. Je tire donc une conclusion élémentaire : je suis confronté à un meurtre. A l’aide de mon portable, j’appelle le bureau du procureur.
1. Cette cale tire son nom du temps où les marins écoulaient à cet endroit une partie de leurs prises, à un prix supérieur à celui qu’ils obtenaient sous criée.
2. Appellation concarnoise du mucus, la substance visqueuse et glissante sécrétée par les tissus muqueux des poissons.
II
Le cerveau à plein régime, je dresse mentalement la liste des choses prévues pour aujourd’hui et en barre certaines qui peuvent ou devront attendre. C’est bien ma veine, ça ! Il a fallu que je sois de permanence la nuit où ce quidam passe l’arme à gauche. En compagnie des pompiers, j’attends l’arrivée du médecin que j’ai fait prévenir et des pompes funèbres. Le corps a été déposé dans une housse mortuaire et il ne manque que la constatation officielle du décès pour tirer la fermeture éclair.
Le noyé n’a pas de papiers d’identité sur lui. Du reste, il est en pull. Pourquoi ? Par la relative fraîcheur de ces nuits d’avril, il ne viendrait à personne l’idée de sortir sans blouson ou manteau. Au début, j’ai supposé que le coup a été porté ailleurs, dans un endroit chauffé ou pour le moins abrité, et que l’on a voulu faire disparaître le cadavre en le jetant à l’eau. Mais une petite mare de sang pas encore séché a attiré mon attention, invalidant cette possibilité. Enfin, il est prématuré d’affirmer que ce sang provient du noyé mais, pour vérifier cette hypothèse, j’ai demandé l’intervention d’un technicien de la police technique et scientifique.
Celui-ci a mis vingt minutes, pas une de plus, pour venir de Quimper. L’air blasé, sans s’occuper de ce qui l’entoure, il a trempé de petits bâtonnets dans le sang et les a placés dans un sac plastique. Puis il a scellé le sac avec de la cire et me l’a remis. Pendant ce temps, j’ai examiné la dépouille et j’ai remarqué des traces suspectes au niveau du cou. Mes connaissances médicales, très limitées il est vrai, me permettent néanmoins de considérer comme acquit que l’homme était mort avant sa culbute dans le grand bain.
Sa sacoche à la main, le docteur Jézéquel se fraye un chemin dans la foule encore nombreuse. Il me reconnaît et m’adresse un petit signe de la main avant de se mettre à la tâche.
Retenus à une quinzaine de mètres par les agents en uniforme, les badauds murmurent leurs impressions et je les vois tenter d’apercevoir le visage du malheureux. Bien qu’accoutumé à cette forme d’indécence, je sens une certaine tension monter en moi et suis à deux doigts d’ordonner à Vernet de les faire reculer quand des cris font diversion et amènent le silence.
— Marco… Marco… Marc…
Derrière moi, par conséquent face à la foule, sont amarrés deux vieux gréements, en attente de leur première sortie printanière. Un homme vient de surgir sur l’un deux et regarde, stupéfait, les gyrophares, les véhicules de secours et la meute de curieux. Il semble entrevoir la cause de ce rassemblement, enjambe la lice et grimpe nerveusement trois barreaux à l’échelle rouillée du quai.
Dans sa précipitation, il rate un barreau et il s’en faut de peu qu’il ne se retrouve dans l’eau deux mètres plus bas. La bouche ouverte, les lèvres tremblantes, il s’approche mi-marchant, mi-courant. Vernet va pour l’en empêcher quand je le retiens par le bras.
La soixantaine, le cheveu rare sur un visage long aux traits fins, l’inconnu porte une veste en tweed et a une écharpe nouée autour du cou.
Plus rien ni personne n’existe pour lui, excepté la housse sur laquelle ses yeux sont braqués. Il ralentit son allure en discernant le profil familier et exécute les derniers mètres à petits pas. Lentement, il s’agenouille près du médecin, caresse une joue du noyé, arrange une mèche de cheveux et ses larmes se mettent à couler.
Son examen terminé, Jézéquel hésite un instant avant de se relever. Après un regard pour le proche de la victime, il le fait enfin et vient dans ma direction.
— Bonjour, Docteur. Alors ?
L’homme de l’art soupire avant de répondre.
— La blessure dans le dos, bien que sérieuse, n’a pas causé la mort. En revanche, je penche pour la strangulation. Vous l’avez trouvé dans le port ?
— Oui. Selon vous, à quand remonte le décès ?
— Pour l’instant, impossible de le dire avec précision. La rigidité cadavérique ne s’est pas opérée, mais il n’y a à cela rien d’étonnant du fait de l’immersion. J’imagine que vous souhaitez une autopsie.
— Bien sûr ! Vers quelle heure les résultats ?
— Aucune idée ! Demandez cela à Valmont, le légiste de Quimper. Appelez-le vers dix-sept heures. Je l’avertirai de votre coup de fil et lui transmettrai mes constatations.
— Merci, Docteur.
Il tourne les talons et je reporte mon attention vers le proche du noyé.
Le sergent des pompiers l’a pris en charge et lui prodigue des paroles réconfortantes… Pendant ce temps, ses collègues ont refermé la housse mortuaire et un fourgon des pompes funèbres effectue une marche arrière. Comme pour signifier que le spectacle est terminé, une mouette lâche son cri strident et la foule repue s’éparpille par petits groupes.
— C’est “Vieux Pierrot”, me glisse Vernet. Ce sont des clochards.
— Je les trouve bien habillés pour des clochards !
— Quand je dis clochards, j’entends par là qu’ils n’ont pas de domicile fixe ni de profession. Disons qu’ils vivent en marge de la société. Ils traînent par ici depuis peu.
— Il y en a un qui aura un domicile fixe maintenant…
Le docteur Jézéquel discute un moment avec les employés des pompes funèbres puis repart vers sa voiture. Les pompiers, leur matériel rangé, s’apprêtent à rejoindre le centre de secours. Les mains le long du corps, “Vieux Pierrot” n’esquisse le moindre mouvement. Si ce n’étaient ses paupières qui s’ouvrent et se referment à intervalles réguliers, on le croirait statufié.
Je suis tout à coup pris de pitié pour le pauvre homme qui, je le sens, ne peut compter sur personne pour soulager sa peine.
— Occupez-vous de monsieur Audrin, dis-je à Vernet. Amenez-le au poste et donnez-lui un coup de remontant. J’enregistrerai son témoignage dès que possible.
Je respire à pleins poumons et marche vers le clochard. Celui-ci ne me voit pas approcher et c’est le contact de ma main sur la sienne qui le fait réagir et sortir de sa torpeur. Sachant que je ne dois pas le brusquer, j’adopte ce qui me semble être un regard compréhensif et une voix douce.
— Sincères condoléances, Vieux Pierrot. Je m’appelle Maxime Moreau et je suis officier de police judiciaire.
J’attends que ces quelques mots se frayent un chemin dans son esprit avant de poursuivre.
— Voulez-vous m’accompagner ? Vous me parlerez de Marc.
Vieux Pierrot plante ses yeux vides de toute expression dans les miens et branle du chef. Je redoutais sa réaction en découvrant que je connaissais son surnom, mais il n’en fait pas cas. Tout en y mettant de la chaleur, mais pas trop non plus, je le prends doucement par le bras et nous traversons l’espace réservé aux cars des liaisons intercommunales pour gagner le commissariat.
Après avoir répondu au bonjour de l’adjoint de sécurité chargé de l’accueil et du standard téléphonique, je lui demande, dans un premier temps, de nous faire parvenir du café et des croissants et, dans un second, de déplacer ma voiture. L’emploi-jeune, nouvellement embauché, accepte avec empressement tandis que nous nous dirigeons vers l’escalier. Nous progressons lentement, ce qui me donne tout loisir pour me livrer à mon passe-temps favori : le comptage des marches. Moi-même ne saurais expliquer ce qui me pousse à le faire, alors qu’en l’occurrence je connais d’avance le résultat.
J’essaye parfois de résister à ce TOC, me traitant de dingo, mais finis par craquer et ne peux m’en empêcher. Il m’est même arrivé, en gravissant un escalier et en me forçant à ne pas compter, de céder
à la tentation et de faire demi-tour pour satisfaire mon envie, à la grande surprise de certains. Il m’a alors fallu inventer un prétexte, sous peine de passer pour le cinglé de service.
En entrant dans mon bureau, je dépose le sac contenant les bâtonnets sur le meuble bas placé sous un plan mural de la ville. Puis je m’assois et propose la chaise me faisant face au semi-clochard. Je pioche une cigarette dans mon paquet, l’allume à la flamme du briquet que m’a offert Murielle pour mon anniversaire, et tends le tout à Vieux Pierrot. Je suis tellement persuadé que mon visiteur va s’en saisir que j’en reste baba quand il me répond d’une voix claire :
— Non, jamais à jeun.
La cigarette aux lèvres, je me fais l’effet d’un imbécile. Je prends le parti d’en écraser l’extrémité consumée et dis :
— Vous avez raison. Elle n’en sera que meilleure plus tard.
Pour la seconde fois de la matinée, je téléphone au procureur qui donne son aval pour l’expertise des bâtonnets. Ces tracasseries administratives réglées, je me tourne vers Vieux Pierrot. Il m’impressionne, le bonhomme. En dépit de l’épreuve qu’il traverse, il dégage un sentiment de force tranquille, d’intelligence et de sagesse. Il se tient droit, la tête haute, dans une position digne, aristocratique même, et je remarque seulement à cet instant la beauté de son visage. Plus jeune, il devait ramasser les filles à la pelle. Il porte une moustache bien taillée et, contrairement à ce que l’on imagine d’un clochard, ses vêtements ne sont ni sales ni élimés. Il y a plutôt une certaine recherche dans l’assortiment des tons, le col de la veste rappelant le pantalon de velours beige. Comme toujours avec ce genre d’hommes je suis tenté de l’interroger sur ce qui a pu le pousser à mener cette existence, mais mon petit doigt me souffle que j’essuierais une rebuffade. Pour me donner une contenance, je range quelques feuillets et l’observe à la dérobée. Il ne semble pas intimidé par les lieux et encore moins par moi. Il vient de perdre un proche et éprouve une tristesse toute naturelle mais sans en rajouter. D’autres, dans ces circonstances, se mettraient à pleurer, à pleurnicher sur leur sort ou à gémir. Pas lui, ce qui amène à penser qu’il a vécu des moments bien plus pénibles. Il connaît la vie, la mort aussi, sait ce que j’attends de lui et se prépare à livrer son témoignage.
— Selon vous, que s’est-il passé ?
— Je ne sais pas. A vous de le découvrir.
Il a médité sa réponse, le bougre. Son regard est maintenant lucide et je le suppose redoutablement intelligent et difficile à manœuvrer. Avec élégance, il croise les jambes, chasse une invisible poussière puis me fixe de ses yeux gris-vert. Tout son être irradie une certaine classe et je suis de plus en plus mal
à l’aise. Ceci n’est pas conforme à ce qui devrait normalement se passer et je dois réagir au plus vite.
— Quel est votre nom ?
— Vieux Pierrot.
— Ce n’est pas un nom, ça, c’est un surnom ! Comment vous appelez-vous ?
J’ai marqué un point et nul doute que l’autre va se ruer à l’attaque pour tenter d’égaliser.
— Mon identité n’a aucun rapport avec le décès de Marc et je…
— Donnez-moi vos papiers.
Non seulement il n’est pas revenu au score, mais voilà que je fais le break. Je lis de la contrariété sur le visage de mon vis-à-vis. Il me présente un superbe portefeuille en crocodile. J’admire l’objet, le tourne et le retourne dans mes mains avant de l’ouvrir. Il renferme tout un tas de papiers, de la carte de groupe sanguin au permis de conduire en passant par des coupures de journaux. Il y a également des photos, mais j’ai suffisamment de savoir-vivre pour ne pas m’y attarder. Pourtant, l’espace d’une seconde, je vois sur la première ce cher Vieux Pierrot, plus jeune d’une trentaine d’années. Ses traits n’ont quasiment pas changé, tout juste si la couronne de cheveux a blanchi. Près de lui pose une femme, très belle, qui donne la main à un charmant petit garçon blond d’environ trois ans. Tous trois sourient sur ce cliché pris devant une grande construction, un château ou un manoir. Au pied du perron sont garées une Porsche et une Jaguar. Je déniche une carte d’identité, l’ancien modèle à deux volets, et lis à haute voix :
— Pierre-Édouard de Vitreux de Barnac, né en 1945 à Paris.
Reposant le tout sur mon bureau, j’interroge :
— Vous m’expliquez ?
— Qu’y a-t-il à vous expliquer ? Vous souhaitiez connaître mon identité, voilà qui est fait.
Un coup discret à la porte annonce l’entrée de l’ADS, qui apporte le petit-déjeuner commandé.
Nous mangeons en silence petits pains au chocolat et croissants arrosés de café. Cet intermède survient au bon moment et permet à l’atmosphère de se détendre. J’allume une cigarette et en propose une à Vieux Pierrot. Nous fumons sans nous adresser la parole, savourant cette trêve. Arrivé au philtre, Vieux Pierrot écrase la sienne et dit dans un soupir :
— Allons-y. Je vous écoute.
— Que s’est-il passé hier soir ? Racontez-moi votre soirée.
— Que voulez-vous savoir ? C’était une soirée comme les autres. Nous sommes montés à bord du “Corentin” vers vingt heures, comme d’habitude… Nous avons mangé et discuté jusqu’à plus de minuit. Quand je me suis réveillé, Marc n’était plus là… Le reste, vous le connaissez.
— Comment s’appelle la victime ?
— Marc Pagel. P.A.G.E.L.
J’entre ces données dans mon ordinateur et questionne, sans lever les yeux du clavier :
— Avait-il des ennemis ?
— Absolument pas. Nous ne fréquentions personne. Notre seule compagnie suffisait à égayer nos journées.
— Des dettes ?
— Bien sûr que non ! Nous ne sommes pas des mendiants, obligés de tendre la main pour nous alimenter quand le RMI s’est volatilisé dans le picrate.
Il a repris du poil de la bête et éclipse momentanément la mort de son copain. Attrapant hardiment le paquet de cigarettes, il en allume une et explique :
— Je crois, capitaine Moreau, que l’étude de mon portefeuille ne vous a pas fourni suffisamment de renseignements pour comprendre notre histoire. Je vais donc éclairer votre lanterne : je suis issu d’une grande famille et porte le titre de baron. Malheureusement, mon père ignorait beaucoup des choses de la Bourse et des placements financiers, pour le moins farfelus, achevèrent de le ruiner. Le baron de Vitreux de Barnac dus se contenter d’une modeste place d’employé de banque pour faire vivre sa famille. Aîné de quatre enfants, j’héritai du titre nobiliaire et eus la chance de suivre des études supérieures. En dehors des cours, je fréquentais des fils et filles de grands bourgeois, envieux de mon titre. Il me fallait chaque jour inventer de nouveaux subterfuges pour renoncer à une invitation, n’ayant du smoking que le nœud papillon, ou pour reporter à une date ultérieure la visite du manoir familial, en fait un appartement dans un immeuble sans cachet de Nanterre. Un jour, après les cours, une jeune fille follement amoureuse de moi me suivit. Elle n’était pas douée pour la filature et je m’en apercevais aussitôt. J’étais pris au piège : je ne pouvais décemment pas rentrer à Nanterre ! Il me vint une idée : je m’arrêtai dans un bar pour téléphoner à un copain dont les parents étaient concierges d’un hôtel appartenant au Premier Ministre de l’époque. Il accepta de me faire entrer pour, je n’avais trouvé que ce motif, me prêter un volume traitant de la reproduction des insectes en milieu hostile… Le lendemain, à l’université, il se racontait que Pierre-Édouard de Vitreux de Barnac rencontrait en secret monsieur le Premier Ministre. Pour le coup, tout le monde s’intéressait à moi. Celle qui m’avait suivi vanta mes relations, mon intelligence, ma beauté, mon élégance naturelle, etc… à son père. Celui-ci, propriétaire d’un grand laboratoire pharmaceutique et de plusieurs usines, voulut à tout prix me connaître et m’envoya chercher en Rolls Royce. Pour l’occasion, je me souviens avoir donné rendez-vous place Vendôme où j’avais soi-disant à faire. En arrivant à la luxueuse demeure, ma camarade m’attendait et me pria d’excuser son papa qui nous rejoindrait plus tard. Elle me fit visiter le parc et, dans une dépendance, se jeta voracement sur moi. Elle était loin d’être laide et ce qui devait arriver arriva… A la fin de la journée, en prenant congé, son père insista pour que nous nous revoyions, cette fois en présence de mes parents. Je le promis, bien entendu.
Absorbé par sa conversation, il n’a pas tiré une seule bouffée de sa cigarette et elle s’est consumée dans le cendrier en laissant un parfait rouleau de cendre. Du geste, il en demande une autre et continue après l’avoir allumée :
— Quand la Rolls me ramena, le chauffeur me déposa sur les Champs-Elysées. Nous étions en juin. Je n’avais pas commis le moindre impair durant des mois, et là, je venais de tout fiche en l’air. Je prétextai un fort mal de tête et de terribles douleurs abdominales pour ne plus me rendre à l’université. Pour l’été, je trouvai un poste de gardien de nuit dans un hôtel. Je me laissai pousser barbe et moustaches, espérant que ces attributs, ajoutés à la durée de mon éloignement, écarteraient ma conquête de mon chemin. Le temps passant, je pensais avoir réussi, quand, un matin de septembre, son père faisait les cent pas au pied de mon immeuble. Il avait engagé un détective privé pour me retrouver ! Il me traita de “petit con”, m’accusa d’avoir sali son nom et l’honneur de sa fille et m’apprit qu’elle attendait un enfant. J’étais coincé. Sans me laisser le temps de réagir, il rencontra mes parents et organisa un mariage en grande pompe en un temps record.
— Vous pouviez refuser cette union.