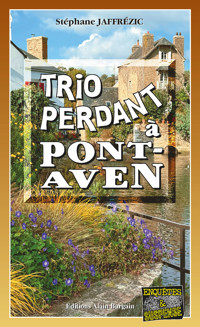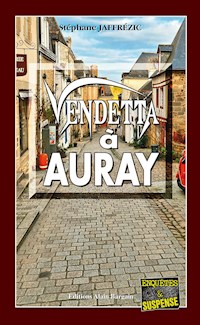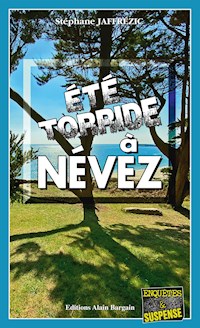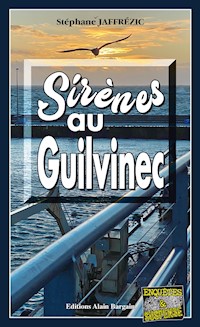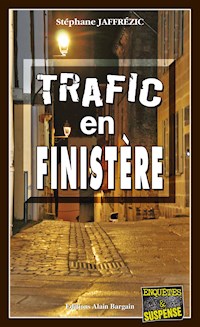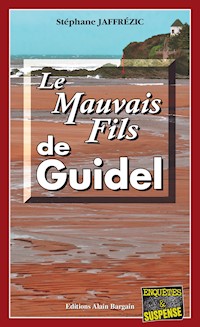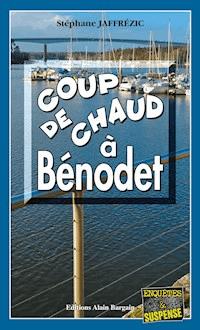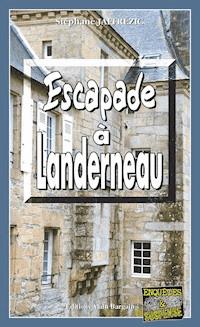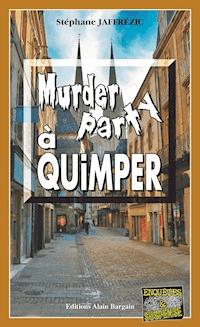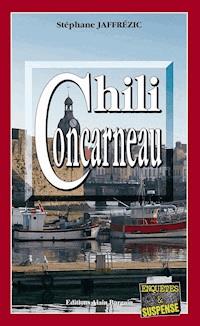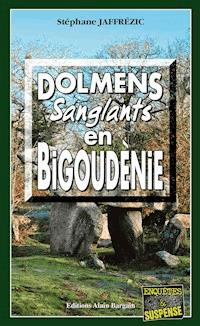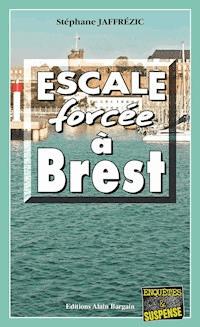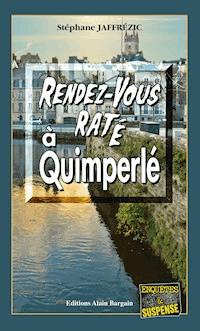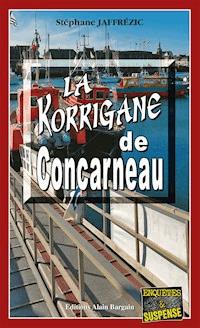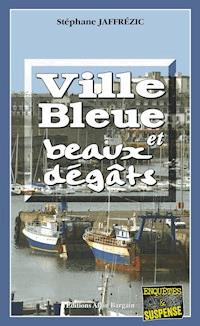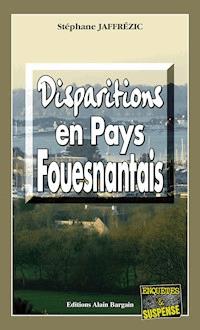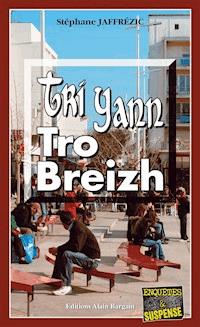Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Alors que le gendarme Clet Moreau se lie d'amitié avec le peintre Paul Sérusier, une mystérieuse disparition survient...
Bénéficiant d’une permission agricole, les gendarmes Clet Moreau et Blaise Furic se rendent à Châteauneuf-du-Faou afin d’y restaurer un penty.
Séjournant à l’hôtel, ils vont entretenir une relation privilégiée avec le peintre Paul Sérusier, ami du célèbre Paul Gauguin. Alors que les journées s’écoulent paisiblement, une étrange disparition va bouleverser cette quiétude.
Une nouvelle enquête passionnante dans les milieux artistiques du XIXe siècle pour le gendarme Clet Moreau !
EXTRAIT
Juin 1895
—Je sais que tu mérites ma confiance, Arsène. Je te confie donc la direction de la brigade durant mon absence. Je suis certain que tu sauras mener à bien les
différentes missions qui vous seront proposées. Le gendarme Arsène Bourhis, au garde-à-vous, gonfla la poitrine et bloqua sa respiration autant qu’il le put. Depuis deux longs mois, lorsque le maréchal des logis avait appris aux quatre hommes qui composaient la brigade de Concarneau qu’il aurait à s’absenter au mois de juin pour une douzaine de jours et qu’Arsène assurerait l’intérim, celui-ci avait à maintes reprises vécu le moment de la passation de pouvoirs.
Une douce excitation faisait trembler ses jambes, tandis qu’un torrent de sueur ruisselait le long de sa colonne vertébrale.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Éditions Bargain, le succès du polar breton. -
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1964 à Concarneau,
Stéphane Jaffrézic habite et travaille à Quimper. Dans ce quatrième roman, il ne se contente pas de plonger le lecteur dans
une enquête policière mais l’emporte à la rencontre d’un univers artistique particulièrement captivant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À Nicolle et Bernard, mes parents.À Monique et Corinne, mes sœurs.
« Je me sens de plus en plus attiré par la Bretagne, ma vraie patrie puisque j’y suis né de l’esprit. »Paul Sérusier
REMERCIEMENTS
- À ma femme Nicole, ma première lectrice.
- À madame Caroline Boyle-Turner, spécialiste de Paul Sérusier et directrice de Pont-Aven School of Contemporary Art, une école ayant pour mission de faire venir des étudiants du monde entier sur les traces des artistes peintres qui ont fréquenté Pont-Aven, afin d’y créer des œuvres d’art contemporain.
- À madame Nathalie Galissot, conservateur au musée des Beaux-Arts de Quimper.
- À monsieur Hervé Irvoas, professeur d’anglais et d’allemand en retraite, sonneur de biniou récompensé en de multiples occasions, adjoint au maire de Châteauneuf-du-Faou chargé de la culture et du patrimoine.
I
Juin 1895
— Je sais que tu mérites ma confiance, Arsène. Je te confie donc la direction de la brigade durant mon absence. Je suis certain que tu sauras mener à bien les différentes missions qui vous seront proposées.
Le gendarme Arsène Bourhis, au garde-à-vous, gonfla la poitrine et bloqua sa respiration autant qu’il le put. Depuis deux longs mois, lorsque le maréchal des logis avait appris aux quatre hommes qui composaient la brigade de Concarneau qu’il aurait à s’absenter au mois de juin pour une douzaine de jours et qu’Arsène assurerait l’intérim, celui-ci avait à maintes reprises vécu le moment de la passation de pouvoirs. Une douce excitation faisait trembler ses jambes, tandis qu’un torrent de sueur ruisselait le long de sa colonne vertébrale.
— Tu t’es déjà montré digne d’endosser cette responsabilité, je pars donc serein. Tiens, voici la clef de l’armoire qui se trouve dans mon bureau. Elle contient les mousquetons et tout un tas de poucettes1. En cas de besoin, tu pourras obtenir des renforts de Quimper. Mais je me répète, tu connais la procédure. A bientôt, Arsène.
Clet Moreau se tourna alors vers sa femme. Un garçon de huit ans se tenait à ses côtés, les yeux encore gonflés par le sommeil, les cheveux hirsutes. Malgré l’heure matinale, il n’avait pas voulu rater le départ de son papa et de son frère. En ce début juin, la chaleur ne s’était pas encore installée et il frissonnait. Au fond de ses sabots, il faisait jouer ses orteils pour éviter le contact froid du bois. Mais il ne regrettait aucunement la chaleur du lit clos qu’il venait de quitter.
— Sois sage, Léon. Et obéis à ta mère ! Elle aura bien assez à faire comme cela.
Penaud, l’enfant baissa la tête avant de la relever quand son père ajouta d’une voix enjouée qui ne laissait percer le moindre doute :
— En contrepartie, si j’en ai le temps, je te fabriquerai un jouet. Sinon, je te ramènerai une surprise.
Léon se jeta en hurlant de joie sur son père et enserra sa taille de ses petits bras.
— Allons, allons ! Tu vas réveiller ta petite sœur.
Craignant que cette bruyante démonstration suffise à annuler l’idée du cadeau, Léon se mordilla les lèvres et relâcha son étreinte. Clet cligna de l’œil pour démontrer qu’il n’en serait rien, ce qui amena un sourire radieux sur le visage de l’enfant. Puis, avisant un curieux équipage qui surgissait à l’angle de la rue, Léon partit en courant à sa rencontre. Son frère Jean, de deux ans son aîné, tenait crânement la bride d’un cheval et écoutait religieusement les conseils que lui prodiguait le gendarme qui l’accompagnait.
Blottie dans les bras de sa maman, Alexandrine, la petite dernière de la famille, remua la tête dans son sommeil et poussa un soupir d’aise. Née à la fin de l’hiver, elle avait réveillé toute la brigade ce matin tant son estomac criait famine. Rassasiée du bon lait maternel, elle s’était rendormie. Seuls le visage aux joues rondes et les mains potelées du bébé apparaissaient au milieu du vêtement trop grand qui la protégeait des morsures de la fraîcheur matinale.
Clet lui déposa un baiser sur le nez, les yeux emplis d’émotion devant tant de pureté, d’innocence et de beauté. Dévisageant sa femme, il chuchota :
— Elle est belle. Prends soin d’elle, Eugénie. Et de toi aussi, bien sûr. Léon sera là pour t’aider, si nécessaire.
Le moment du départ était venu. Il prit sur lui pour ne pas serrer Eugénie contre lui. La décence lui en interdisant plus, il l’embrassa sur le front. Certes, le baiser dura, mais nul ne s’en offusqua. Le coup de coude de Jean à son frère n’eut d’ailleurs pas la même signification que d’habitude, quand leurs parents prétextaient l’étroitesse de l’espace entre la table et la grande armoire pour se rapprocher.
— Allez, Jean. Dis au revoir à ta mère.
Pendant que celui-ci s’exécutait de bonne grâce, Clet s’accroupit face à Léon.
— La prochaine fois, ce sera toi qui m’accompagneras.
— Sûr ?
Répondre par une question était la spécialité de Léon.
— Sûr et certain ! Sauf si tu te conduis mal en mon absence. Mais je ne me fais pas de souci : tu es un petit garçon gentil et intelligent. Avec toi, les femmes de la famille sont en sécurité.
Se sentant soudain important, il tricha de quelques centimètres en se mettant sur la pointe des pieds et leva fièrement le menton.
— Ne t’inquiète pas, papa : tout va bien se passer.
— Je sais.
Clet embrassa son fils puis se releva. Il saisit la bride que lui tendait le solide gendarme Corentin Dervout. Dans un ensemble parfait, celui-ci et Arsène Bourhis s’engouffrèrent dans la maison qui abritait au rez-de-chaussée la brigade de gendarmerie et à l’étage, les militaires et leurs familles. Clet bloqua un ballot contenant des vêtements pour lui et Jean sur l’encolure du cheval et y grimpa lentement.
— Heureusement qu’Alain Rannou accepte de prêter un canasson à la brigade, sinon j’aurais été dans l’obligation de me passer de ce brave Skouarn Treuz2.
Comme s’il avait compris le compliment du maréchal des logis, le cheval poussa un hennissement et souffla des naseaux. Les garçons s’amusèrent de la réaction de l’animal, mais bien vite un masque de tristesse figea leurs traits. Jean s’approcha de Léon. Plutôt que de l’embrasser comme celui-ci s’y attendait, il lui prit la main et la serra longuement. Les yeux dans les yeux, ils communiquèrent. Nulle parole ne fut prononcée, mais ils se dirent bien des choses.
— Viens, bout d’homme, fit Clet en allongeant les bras.
D’une traction, il arracha son fils du sol et le posa derrière lui.
— Accroche-toi à moi. Ce n’est pas trop dur ?
— Ça ira, répondit Jean en se balançant d’une fesse sur l’autre.
— On m’a raconté qu’en Amérique, c’est un pays très loin d’ici…
— Plus loin que Quimper ? coupa Léon.
— Oh oui ! Beaucoup, beaucoup plus loin.
— Plus loin que Châteauneuf-du-Faou ?
— Aussi, Léon ! Tiens, pour t’expliquer à quel point c’est éloigné de Concarneau, imagine que l’on ne peut y aller à pied ou à cheval. Il faut prendre le bateau et naviguer pendant des semaines et des semaines.
La bouche du petit garçon s’était ouverte en un rond presque parfait que crénelaient ses incisives définitives que l’on voyait poindre. Déjà, son esprit vagabondait par-delà les îles Glénan.
— Donc, comme je le disais, on m’a raconté qu’en Amérique, les hommes montent directement sur le dos des chevaux. Ils n’utilisent pas de selle et ne s’en portent pas plus mal.
— Ils doivent avoir le c…
Jean avait failli émettre une grossièreté mais s’était retenu à temps. Il poursuivit d’une voix de fausset :
— Ils doivent avoir les fesses en compote, les Américois.
— Les Américains, corrigea Eugénie.
— Tu es sûre qu’on dit comme ça ? demanda Léon.
— Oui, assura la maman.
— Et pourquoi on ne dit pas les Concarnains, alors ?
Prise au dépourvu, Eugénie ne sut que répondre. Clet la tira de ce mauvais pas.
— On appelle ces hommes des Indiens. Ils habitaient ce pays avant que les hommes blancs venus d’Europe ne débarquent et colonisent…
— Des hommes blancs ! Tout blancs ?
— Mais non. On dit des hommes blancs parce qu’on appelle les Indiens des Peaux-Rouges, et que…
— Des Peaux-Rouges !
Clet perdait pied. Les interrogations candides de Léon avaient raison de ses qualités de pédagogue. Il s’embourba dans une série de : « euh… euh… »
— Est-ce que ce sont les mêmes Indiens que ceux que rencontrent les marins de la Compagnie des Indes, à Lorient ?
Cette fois, c’était Jean qui posait une question. Son père afficha clairement que les limites de sa patience étaient atteintes et explosa :
— Bon, ça suffit ! On ne va pas rester discuter toute la journée ! Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Et pourquoi que ? Assez !
Lisant un profond désaccord dans les yeux d’Eugénie, il revint illico à de meilleurs sentiments.
— Vous apprendrez tout cela à l’école. Vous êtes encore trop “pitits”, comme on dit à Concarneau… Remarquez, c’est bien de poser des questions. Mais ce sont des choses tellement compliquées que vous ne comprendriez rien à mes réponses.
Les garçons hochèrent pensivement la tête, se demandant à quel âge on était réceptif à la différence entre un Indien peau-rouge et un Indien, et entre un Américois et un Américain.
Leur père retrouva sa bonne humeur et annonça :
— A bientôt. Nous penserons à vous.
Les yeux d’Eugénie s’étaient mouillés. Craignant à son tour de se laisser submerger par le flot de son émotion, Clet fit faire demi-tour à sa monture et lui flatta les flancs de ses talons. La bête se mit au trot, ses fers heurtant en cadence les pavés de la rue Colbert.
Léon courut derrière eux sur une vingtaine de mètres, encouragé par son frère qui multipliait les signes de bras à son adresse ainsi qu’à celle de sa maman. Il s’arrêta quand l’équipage tourna dans la rue Jean Bart. Dépité, il revint à petits pas vers sa mère et sa sœur toujours endormie.
Eugénie aussi avait le cœur gros. Depuis onze années qu’ils étaient mariés, jamais Clet et elle ne s’étaient séparés plus d’une journée. Mais il lui fallait donner l’exemple et ramener de la joie sur la frimousse de son rejeton !
— Ne sois pas triste, Léon. Ils reviendront aussi vite que possible. D’ailleurs, avec un peu de chance, ce sera plus rapide que prévu.
Ses paroles ne se révélant pas aussi apaisantes qu’elle l’espérait, elle jugea stratégiquement préférable d’occuper l’esprit de son fils avant qu’il ne se laisse dominer par l’affliction.
— Ne reste pas là comme un godec3 ! Tiens, je vois ton copain Roger et sa sœur qui vont vers la grève. Tu n’as qu’à les rattraper. Et comme la mer est basse, ramasse donc des moules ou des berniques pour midi. Ça nous changera de l’ordinaire.
*
Avant de quitter Concarneau, Clet Moreau prit la direction du quartier de la Croix. A défaut d’en être le berceau, ce quartier était l’âme de la ville. Les conserveries y étaient légion. L’animation était rythmée par l’arrivée des chaloupes sardinières. Les marins couraient alors apporter le précieux petit poisson d’argent aux acheteuses des usines qui avaient les pleins pouvoirs pour en estimer le prix. Les penn-sardinn’, ces ouvrières qui tiraient leur nom de leur coiffe de travail, se précipiteraient alors vers les usines. Leur travail consistait à couper la tête des poissons d’un geste expert pour, dans le même temps, en ôter les viscères. Disposées sur des grilles, les sardines étaient lavées à l’eau salée puis mises à sécher. On les passait ensuite dans un bain d’huile avant de les laisser s’égoutter. Pour l’ultime étape, la mise en boîte proprement dite, les ouvrières leur coupaient le collet et la queue et les disposaient tête-bêche dans la boîte. Il fallait enfin verser de l’huile, puis les hommes pouvaient procéder au sertissage.
Toute l’économie locale reposait sur la pêche. Cette mono-industrie comportait un inconvénient majeur : lorsque la sardine boudait les côtes bretonnes, toute la population en souffrait. C’était précisément le cas depuis de longs mois, et de nombreuses familles connaissaient le dénuement.
Le maréchal des logis promena son regard sur la baie. Elle était délimitée à main droite par la pointe de Beg-Meil et à main gauche par la pointe du Cabellou. Pour l’heure, nulle étrave ne fendait la surface lisse de l’océan. Fallait-il en déduire que la pêche n’était pas satisfaisante et que les marins poursuivaient la traque ? Cela était vraisemblable et augurait que la désastreuse période de disette n’était pas près de s’achever. Avec le chaud soleil de mai et du début juin, la température de l’eau était montée de plusieurs degrés. Ceci laissait cependant entrevoir une lueur d’espoir quant au retour de la sardine.
A mille lieues de ces tracasseries, Jean contemplait le panorama. Même s’il désertait sa ville natale pour seulement dix à douze jours, il voulait graver au plus profond de sa mémoire l’emplacement de chaque rocher. Il enregistrait également la fréquence molle et répétitive des vagues venant mourir sur le sable.
— Ouvre grand les yeux, fiston. Là où nous allons, il n’y a pas la mer.
— Ça doit être moche, alors.
— Mais non ! Tu verras, tu seras agréablement surpris. De toutes façons, nous n’aurons pas le temps de musarder.
Il remit Skouarn Treuz au pas. Sans descendre de sa monture pour pénétrer dans l’édifice, il se signa en passant devant la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours. Conscient des difficiles conditions de vie de ses concitoyens, il lui adressa une prière muette pour une rapide et généreuse réapparition de la sardine.
Un peu plus loin, la criée à thons construite deux années plus tôt était déserte. La situation était vraiment délicate pour tous. Pour l’anecdote, le seul endroit où l’on pouvait voir du poisson à coup sûr était… le laboratoire de biologie marine. Premier établissement de ce type dans le monde, il accueillait des chercheurs et des scientifiques attirés par la richesse et la variété des espèces qui fréquentaient la baie.
Depuis le seuil de sa maison, l’artiste peintre Alfred Guillou hésita une seconde avant de lever une main amicale en guise de salut.
Il avait parfaitement identifié le cheval et la silhouette de celui qui le montait, mais un petit quelque chose d’inhabituel avait freiné son geste. Tout en modifiant sa trajectoire, Clet répondit également silencieusement en joignant deux doigts qu’il porta à sa tempe.
— Bonjour, monsieur Guillou. Vous ne m’aviez pas reconnu ?
— Pas tout de suite, non. Sans doute ma vue qui commence à baisser, ou… Mais oui ! J’y suis ! C’est la première fois que je vous vois nu-tête. Voilà ce qui m’a intrigué. Où est votre tricorne ? Ne me dites pas que vous l’avez oublié.
— Non, rigola Clet. Je dispose d’une période de détente, aussi est-il resté à la maison.
— Profitez-en bien, alors ! Il s’agit là d’un repos bien mérité.
Laissant le gendarme bredouiller quelques mots de remerciement, le peintre consulta le ciel puis grimaça d’aise.
— Si je veux travailler, il ne faut pas que je traîne.
Il s’empara prestement du chevalet appuyé contre le mur avant de saisir une toile vierge montée sur un châssis et une boîte en bois recélant palette, pinceaux et tubes de couleurs. Déjà, il se pressait pour aller croquer sur le vif une scène portuaire de la vie de tous les jours. Son beau-frère, Théophile Deyrolle, aurait sûrement aimé l’accompagner, mais il travaillait tous les matins dans ses parcs à huîtres situés à l’embouchure de la rivière Moros.
Il ne s’accordait que l’après-midi pour arpenter la campagne environnante à la recherche d’un sujet intéressant ou, selon les conditions atmosphériques, rejoindre son atelier de la rue Gam4. L’année précédente, pour les besoins d’une enquête longue et compliquée, le gendarme avait été amené à pousser la porte de l’atelier5. Il se remémorait souvent cet après-midi-là et conservait l’excellent souvenir d’innombrables toiles au milieu d’objets hétéroclites : poteries, sabres, fusils…
Clet et Jean traversèrent la ville au trot, sans s’attarder outre mesure. Inconsciemment pourtant, ils archivaient mentalement la configuration des rues et bâtiments et en relevaient chaque détail architectural qu’ils connaissaient déjà parfaitement. Ils remplissaient leurs poumons d’air iodé, comme s’ils goûtaient à ce bonheur pour la dernière fois. Même le cri strident des mouettes était mélodieux ce matin.
Jean était né à Concarneau dix ans plus tôt. Il adorait cette ville et ses habitants au caractère bien trempé. Du reste, il ne connaissait que Concarneau et Audierne, un autre port, où il se rendait une ou deux fois l’an chez ses grands-parents paternels.
Clet, quant à lui, s’était laissé séduire ; par Eugénie d’abord, puis par la cité ensuite. Son travail l’ayant amené à fréquenter toutes les couches de la société, il avait su se faire admettre et se sentait maintenant concarnois au plus profond de lui-même.
« Loin des yeux, loin du cœur ! » disait le dicton. Ce ne serait évidemment pas vrai concernant Eugénie, Léon et Alexandrine. Ce ne serait pas non plus le cas pour la ville. Clet savait que, lorsqu’il ne penserait pas à sa femme et à ses “pitits”, son esprit vagabonderait sur le quai Pénéroff, à moins que ce ne soit près du Fort Pleurou ou encore sur les remparts de la Ville Close, cette ancienne place forte construite selon les plans du célèbre maréchal de France, Sébastien Le Prestre de Vauban.
Ce ne fut qu’à la sortie du pont servant de frontière avec Lanriec, la ville voisine, que Clet taquina les flancs de Skouarn Treuz pour forcer la cadence.
1 Ancêtres des menottes, elles maintenaient seulement les pouces.
2 Oreilles de travers, en breton.
3 Littéralement « poche » en breton. On peut traduire par : « ne reste pas là à ne rien faire. »
4 Rue Dupetit-Thouars.
5 Voir Toile de fond à Concarneau, même auteur, même éditeur.
II
La matinée était bien entamée quand Clet et Jean entrèrent dans Pont-Aven. Les fesses du jeune garçon le faisaient souffrir, et une halte à Trégunc, à mi-route, avait été la bienvenue.
La population vaquait à ses occupations habituelles, tandis qu’une troupe d’une demi-douzaine d’artistes peintres, chevalet sur le dos et toile vierge en bandoulière, grimpaient la rue de Concarneau. Ils en avaient déjà croisé un peu plus avant qui discutaient bruyamment de la couleur du ciel et de sa luminosité changeante, d’une qualité si particulière. Ceci, ajouté au prix modique des pensions ou hôtels, valait à ce petit village du sud de la Cornouaille une réputation grandissante. On venait de loin pour le constater et se frotter, artistiquement s’entend, à la colonie toujours plus nombreuse des peintres. Certains n’avaient pas hésité à traverser l’Atlantique, d’autres s’étaient contentés du Channel1, tandis que d’autres encore avaient traversé plusieurs pays avant de prendre le train pour la Bretagne et la gare de Quimperlé. Ces hommes et ces femmes d’horizons si différents offraient un fabuleux métissage, source d’inspiration et d’effervescence culturelle.
Comme à l’ordinaire, des lavandières avaient envahi le chaos de roches qui crevait la surface de la rivière Aven. Constantes et généreuses dans l’effort, elles plongeaient leurs mains dans l’eau froide et vive et en extirpaient draps ou vêtements. Elles les frappaient ensuite de leur battoir pour en extraire savon et impuretés avant de les replonger dans l’eau. Puis, seules ou par groupes de deux si nécessaire pour les plus grandes pièces, elles les essoraient avant de les étaler au soleil. Ces besognes se déroulaient sur fond de papotages et de fous rires. Parfois, la situation dégénérait et donnait lieu à des échanges agressifs et injurieux.
Un artiste ayant décidé de planter son chevalet près d’elles pour mieux se pénétrer de la pénibilité de leur tâche et la transposer sur sa toile, elles conversaient en breton afin qu’il ne saisisse pas la teneur de leurs paroles.
Après avoir enjambé le pont de pierre, ils laissèrent sur la droite l’ancienne pension Gloanec qui a vu défiler tant et tant de peintres2. Un peu plus haut, ils ignorèrent la petite place triangulaire que bordaient le nouvel hôtel Gloanec et l’hôtel Julia, deux lieux bien connus des artistes en villégiature.
Ils se dirigèrent vers la rue du Gac3 alors qu’un trio de joyeux lurons s’engouffrait dans l’hôtel Julia, réclamant à grands cris du cidre à la “bonne hôtesse”. Des commentaires vraisemblablement hardis accompagnaient ces demandes pressantes, mais Clet ne put identifier la nationalité des assoiffés : il ne parlait que le français et baragouinait seulement quelques mots de breton. Deux cents mètres plus loin environ, Clet arrêta Skouarn Treuz. Passant une jambe par-dessus la crinière du cheval et le volumineux sac de vêtements, il sauta à bas de sa monture. Il attrapa ensuite Jean par les aisselles et le posa délicatement au sol.
— Ça va mieux, fiston ?
— Ouh… Un peu. Je ne veux plus remonter sur un cheval. Je ne sais pas comment ils font, les Indiens américains, pour se passer de selle.
— Ton calvaire est terminé ; tu feras le reste du trajet dans de meilleures dispositions.
Par un étrange hasard, Clet Moreau et le mari de la cousine de sa femme, Blaise Furic, étaient gendarmes et assumaient les responsabilités de maréchal des logis dans deux villes distantes de quinze kilomètres. Clet noua les rênes dans un anneau fixé dans la maçonnerie de la façade de la brigade quand une voix les interpella depuis une fenêtre de l’étage.
— Ah, vous voilà enfin ! Comme je suis contente de vous voir ! Entrez donc et montez nous rejoindre.
— Bonjour, Marie-Annick. A nous aussi, cela nous fait plaisir de te voir. Blaise est-il prêt ?
— Penses-tu ! Tu le connais ; Monsieur, qui se croit toujours plus malin que les autres, n’a même pas encore préparé son bagage.
— Allons ! répliqua depuis l’intérieur de la pièce une voix d’homme sur un ton faussement bourru. Cesse donc de raconter des âneries et dis-leur plutôt de monter. Ils doivent avoir la gorge sèche, et tu ne trouves rien de mieux que de les laisser dehors.
— Mais je viens de leur dire de monter !
— Ou alors, tiens, occupe-toi donc de mes vêtements pendant que je descends les accueillir comme il se doit.
— Eh bien voilà ! J’en étais sûre ! Tu n’es pas capable de prendre toi-même tes frusques. Il faut que je fasse tout, dans cette maison.
— Erreur, madame Furic ! Si je vous confie cette mission, c’est parce que, pendant ce temps, je compte donner une collation bien méritée au cheval de Clet avant notre départ.
Le maréchal des logis de Pont-Aven était parvenu à tourner la situation à son avantage. Blaise et son épouse s’opposaient souvent en des joutes verbales qui se terminaient invariablement par le vouvoiement, démonstration évidente d’une colère extrême. Cependant, la qualité des bons mots et des métaphores qu’ils échangeaient n’avait d’égale que l’amour qui les liait. Toutes truculentes qu’elles fussent, ces dissensions faisaient les gorges chaudes des autres gendarmes et de leurs familles. Par ricochet, les habitants de Pont-Aven en étaient rapidement avisés.
Au rez-de-chaussée, Blaise salua chaleureusement Clet et caressa la tignasse brune de Jean avant de proposer :
— Pose ton sac et allons nourrir ton cheval. Quant à toi, mon grand, monte donc dire bonjour à ta tante. Elle n’a pas toujours bon caractère, mais je crois qu’elle t’a à la bonne.
Le jeune garçon obéit pendant que les deux hommes sortaient. Tout comme Clet, Blaise avait abandonné la tenue de gendarme. En fait, il avait seulement retiré la bande de drap bleu foncé qui ornait le pantalon réglementaire en drap satin bleu clair. Lui non plus n’avait pas pris son ceinturon ni la plaque de cuivre sur laquelle figuraient en relief les mots « gendarmerie » et « ordre public ». Une chemise de lin complétait sa tenue. Il portait aux pieds des sabots fraîchement acquis.
— Si je ne me trompe, fit Blaise en désignant Skouarn Treuz de la pointe du menton, il n’est plus très jeune.
— Il va sur ses douze ans, répondit Clet tout en dénouant les rênes de l’anneau. J’ai hésité avant de le prendre. Je suis persuadé qu’Alain Rannou, le cocher de Concarneau, m’aurait gracieusement prêté une de ses montures, mais je ne voulais pas l’en priver pour une aussi longue période. Et puis… Et puis j’aime ce cheval. On en a fait des kilomètres ensemble !
— Je te comprends, acquiesça Blaise. Mais tu ne peux pas l’amener. J’ai oublié de te le dire avant, mais la route est longue d’ici à Châteauneuf-du-Faou. Le mieux, c’est que tu le laisses ici. Mes hommes le soigneront et le nourriront. Et nous, nous voyagerons en diligence.
Tout en contournant la maison, Clet pesait le pour et le contre de cette proposition. En découvrant l’appentis fermé sur deux côtés et sous lequel il y avait déjà un cheval, il conclut qu’il ne s’agissait pas d’une mauvaise idée. Après que Blaise eût versé un seau d’eau dans une auge de pierre et alors qu’il prenait une ration conséquente d’avoine, il objecta pourtant :
— Qui sait si, sur place, nous n’aurons pas besoin de nous déplacer…
— Je regrette, Clet. Ton cheval sera bien mieux ici, crois-moi.
Blaise développa toute une liste d’arguments et Clet Moreau finit par admettre qu’il avait raison.
*
Marie-Annick reçut le mari et le fils de sa cousine comme des rois, ou pour le moins comme des princes. La généreuse et variée collation avalée, l’heure était venue de se séparer. Devant la gendarmerie, les deux hommes et le jeune garçon s’apprêtaient à rejoindre le point de ralliement pour le départ de la diligence. D’un œil attendri et légèrement humide, Marie-Annick les observait.
— Vous n’avez rien oublié ? questionna-t-elle.
— Mais non, souffla Blaise. Cela fait dix fois que tu nous le demandes.
— Vêtements ?
— Non !
— Pelle ?
— Non !
— Marteau ?
— Mais tu es casse-pieds, Mimie ! Si je te dis que nous…
— Pipe et tabac ?
— Gast4 oui ! J’allais partir sans !
Alors que Blaise hésitait entre embrasser sa femme pour la remercier d’y avoir pensé et se ruer à l’étage, elle exhiba une splendide pipe ouvragée et une blague à tabac en cuir qu’elle cachait dans son dos.
— Qu’est-ce qu’on dit, Blaise Furic ?
Penchant la tête sur le côté, il adressa à sa chère et tendre un regard admiratif et débordant d’amour.
— Je dis que tu es la meilleure, Mimie. Sans toi… Sans toi…
Elle ne laissa pas son mari dans l’embarras et changea de sujet.
— Ça fait drôle de vous voir habillés ainsi. Tu reconnais ton père, Jean ?
— Ce qui m’étonne le plus, c’est de le voir nu-tête. Je suis tellement habitué à le voir avec son tricorne. Sauf à la maison, bien sûr.
— Tu entends cela, Clet ? Nous sommes vêtus comme des civils, et nos proches nous reconnaissent à peine. En clair, cela signifie que nous devons porter nos uniformes en permanence.
— Et voilà Blaise Furic qui en rajoute ! ponctua Marie-Annick. Allez, vous allez finir par rater votre berline…
Soucieux d’apaiser une situation qui ne demandait qu’à devenir haute en couleurs, Clet Moreau acquiesça :
— Tu as raison, il est temps pour nous d’approcher. Tu nous accompagnes ?
— Non. Je n’aime pas les départs. Ils me rendent triste.
— Exactement comme ta cousine. Ce matin, il n’aurait pas fallu grand-chose pour qu’Eugénie se mette à pleurer.
— Sensibilité féminine, résuma Marie-Annick. Les hommes n’y comprennent rien.
— Si, assura Clet. Contrairement à une idée reçue, pleurer n’est pas réservé uniquement aux femmes. Mais ne t’inquiète pas, nous serons bientôt de retour. Au revoir, Marie-Annick.
— Au revoir, Clet. Au revoir, Jean.
Du haut de ses dix ans, Jean ignorait pudeur et retenue, aussi alla-t-il déposer un baiser goulu et sonore sur la joue de la femme avant de se placer à côté de son père.
— Nous y allons toujours, fit Clet.
Il se chargea du bagage, d’une pelle et d’une pioche. Jean saisit un seau rempli d’outils et une serpe.
Les époux Furic restèrent ensemble une poignée de secondes, émus comme au premier jour de leur rencontre. Tous deux avaient les yeux embués quand ils se quittèrent. Point besoin d’être devin pour savoir l’affection qu’ils se vouaient.
1 Nom anglais de la Manche.
2 On y trouve aujourd’hui au rez-de-chaussée la maison de la presse, et à l’étage les bureaux de Pont-Aven School of Contemporary Art, une école d’art contemporain qui organise le séjour d’étudiants des Beaux-Arts du monde entier.
3 Maintenant rue Paul Sérusier.
4 Littéralement : putain. Ce mot est également utilisé pour renforcer une affirmation ou traduire une émotion.
III
Blaise rattrapa Clet et Jean juste avant qu’ils ne débouchent sur la petite place traversée plus tôt en arrivant à Pont-Aven. Il avait savamment fixé un baluchon contenant ses vêtements aux manches d’une pelle et d’une pioche qu’il portait sur l’épaule. A la main, il tenait deux seaux de bois empilés ; celui du dessus contenait leur repas de midi.
Lorsqu’ils parvinrent à l’endroit où la berline s’arrêtait invariablement, Blaise se défit de tout ce matériel et assura :
— Ça n’a l’air de rien, mais finalement ça fait du poids. Quelle heure est-il ?
Clet consulta sa montre gousset.
— Onze heures dix.
— La diligence a du retard, aujourd’hui. Et si on allait dire bonjour à Armand ?
— Armand ? Quel Armand ?
— Oh, ne me dis pas que tu as oublié ! Armand Gloanec, là, à l’hôtel ! Tu ne te souviens pas de son bon petit vin, l’année dernière ?
Clet se tourna dans la direction de l’hôtel. Ouvert depuis trois années, l’établissement avait fière allure, avec sa large porte d’entrée surmontée d’un fronton triangulaire. Au-dessus des cinq fenêtres du premier étage de la façade, la toiture en ardoises posées en écailles ajoutait un plus à la construction. Émile Péron, un peintre en bâtiment doté d’une force phénoménale qui lui permettait de remporter nombre de concours de gouren1 dans le pays, était occupé à repeindre un banc accolé à la façade avant l’arrivée des beaux jours. Le peintre leur adressa un démonstratif signe du bras. Il réalisa soudain qu’il les voyait pour la première fois en “civil” et éclata d’un puissant rire moqueur. Se frappant les cuisses du plat de la main, il dodelina de la tête de droite à gauche puis de gauche à droite.
Vexés, Blaise et Clet se retournèrent tandis que Jean n’en finissait pas de le regarder, gagné par l’exubérance du personnage et son rire communicatif.
— Bien sûr que je m’en souviens, dit Clet. Mais je n’ai pas soif.
— Moi non plus. L’envie m’en est passée. En plus, la diligence ne devrait plus tarder.
Ils gardèrent le silence quelques instants, observant les abords de la place et, un peu plus loin, le pont de pierre. De jeunes garçons entouraient un peintre qui, plus pour faire le malin qu’en quête d’une pêche miraculeuse, avait mis une ligne à l’eau. Une jeune femme, une petite fille d’à peine deux ans dans les bras, s’approcha à petits pas et demanda d’une voix empreinte de timidité :
— N’eo ket bet an dilijans c’hoazh ?2
De fait, son costume en velours noir paré d’un tablier en crêpe et son fond de coiffe rond affichaient son origine huelgoataine, terminus de la diligence. Une fine pèlerine d’été en crochet reposait élégamment sur ses frêles épaules.
— La voilà qui arrive justement, renseigna Blaise.
Comme elle ne semblait pas avoir compris, il traduisit en breton, la seule langue qu’elle parlait.
Ainsi donc, ils ne seraient pas les seuls usagers de la berline. Un moment, ceci dérangea quelque peu Blaise qui, pour passer le temps, avait préparé tout un tas d’histoires drôles et d’anecdotes. Mais maintenant qu’il savait qu’elle n’entravait rien au français, il pourrait donner libre cours à ses fantaisies. Il devrait seulement taire les plus croustillantes pour les raconter plus tard, uniquement à Clet. Jean avait beau être grand pour son âge, il y avait des choses pour lesquelles il était encore trop jeune.
Sans renâcler, les deux chevaux qui tiraient la berline vinrent se positionner juste devant le petit groupe ainsi constitué. Le cocher sauta au sol pour encaisser auprès des voyageurs le prix du trajet.