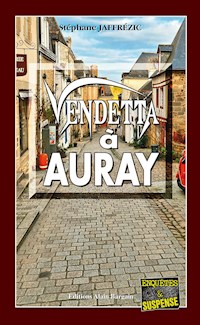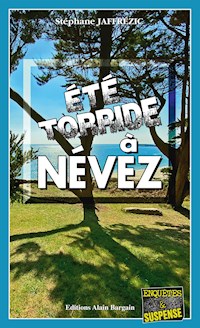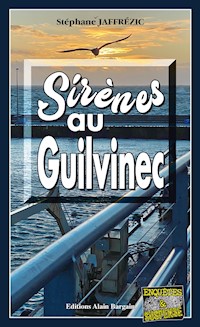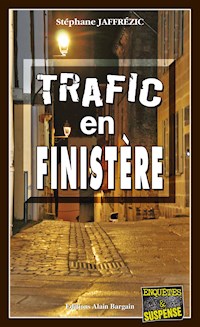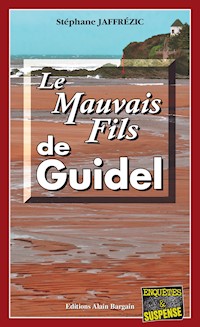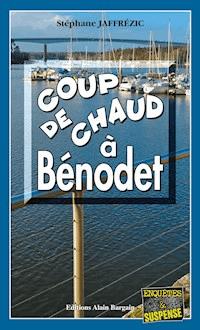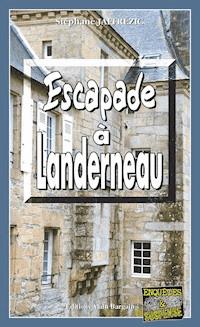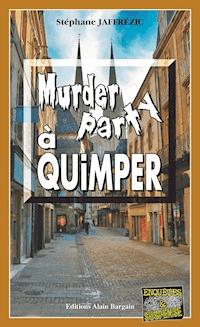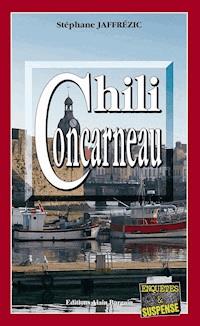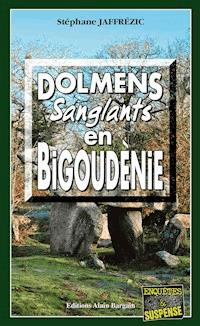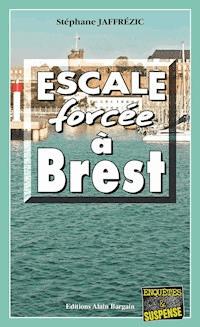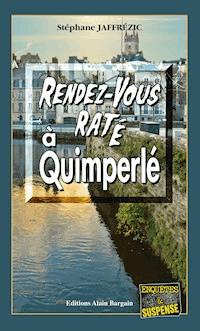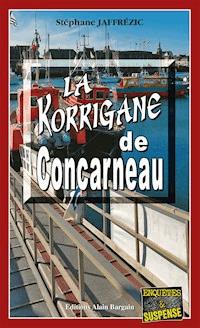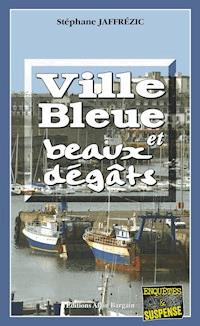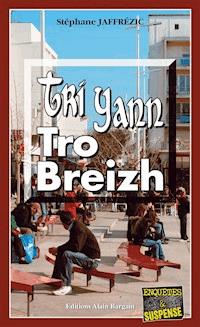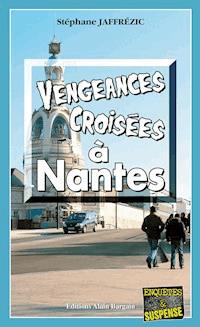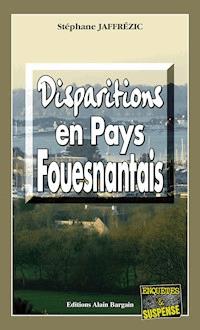
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Krimi
- Serie: Maxime Moreau
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Une nouvelle enquête commence pour le capitaine Maxime Moreau.
Par une belle journée de juillet, un jeune homme de Concarneau disparaît. Fugue ? Enlèvement ? Chargé de cette affaire, le capitaine Maxime Moreau va rapprocher cette disparition d'autres disparitions survenues dans la région, quelque temps auparavant. Mais l'enquête piétine… Il faut pourtant interrompre au plus vite ce sordide massacre…
Le capitaine Maxime Moreau n'est pas au bout de ses peines, dans ce troisième tome au suspense omniprésent.
EXTRAIT
Tout en posant un doigt sur la base du combiné pour couper la communication, Jean-Claude lève un visage creusé de rides de contrariété sur Mireille. Il n’a pas besoin de s’expliquer, elle a compris. Elle est maintenant persuadée qu’il est arrivé malheur à son rejeton. Les premières larmes coulent, tandis que ses mains se contractent sur le torchon qu’elle martyrise depuis les premières heures de la matinée. L’une de ses filles caresse les cheveux grisonnants de sa mère pendant que l’autre essuie les larmes qui roulent sur les joues soudainement creuses.
— Sois forte, Mireille. Attends, je vais d’abord appeler l’hôpital ! Qui sait, il a peut-être eu un malaise et n’a pu fournir son identité…
Sa tentative d’entretenir l’espoir ne trompe personne. Lui-même ne croit pas à cette possibilité car, en cas de malaise de Yoann, son camarade Kylian les aurait prévenus ainsi que les secours. Idem dans le cas inverse. Il essaie quand même.
— Allô, l’hôpital Laënnec à Quimper ? Bonjour, je souhaiterais savoir si mon fils a été conduit dans vos services.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Stéphane Jaffrézic est né en 1964 à Concarneau. Il habite et travaille à Quimper. Dans son cinquième roman de la collection Enquêtes et Suspense, nous retrouvons son personnage récurrent, le capitaine Maxime Moreau. Il est également auteur de deux romans dans la collection Pol'Art.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À Nicolle et Bernard, Marie-Thérèse et Henri, mes parents et beaux-parents.
REMERCIEMENTS
- Au commandant de police Vincent Martin.
- Au docteur Marc Jacq.
- À Jean-François Sicallac pour l’utilisation des dénominations de ses créations culinaires.
- À Nathalie Dellion de la SEPNB Bretagne Vivante.
I
— Waouh ! J’ai flashé à mort sur une meuf ! Tu sais, une blonde qui était appuyée au comptoir quand on est arrivés. Elle m’a regardé danser pendant toute la soirée !
— Je vois de qui tu parles. Elle portait une jupe en jean et un débardeur blanc ? Moi, c’est sa copine qui me branche grave. Je les ai vues à la plage de Mousterlin la semaine dernière. Je crois qu’elles sont au lycée à Quimper. Elles sont toujours ensemble, aussi inséparables que nous… Tu vois, Yoann, le pied serait qu’elles soient en bagnole et qu’elles s’arrêtent pour nous embarquer. On parcourrait quelques kilomètres, histoire de faire un peu plus connaissance, puis on tournerait dans un petit chemin, en quête d’un coin discret pour… Tu vois ce que je veux dire ?
— Oh ouais ! Trop top ton plan ! Mais faut pas rêver, c’est pas pour nous des gonzesses pareilles. Elles ont au moins deux ans de plus que nous.
— Ouais… Pourtant, j’sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression qu’il s’est passé un truc entre elle et moi. On s’est juste matés, mais j’ai senti comme… comme un j’ne sais quoi. Comme qui dirait qu’on était sur la même longueur d’onde et qu’on se comprenait sans avoir besoin d’ouvrir la bouche.
— Oh ouais, j’vois. Ça me fait ça, des fois. J’regarde une meuf et, tout de suite, je sens si ça peut carburer entre elle et moi. Peut-être pas au point de me maquer pour la vie avec elle, mais au moins faire un bout de route.
— Pfff ! En parlant de bout de route, je crois qu’on est bons pour rentrer à pied.
— C’est clair. C’est ça le problème, quand on va en boîte et qu’on n’a pas de caisse. Ils devraient faire les discothèques en ville.
— Ce serait le kif ! Et merde pour les vieux que la musique empêcherait de dormir ! Ils auraient une semaine pour s’en remettre.
Marchant sur l’herbe qui borde le ruban d’asphalte, Yoann et Kylian tentent dans la pénombre d’éviter creux et bosses. Les chevilles mises à rude épreuve, ils jettent de temps à autre une grossièreté en témoignage de leur calvaire. Ils progressent sur plusieurs dizaines de mètres avant que Kylian ne grommelle :
— Et merde ! Il pleut de plus en plus ! On est mal.
En effet, une pluie, froide malgré la saison, redouble de violence et achève de tremper les adolescents. Les gouttes éparses ont fini par se rassembler pour constituer un épais rideau.
Rentrant la tête dans les épaules pour une inutile parade, ils frissonnent rapidement. Après la transpiration consécutive aux danses effrénées sur la piste de la discothèque, leurs corps connaissent une soudaine chute de température.
— On est bons pour la crève, souligne Yoann.
— Oh ouais, c’est clair. J’ai déjà le nez qui coule… Écoute ! J’entends le bruit d’un moteur.
En effet, deux phares trouent la nuit derrière eux, tandis que le ronronnement caractéristique d’un diesel enfle.
— Et si on faisait du stop ?
Kylian a lancé cette suggestion par bravade, car il sait pertinemment que ses parents s’opposent à cette pratique. La Bretagne est, certes, éloignée des métropoles de l’Hexagone et recense moins de crimes crapuleux que d’autres régions, il n’empêche que la crainte est présente chez tous les parents le samedi soir. Elle ne s’éteint que lorsqu’ils entendent rentrer leur progéniture ou constatent le dimanche matin la présence rassurante du blouson et des chaussures.
— T’es ouf* ! jette son copain en haussant les épaules. On ne sait pas sur qui on peut tomber.
— Allez, Yo ! Ne me dis pas que tu flippes ! Nous sommes deux et, en plus, on n’est pas franchement des demi-portions. Qui sait, c’est peut-être les meufs de t’à l’heure ?
Est-ce l’argument qui porte ou le fait que la pluie les glace jusqu’aux os ? Toujours est-il que Yoann se décide.
— OK, on fait du stop. Mais je te préviens : si le mec est chelou* ou bourré, je laisse tomber le stop et je rentre à pinces.
— T’inquiète pas, Yo !
Bras et pouce tendus tout en prenant soin de rester sur la zone herbeuse, ils cessent de marcher. Le véhicule n’est plus qu’à une vingtaine de mètres. Impossible pour les jeunes garçons d’affirmer avec certitude de quel type il s’agit tant la puissance des phares les aveugle. Durant quelques secondes, de nombreux sentiments les animent : d’abord pleins d’espoir, ils se font pessimistes plus la distance raccourcit. Dans un freinage tardif qui laisse supposer que le conducteur ne les a aperçus qu’au dernier moment ou qu’il allait poursuivre sa route avant finalement de se raviser, le véhicule les dépasse puis s’immobilise. Deux feux blancs annoncent que la marche arrière est enclenchée. Poussant un soupir de soulagement, Kylian et Yoann se précipitent.
— Vous pouvez nous approcher du centre-ville ?
— Bien sûr, fait l’homme assis au volant. Montez vite vous mettre au sec.
— Merci.
*
Les parents et les sœurs de Yoann Carlier attendent désespérément que la massive horloge bretonne sonne midi. Comme ils s’y étaient engagés en constatant l’absence de leur fils et frère au petit matin, ils se sont fixé cette échéance avant d’alerter les secours. Se dirigeant dès le douzième coup vers le téléphone sans fil posé sur sa base, Jean-Claude Carlier murmure à l’intention de son épouse et de Ludivine et Aurélie :
— J’appelle une dernière fois le père de Kylian avant de contacter la… la gendarmerie.
Prononcer ce mot est une épreuve, synonyme dans le cas présent d’inquiétude.
— Allô, monsieur Betton. Toujours rien ?
—…
— Toujours pas de trace de son portable ?
—…
— Je vais prévenir les autorités. Nous avons patienté plus qu’il ne fallait. Je vous tiens au courant, bien entendu.
Tout en posant un doigt sur la base du combiné pour couper la communication, Jean-Claude lève un visage creusé de rides de contrariété sur Mireille. Il n’a pas besoin de s’expliquer, elle a compris. Elle est maintenant persuadée qu’il est arrivé malheur à son rejeton. Les premières larmes coulent, tandis que ses mains se contractent sur le torchon qu’elle martyrise depuis les premières heures de la matinée. L’une de ses filles caresse les cheveux grisonnants de sa mère pendant que l’autre essuie les larmes qui roulent sur les joues soudainement creuses.
— Sois forte, Mireille. Attends, je vais d’abord appeler l’hôpital ! Qui sait, il a peut-être eu un malaise et n’a pu fournir son identité…
Sa tentative d’entretenir l’espoir ne trompe personne. Lui-même ne croit pas à cette possibilité car, en cas de malaise de Yoann, son camarade Kylian les aurait prévenus ainsi que les secours. Idem dans le cas inverse. Il essaie quand même.
— Allô, l’hôpital Laënnec à Quimper ? Bonjour, je souhaiterais savoir si mon fils a été conduit dans vos services.
—…
— En effet, nous sommes sans nouvelles. Ce n’est pas dans ses habitudes, aussi commençons-nous à… D’accord. Normalement, il a sur lui ses papiers d’identité. Mais il est possible qu’il les ait égarés. Il se nomme Yoann Carlier.
—…
— Dix-sept ans. Il aura dix-huit en novembre.
—…
— Vous en êtes certaine ?
—…
— Bien. Merci Madame.
Cette fois encore, point besoin de longue phrase. Mireille se remet à pleurer. Doucement pour commencer, puis de plus en plus fort. Le corps secoué de soubresauts, elle conserve la tête baissée et les yeux fermés.
Jean-Claude, que ce spectacle achève d’anéantir moralement, l’exhorte sans élever la voix à se retenir. Après tout, la situation n’est pas dramatique. Rien ne prouve que…
Utilisant le torchon comme un mouchoir, elle s’essuie les yeux et se mouche bruyamment avant que ses glandes lacrymales ne se remettent en action. Constatant qu’il est vain de lui demander de calmer ses pleurs, Jean-Claude adresse une supplique muette à ses filles et décroche le téléphone de sa base avant de sortir de la pièce. Il compose le 17 plutôt que le numéro administratif.
— Brigade de gendarmerie de Fouesnant. À qui ai-je l’honneur ?
— Bonjour, Monsieur. Je… Je vous appelle au sujet de mon fils et de son copain. Ils… Ils ne sont pas rentrés de la nuit, et nous sommes très inquiets.
— Quel âge a-t-il ?
— Dix-sept ans.
— Il est donc mineur. Est-ce également le cas de son copain ?
— Oui. Ils sont nés la même année, il n’y a que deux mois de différence entre eux.
— Bien. Dans l’état actuel, je ne peux que vous conseiller de venir nous voir. Un officier prendra votre déposition et nous pourrons émettre un avis de recherche. Depuis combien de temps êtes-vous sans nouvelles ?
— Depuis hier soir. Nous avons dîné ensemble, puis il est parti rejoindre son copain Kylian. Ils avaient projeté de se rendre en boîte de nuit.
Le gendarme marquant un arrêt, Jean-Claude justifie s’il en était besoin :
— Comme c’est le début des grandes vacances, nous avons autorisé cette sortie.
— Je comprends. Le mieux, Monsieur, serait que vous veniez jusqu’ici. Munissez-vous d’une photographie récente. Demandez aux parents de son camarade de venir également avec une photo.
— Entendu. Merci.
Interrompant la communication, il porte nerveusement un doigt à sa bouche et ronge un instant un ongle qui n’en avait pas besoin. Il reste ainsi pendant une bonne minute avant de se ressaisir. Mireille est toujours assise sur le bras d’un fauteuil, la tête orientée vers les lattes du plancher impeccablement ciré. Seuls ses yeux rougis mettent un peu de couleur sur son visage blafard. S’approchant, il se force à sourire et murmure :
— J’ai discuté avec un gendarme. Ils attendent notre passage pour se lancer à la recherche de Yoann et Kylian. Je préviens le papa de Kylian. Prépare-toi pendant ce temps… Ah, ils veulent une photo récente pour les aider dans leurs recherches.
Comme elle demeure immobile, il l’encourage comme il le peut d’un argument auquel il feint de croire, même si le ton est sans conviction :
— Allez, Mimi, remue-toi ! Plus vite nous irons déposer à la gendarmerie et plus vite Yoann rentrera.
Puis à Aurélie et Ludivine :
— Si votre frère rentre dans l’intervalle, avertissez-nous sur mon portable.
*
Le lieutenant Paul Le Franc bâille à s’en décrocher la mâchoire. Les heures de travail s’accumulant, il éprouve l’impérieux besoin de souffler. Cette nuit, la chasse aux conducteurs alcoolisés sur la commune de Fouesnant a débuté à une heure du matin et s’est achevée à l’aurore. Succès total, l’opération a permis de procéder à une douzaine d’arrestations. Il vient d’entendre le dernier, un jeune Bénodétois qui détenait son permis depuis moins de six mois et conduisait avec plus d’un gramme cinquante d’alcool dans le sang. Encore un qui s’est cru plus malin que les forces de l’ordre ! Pour sa peine, il remisera sa voiture dans le garage familial durant plusieurs mois. Il pourra enlever le A de l’Apprenti conducteur qui ornait la lunette arrière de sa Twingo et se le coller sur le front : ce sera le A majuscule d’Abruti. Ou d’Alcoolique !
Jetant un œil par la fenêtre, Le Franc constate que le soleil est toujours au rendez-vous. Cet après-midi, c’est décidé, après le classique poulet-frites du dimanche midi et une sieste réparatrice, il ira bercer son corps fatigué sur les vagues nonchalantes de l’océan Atlantique. Alors qu’il se voit déjà étendu sur sa serviette sur une plage de Mousterlin ou de Beg-Meil, ou jouant au volley-ball avec femme et enfants, le téléphone posé sur son bureau le ramène à la réalité.
— Oui ?
— Ici l’accueil, mon lieutenant. Des parents voudraient vous entretenir sur la disparition de leurs fils. Je leur ai dit que vous étiez disponible.
— Parfait, grogne l’officier au gendarme Pellieux. Donnez-moi une minute.
Intérieurement, il sait que son planning risque de se trouver modifié. Le blanc du poulet sera sec comme le vent du Nord, aujourd’hui. Il appose sa signature au bas de la dernière feuille de son rapport, puis referme le dossier contenant les procès-verbaux des auditions de la matinée. Enfin, il numérote sur son téléphone les chiffres de l’accueil. Il a d’ores et déjà mis entre parenthèses l’après-midi de farniente qu’il a entrevu et est redevenu professionnel.
— Vous pouvez faire entrer.
— D’accord, mon lieutenant.
Une poignée de secondes plus tard, deux couples se présentent à la porte du bureau. Lorsque le gendarme Pellieux a indiqué que des parents souhaitaient évoquer la disparition de leurs fils, Le Franc ne s’est pas douté qu’il s’agissait de deux familles distinctes.
— Bonjour, Messieurs-Dames. Entrez toujours, pendant que je vais prendre des chaises supplémentaires dans le bureau voisin.
— Pas la peine, fait un père. Il n’y aura pas assez de place, de toute façon.
L’irréprochable logique de cet argument le stoppe dans son élan ; difficile, en effet, de caser deux chaises de plus dans l’espace limité qui lui sert de bureau.
— Nous allons rester debout, fait le second, laissons les chaises à nos épouses.
Il est superflu de réitérer l’invitation tant elles ont les jambes en coton. Lorsqu’elles se sont installées, leurs maris se postent derrière elles et, dans une étrange homologie, posent des mains qui se veulent réconfortantes et protectrices sur les épaules de leurs épouses respectives.
L’inquiétude et l’angoisse se lisent sur les visages dont les traits semblent s’affirmer et se creuser à chaque minute.
— Je me présente : je suis le lieutenant Paul Le Franc, responsable de la brigade. Je vous écoute, Messieurs-Dames. Que se passe-t-il exactement ?
Les quatre visiteurs dévisagent leur hôte, un tantinet désarçonnés par les intonations sèches de l’officier. Puis Jean-Claude Carlier prend la parole :
— Nos fils sont copains depuis de nombreuses années. Ils se connaissent depuis l’école primaire et ont toujours été scolarisés dans les mêmes établissements et les mêmes classes. C’est dire si… s’ils sont… Ils se fréquentent en dehors du lycée et pratiquent le football dans le même club. Ce sont des garçons posés et sensés. Sinon… sinon, imaginez bien que nous ne serions pas venus vous importuner.
— Nous sommes sûrs et certains qu’il leur est arrivé malheur, coupe le second homme en se grattant la tempe. Ce n’est pas du tout leur genre que de nous laisser sans nouvelles.
— C’est vrai, reprend le premier. Ils ont pour consigne de nous prévenir lorsqu’ils ont un contretemps. Pour cela, ils ont chacun un téléphone portable. Comme tous les jeunes, maintenant. Le fait qu’ils n’aient pas prévenu est plutôt… heu… inhabituel.
Le lieutenant Le Franc se contente de recueillir mentalement ces renseignements. Les deux couples, la cinquantaine allégrement franchie, sont d’une excellente présentation. Signe d’une certaine éducation, ils s’expriment dans un langage châtié et sans emportement. En ce qui concerne les hommes du moins, car les femmes n’ont pas ouvert la bouche. Leur cœur de maman est déchiré et, ne se sentant pas le courage de parler elles cèdent volontiers à leurs époux le soin d’exposer les faits. Malgré tout, elles savent rester dignes et retiennent leurs larmes.
— Bon, résume le gendarme, si j’en crois ce que vous me dites, vos fils sont des jeunes gens responsables. Par conséquent, il y a sûrement une explication rationnelle au fait qu’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles. Nous allons, si vous le voulez bien, tenter d’établir leur emploi du temps. Première question : quand les avez-vous vus pour la dernière fois ?
— Hier soir.
Les pères ont répondu dans le même élan. Avec un léger sourire condescendant, Jean-Claude Carlier indique à Roger Betton qu’il lui laisse la parole. Celui-ci annonce donc :
— Kylian a mangé avec nous, puis il est monté dans sa chambre écouter de la musique et se changer. Ils avaient prévu d’aller en boîte de nuit, il voulait donc troquer le tee-shirt qu’il avait porté pendant la journée contre une chemise. À cet âge-là, on veut plaire… Il n’est redescendu qu’à vingt-deux heures vingt. Je suis précis parce que j’étais assis devant la télévision. J’attendais le début d’une émission.
— D’accord. Ensuite ?
— Nous habitons le secteur du Cap-Coz, au hameau de Kersiles, et Yoann et ses parents résident au centre-ville. Kylian est parti à vélo, car ces deux lieux ne sont pas éloignés si l’on coupe par… Bref ! Ils avaient dans l’idée de se rendre dans un bar du centre, car ils y rencontrent souvent des copains du lycée susceptibles de les amener en boîte. Bien évidemment, nous leur avons fait la leçon, monsieur Carlier tout comme moi, de ne pas monter en voiture si ces gars-là avaient bu plus que de raison.
— Vous avez bien fait.
— Remarquez, avec ce qu’on lit dans la presse le lundi matin, il y a de quoi…
Il se mord la lèvre supérieure et ne termine pas sa phrase, conscient qu’elle risque de déclencher les larmes des deux femmes qui y verraient un funeste préambule.
Après un silence gêné, il poursuit :
— Où en étais-je ? Ah oui ! Donc, Kylian est parti rejoindre Yoann dans ce bar. Nous en avons discuté, monsieur Carlier et moi, et il apparaît qu’ils y sont arrivés à peu près au même moment, soit vers vingt-deux heures trente. Après… après, nous ne savons pas ce qu’ils ont fait. J’ai bien essayé de contacter le patron de ce bar ce matin, mais personne n’a répondu à mes différents appels.
Saisissant une feuille, le lieutenant demande, sans lever la tête :
— Quel nom, ce bar ?
— “Les Estivants”, Rue Armor.
— Je connais, c’est au centre-ville. C’est vrai que la clientèle est presque exclusivement constituée de jeunes. Le samedi soir, c’est plein à craquer. Avaient-ils rendez-vous avec d’autres garçons ou filles ?
— Nous l’ignorons. Nous nous sommes posé la question, mais vous savez comment sont les adolescents : lorsqu’on les interroge sur leurs fréquentations, ils vivent cela comme une intrusion dans leur vie privée. Et si l’on ne le fait pas, pour éviter de se faire rabrouer, ils s’imaginent que leurs amis et leur vie en général ne nous intéressent pas…
— Ah, ce n’est pas facile d’être parent ! J’ai moi aussi deux ados à la maison et j’ai les mêmes préoccupations que vous.
Cette indication apporte un soupçon de soulagement dans l’esprit des parents Betton et Carlier. L’homme assis en face d’eux n’est soudain plus un officier de gendarmerie froid et sec, mais un papa apte à comprendre leur tourment dans toute son ampleur et prêt à tout mettre en œuvre pour leur ramener leurs rejetons en un temps record.
— Voyez-vous autre chose à ajouter ? Vous savez que chaque détail peut avoir son importance. Il se peut qu’au cours d’une conversation, l’un d’eux ait évoqué un copain qui se proposait de les recevoir pour une nuit. Ou… ou une petite copine.
Au silence qui s’ensuit, Le Franc subodore que ce point, même s’il n’est pas tabou pour les deux familles, n’a pas été abordé. Il décide alors d’approfondir le sujet :
— Ont-ils une copine attitrée ?
— Non, répond Roger Betton après un regard à son épouse. En tout cas pas à notre connaissance.
— Yoann non plus, renseigne Jean-Claude Carlier. Ses sœurs, Aurélie qui a quatorze ans et Ludivine, douze, l’auraient su et vendu la mèche.
— Hum… Donc, vos fils n’ont pas de petite copine. Mais il est possible qu’ils en aient rencontré une hier soir. Qui sait ? Peut-être dans ce bar, “Les Estivants”, ou plus tard en boîte de nuit… Alors que vous vous inquiétez, ce qui est parfaitement légitime, ils sont peut-être tranquillement et confortablement allongés auprès de leur belle.
Les quatre personnes affichant des visages peu convaincus par ce qui n’est pourtant pas une extravagance, il change l’orientation de la conversation.
— Au fait, dans quelle discothèque devaient-ils se rendre ?
— On n’en sait rien ! s’exclame Roger Betton. On sait seulement qu’ils apprécient le “Speed 29”, mais ils ne sont jamais allés ailleurs. D’un autre côté, comme Kylian me l’a expliqué une fois, le choix de la boîte dépend du conducteur. S’il veut aller à tel ou tel endroit, soit ils suivent le mouvement, soit ils rentrent à la maison.
— Logique, soupire le lieutenant. La décision dépend toujours du chauffeur. Si on résume, on perd la trace de vos enfants depuis hier soir peu après vingt-deux heures trente… Une minute, s’il vous plaît.
Cueillant l’annuaire des pages jaunes dans un tiroir de son bureau, il se lance dans une rapide recherche. Relevant la tête, il attrape son téléphone et compose un numéro. Au bout de quinze sonneries, estimant avoir suffisamment attendu, il repose le combiné.
— Il n’y a toujours personne au bar Les Estivants.
Il s’accorde un instant de réflexion, puis expose le résultat de son aparté :
— Il est important d’aller vite, d’agir dans les premières heures qui suivent une disparition ; aussi vais-je noter vos identités et enregistrer vos déclarations. Je tenterai ensuite de reconstituer leur emploi du temps en rencontrant le patron du bar et les propriétaires des boîtes de nuit de la région. Je pense parvenir à les localiser même si leurs établissements sont fermés. Le coup de chance serait que le patron du bar m’indique dans laquelle ils se sont rendus ou que ce soit la première où j’enquêterai. Avez-vous des photographies récentes de vos enfants ?
Déjà les mains des mères se tendent. Elles aussi veulent que l’enquête débute au plus tôt et souhaitent apporter leur modeste contribution.
— Merci. Je vais veiller à ce qu’il en soit procédé une diffusion dans les services de gendarmerie et de police. De votre côté, je dis cela spécialement à votre intention, Mesdames, ne vous laissez pas aller au découragement. Utilisez votre énergie pour appeler tous les amis de vos fils. Peut-être ces démarches porteront-elles leurs fruits… Il se peut également qu’ils soient rentrés dès que vous avez quitté la maison ou qu’ils soient sur le chemin du retour. Dans ce cas, merci de me tenir au courant pour que je cesse mes investigations.
— Bien entendu. Vous pouvez compter sur nous.
Dix secondes plus tard, le bureau se vide. Dix autres encore, et le lieutenant est en communication téléphonique avec un lieutenant du commissariat de Quimper. En effet, Paul Le Franc s’est souvenu durant la conversation avec les parents Betton et Carlier de la disparition inexpliquée d’une jeune fille, une semaine plus tôt, dans la capitale cornouaillaise…
* Fou en verlan.
* Louche en verlan.
II
— Saleté de bécane ! peste Wilfrid en retirant son casque intégral. J’aurais mieux fait d’acheter une bagnole !
Délaissant sa moto, il fait quelques pas avant de se laisser tomber sur le talus. Pour ajouter à son abattement, il a l’impression que le soleil concentre ses implacables rayons sur lui seul. Déjà de la sueur perle à son front, tandis que son tee-shirt se plaque ostensiblement sur son dos, lui faisant comme une seconde peau. Ceci est de mauvais augure pour l’épreuve qui l’attend. Avant-hier déjà, il a dû pousser sa japonaise sur plus de deux kilomètres. Mais aujourd’hui, il est à plus de quatre bornes de chez lui.
— Le plus crétin dans cette histoire, c’est que je suis certain qu’il s’agit d’une panne bénigne. Mais comme je suis nul en mécanique… Si je n’avais pas bouffé le forfait de mon portable, j’aurais pu appeler Lucas. Lui s’y connaît en mécanique… Ou alors, j’aurais téléphoné à la maison : p’pa serait venu avec la remorque… Fait chier, tiens ! Bon, quand faut y aller…
Le moral au fond de ses chaussures bateau, il se remet debout. Après une énorme inspiration, il descend son engin de sa béquille d’un coup de rein rageur et s’arc-boute pour donner une bonne impulsion en poussant sur ses jambes. Deux cents mètres plus loin, il est en nage. Son visage angélique est comme ceint d’une couronne de cheveux mouillés. Baissant la tête pour s’essuyer le front contre l’intérieur de son biceps, il souffle pour s’exhorter :
— Encore un peu de plat, puis je pourrais profiter de la descente de Stang Vihan… Après, ce sera la côte… Elle est balaise, celle-là !
Le bruit grossissant d’un moteur de voiture lui enjoint de braquer le guidon sur la droite et de rouler sur le bas-côté. Cette manœuvre diminue sa vitesse et il doit forcer pour reprendre un rythme correct. Les touffes d’herbe, les creux et les bosses, ne lui facilitent pas la tâche.
Une voiture immatriculée en Gironde passe en trombe. De la musique s’échappe des vitres ouvertes, mais impossible de définir de quelle chanson ou de quel chanteur il s’agit.
— Heureusement que ça ne roule pas beaucoup, soliloque-t-il en revenant sur l’asphalte. Tu parles, ils sont tous à table ! Et moi, je pousse ! Les Shadoks pompaient, moi je pousse !
Le ronflement du moteur d’un autre véhicule l’oblige à retourner sur l’herbe. Percevant les décélérations du véhicule, il jette un regard par-dessus son épaule. Un fourgon blanc n’est plus qu’à une dizaine de mètres. À son bord, le conducteur arbore un sourire et indique du doigt l’endroit où il va s’arrêter. Wilfrid retient son engin pendant que le conducteur manœuvre pour ne pas trop empiéter sur la route. De la sorte, il reste à Wilfrid un espace limité entre le fourgon et le talus.
— Bonjour jeune homme, l’aborde l’homme après avoir abaissé la vitre. Tu es en panne ?
Wilfrid n’a pas fait attention à la plaque d’immatriculation, mais il suppose que l’occupant n’est pas de la région et cherche son itinéraire. S’il allait au centre-ville de Concarneau, cela lui conviendrait. Mais aurait-il le cran de demander à l’inconnu de le prendre à son bord ? Et que ferait-il de sa moto ? Serait-il possible de la monter à l’arrière ? Une déferlante de questions submerge Wilfrid, aussi bégaie-t-il sa réponse :
— Oui. Je ne pense pas que cela soit sérieux, mais je ne m’y connais pas des masses.
— Moi non plus, malheureusement. En revanche, si tu veux, je peux te déposer en ville ou chez toi.
Pressentant que le jeune homme hésite, le conducteur explique son comportement :
— Je suis un ancien motard et, moi aussi, je sais ce que c’est que d’être en panne. Combien de fois ai-je espéré que l’on me prenne en stop ! Alors, quand je peux rendre service… Enfin, c’est comme tu veux. Mais décide-toi vite, je ne voudrais pas me faire défoncer l’arrière du fourgon par une bagnole.
La proposition n’est pas pour déplaire à Wilfrid. Il sait pertinemment qu’il ne faut jamais monter en voiture avec un inconnu, mais une petite voix au fond de lui lui chuchote qu’il ne risque rien. L’homme est d’un abord sympathique et, de plus, en pleine journée, l’idée d’un enlèvement ne viendrait à personne de sensé. Qui plus est en Bretagne ! À moins que l’homme ne soit de la pédale ? « S’il me propose la botte, je lui mets une grosse tête ! Il n’a pas l’air très costaud. Et pas très jeune non plus. »
Cet ultime argument achève de le convaincre. Du haut de ses vingt ans, Wilfrid se sent au moins aussi fort que l’homme du fourgon.
— Et ma bécane ?
— Je n’ai pas de place à l’arrière. Tu n’as pas un moyen pour revenir la chercher plus tard ?
— Si. Mon père a une remorque.
— Il n’y a pas de problème alors.
Le conducteur consulte son rétroviseur extérieur gauche puis insiste, une pointe de nervosité dans la voix :
— C’est comme tu veux, mais décide-toi tout de suite.
N’écoutant que l’impulsivité de sa jeunesse, Wilfrid acquiesce :
— OK. Une seconde, je l’appuie contre le talus.
— Fais vite… Non, pas la portière. Elle est cassée. Passe par la porte de côté.
Wilfrid obtempère. Il pose la main sur la poignée et fait coulisser la porte latérale sur son rail. Dans le même mouvement, il a déjà un pied à l’intérieur. Soudain, sans qu’il ait le temps de réagir, il est happé par une solide poigne. Une deuxième lui applique une compresse copieusement imbibée de chloroforme sur le nez. Instinctivement, le jeune homme tente de raidir ses membres inférieurs et de sauter au dehors. Mais son assaillant possède une force hors norme. Se débattre est inutile. De plus, l’anesthésiant produit rapidement son effet. La main du jeune homme lâche le casque et celui-ci tombe sur le sol du fourgon avant de rouler dehors. Une touffe d’herbe imposante et indisciplinée le retient après quelques roulades, tandis que le véhicule démarre déjà.
À travers un brouillard, Wilfrid distingue difficilement le conducteur. Ce dernier sourit et adresse un pouce levé à son comparse dont le jeune motard n’a pas même entrevu le visage. Sentant ses forces l’abandonner, il lance une ruade molle avant de perdre définitivement conscience.
III
J’ai raccompagné Murielle jusqu’à la maison. Notre ami Keran Sheridan* vient de quitter le port de plaisance de Concarneau et vogue vers son Irlande natale sur son nouveau voilier. Nous savons qu’il s’écoulera de longues semaines, voire d’interminables mois, avant que nous ne revoyions dans la baie les lignes profilées du “Christelle”. Parce qu’il faut tenter d’oublier cette séparation et positiver, quelle que soit la situation, je me dis que le soleil généreux est bien agréable et me met du baume au cœur. Il ne manquerait plus qu’il pleuve pour qu’un début de déprime m’assaille ! Ma voiture remisée sur la place de l’Office de Tourisme, je me dirige sans me presser vers le commissariat.
Je ne suis pas d’humeur travailleuse ce matin. Derrière le guichet de l’accueil, l’ADS (adjoint de sécurité) me salue respectueusement. Puis, aussitôt, il m’annonce que le commandant Bernier est hospitalisé à Quimper au CHU de Cornouaille et m’espère dans sa chambre, dans les plus brefs délais. Je ne suis pas enchanté d’entamer ma journée par cet entretien, mais pas moyen d’y échapper. Tel un employé modèle, ce que pourtant je ne suis absolument pas, je fais demi-tour sans monter jusqu’à mon bureau.
Vingt minutes plus tard, je me gare sur le parking de l’hôpital dans lequel justement travaille Murielle, mon “amoureuse”. Montant directement au deuxième étage, au service cardiologie, je me rends au bureau infirmier où une charmante jeune femme m’oriente vers la chambre du commandant. Je parviens devant la porte de la chambre en question quand une infirmière en sort, encore plus mignonne que la première. À moins que ce ne soit la blouse blanche qui m’interpelle ! S’il s’avère que le port de l’uniforme émoustille la gente féminine, l’infirmière nue sous sa blouse est sans doute le fantasme numéro un des hommes. Faudra que je dise à Murielle de se mettre en tenue de travail, un de ces soirs… La belle brune laissant la porte ouverte, je m’efface pour la laisser passer. Me décochant un sourire à damner un saint, elle s’éloigne en poussant un petit chariot métallique qui supporte un foisonnement d’instruments de toutes sortes.
Me découvrant, Daniel Bernier abandonne l’article du journal dans lequel il allait se plonger. Il fait mine de se lever du fauteuil dans lequel il est assis, avant de finalement y renoncer, comme si cela était au-dessus de ses forces. À peine amaigri depuis notre dernière rencontre, il est pourtant, selon moi, capable de ce modeste effort.
— Bonjour, Commandant. Restez assis, je vous en prie.
— Oh, Maxime ! Ce que vous m’avez manqué ! Quel bronzage ! Vous avez une mine superbe. Vous êtes resplendissant de santé et d’énergie.
Un instant, j’ai envie de me pincer pour m’assurer que je ne rêve pas. Pareil accueil n’est pas dans les habitudes de l’individu, même s’il a adopté le même scénario il y a peu à mon retour du Chili. Du reste, une lueur dans ses prunelles indique qu’il est tout aussi attentif à ma réaction qu’au rôle qu’il s’est attribué. Comme je ne suis pas à un mensonge près et que je déteste jouer les utilités, je me glisse dans la peau d’un personnage de ma composition.
— Moi aussi je me languissais de vous, Commandant. Durant mon absence, combien de fois me suis-je retenu alors que je m’apprêtais à vous téléphoner. Il a fallu que je me fasse violence pour ne pas céder à cette irrépressible envie de vous joindre. Non pas pour vous donner de mes nouvelles, bien évidemment, mais pour m’enquérir de votre santé. Maintenant que je me tiens en face de vous, je constate que vous vous portez comme un charme.
— Vous êtes gentil, Maxime. Mais où donc étiez-vous passé ?
En demandant cela d’une voix qui se veut caverneuse et curieusement feutrée, il a adopté l’air suspicieux du gars à qui on ne la fait pas. Si je me base sur son attitude de chien battu, il donne à penser qu’il a compris que son avenir se limite à quelques jours, au mieux à quelques semaines. Je le fréquente depuis mon affectation à Concarneau, il y a neuf mois de cela, soit suffisamment longtemps pour ne pas tomber dans le panneau. J’élude sa question et embraye sur un mode réconfortant :
— Allons, Commandant ! Nous avons besoin de vous. Vous devez vous ressaisir.
— Je sais, mon petit, je sais. Mais je me sens si faible… Où étiez-vous donc passé ces derniers temps ? J’ai remué ciel et terre pour obtenir de vos nouvelles.
Quel acteur ! S’il continue ainsi, je pressens qu’il va finir par insinuer que son pépin cardiaque est de ma faute. Il va pour reprendre la parole et axer la conversation à sa guise, mais je ne lui laisse pas l’initiative malgré le respect dû à son âge et surtout à son grade. Au contraire, même ! Pour éviter qu’il ne m’interroge plus avant sur la nature de mon escapade, je lui livre la même explication qu’avant mon départ pour Sesnara.
— Je ne peux toujours rien vous dire, Commandant. Il en va de l’intérêt de l’État. Si cela ne dépendait que de moi, je vous mettrais dans la confidence. Mais je ne peux pas parler. Je possède toujours sous la peau une puce électronique. Elle est placée sur une partie de mon anatomie que la décence m’interdit d’exhiber, sinon je vous la montrerais. Elle enregistre mes paroles et faits et gestes à l’intention de ceux qui l’ont installée. Si je venais à divulguer le secret entourant mon absence, ma vie et la vôtre seraient en danger. Plus tard, peut-être… Enfin, nous verrons. Mais parlons plutôt de vous, Commandant : comment vous sentez-vous ?
Il m’observe un instant, se demandant si je le prends pour un imbécile avec cette histoire de puce électronique ou si je suis moi-même un déséquilibré. Puis il lance du bout des lèvres :
— Je me sens las. Je suis épuisé… Chaque jour, je sens la vie me fuir un peu plus.
— Il faut vous battre, Commandant ! Avant d’entrer, j’ai croisé le médecin et il m’a confié que rarement il a vu un patient se remettre aussi vite que vous. Selon lui, après une nécessaire période de repos, vous pourrez reprendre le travail et donner le meilleur de vous-même.
— Je ne le crois pas, mon cher Maxime. C’est d’ailleurs pour cela que je voudrais savoir ce que vous avez fabriqué ces deux dernières semaines. Mieux vaut que vous me le disiez maintenant, mon petit : demain, je serai peut-être mort.
— Bien sûr que non, Commandant ! Pour répéter la formule du médecin, vous pétez la forme ! Promis, je vous raconterai tout plus tard. En attendant, reposez-vous. Je vais d’ailleurs vous laisser dormir.
Il pose sur moi un regard agacé et inquisiteur, ne sachant trop si je me moque de lui en lui suggérant de se coucher à dix heures du matin ou si je l’imagine plus mal en point qu’il ne l’est réellement. Je ne suis pas aussi bon comédien que lui, mais je choisis dans la gamme dont je dispose un sourire empreint de compassion à faire pâlir de jalousie un élève du cours Florent. Comme je vais pour sortir, il objecte d’un ton abrupt :
— Attendez, Moreau !
Me retournant lentement, je note le passage du « mon cher Maxime » et autre « mon petit » à un « Moreau » moins amical. Déçu de ne pas avoir apaisé sa curiosité et se doutant que je le mène en bateau, il use de mon nom de famille et non plus de mon prénom. En une fraction de seconde, il a gommé yeux vitreux et lèvres tombantes pour son visage habituel. Sur un ton froid et distant, il jette :
— Durant mon absence, je vous somme d’assumer ma fonction. Par chance, nous n’avons pas d’affaire nécessitant de dispositions ou de qualités particulières. Si cela était, j’exige d’en être averti immédiatement.
— Entendu, Commandant !
Sans lever un sourcil, il ignore mon assentiment et poursuit :
— Tous les matins, vous viendrez ici m’exposer l’activité du commissariat et les difficultés rencontrées. Je saurai, depuis ce lit d’hôpital, vous aiguiller. En quelque sorte, je serai votre tête et vous serez mes jambes.
— À vos ordres, Commandant.
Ma servilité le comble d’aise, même s’il sait qu’elle est forcée.
On ne se quitte pas bons copains. Je ne suis pas dans ses papiers et il ne cherche plus à masquer son antipathie à mon encontre. Antipathie n’est peut-être pas le terme adéquat ; disons que Daniel Bernier désapprouve mes manières de faire et le secret qui couvre mon emploi du temps depuis plus d’un mois. En effet, après le dénouement de l’affaire Lamingue-Segrais-Parda*, j’ai disparu de la circulation pendant trois semaines. Certes, j’épuisais mes congés de l’année précédente, mais le commandant n’est pas dupe et soupçonne du croustillant là-dessous. Puis après une demi-journée de boulot, j’ai à nouveau pris la poudre d’escampette. Bénéficiant d’une couverture des services secrets français, j’ai réalisé un travail particulier, à l’opposé de ce que l’on attend d’un représentant de la loi. Je me suis ensuite adjugé quelques jours de repos en compagnie de Murielle et Keran pour me remettre de mes émotions.
*
J’ai roulé doucement pour effectuer les vingt kilomètres qui séparent Quimper de la Ville Bleue, surnom de Concarneau en clin d’œil aux filets que les marins teintaient en bleu pour pêcher la sardine. Un peu comme si je souhaitais retarder au maximum ma reprise de travail.
Je monte sans entrain l’escalier menant à l’étage de mon bureau ; fidèle à mon TOC je compte chacune des vingt marches réparties en quatre volées et vais saluer les lieutenants. Ils sont tous les trois présents dans le bureau qu’ils partagent.
— Alors, les gars ! Quoi de neuf ?
Ils se consultent du regard avant que le Marseillais, Luc Pallas, ne me renseigne de son accent chantant :
— Bé, à vrai dire, rien de terrible. Le train-train.
— Tu sais que le patron est à l’hosto ? interroge David Fournot.
— Oui, je sors à l’instant de sa chambre. J’y pense, avez-vous revu le baron de Vitreux de Barnac ?
Tous trois répondant par la négative, je ne m’appesantis pas sur le sujet.
— Au fait, les gars : je ne vous ai pas remercié pour votre coup de main de la semaine dernière à Lorient. Sans votre aide, je mangerais des pissenlits par la racine à l’heure qu’il est.
Des sourires complices se dessinent sur les visages des officiers de police. Il n’est pas utile de se perdre en longues phrases pour comprendre qu’ils ne regrettent rien et savent que j’aurais agi de façon semblable dans des circonstances analogues.
— En guise de reconnaissance, j’aurai quelques bricoles à vous offrir ce soir après le boulot. Et pour couronner le tout, je vous invite, vous et vos épouses ou petites copines du moment, au resto, le samedi d’après. J’espère que vous serez disponibles, car j’ai réservé une table au restaurant “La Coquille”. Plateau de fruits de mer, homard ou turbot seront au menu, même s’il sera possible de commander autre chose.
— À La Coquille ! s’enthousiasme Luc. Ça ne se refuse pas.
David Fournot dit qu’il sera en vacances mais que, comme il ne bouge pas, il sera présent, tandis que Frédéric Gaubert, le plus jeune, ajoute :
— Pour l’instant, je suis célibataire, mais je ne désespère pas de venir accompagné.
— Le contraire m’étonnerait.
— Au pire, je mangerai pour deux.
Sa boutade nous fait d’autant plus rire qu’on le sait capable de cette prouesse.
— Je te reconnais bien là ! On est d’accord pour samedi d’après ? Ah, pas un mot au patron : il serait vert de jalousie.
— Pas de danger ! répond Pallas.
— Et je ne veux pas entendre parler de corruption de fonctionnaire ! Si je vous invite à une tablée gargantuesque, c’est parce que vous l’avez mérité.
Ayant gagné mon bureau, je m’empresse d’adresser un coup de fil à l’Hôtel de l’Océan. Le silence du baron m’étonne.
La réceptionniste m’apprend qu’il a quitté sa chambre le lendemain de mon départ pour le Chili. Hélas, il n’a laissé ni message ni coordonnées. De plus, il a réglé ses nuitées en liquide.
Je téléphone ensuite à mon copain Yves Perrot, en poste à Nantes.
— Salut, ma poule ! Comment vas-tu ?
Mon interpellation enjouée le ravit. Il reprend sur le même mode :
— Bien. Et toi ? Dis, je n’avais plus de tes nouvelles depuis un bon mois.
— J’étais sur un gros coup, je n’ai pas eu une minute à moi.
— Ça a marché ?
— Impec ! Par la suite, j’ai soldé mes congés et je suis parti en vacances.
— Quelle destination ?
— Je te raconterai plus tard. Bon, on ne va pas rester papoter sur le compte des contribuables ! Je voudrais savoir comment cela s’est goupillé dans le pays nantais ?
— D’enfer ! Le capitaine Doiron a appréhendé une cinquantaine de personnes. Il faut avouer que le carnet que tu lui as remis contenait toute une liste de noms, ce qui lui a facilité la besogne.
— Parfait… Ici, l’instruction suit son cours. Je finirai sûrement par rencontrer Doiron un de ces jours. J’ai reçu une copie de son rapport, mais je n’ai pas eu le temps de le lire. Remercie-le si tu le croises.
— Je n’y manquerai pas.
— À part cela, as-tu l’occasion de venir à Concarneau ?
— Pas vraiment. Mais je peux la provoquer, cette occasion.
— Excellente idée. Je désirerais vous présenter Murielle. Êtes-vous libre ce week-end, toi et la charmante Lætitia ?
— Normalement oui. Je te confirmerai demain.
— Ne te tracasse pas pour l’hébergement, je vous prête mon appartement.
— Oh oh ! Cela signifie que tu as emménagé chez ta belle. Les choses ne traînent pas, avec toi !
— Jamais. Tu devrais le savoir, depuis le temps que tu me fréquentes. Je te fais quand même remarquer que Murielle et moi sommes ensemble depuis plusieurs mois.
— Combien ?
— Trois.
— Compliments. C’est un bon début. Presque un record pour toi !
— Ne charrie pas et attends de la connaître pour me complimenter. Bon, on fait comme ça ? Tu me rappelles pour voir si ça tient ?
— Dès demain.
— OK. Salut, Yves. Le bonjour à Lætitia.
Sitôt raccroché, je m’avachis sur mon siège. La pile de paperasses déposées durant mon absence me donne le vertige. Elle se compose de dossiers, de rapports d’enquête, de procès-verbaux… Avant d’allumer mon ordinateur pour consulter ma boîte email, je vais me servir un café serré.
*
Peu après midi, on frappe à ma porte.
— Entrez.
— On va manger, déclare Fred Gaubert. Tu nous accompagnes ?
— Non. Murielle est de repos aujourd’hui. Elle a sûrement préparé un bon petit plat. Comme elle avait pas mal de trucs à faire ce matin, je quitterai le poste vers treize heures seulement. Je serai de retour vers quatorze heures quinze.
— Bon ap’. Ciao.
— À plus.
De minute en minute, l’activité du commissariat diminue. J’aime ce silence qui n’en est pas réellement un puisqu’il y a toujours la sonnerie d’un téléphone, le crachotement de la radio ou un simple bruit de pas dans l’escalier ou le couloir pour troubler la quiétude des lieux. La machine tourne au ralenti, mais elle est prête à s’emballer au moindre appel inquiétant. Elle me fait penser à une ruche. En ce moment, elle ronronne, mais en un éclair elle peut se mettre à bourdonner.
Un gargouillis de mon horloge naturelle m’annonce qu’il est l’heure de me sustenter. Je signe une ultime note de service et vais pour me lever de mon siège quand le biniou me stoppe dans mon geste.
— Allô !
— Ici le standard, Capitaine. La patrouille a été appelée sur le lieu d’un accident, mais les collègues ne trouvent pas de victime.
— Comment cela ?
— Eh bien, ils ont effectivement trouvé une moto et un casque, mais il n’y a personne. Pas de pilote.
— Hum… Dites-leur de relever la plaque d’immatriculation et fouinez de ce côté-là.
— On l’a déjà fait, Capitaine. La moto appartient à un certain Wilfrid Colbert. J’ai téléphoné à son domicile, ou plutôt à celui de son père, comme il réside chez lui, mais personne ne répond.
— Recommencez. Où habitent-ils ?