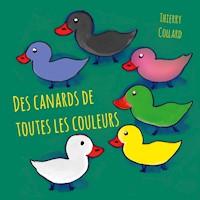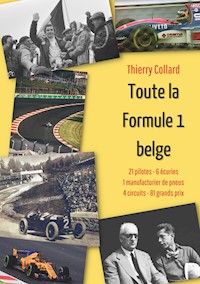Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Un prêtre condamné pour pédophilie ; une fake news qui se répand comme une traînée de poudre ; un éditorialiste qui s'alarme de voir la population locale bientôt remplacée par des familles venues d'ailleurs ; la hausse du prix du gaz qui conduit les communes à réduire l'éclairage public... Vous croyez lire les titres de la presse contemporaines ? Ces événements sont pourtant datés d'au moins cent ans, voire nettement plus. L'actualité d'antan, lorsque la Charente-Maritime s'appelait encore Charente-Inférieure, entre en résonance avec celle d'aujourd'hui. En transposant ces récits dans un ton plus actuel, en recoupant et en complétant ces infos du XVIIe au XXe siècle, l'auteur a voulu à la fois distraire et instruire. Leur lecture éclaire les actualités du XXIe siècle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Les actualités d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. »
Raymond Queneau
Table des matières
Avant-propos
Le grand chêne brûlé pour un feu de joie
Le doyen meurt avant son septième mariage
Aunis et Saintonge, un mariage sans amour
Gare à la ganipote !
L’instruction, quel malheur !
Il grignotait les noisettes des épargnants
Le potage à l’arsenic
De très honorables trafiquants de cognac
Le curé interdit l’accès au cimetière
Autour du triangle de Beillant
Le jeune meunier écrasé par son moulin
La chute de l’intrépide aéronaute
Venez découvrir le télégraphe parlant
Des loups aux portes des villes
Infirme un peu, comédien beaucoup
Six coups de feu dans le train 508
Pierre Loti (enfin) élu à l’Académie française
La condamnation d’un prêtre pédophile
Les premières séances du cinématographe
L’effondrement du phare de la Coubre
Le spectacle de la noyade d’un matelot
Les amants empoisonnent le mari
Le passage du premier Tour de France
Émile Combes, charmeur républicain
Un monument pour Fromentin
On crache au visage du ministre
Le notaire s’enfuit avec la caisse
Pierre Loti habite… rue Pierre-Loti !
Pierre Loti retraité ? Une
fake news
en 1918
Les postiers pillent le courrier du guérisseur
L’année de la grande sécheresse
D’anciens poilus méprisés par des officiers
Une question de fin de race
Les wagonniers prélèvent leur part
Au poste, son voleur est déjà en cellule
La première École Normale part en fumée
L’amant acquitté du meurtre du mari trompé
Le médecin se tue à bicyclette
La carte postale éclipse la carte de visite
Un bureau de poste si longuement attendu
Un cadavre dans le caniveau
Le prix du gaz réduit l’éclairage public
Premiers drames de la circulation
La musique n’adoucit pas les mœurs
Discours et banquets-fleuves pour le président
Le serrurier visitait les villas inoccupées
Le boucher voulait « griller » l’octroi
La laïcité n’est pas soluble dans l’eau bénite
L’hydravion du Royannais s’échoue en mer
Les multiples vies de Boyardville
Avant-propos
Un prêtre condamné pour pédophilie ; une fake news qui se répand comme une traînée de poudre ; un éditorialiste qui s’alarme de voir la population locale bientôt remplacée par des familles venues d’ailleurs ; la hausse du prix du gaz qui conduit les communes à réduire l’éclairage public… Vous croyez lire les titres de la presse de notre début de XXIe siècle ? Ces événements sont pourtant datés d’au moins cent ans, voire nettement plus.
L’actualité d’antan, lorsque la Charente-Maritime s’appelait encore Charente-Inférieure, entre en résonance avec celle d’aujourd’hui. Sans croire comme Thucydide que l’histoire est un perpétuel recommencement, les travers et les réactions de la société empruntent souvent les mêmes chemins qu’autrefois. Si l’Homme apprend de ses erreurs, c’est avec une désespérante lenteur.
La lecture de la presse locale du XVIIe au XXe siècle émeut, intrigue, attriste ou amuse, selon les faits rapportés. Jamais elle ne laisse indifférent.
En transposant ces récits dans un ton plus actuel, en recoupant les versions des différents journaux de l’époque, en les complétant par des recherches dans d’autres archives, j’ai souhaité distraire et instruire avec ces Chroniques de Charente-Inférieure.
Lisez pourquoi un prêtre saintais pédophile a été condamné par la cour d’assises en 1894 ; qui a propagé des rumeurs sans fondement sur Pierre Loti en 1918 ; comment les Vendéens étaient pointés du doigt par certains Charentais en 1921 ; pourquoi on ferma des becs de gaz à La Rochelle en 1922… Vous verrez d’un autre œil les informations d’aujourd’hui.
T. C.
Le grand chêne brûlé pour un feu de joie
1682, Courcerac
Point de rave party champêtre dans la Xaintonge du XVIIe siècle, mais une fête galante donnée par et pour la noblesse locale. Les pages du Mercure galant — précurseur de notre presse people — en ont gardé la trace.
Le seul, l’unique, le grand événement de cet été 1682, pour la haute société, c’est la naissance de Louis de France, le 6 août à Versailles. Il est le Petit Dauphin, destiné à monter un jour sur le trône occupé par son grand-père, Louis XIV. Autant vous le dire tout de suite, son papy a la peau dure et établira le record de France du plus long règne (72 ans et des brouettes) en s’éteignant en 1715. Trop tard pour que le prochain roi soit son petit-fils, mort en 1712 de la rougeole. C’est l’enfant de l’ex-Petit Dauphin — donc l’arrière-petit-fils de Louis XIV — qui deviendra Louis XV.
Mais n’anticipons pas et revenons à la joie que provoque cette naissance chez trois ou quatre demoiselles saintongeaises, car la royale nouvelle est très vite parvenue dans toutes les provinces. Un brin jalouses d’une célébration qui a rassemblé la noblesse à Jarnac quelques jours plus tôt, elles adressent un carton d’invitation aux gentilshommes et dames de leur entourage.
La fête se déroule le 25 août au logis Bardon, « à trois lieues de Cognac ». Cette maison de campagne est entourée de douves et bordée par la rivière l’Antenne, par une futaie et par de grandes prairies.
On se trouve là chez Monsieur de Courcerac, « converti depuis peu » et père de treize enfants, dont deux fils qui servent le roi depuis douze ans. L’un, appelé Monsieur de Bardon, est capitaine dans le Régiment du Maine ; l’autre est lieutenant au Régiment Colonel.
Non loin de l’eau et d’une longue allée couverte, les demoiselles jettent leur dévolu sur un beau chêne vert qu’elles trouvent follement amusant de garnir de fagots secs afin d’en faire un grand bûcher.
Pour parfaire le feu de joie, Mademoiselle de Bardon demande qu’on abatte « un gros laurier qui avait résisté à la gelée de plus de cinquante hivers ». La jeune noble fait ainsi savoir que si une de ses branches couronnait les empereurs, un arbre entier n’est pas de trop pour la naissance du petit-fils du roi. Elle en compose un sonnet :
Quoi ? Nous verrons encore des Lauriers dans la France,
Comme l’on en voyait aux Siècles de jadis ?
Nous choquerions du Ciel la divine Ordonnance
Qui nous donne en effet ce que fut Amadis.
D’un Duc tant désiré la Royale Naissance,
Fatale à tout Tyran plus que je ne prédis,
Nous fait tout espérer, la joie et l’abondance
Ses grands destins déjà sont partout applaudis.
Brûlons donc ce Laurier, n’épargnons point la Palme,
Tout sous Louis le Grand est en paix, tout est calme,
Chez les Rois éloignés il prendra les Lauriers.
Il en composera sa gloire et sa Couronne ;
Mais ses Peuples en verront son auguste Personne
Se couronner pour eux de Festons d’Oliviers.
Quand on sait l’avenir écourté et jamais royal du petit Louis, ce grandiloquent poème sonne bien creux ! Passons.
Un orchestre composé des meilleurs hautbois de la province accueille une cinquantaine d’invités. Mademoiselle de Bardon, ses sœurs et une vingtaine d’amies apparaissent vêtues en Amazones brandissant chacune un pistolet. Quand la jeune fille allume le bûcher, un tonnerre de coups de fusil, mousquetons et autres armes à feu retentit.
Monsieur de Courcerac prend le relais pour inviter les convives à approcher des tables dressées dans l’une des allées du bois. En musique, on s’empiffre et on vide quantité de bouteilles de vin de Graves à la santé de Sa Majesté et de toute la famille royale.
Aux agapes succèdent les danses. Bref, la fête se poursuit tard et, surtout, les nobliaux saintongeais comptent bien que ses échos remontent jusqu’à Versailles afin de ne pas laisser aux Jarnacais le monopole de la flagornerie.
Le doyen meurt avant son septième mariage
1710, Geay
Jean Amiot meurt le 1er septembre 1710 à Geay. Il est pieusement inhumé dans le cimetière qui jouxte l’église du bourg, ainsi qu’en atteste le registre soigneusement tenu par le curé de la paroisse, le père De la Tribouille. Jusque-là, rien d’exceptionnel.
Si ce décès sort de l’anonymat, c’est parce que l’âge du défunt est tout bonnement extraordinaire pour l’époque — et il le serait encore aujourd’hui — car Jean Amiot s’éteint à 106 ans et trois mois ! À moins d’une erreur de calcul de la famille ou du prêtre, on a sûrement affaire au doyen de la Saintonge et de l’Aunis car — pardon de remonter le temps un peu plus qu’annoncé — la Charente-Inférieure n’existe pas encore en 1710. Faute de pouvoir consulter le registre paroissial des naissances du printemps 1604, on veut bien croire que le vieil homme est né à l’avènement de Louis XIII.
On en cause jusqu’à Paris ! La Gazette rapporte cette information. Elle y glisse, au passage, quelques imprécisions par rapport à l’acte de décès mais elle y ajoute des compléments étonnants : Jean Amiot avait connu six épouses durant sa longue existence et il était, paraît-il, sur le point de contracter un septième mariage ; hélas, la mort l’a fauché prématurément.
Si le registre paroissial mentionne que son inhumation s’est déroulée en présence du fils, Louis Amiot, et du petit-fils, Guillaume Amiot, La Gazette indique que la famille était bien plus importante puisque Jean Amiot a connu la cinquième génération de ses descendants.
Aunis et Saintonge, un mariage sans amour
1790, Charente-Inférieure
Une Révolution, ça ne se fait pas en deux temps, trois mouvements. Les multiples transitions qui ont accompagné le passage de la royauté à la République ont nécessité quelques années de travail et de longs débats qui ont parfois été tranchés par la guillotine.
Résumons. Jusqu’en 1789, deux provinces occupent grosso modo l’emplacement actuel de la Charente-Maritime. Au nord-ouest, l’Aunis englobe les alentours de La Rochelle, Marans, Surgères, Rochefort. La Saintonge, c’est tout le reste, donc ce qui gravite autour de Saintes, Royan, Saint-Jean-d’Angély et Jonzac. Chacun chez soi et les vaches sont bien gardées.
Mais, paf ! On dézingue la Bastille, on constitue une Assemblée qui prend au roi quasiment tous ses pouvoirs et on se met en tête de réorganiser tout le territoire. On appellera ça « départements » au lieu de « provinces » et basta…
Tsss ! Pas si vite ! Dans les premiers jours de 1790, le projet présenté par le député — de la noblesse — et ingénieur Jean-Xavier Bureau de Pusy prévoit de réunir en un seul département l’Aunis, la Saintonge et l’Angoumois (Cognac, Angoulême, Ruffec, etc.). Le Comité pour la division des Départements a tranché : les 100 lieues de surface du pays d’Aunis ne suffisent pas à constituer une entité isolée — pas plus que les 140 lieues du Pays basque d’ailleurs. Maintenant, au boulot ! Les élus n’ont que quelques jours pour « que chaque Département porte le tableau de ses limites, sinon le Comité les tracera lui-même ».
C’est là que commencent les véritables négociations. Premièrement, la fusion avec l’Angoumois est très rapidement écartée ; comment voulez-vous gérer un territoire qui s’étendrait de Saint-Clément-des-Baleines jusqu’à Roumazières ?
Deuxièmement, les Aunisiens reviennent à la charge : ils veulent leur propre département, parce qu’ils le valent bien ! Le pays d’Aunis met en avant ses cinq ports de mer, les différences entre une province maritime et une agricole, « l’importance de sa situation et sa quotité de contribution : près d’un million de contributions directes et sept cent mille livres de contributions indirectes ». Si son territoire est trop petit, qu’on lui associe donc l’île d’Oléron ! Bref, l’Aunis « trouverait impolitique d’être associé à la Saintonge, pays sans commerce et sans vie ». Prends ça dans les dents, cher voisin !
Un observateur du Courrier de Provence estime que la véritable motivation des Aunisiens tient à la situation géographique de La Rochelle ; trop excentrée en cas de fusion avec la province voisine, la grande ville portuaire ne pourrait prétendre être chef-lieu et devrait céder ce privilège à Saintes.
Placides, les députés saintongeais ne s’opposent pas à ce que leurs voisins fassent « département à part », mais pas question de leur céder Oléron.
L’Assemblée tranche : Aunis et Saintonge ne formeront qu’un, que ça leur plaise ou non ! Pierre-Étienne-Lazare Griffon de Romagné, noble député rochelais, n’est pas content.
Le 5 février 1790 paraît le décret suivant : « Le département d’Aunis et de Saintonge sera divisé en sept districts, dont les six premiers auront pour chefs-lieux La Rochelle, Saint-Jean-d’Angély, Rochefort, Marennes, Saintes et Pons. Dans le septième, les électeurs assemblés à Montlieu décideront si le directoire et les assemblées subséquentes seront fixés dans cette ville ou ailleurs. »
La suite du texte porte l’embryon de la guerre de pouvoir qui va se poursuivre entre les deux principales villes charentaises : « La première convocation d’assemblée de département se tiendra à Saintes (…). Les convocations des sessions suivantes auront lieu successivement à La Rochelle et à Saint-Jean-d’Angély, à moins que, dans le cours de la première, l’assemblée de département ait cru devoir proposer à l’Assemblée nationale une autre disposition définitive, et sous la réserve encore, dans le cas où l’alternat de l’assemblée de département ne se réaliserait pas, de fixer dans la ville de La Rochelle tous les établissements publics qui pourront y être placés, particulièrement ceux qui seront les plus propres à favoriser son commerce. »
Voilà donc Saintes « provisoirement chef-lieu » mais déjà délestée de certaines administrations. Le lobbying rochelais reprendra de plus belle sous Napoléon Ier qui finira par ordonner le transfert de la préfecture de la capitale de la Saintonge vers celle de l’Aunis.
En mars 1790, le département délaisse l’appellation de ses anciennes provinces et prend le nom de Charente-Inférieure1.
Dans l’ordre alphabétique, il porte alors le numéro 16. C’est seulement en 1860, avec la création des Alpes-Maritimes, que le département prend l’indicatif postal 17 dont découlent nos codes postaux, plaques d’immatriculation, etc.
1 Le nom Charente-Maritime remplacera celui de Charente-Inférieure en 1941.
Gare à la ganipote !
XIXe siècle, Charente-Inférieure
La ganipote ne fait plus peur aux petits Saintongeais depuis belle lurette. Cette sorte de loup-garou, parfois appelée aussi bigourne, peuple les anciens contes en Charentes, en Poitou, en Touraine, en Pays Gabay, en Guyenne, jusqu’en Forez, dans le Morvan et au Québec. Sûrement un bon moyen de dissuader les enfants d’aller traîner dehors une fois la nuit tombée !
Dès le XIXe siècle, on ne la prend plus guère au sérieux. Au printemps 1836, L’Écho rochelais publie une série d’articles moquant les cours de « magnétisme animal » délivrés à La Rochelle par les frères Ricard. Le préambule est sans appel : « Les hommes ont un tel besoin de merveilleux qu’ils regardent comme vraies les choses les plus absurdes. » Et la conclusion enfonce le clou : « Si ma grand-mère vivait encore, je me garderais bien de rire comme je le faisais autrefois quand elle me parlait des ganipotes. »
Fin octobre 1862, un rédacteur de L’Indépendant de la Charente-Inférieure décrit avec humour : « Voilà les veillées qui commencent. Le vent sanglote au-dehors, les forêts gémissent comme des harpes éoliennes, la pluie frappe les vitres ; on entend au loin le hou hou lugubre et sans trêve de Maumusson, la nuit est pleine de bruits mystérieux ; de vagues terreurs règnent dans la campagne sombre ; c’est à présent que les ganipotes et les loups-garous se promènent dans les ténèbres… mais il ne faut pas être à jeun pour les voir ! »
Cependant, la crédulité demeure dans une frange de la population. En 1869, du côté de Sainte-Gemme, une servante fort simple tombe évanouie un soir où une camarade farceuse l’attend, sur le chemin, accoutrée en ganipote.
En 1884, deux farceurs vêtus de peaux de bêtes veulent jouer un tour à un chasseur de Marennes, sur le chemin des Ombrettes ; les deux ganipotes s’enfuient avec quelques plombs de chasse dans les fesses !
L’Union libérale se moque de ces croyances tenaces en 1887 : « Interrogez dix paysans saintongeais, cinq au moins vous affirmeront avoir vu une ganipote. Aucun ne pourra vous dire exactement quelle est sa forme ; les uns l’ont vu marcher sur deux pieds, d’autres courir à quatre pattes, d’autres encore planer au-dessus du sol ; elle prend cent aspects différents, mais c’est toujours la ganipote, et ces braves gens se feraient couper en morceaux plutôt que de renoncer à leur illusion. »
La dernière mention au premier degré se trouve dans L’Écho de Châtelaillon-les-Bains qui, en novembre 1895, alerte très sérieusement ses lecteurs : « Une bigourne (ganipote ou loup-garou) vient de faire son apparition à Fouras, on n’en avait pas vu depuis une douzaine d’années. Cette horrible bête va se poster tous les soirs, vers 8 heures ½ dans un bois le long de la ligne ferrée. Elle se montre sous différentes formes et effraie les personnes qui passent par là. Mères de famille, veillez ! »
L’instruction, quel malheur !
1839, La Rochelle
Quand les progrès de la société menacent de précarisation les travailleurs indépendants et de disparition les artisans, il y a du souci à se faire, mon brave monsieur ! Et ça ne date pas de la robotisation ni même de la révolution industrielle…