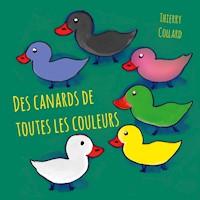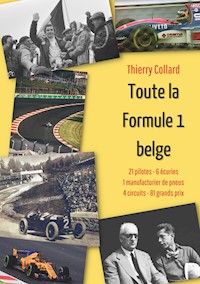Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Vous avez aimé les "Chroniques de Charente-Inférieure" ? Vous allez adorer ces "Nouvelles Chroniques" ! Ce tome 2 rassemble trente-cinq faits divers, catastrophes naturelles, exploits, innovations techniques et débats de société qui font revivre le quotidien de nos ancêtres, du XVIIIe au XXe siècle. Découvrez comment la spéculation sur les céréales fit tant grimper le prix du pain que de violentes émeutes agitèrent le département, de La Rochelle à Saint-Jean-d'Angély. Amusez-vous des fêtes truculentes organisées autour de Gustave Courbet lorsqu'il séjourna à Saintes. Lisez pourquoi la course Paris-Royan était l'une des grandes classiques de la saison cycliste. Tremblez devant la haine hurlée par la foule lors du passage de Dreyfus à La Rochelle. Interrogez-vous sur l'innocence de cette jeune fille d'Ozillac acquittée deux fois aux assises de l'empoisonnement de ses parents. Toutes ces chroniques éclairent encore notre présent car les passions humaines persistent invariablement à travers les siècles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« L’histoire humaine est par essence l’histoire des idées »
(H. G. Wells, Esquisse de l’histoire universelle)
Table des matières
Quand Du Paty voulait reboiser l’Aunis
Les mystères des moules de bouchot
La charrue : une poule aux œufs d’or
Une leçon de géographie républicaine
Un aérolithe dans le ciel jonzacais
La comtesse n’est pas prêteuse
Creuser des tunnels sous la Charente
Violentes émeutes contre la hausse du pain
Deux procès pour un empoisonnement
Il assène calmement des coups de hache
À peine bâti, le nouveau pont s’effondre
La guéguerre du chemin de fer
Une Vierge qui effarouche
Le procès des « carotteurs »
Mille fêtards autour de Gustave Courbet
Des sardines au rythme des cagouilles
Naufrage au pied du fort Boyard
Des grêlons de plus de 500 grammes
Le lent rapprochement de Ré du continent
L’incroyable drame du dompteur nain
Quand la terre tremble en Saintonge
Vingt-trois ouvriers noyés à la Pallice
Les remparts de Brouage sont à vendre
L’ancien maire meurt dans un accident
L’agresseur fantôme du facteur
Le curé s’approprie le corbillard
Les invraisemblables péripéties d’un héritage
Dreyfus « le traître » menacé par la foule
L’élite vélocipédique converge vers le casino
Les marins cognent d’abord, discutent ensuite
L’abbé Gatineau s’est volatilisé
L’aviateur Deneau, de l’exploit au drame
La tournée des facteurs ne tourne plus rond
Double meurtre dans le Marais poitevin
L’accident d’un notable
Carte de la Charente-Inférieure en 1852
Quand Du Paty voulait reboiser l’Aunis
1er mai 1748, La Rochelle
Aunis, morne plaine ! Un bon siècle avant L’Expiation, on ne peut soupçonner Charles Jean Baptiste Mercier du Paty1 de paraphraser Victor Hugo. L’échevin rochelais prend ainsi la parole non pour faire des vers mais afin d’éclairer des lumières des sciences l’économie locale.
Disons-le tout de suite, en ce 1er mai 1748, le public réuni dans la grande salle de l’hôtel de ville n’est pas là pour rigoler. Le sieur Gastumeau, directeur de l’Académie Royale des Belles Lettres de La Rochelle, le rappelle en ouverture de cette séance publique en déplorant « le goût trop vif qui règne dans la littérature pour les choses de pur amusement ». En un temps où, pourtant, l’on n’abuse pas encore d’Internet, trop d’écrits consacrés aux « objets frivoles et de pur agrément font que l’esprit s’amollit et perd le goût des choses solides », alerte-t-il. « À la place des ouvrages immortels où brille la plus pure raison, on va puiser dans des sources qui font la honte de l’Antiquité. » Bah oui, comme toujours, c’était mieux avant !
Bref, l’académie rochelaise préfère les sciences et la diffusion des savoirs auprès de tout un chacun, notamment à l’occasion de ses séances publiques, comme en ce jour.
L’un des intervenants est donc Mercier du Paty. Il donne lecture d’un « Mémoire sur les causes de la rareté du bois dans le pays d’Aunix2 et sur les moyens de le multiplier ».
Premier constat : si l’on excepte la forêt de Benon, la province est chauve comme un œuf. Ce ne sont pas les quelques taillis présents dans les marais qui suffisent aux besoins de la population aunisienne. Alors on achète du bois du Poitou, de Xaintonge3 et de Bretagne. Or, que ce soit à l’échelle d’une ville, d’une région ou d’un pays, l’économie n’aime pas importer. Voilà une chose qui ne change pas avec le temps.
Le conférencier affirme que l’Aunis ne fut pas toujours ce grand désert arboricole. Au contraire, il assure qu’on voyait des forêts et des bosquets même dans des endroits où l’on n’imaginerait pas planter un arbre aujourd’hui.
Du Paty raconte le déclin : « La destruction du bois a commencé par les besoins des habitants, dont le nombre se multipliait par l’accroissement de la capitale, et par ceux de la marine devenue plus considérable. » Suivit une période de déboisement pour faire place aux plantations de vignes, quand les vins d’Aunis bénéficiaient d’une grande réputation. Puis, lorsque cette production n’eut plus le même succès, on brûla massivement du bois de chauffe afin de convertir ces vins en eau-de-vie.
« Les nouveaux habitants trouvant le pays dénué d’arbres se sont insensiblement persuadés que le terrain n’était pas propre à en produire », analyse le conférencier comme origine d’un préjugé contre les plantations.
Du Paty, écolo avant l’heure, rêve d’une « heureuse union de l’agréable et de l’utile, en élevant des arbres pour le plaisir des yeux et pour nos usages ».
Afin d’encourager les semis et les plantations, il se réfère aux conseils de son contemporain Georges-Louis Leclerc de Buffon, déjà célèbre naturaliste : « Les labours qu’on donne aux jeunes chênes ne servent qu’à les faire périr. Il faut donc imiter la nature et planter des buissons et des arbrisseaux qui puissent mettre les jeunes plants à l’abri des injures de l’air et de l’intempérie des saisons. » Il exhorte à ne pas négliger des arbres qui paraissent étrangers tels que les mûriers blancs, les châtaigniers, les pins… Il y ajoute le cyprès, « dont le bois peut servir avec succès pour les parcs ou bouchots à moules qui sont particuliers au pays d’Aunis ».
Près de quatre siècles après cette docte conférence, la physionomie de la région n’a guère évolué. Maïs et tournesol ont souvent remplacé les mauvaises vignes. Du Paty n’a pas plus été entendu en son temps que les scientifiques d’aujourd’hui qui nous exhortent à changer notre rapport à la nature.
1 Père du juriste et homme de lettres Jean-Baptiste Mercier Dupaty (1746-1788) qui a laissé son nom à une rue de La Rochelle.
2 Sic.
3 Re-sic.
Les mystères des moules de bouchot
1750, Esnandes et Charron
Toujours à l’affût des nouvelles connaissances et techniques susceptibles de favoriser les productions et le commerce, le Mercure de France du 1er août 1750 consacre plusieurs pages à un mémoire sur les moules de bouchot présenté par ce même M. du Paty qui se souciait, deux ans auparavant, de reboiser l’Aunis. Cette lecture nous apprend qu’au milieu du XVIIIe siècle, les méthodes empiriques d’élevage4 des mollusques marins ne différaient guère de celle d’aujourd’hui, alors que la connaissance des bivalves était encore balbutiante.
« Les choses dont nous faisons un usage fréquent ne nous sont pas toujours les plus connues, explique en substance Du Paty. Ainsi l’on trouve dans les moules une nourriture saine et abondante, mais l’on ignore la façon dont ces poissons s’élèvent et se multiplient. […] Leur structure et leur manière de vivre ont échappé aux naturalistes mêmes. »
Avant toute chose, l’érudit rochelais distingue deux variétés de moules sur les côtes de l’Aunis : « Les unes, plus petites et moins saines, se trouvent par bancs ou par lits dans la mer ; les autres, plus grosses et meilleures, croisent sur des bois qu’on y plante à dessein. » Son étude s’intéresse exclusivement à ces dernières.
Du Paty dément vigoureusement la thèse du « mouvement progressif » des moules, soutenue par des savants réputés et qui figurera, l’année suivante, dans la première édition de L’Encyclopédie de D’Alembert et Diderot, où l’on peut lire que ces bivalves « s’ouvrent, se ferment, sortent de leurs coquilles ; ils rentrent, s’enterrent dans le sable ou dans la glaise des rivières, marchent, ont un mouvement progressif, s’attachent où elles veulent, respirent, et quelques-unes voltigent sur la superficie de l’eau ». C’est Bob l’éponge avant l’heure !
Selon notre Rochelais, cette théorie « n’a aucune réalité ». Il affirme que « ces poissons sont nés pour un repos éternel ; le même lieu les voit naître et mourir. […] Malheur aux moules que quelque accident détache ; celles qui tombent dans la boue resteront dans l’endroit de leur chute et y trouveront leur perte ».
Du Paty en voit la preuve dans « la pratique constante des propriétaires des bouchots pour repeupler les endroits qui sont nus. Sans cette précaution, leurs bouchots seraient bientôt dégarnis ».
L’érudit décrit longuement la morphologie des mollusques puis les pieux qui les hébergent à l’embouchure de la Sèvre, « à l’occident de l’Aunis ». Sa description de la récolte est sommaire : « Depuis la fin de juillet, pendant plus de six mois, on recueille à mer basse ces coquillages qu’on trouve à gros paquets sur les bouchots. »
Du Paty évoque brièvement l’acon, cette minuscule embarcation rudimentaire à fond plat « dont les habitants d’Esnandes et de Charron se servent pour se rendre en tout temps à leurs bouchots, pour y prendre leurs moules et faire les réparations nécessaires ».
Enfin, le conférencier rochelais déplore la dégradation du bois des bouchots par des vers depuis une vingtaine d’années : « Ces vers sont les mêmes que ceux qui rongent nos vaisseaux et les digues de Hollande. » Il situe l’irruption de ces vers en Aunis à l’époque du naufrage d’un navire au long cours qui échoua sur les côtes d’Esnandes, premier signe d’une mondialisation qui fait voyager le meilleur comme le pire.
4 Une légende largement répandue affirme que l’élevage des moules sur des bouchots aurait été inventé en 1235 dans la baie de l’Aiguillon par Patrick Walton, un Irlandais naufragé.
La charrue : une poule aux œufs d’or
1771, La Rochelle
Remplacer les travailleurs par des machines ; cette idée lucrative ne date pas d’hier. On en trouve trace avant même la révolution industrielle dans les plaines d’Aunis.
À l’automne 1771, la Gazette du commerce rassemble — comme son nom l’indique — des nouvelles d’ordre économique en provenance de tout le royaume. On y apprend, par exemple, que les vignes saintongeaises « ne se sont pas relevées des gelées des 15, 16, 17 et 18 avril dernier » ; pour la quatrième année consécutive, elles ne donnent que le douzième d’une récolte ordinaire.
Pour sa part, le correspondant aunisien du journal évoque le naufrage du navire bordelais La Gloire, éventré « sur les roches de la Tour de la Baleine en l’Isle de Ré » dans la nuit du 17 au 18 octobre ; catastrophe, sa cargaison est entièrement perdue et huit des vingt-sept hommes de l’équipage se sont noyés. Le ton de l’article peut laisser croire qu’on pleure davantage les marchandises que les marins !
Toutefois, l’honorable rédacteur rochelais s’épanche bien davantage sur un tout autre sujet qui, visiblement, fait saigner son petit cœur d’économiste. Figurez-vous que quelques gentilshommes, propriétaires terriens de la province, ont voulu adopter l’usage de la charrue « pour diminuer les dépenses de la main-d’œuvre dans la culture des vignes ». Question rendement, l’affaire est un succès.
Mais, au XVIIIe siècle comme au XXIe, les tenants du libéralisme vous diront toujours que la fiscalité est l’ennemi numéro un de l’entrepreneuriat. Que croyez-vous qu’il advint aux vignerons qui voulurent suivre cette méthode ? « Aussitôt, les collecteurs de leurs paroisses, pour la plupart vignerons comme eux, mais moins intelligents ou plus entêtés, et intéressés à leur ravir le fruit de l’épargne, les ont menacés d’une augmentation de la taille5. »
Pas fous, les taillables sortent les calepins qui leur tiennent lieu de calculettes. L’opération est vite faite : le montant de l’impôt auquel ils s’exposent est supérieur au coût de la main-d’œuvre paysanne. Leur intérêt financier leur impose donc d’abandonner la charrue et de revenir aux bonnes vieilles méthodes de culture à la main.
Le correspondant de la Gazette du commerce s’en étrangle : « Pourquoi ne dénonce-t-on pas au Gouvernement, si jaloux de favoriser les progrès de l’Agriculture, un abus tyrannique qui s’oppose invinciblement à son amélioration ? Ces exacteurs seraient certainement punis comme des ravisseurs iniques et des ennemis publics, dignes d’un châtiment d’autant plus rigoureux qu’en violant les ordres du Gouvernement, ils voudraient le séduire par l’apparence d’un accroissement de richesse, tandis qu’ils en étoufferaient le germe. »
La fable de la poule aux œufs d’or, qu’on tue à force de vouloir en tirer davantage, a été bien mieux assimilée par la suite. Aujourd’hui, aucun gouvernement libéral n’imaginerait sérieusement de taxer les profits des machines-outils et de ne plus financer des plans sociaux. Faut-il s’en réjouir ?
5 Sous l’Ancien Régime, impôt direct dont les bourgeois des grandes villes, le clergé et la noblesse sont affranchis.
Une leçon de géographie républicaine
1798, Charente-Inférieure
Enseigner n’est jamais anodin. Bâtir un programme scolaire n’est jamais neutre. Quand la Révolution française abolit la royauté au profit de la République et remplace le découpage du territoire de provinces en départements, il est important d’ancrer ces notions chez les citoyens dès leur plus jeune âge.
En 1798, J.-M. Mahias, présenté comme « homme de lettres », rédige une Géographie moderne de la France, par le cours des fleuves et des rivières ou Méthode facile pour en apprendre en peu de temps la nouvelle division qui nous dit la vision qu’il faut avoir de la Charente-Inférieure à cette époque. L’auteur promeut une science encore trop peu en vogue à son goût : « L’étude de la géographie est d’une nécessité absolue, puisque sans les Lumières qu’elle répand sur l’histoire, il est impossible de mettre chaque État à sa place, d’en fixer les limites, d’en connaître les ressources, ce qui jette une confusion étrange dans le récit et dans la lecture des événements, parce que ne pouvant les suivre exactement sur les lieux où ils se sont passés, il est impossible d’en saisir le fil et d’en apercevoir l’ensemble. »
Le chapitre consacré à la Charente-Inférieure débute par l’énumération des départements limitrophes, immédiatement suivie des ressources locales : « On y récolte beaucoup de bled6, du vin, du chanvre, de la graine de lin et de moutarde, du tabac. Il y a beaucoup de pâturages et des marais salants : on y élève quantité de bêtes à cornes ; il y a des eaux minérales. » On remarque, d’une part, que tournesol, maïs et colza n’étaient pas encore à l’ordre du jour et, d’autre part, que de futures ressources thermales7 étaient déjà connues.
Puis l’auteur reprend une description physique, celle des cours d’eau : « La Charente partage ce département en deux parties à peu près égales. La Saudre8 et la Seygne9 en arrosent la partie méridionale. Elles y ont toutes deux leur source. La première se perd dans l’Océan, au nord de l’embouchure de la Gironde ; l’autre dans la Charente au-dessus de Saintes. »
Suivent quelques mots sur les trois villes principales. La Rochelle : « La plupart des vaisseaux qui font le commerce d’Amérique abordent d’ordinaire dans ce port, qui est commode et sûr. Il y a des raffineries de sucre, des manufactures de faïence et une verrerie nationale. » Remarquons comment le terme commerce d’Amérique élude très pudiquement ce qu’il faut clairement appeler la traite négrière.
Rochefort : « Il s’y trouve un magnifique arsenal, un superbe hôpital, de très belles casernes, une belle corderie, une fonderie de canons et un magasin fourni de tout ce qui est nécessaire pour les vaisseaux de ligne. » Saintes, pourtant chef-lieu : « Les rues sont étroites et mal disposées. Elle fut, sous les Romains, ornée de monuments magnifiques dont il ne reste plus que des ruines. »
Tonnay-Charente, Saint-Jean-d’Angély, Taillebourg, Tonnay-Boutonne, Marennes, Royan, Brouage et Soubise sont tout juste citées comme « communes peu considérables », au même titre que Talmont, Pons et Jonzac.
L’auteur leur préfère assurément les îles. L’île de Rhé : « Elle est très fertile en vin ; mais il n’y croît ni bled ni foin. On y fait beaucoup d’eau-de-vie. » L’île d’Aix : « Très petite. C’est là qu’on arme les vaisseaux de ligne qui sortent du port de Rochefort et que l’on désarme ceux qui doivent remonter la Charente. » L’île d’Oleron : « Elle est très bien cultivée, et fertile en bled et en vin. »
Enfin, pour ceux qui entendraient leurs parents évoquer des provinces désormais disparues, l’auteur rappelle brièvement que la Charente-Inférieure est formée d’une partie de la Haute et Basse Saintonge, de la Généralité de La Rochelle et du pays d’Aunis.
6 blé
7 Les eaux thermales de Saujon, Rochefort et Jonzac sont découvertes respectivement en 1860, 1866 et 1979.
8 Seudre
9 Seugne
Un aérolithe dans le ciel jonzacais
13 juin 1819, entre Jonzac et Archiac
Le ciel est clair au-dessus de la Saintonge, ce 13 juin 1819. Il n’est que 5 h 45 mais déjà les rayons du soleil réchauffent rapidement l’atmosphère. Dans huit jours, ce sera l’été, alors tout va bien.
Des agriculteurs sont déjà aux champs, des marchands sur les routes, des commerçants à leurs étals. Soudain, tout ce petit monde sursaute en entendant plusieurs détonations terrifiantes ! À Mauzé-sur-le-Mignon comme à Angoulême, on se dit que le dépôt de poudre de Saint-Jean-d’Angély vient encore de sauter. Le bruit retentit de Blaye jusqu’aux environs de Niort, en passant par Marennes. Un sacré boucan !
Un claquement sec est suivi d’un long grondement puis de deux violentes détonations. Un laboureur compare les craquements successifs au bruit que feraient plusieurs sacs de noix qu’on jetterait les uns sur les autres.
En Haute Saintonge, ce n’est pas tout. Le son s’accompagne de la vision d’une boule de feu qui traverse le ciel à toute vitesse avant de disparaître en fumée dans une ultime explosion. Un paysan compare cette forme lumineuse à deux draps blancs mis bout à bout.
Le pire survient entre Jonzac et Archiac : une grêle de pierres s’abat en sifflant sur sept communes10. Certaines tombent tout près d’un groupe d’ouvriers et brisent des branches d’un arbre voisin. Par chance, personne ne semble blessé.
Le jour même et le lendemain, on découvre dans les champs et les vignes de nombreuses de ces « pierres tombées du ciel », que les plus instruits nomment aérolithes. L’une a fait un trou dans la terre et brûlé l’herbe autour. La plus grosse qui ait été retrouvée pèse 6 livres11.
Dans les familles saintongeaises, on se transmet ces pierres et le souvenir de leur chute. Chez les Mathieu, la journaliste Nicole Bertin a recueilli en 2014 le témoignage suivant : « On se raconte les faits de génération en génération. Ils pensaient que c’était la fin du monde. Ils ont entendu des bruits très violents qui ressemblaient à plusieurs batteries de canons. Ils ignoraient de quoi il s’agissait. Par la suite, ils ont constaté que des pierres étaient tombées autour de chez eux. Ils en ont ramassé. Mon père les appelait les pierres de lune et disait : “C’est précieux, elles viennent des fins fonds de l’univers.” Ceci dit, il s’en servait pour caler ses barriques ! »
Le préfet, le baron de Lachadenède, ordonne au savant rochelais Fleuriau de Bellevue de se rendre sur le terrain et de lui rédiger une notice. C’est de ses rencontres avec les témoins directs et des échantillons recueillis qu’on sait aujourd’hui retracer l’événement.
Deux de ces pierres sont remises au baron de Lachadenède. L’une d’elles, dont le préfet fait présent au cabinet d’histoire naturelle de La Rochelle, provient de Saint-Martial-de-Vitaterne. Elle pèse 4 livres et présente à peu près la forme d’un cône surbaissé. Elle est actuellement exposée dans les collections géologiques du Muséum d’histoire naturelle de La Rochelle. On sait aujourd’hui qu’il s’agit d’une eucrite relativement rare, composée des mêmes matériaux que certains astéroïdes qui circulent entre Mars et Jupiter.
Mais, un demi-siècle après ce phénomène observé près de Jonzac, les météorites continuaient d’intriguer les scientifiques qui émettaient toutes sortes d’hypothèses.
Selon certains, elles auraient été projetées en l’air lors d’éruptions volcaniques, grâce à la légèreté de l’hydrogène et la dissolution des métaux, avant de s’enflammer à la faveur d’un orage qui les ferait retomber sur terre.
Le célèbre mathématicien, astronome et physicien Pierre-Simon de Laplace, qui avait pourtant compris l’origine nébuleuse du Système solaire, pensait que les météorites étaient lancées de la Lune par quelques-uns de ses volcans. Il avait même calculé précisément la force de projection qui serait nécessaire pour qu’un corps, sorti de notre satellite, pût arriver au point où l’attraction terrestre l’entraînerait sur notre globe. Comme quoi, quand on se fourre le doigt dans l’œil, on peut toujours l’enfoncer plus profond.
Lagrange, Chladny et Gay-Lussac imaginent — mais sans pouvoir la démontrer — la véritable origine des aérolithes : « Des fragments de planète qui circulent dans l’espace jusqu’à ce qu’ils se trouvent engagés dans notre sphère ; là, le frottement qu’ils éprouvent par leur contact avec l’air atmosphérique les échauffe à un tel point qu’ils s’enflamment et se brisent en éclats. »
10 Allas-Champagne, Archiac, Brie-sous-Archiac, Moings (désormais Réaux-sur-Trèfle), Saint-Ciers-Champagne, Saint-Eugène et Saint-Martial-de-Vitaterne.
11 Soit 12 kg.
La comtesse n’est pas prêteuse
1828 à 1877, Benon
Les conflits d’usage en forêt — à l’instar des débats sur les chasses privées qui se pratiquent toujours au XXIe siècle — ne sont pas une affaire nouvelle. Une polémique particulièrement longue débuta à ce sujet il y a près de deux cents ans, époque où les changements induits par la Révolution française n’étaient pas encore digérés par tout le monde.
En 1828, la forêt de Benon est la propriété de Zoé Talon, dernière favorite de Louis XVIII et ci-devant comtesse du Cayla. Oui, il reste bien une noblesse car la République a été transformée en Empire par un caprice du petit Napoléon, dont la défaite a conduit le pays à la restauration de la monarchie, comme un retour à la case départ. Bravo, bien joué !...
Il faut néanmoins nuancer ce raccourci historique car si les nobles se croient revenus aux usages du XVIIIe siècle, le petit peuple a vite pris goût à certains droits nouveaux qui demeurent en vigueur. C’est sur ce terreau que notre histoire débute.
Donc, la comtesse est propriétaire de plus de 2 000 hectares de la forêt dont la coupe des bois lui rapporte chaque année de substantiels revenus. Mais, comme la fourmi de la fable, madame n’est pas prêteuse. Pour faire régner sa loi dans ses bois, elle peut compter sur le dévouement de ses gardes forestiers, aux ordres d’un régisseur particulièrement zélé et opportunément nommé Le Roy. Disons-le tout net : ce bonhomme est unanimement détesté.
En juin 1828, des habitants de Cramchaban et de Benon retrouvent blessés pas moins de quatre-vingts animaux qu’ils avaient menés à paître en forêt. Les bêtes ont été piquées profondément au-dessus du sabot par un instrument aigu, probablement empoisonné car les blessures s’infectent et deux juments en crèvent.
Des plaintes sont déposées dans les gendarmeries de Courçon et de Nuaillé. Les soupçons se portent sur un domestique de la comtesse, Nicolas Ost, que des témoins ont croisé en forêt sous différents déguisements et armé d’une fourche, ainsi que sur le régisseur Jean-Louis-François Le Roy. Tous deux comparaissent devant le tribunal correctionnel de La Rochelle qui consacre pas moins de vingt et une audiences à cette affaire, entre la mi-novembre 1828 et la mi-janvier 1829.
Habilement, Le Roy se place sur le terrain de la légalité. S’il est en bisbille avec des propriétaires d’animaux, c’est uniquement pour faire respecter scrupuleusement le droit forestier, dit-il en substance. Le pacage est toléré en forêt sous certaines conditions, mais les riverains useraient et abuseraient sans limites de cette faculté. Il jure ses grands dieux s’en tenir aux moyens légaux et ajoute qu’une des juments de son haras figure parmi les bêtes retrouvées mortes. L’enquête a pourtant constaté que l’animal ne portait aucune blessure ; les juges supposent qu’elle était malade et que son cadavre a été transporté dans les bois afin de disculper Le Roy. Petit filou !
Toutefois, le tribunal note également que les blessures n’ont été infligées qu’aux animaux de quelques propriétaires originaires de certaines communes bien précises, mais jamais au hasard. « Ce délit, qui suppose une parfaite connaissance des localités, ne peut être l’œuvre de Ost ou de Le Roy, récemment établis dans le pays » motivent les juges. Faute de preuve, d’aveu ou de témoignage fiable, la justice conclut « qu’il existe donc des coupables qui ne sont ni Ost ni Le Roy ».
Le mystère demeure entier. Le conflit aussi. Les députés Pierre-François Audry de Puyravault et Moyse-André Gallot déposent à la Chambre huit pétitions émanant de Benon, Courçon, Saint-Georges-du-Bois, Amilly, La Laigne, Blameré12, Le Gué-d’Alleré et Cramchaban. Les habitants y évoquent un acte de 1303, consenti par Philippe le Bel, qui leur accorde un droit de pacage, de fourrage et d’usage de la forêt, tandis que la comtesse du Cayla s’appuie sur l’article 119 du Code forestier qui retire certains usages publics d’une propriété privée. Ils en appellent au ministre de la Justice pour clarifier le droit et trancher ce différend en abrogeant ce fameux article 119.
Sans attendre les résultats de cette démarche, la noble propriétaire juge bon pour sa forêt de détruire certains des chemins qui y menaient et qu’empruntaient les propriétaires d’animaux. Le message est on ne peut plus clair.
En mars 1831, devant la Chambre des députés, la pétition est entendue mais elle n’aboutit pas à une modification de la loi. C’est le statu quo.