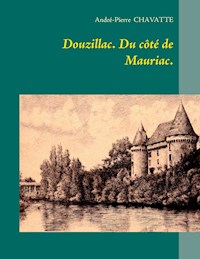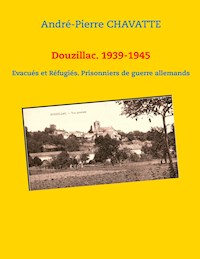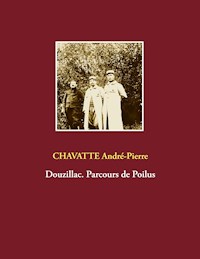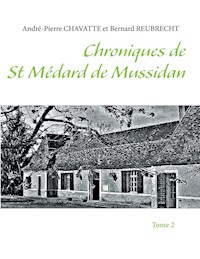
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Monographie de la commune de Saint-Médard-de-Mussidan, village de Dordogne sur les bords de la rivière Isle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières.
Personnages connus ou inconnus nés ou ayant vécu à Saint-Médard-de-Mussidan.
Timoléon de Cossé-Brissac ou l'énigme de la chapelle du château de Longua
.
Mais qui était Timoléon de Cossé, Comte de Brissac?
Les obsèques du Comte de Cossé-Brissac à Paris.
La fin du couvent des Célestins.
La famille Bacharetie de Beaupuy.
Nicolas Bacharetie de Beaupuy.
Pierre Armand Bacharetie de Beaupuy.
Louis Gabriel Bacharetie de Beaupuy.
Michel Arnaud Bacharetie de Beaupuy.
Jean (dit Guy) Bacharetie de Beaupuy.
Les bataillons des volontaires de la Dordogne.
La famille Desmoulins de Leybardie.
Louis Desmoulins de Leybardie.
Jean Louis Desmoulins de Leybardie.
Vincent Desmoulins de Leybardie.
Jean Baptiste Ignace Desmoulins de Leybardie.
Jean Baptiste Desmoulins de Leybardie.
Guillaume Desmoulins de Leybardie.
Henry Desmoulins de Leybardie.
Jaque Desmoulins de Leybardie.
Louis Amédée Desmoulins de Leybardie.
Jean Baptiste Jules Desmoulins de Leybardie.
Louis Gustave Binger.
Le Général Henri Eugène Calvel.
Les voyages de Jean Lachaud.
Un autre Jean Lachaud.
Antoine Saint-Blancard.
Roger Robert. Tué par la Royal Air Force. Méprise ou pas?
Les bagnards.
Pierre Chapelet.
Jean Eymery.
Jean Eugène Villechanoux.
Lieux remarquables de Saint-Médard-de-Mussidan.
Le château de Longua.
Le domaine de Maraval.
Le domaine et le château de Bassy.
Moulins et meuniers.
Les moulins.
Les meuniers.
Les propriétaires de moulins.
Documents divers.
Un désespéré: Pierre Chaumeil.
Un arrêté municipal qui ferait couler beaucoup d'encre aujourd'hui.
Un loup tué à Bellevue.
Une jeune fille de Saint-Médard prostituée à Périgueux.
Le maire chargé de la surveillance des forçats.
Aux Jaunies, des contrebandiers ... d'allumettes.
Avril 1961. Le Général De Gaulle en visite en Dordogne.
Deux squelettes à la mairie de Mussidan.
Des légendes? Qui sait?
La "Miraoudio".
La fontaine de la vieille.
Bibliographie.
Remerciements.
Personnages connus ou inconnus nés ou ayant vécu à Saint-Médard.
Timoléon de Cossé-Brissac ou l’énigme de la chapelle du château de Longua.
Au Musée des Arts et Traditions Populaires de Mussidan, on trouve un échange de lettres, datant de 1926, entre le Dr Voulgre et un Médecin français, le Dr Cottard, installé à Lisbonne au Portugal ; celui-ci, devant rédiger un discours sur les Brissac, rencontre des difficultés pour la construction de son projet :
Lettre du 4/10/1926 1
Mon cher confrère,
La page d’histoire que j’ai commencée d’écrire comme discours sur les Brissac n’est pas sans présenter quelques difficultés qui ne sont pas conséquemment sans me causer quelque embarras. En voici une que seul, il me semble, vous pouvez m’aider à répondre.Dans les notes que vous m’avez si aimablement remises, je lis :
"Le comte de Brissac fût enterré dans la chapelle de Longua, à un kilomètre de Mussidan où son tombeau se trouve encore."
Puis suit l’épitaphe qui a fait l’objet de nos échanges de lettres, et que naturellement je reproduis dans mon travail.
D’un autre côté, un auteur qui était bien placé pour être renseigné, écrit ceci après avoir décrit les circonstances de la mort de Brissac :
"Le corps du comte de Brissac, apporté à Paris, fut enterré dans la Chapelle d’Orléans de l’église des Célestins où son épitaphe se voit encore."
Cette citation est extraite des illustrations de la Noblesse Européenne, par l’abbé d’Ormancey, vicomte de Frejacques, fondateur, Paris, MDCCCXLII.
Je fais de nombreux emprunts à ce travail fort intéressant et fort bien fait il me semble, en ce qui concerne la famille de Brissac.
Mais, voilà la difficulté : où dort l’illustre macchabée ? (Quel joli sujet entre nous, que cette incertitude sur le lieu de son dernier repos). Car, il ne peut être à la fois à Paris, et au château de Longua.
Vous qui connaissez ce pays qui est le vôtre, pouvez affirmer votre certitude au point de vue documentaire, car il est plus que probable qu’on n’a pas dû transporter le corps de Brissac à Paris. On n’a guère, si mes souvenirs sont exacts, transporté ainsi pour inhumer à Saint Denis, que le corps de Duguesclin.
Mais alors où pareille erreur a-t-elle pu prendre naissance ?
Voulez-vous être assez aimable, une fois encore, pour m’aider à résoudre ce délicat problème. Suivant ce que vous me direz, j’écrirai, si besoin est, à Paris.
Pardonnez-moi le petit dérangement et le petit travail supplémentaire que cela va vous occasionner, et voulez bien recevoir, avec tous mes remerciements déjà, tous mes sentiments reconnaissants et distingués.
Signé : Cottard
Nous voyons bien à la lecture de ce courrier, que le Dr Cottard cherche où se trouve le corps de Timoléon de Cossé-Brissac mort pendant le siège de Mussidan en 1569. Le Dr Voulgre n’ayant pas les éléments nécessaires pour répondre, sollicite le Marquis de Vignet de Vendeuil, héritier du château de Longua, où serait enterré le Comte de Brissac...
Le Marquis répond :
Mussidan (Dordogne) le 19 octobre 1926 2
Monsieur,
Je ne m’attendais pas, en effet, à ce qu’un Médecin Portugais s’intéressât à notre histoire locale, mais je suis heureux de constater, qu’à notre époque où le plaisir et la politique priment tout, il existe encore des gens s’occupant de choses sérieuses et de recherches intéressantes.
Voici les quelques renseignements que je possède au sujet du Comte de Brissac. J’ai toujours entendu dire, par mon beaupère Monsieur de Leybardie que le Comte de Cossé-Brissac, tué au siège de Mussidan par une balle dans l’œil, était inhumé dans le caveau de la Chapelle de Longua et que l’on voyait très bien le trou fait par la balle ( ?...). C’est du reste une tradition qu’on se transmet de père en fils. Notre oncle, le Cardinal de Cabrières, mort il y a 2 ans, et aussi les sœurs de mon beaupère, comme mon beau-père lui-même, prétendaient l’avoir vu très bien conservé. Les gens bien informés (on en trouve toujours) précisaient même qu’il y avait sur le cercueil une vitre à l’emplacement de la figure, aussi, il y a 20 jours, lorsque malheureusement j’ai été obligé d’inhumer à son tour mon beau-père dans le caveau de la Chapelle de Longua, j’ai tenu, comme vous le pensez bien, à examiner attentivement le cercueil en question.
J’ai pu alors constater une fois de plus le peu de créance qu’il faut attacher aux "on dit" et combien l’exactitude et la rigueur scientifique étaient rares.
Monsieur de Leybardie, pas plus que les autres personnes, n’était descendu dans le caveau, il ne faisait que répéter ce qu’il avait entendu dire lui-même.
Les choses se passent ainsi, on passe la tête dans l’ouverture du caveau et, à cause de la distance, de l’obscurité et de la crainte qu’éprouvent bien des gens, on ne voit rien du tout, mais une fois que tout est rebouché, avec un ensemble parfait, tout le monde dit avoir très bien vu.
A peine le caveau ouvert, le maçon et moi y avons pénétré. Voici ce que nous y avons constaté :
Sous une voute basse et, sur le sol même, se trouvaient 5 rangées de cercueils (croquis ci-après) :
les 3 de gauche, de date relativement récente, en bon état. Le 4e renfermant les restes de la sœur de mon beau-père, morte à l’âge de 4 ans et, inhumée il y a environ 80 ans, était complètement désagrégé ainsi que les ossements, du reste.
Enfin, contre le mur, à droite, se trouvaient 2 cercueils, l’un sur l’autre. Celui de dessus, en bois, complètement en poussière : les ossements qu’il renfermait étaient en partie tombés dans celui de dessous qui était ouvert. Ce dernier en plomb avait la forme et les dimensions suivantes :
Dans ces deux cercueils se trouvaient un ramassis d’os désagrégés et tombant en poussière. Ils avaient déjà dû être manipulés plusieurs fois, car ils se trouvaient pêle-mêle et n’occupaient plus leur place naturelle dans le squelette. Etant donné leur nombre considérable il est certain que ces cercueils renfermaient plusieurs corps, surtout celui en plomb. Mais, l’état d’effritement de ces ossements ne m’a pas permis de pouvoir m’en rendre compte d’une façon précise. Il ne restait aucun crâne entier, mais des morceaux de crâne, aucune mâchoire entière, mais des bouts de mâchoires. Il eut fallu, pour se rendre compte d’une façon exacte du nombre de corps qu’ils contenaient, trier et cribler dans ces débris d’os, de bois et de poussière, compter les dents, tibias, etc. Mais, étant donné les circonstances, vous comprendrez facilement que je n’avais ni le loisir ni l’esprit à procéder à cet examen. De ces constatations, il s’agit d’en tirer des conclusions logiques.
Le cercueil en bois du dessus, n’en parlons pas ; il ne date certainement pas de 400 ans étant donné que celui de Mlle de Leybardie qui ne datait que de 80 ans était déjà réduit en poussière. En outre, il n’aurait pas résisté aux nombreuses manipulations qu’il eut dû subir, alors que, ainsi que nous allons le voir, celui en plomb, ne nous est parvenu qu’en fort mauvais état malgré son épaisseur.
Reste donc le cercueil en plomb.
Celui là ne fait pas de doute, il date de 1569. D’abord il est en plomb, or depuis bien longtemps, au moins un siècle, on emploie le zinc moins cher, plus facile à faire. Ensuite il est d’une épaisseur considérable : 3 mm ; actuellement on emploierait que des feuilles de plomb de 1 ou 2 mm d’épaisseur au maximum.
Il a une forme spéciale, une partie cylindrique pour le logement de la tête. Cette forme particulière, un sarcophage n’est pas une forme moderne. Et même anciennement on ne se serait pas amusé à employer cette forme difficile et coûteuse pour une personne quelconque. Ce cercueil renfermait donc un personnage illustre. Enfin, ce plomb est tellement oxydé qu’il s’effrite et se casse facilement en morceaux ; il n’est donc pas douteux qu’il date de plusieurs siècles.
Ce cercueil est éventré à coups de pic et de pioche, dessus, dessous et de côté. C’est donc qu’il renfermait les restes de quelqu’un de célèbre, on n’aurait pas touché à un cercueil contenant un inconnu.
La tradition qui se transmet de génération en génération veut que la Chapelle de Longua renferme les restes du Comte de Brissac et du Marquis de Pompadour, il n’est donc pas étonnant que par curiosité les fossoyeurs ou d’autres personnes aient voulu voir ces personnages célèbres.
Mais, une constatation me laisse perplexe : le couvercle du cercueil est complètement détaché sur tout le pourtour, il ne tient plus que par le côté A.B. (voir croquis). Il a été ouvert avec une cisaille, on voit très bien toutes les dents faites par les coups de cisaille.
Dans quel but a-t-on ouvert ce cercueil ? Certainement pas par curiosité, les ouvertures faites à coup de pic, sont suffisantes pour se rendre compte de ce qu’il renferme. Etait-ce pour voler des bijoux, ou son armure, car on prétend qu’il a été inhumé avec son armure. Des bijoux ? Il est peu probable qu’un guerrier tué dans une bataille en portât sur lui.
Son armure ? Un homme revêtu de son armure eut-il pu tenir dans un cercueil de si petite dimension ? Serait-ce que, pendant la Révolution, par haine, on aurait jeté au vent ses ossements ?
Ce cercueil, très ancien, renferme t-il les restes du Comte de Brissac ou du Marquis de Pompadour ?
La tradition veut qu’ils soient tous les 2 à Longua. Il faudrait donc que l’un des 2 ait été mis dans un cercueil en bois dont il ne reste plus rien. Ou bien que tous les 2 ayant été inhumés chacun dans un cercueil en plomb, l’un soit resté à Longua et l’autre ait été transporté à Paris plus tard.Le Comte de Brissac, le descendant3 de Timoléon de Brissac, est venu à Longua4 et a donné à Monsieur de Leybardie, avec lequel il était en relation, une gravure en lui disant : "Puisque mon aïeul est enterré ici, il est bien juste que vous ayez son portrait."
Cette gravure qui se trouve ici, dans le Grand Salon, représente un jeune homme, la barbe taillée en pointe. Il est revêtu de son armure. Sous la gravure, on lit :
"Thimoléon (écrit ici avec un h) de Cossé, Comte de Brissac, Chevalier des Ordres du Roi, Colonel Général de l’Infanterie Française, Grand Panetier et Grand Fauconnier de France, Gouverneur d’Anjou, Touraine et le Maine. Tué au siège de Mussidan, dans le Périgord, en 1569, à l’âge de 26 ans."
Donc, pour la famille de Cossé-Brissac cela ne fait pas de doute Timoléon de Cossé est bien inhumé à Longua. Je n’ai pas pu trouver le moindre indice pouvant lever l’incertitude, ni arme, ni décoration, ni bouton, ni la moindre pièce métallique. Tout a été volé s’il y avait quelque chose. Aucune inscription n’a pu être relevée, une couche d’oxyde de plusieurs millimètres couvrant le plomb. Longua ayant appartenu aux Lur-Saluce avant d’appartenir aux Leybardie, et les Lur-Saluce étant apparentés aux Clermont-Tonnerre et aux Brissac, si Timoléon de Brissac a été inhumé à Paris, ils doivent en avoir des traces dans leurs papiers de famille. Il serait donc intéressant de le leur demander.
Pour moi le doute subsiste entier. Rien ne prouve que le Marquis de Pompadour ait été enseveli dans un cercueil en plomb, donc le sarcophage peut fort bien être celui du Comte de Brissac conformément à la tradition. (Le sarcophage est un travail très soigné, et chose bizarre, cousu avec du fil de plomb, en dessous de la soudure, je m’en suis assuré avec mon couteau. Je me refuse à croire qu’on ait pris tant de soin pour ensevelir Pompadour bien moins célèbre que Brissac).
Celui qui est enterré à Paris peut fort bien être Charles 1er 5 mort en 1563.
Comme vous le voyez, Cher Monsieur, l’énigme demeure, peutêtre les Lur-Saluce pourront-ils fournir quelques précisions intéressantes.
Veuillez m’excuser de ne pas vous avoir répondu plus tôt, mais j’ai eu quantité de lettres à répondre, pour la mort de mon beaupère.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués.
Signé : Marquis de Vignet de Vendeuil
Nous comprenons l’embarras du Dr Cottard à la lecture de la missive. La question posée reste sans réponse, tant le Marquis semble convaincu de la tradition familiale.
Mais qui était Timoléon de Cossé, Comte de Brissac ?
Fils de Charles 1er de Cossé-Brissac 1505-1563, militaire et aristocrate français, Maréchal de France en 1550. Grand maître de l’artillerie de France, Gouverneur militaire de Paris, Grand panetier6 et Grand fauconnier de France.
"Si je n’étais Dauphin, je voudrais être Brissac" avait dit le fils de François 1er, futur Henri III, en 1542 à Charles 1er de Cossé le félicitant pour sa bravoure au siège de Perpignan. Lui que les dames de la cour surnommaient le "beau Brissac" et que l’historiographe Mezeray décrit comme "le Seigneur le plus aimable et le plus aimé de Diane de Poitiers." Il sera le premier Maréchal de France d’une lignée qui en comptera quatre.
Timoléon de Cossé-Brissac, né en 1543, sera le digne fils de son glorieux père. Il avait été, premièrement façonné aux bonnes mœurs en sa tendre jeunesse par sa mère, et aux bonnes lettres par le docte Bucchanan7.
Il fut élevé enfant d’honneur auprès de Charles IX qui, parvenu Roi, le fît en 1560, Gentilhomme Ordinaire de sa chambre, et lui donna en 1561, la charge de Colonel Général de l’Infanterie Française de là les monts.
Il fît ses premières armes en 1562 au siège de Rouen et rejoignit l’armée du Lyonnais, commandée par le Duc de Nemours, où il servit comme Colonel à la tête des bandes du Piémont. Charles IX créa Brissac Chevalier de son Ordre, Capitaine de cinquante hommes d’armes, lui donna la charge de Grand Fauconnier de France, et la charge de Premier Panetier, vacantes à la mort de son père.
Il combattit les Turcs qui faisaient le siège de Malte en mars 1565. Brissac décida les troupes chrétiennes à sortir de leurs retranchements et poussèrent jusque dans leurs vaisseaux les Turcs, qui abandonnèrent leur entreprise, après avoir perdu 30.000 hommes. Brissac revint en France.
Cette même année 1565, sans doute a t’il rejoint8 le roi Charles IX partit en 1564 avec sa mère, la reine Catherine de Médicis, faire visite à ses Provinces les plus reculées du Royaume. Sans battre le record absolu de 33 mois détenu par François 1er, ce fut tout de même un voyage de 27 mois. Commencé le 24 janvier 1564, il se termina le 1er mai 1566.
Il semblerait que le jeune Henri de Navarre, futur Henri IV ait aussi été du voyage.
"Le jeudi 9e jour dudict mois, disner et coucher à Laugat (Longua, s'écrit aussi avec ou sans le u) qui est un petit chasteau dans un bois9.
Longa appartenait à la famille de Lur, représentée à l’époque par Jeanne de Cardaillac, veuve de Bertrand II de Lur, chevalier et seigneur de Longa."
"Et le vendredi 10e jour dudict mois, le Roi alla en passant faire son entrée à Meusien (Mussidan) qui est une belle petite ville. Au sortir d’icelle passa la rivière de l’Isle, et alla diner et coucher à Ribera (Ribérac), qui est un beau et grand village et château sur Montaigne."
En 1567, la guerre recommença ; après la bataille de Saint-Denis, la bataille de Chalons, la bataille de Jarnac en 1569.
La route du Midi, que Condé avait voulu suivre en mars, passait à partir de Cognac par Barbezieux, Chalais, franchissait la Dronne à Aubeterre, traversait l’Isle à Mussidan, et la Dordogne à Bergerac. Dans cette dernière section de route, Aubeterre et Mussidan, étant aux mains des réformés, assuraient leurs communications avec le Midi ; en outre, la garnison de Mussidan, grossie par les fuyards de Jarnac, gênait beaucoup Périgueux par ses incursions. Le duc d’Anjou résolu, faute d’opérations plus sérieuses, de s’emparer de ces deux places. Il commença par Aubeterre, petite ville couronnant une éminence isolée sur la rive droite de la Dronne, à 22 kilomètres au sud de Montmoreau. Le duc chargea de la direction des sièges : d’Escars et La Vauguyon. Il leur donna six compagnies de gendarmerie et trois régiments d’infanterie, deux de Brissac et celui de Sarlabous. Aubeterre se rendit à composition dès qu’elle fut sommée, le 27 avril. Le duc d’Anjou écrivait de Montmoreau à son frère, le 26 avril, qu’après la prise d’Aubeterre, il ferait filer sur Mussidan le corps de siège avec l’artillerie10 :
"Je me suis délibéré, disait-il, d’attendre dans ce lieu la fin du siège pour tenir toujours plus de court nos ennemis, estant réduits dedans les villes qu’ils tiennent où és lieux prochains d’alentour, afin de leur faire tout ainsi consommer leurs vivres…, il n’y a plus d’avoine, on fait manger du blé aux chevaux…"
Le 29 avril, le duc d’Anjou rendait compte au Roi de la prise d’Aubeterre et du commencement du siège de Mussidan ; cette place était défendue par Beaudiné avec 400 hommes d’élite. Le duc d’Anjou annonçait qu’un premier assaut au corps de place avait été interrompu par une grande pluie, et rendait compte de la perte d’un officier de valeur, Monsieur le Vicomte Jean de Pompadour, tué à la tranchée par une arquebusade. Le duc d’Anjou se préoccupait beaucoup, à ce moment, des mouvements de la colonne d’Andelot, en Poitou.
Le siège commencé le 28 avril fut marqué, ce jour là, par la perte de Pompadour11 ; le lendemain, l’armée royale eut à regretter une perte bien plus sensible. Voulant aller reconnaitre le château de Mussidan et bien qu’il eut son casque, très bas et fut fort couvert, le comte de Brissac, d’après de Thou, fut tué d’un coup d’arquebuse qu’il reçut dans la tête, s’étant découvert le visage sans y penser. Les siens le regrettèrent beaucoup ; car, outre qu’il était fils d’un père illustre, il s’était déjà fait par sa vertu un chemin aux plus grands honneurs et aux plus dignités, bien qu’il n’eut qu’à peine 26 ans. Pierre de Bourdeille12 nous apprend le nom du soldat calviniste qui donna au comte Timoléon de Brissac le coup mortel :
"Un bon soldat périgordin le tua qu’on appelait Charbonnière, lequel avait été avec moi et de ma compagnie et était un des meilleurs et plus justes harquebuziers qu’on eut pu voir, et ne faisait autre chose séant, sinon qu’étant assis sur un petit tabouret, où la plus part du temps il disnoit et souppoit, regardant par une canonnière que tirer incessamment, et avoit deux harquebuz à rouet et une à mesche, et sa femme et un valet près de luy, qui ne luy servoient que de charger ses harquebuz et luy de tirer, si bien qu’il en perdoit le boire et le manger. Il fut pris ; Monsieur, frère du Roy, le voulut voir, et, pour avoir tué un si grand personnage, commanda qu’il fust pendu.
J’avois grand’envie de le sauver, (mais je ne peux, encor que je l’eusse faict esvader une fois par une fenestre, mais il fut repris) bien que j’eusse un très grand regret dudit comte, car je l’aymois bien, aussi m’aymoit-il."
Brantôme ajoute :
"Ainsi périrent, à la fleur de l’âge, ces deux jeunes officiers (Pompadour et Brissac