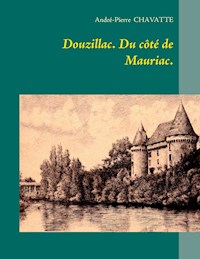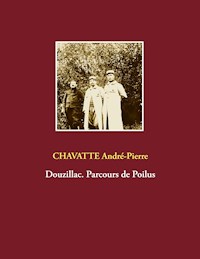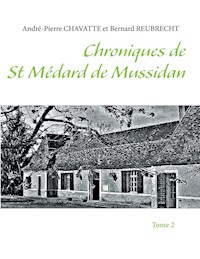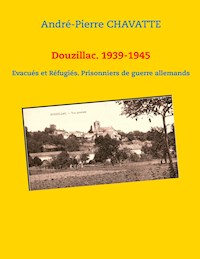
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Septembre 1939: un grand nombre d'Alsaciens-Lorrains sont déplacés en Dordogne. Douzillac doit en recevoir 360. Certains repartiront en 1940, d'autres resteront devenant ainsi des réfugiés. Arrivent ensuite des personnes fuyant les zones interdites ou occupées et même de l'étranger. Au total, 1038 personnes seront hébergées à Douzillac entre 1939 et 1945. La liste de ces réfugiés est reprise dans cet ouvrage avec les périodes et les lieux d'hébergement. En 1945, 14 prisonniers de guerre allemands venant principalement du dépôt de prisonniers de l'Axe n°125 de Brantôme vont être utilisés à des travaux de toute nature par des employeurs Douzillacois. Ils sont ici recensés ainsi que leurs adresses en Allemagne et le nom de leurs employeurs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Douzillac, terre d'accueil des évacués et réfugiés en 1939
Liste des évacués et réfugiés à Douzillac
Des prisonniers de guerre allemands à Douzillac en 1945
Remerciements
Douzillac, terre d’accueil des évacués et réfugiés en 1939
En 1939, avant la déclaration de guerre à l’Allemagne de Hitler, le gouvernement français évacue, à titre préventif, près d’un demi-million d’Alsaciens (surtout des Strasbourgeois) vers l’intérieur du pays et notamment en Dordogne.
Pourquoi la Dordogne?
Ce département est loin du front et offre, à priori, assez d'espace pour loger une population de plusieurs milliers de personnes. La Haute-Vienne et l'Indre recevront aussi beaucoup de réfugiés. De plus, Paul Valot, directeur des services d'Alsace-Lorraine à la Présidence du Conseil, originaire du Périgord, aurait influencé le choix de la Dordogne.
Le choix du département a été mûrement réfléchi et ce, depuis 1938. La destination des Alsaciens relevait alors du secretdéfense.
La guerre est déclarée le 3 septembre 1939 et quelques jours plus tard, Périgueux, dont la population a brusquement doublée, devient officiellement la préfecture du Bas-Rhin.
Lors de la réunion du Conseil Municipal de Douzillac, le 5 septembre 1939, Monsieur Joseph Pierre Dessagne, Maire, annonce l’arrivée dans la commune de 360 évacués du Bas-Rhin. Un comité d’accueil est constitué composé de Mr Joseph Pierre Dessagne, Maire, Président ; Mr Emile Duponteil, Adjoint au Maire, Vice-Président ; Mrs Georges Tronche, Georges Veyssière et Jean Faure, membres. Les membres du Comité seront chargés de loger et de recevoir les évacués du Bas-Rhin devant arriver dans la commune.
Délibération du Conseil Municipal de Douzillac en date du 5 septembre 1939.
Les premiers évacués du Bas-Rhin arrivent à Douzillac le 8 septembre 1939. Ils seront suivis de beaucoup d’autres arrivant non seulement d’Alsace mais aussi de Moselle ,surtout de Glatigny(82 personnes) et de Maizeroy (41 personnes), de la zone interdite, de la zone occupée voire de pays étrangers notamment de Belgique, d'Allemagne, de Pologne, de Roumanie, de Tchécoslovaquie, de Suisse, du Luxembourg et même de Russie. (voir cartes des différentes zones ci-après). Au total, 1038 réfugiés de toutes origines géographiques passeront à Douzillac entre 1939 et 1945, certains pour quelques jours, d’autres plusieurs mois voire plusieurs années.
Les différentes zones.
A Périgueux, chaque jour les cars et les trains déversent des centaines de réfugiés qui sont ensuite répartis dans le département.
Périgueux voit ainsi arriver plus de 11000 Strasbourgeois avec bagages qui remplissent la ville d'une manière soudaine.
L'administration de ces évacués est confiée à Marcel-Edmond Naegelen, adjoint au Maire de Strasbourg. Le Maire, Charles Frey, resté dans sa ville, se déplacera plusieurs fois à Périgueux où sont logés les services centraux.
35 mairies annexes de Strasbourg sont installées en Dordogne et dans l'Indre afin de maintenir le lien avec la population alsacienne, notamment pour l'aide d'urgence aux évacués.
Arrivée d'un wagon d'évacués Alsaciens.
L'hôpital civil de Strasbourg est transféré à Salagnac (Clairvivre). Y exerceront des professeurs, des chefs de cliniques, des internes, des externes ... venus de Strasbourg. En septembre 1940, après la "drôle de guerre", lorsque l'hôpital regagne la capitale alsacienne, certains médecins, refusant la domination allemande comme le professeur Fontaine resteront à Clairvivre.
Charles Altorffer, dans son journal, note que « les évacués qui n’ont pu emporter beaucoup de choses, manquaient de beaucoup d’articles » et que « les commerçants de Périgueux n’avaient jamais fait un pareil chiffre d’affaires :les quincaillers, les marchands de vêtements ou de chaussures, de meubles légers voyaient se vider leurs stocks…. Les patissiers, cafetiers, pharmaciens étaient pris d’assaut car, surtout au début les évacués avaient beaucoup d’argent liquide, recevaient des allocations et voyageaient gratuitement. » Ce « gaspillage » sera critiqué par nombre de Périgordins assez économes par nature.
Les évacués, habitués pour beaucoup à un certain confort arrivent dans un des départements les plus pauvres.
Ils se plaindront de leurs conditions d’hébergement : parfois, ils seront logés à 8 ou 10 dans des logements trop petits, des maisons inoccupées , parfois des granges et, au début les moyens mis à leur disposition seront assez rudimentaires, dormant parfois sur des paillasses faites de « panouilles ». Les Périgordins en général et les Douzillacois en particulier ne peuvent offrir que ce qu’ils ont et ils l’offrent en général de grand cœur.
La banque de Strasbourg à Périgueux.
Mais la solidarité existe, non seulement entre évacués mais aussi entre les Douzillacois et évacués. La vie s’organise. En échange de quelque nourriture (pain, œufs, lait, volaille, légumes…), les arrivants aident aux travaux des champs… Certains d’entre eux trouveront même du travail sur place notamment à l’Usine Bata.
Des « jardins ouverts » ou « jardins ouvriers » sont mis à la disposition de ceux qui désirent cultiver quelques légumes.Des bons de pantoufles sont attribués par la mairie (un cahier conservé en mairie reprend ainsi toutes les pointures des réfugiés).
Bien sûr, l’arrivée massive dans la commune de tous ces réfugiés crée parfois des conflits avec les locaux. Les Alsaciens ont coutume de parler la langue alsacienne entre eux, les rapports entre les quelques Belges et les Alsaciens sont aussi parfois tendus.
Le Préfet de la Dordogne, Marcel Jacquier fait placarder un appel à la population afin que « les Alsaciens ne soient en rien suspectés ou maltraités… , ne soient pas traités de Boches » et l’avis mentionne « qu’il serait absurde de croire que le fait de parler l’Alsacien implique que l’on a des sentiments allemands ».
Aux Alsaciens, il demande « de parler autant que possible le français ».Il invite aussi les ressortissants Belges « de s’abstenir de faire des réflexions désobligeantes à l’égard des Alsaciens ».
Cet appel à la population est rédigé en français et en allemand (voir fac-similé).
L'affiche signée du Préfet de la Dordogne
Après la débâcle de l'armée française, l'armistice est signé le 22 juin 1940 à Rethondes (Hitler a exigé que cet armistice soit signé au même endroit qu'avait été signé celui de 1918).
L'article 2 de la convention d'armistice définit les zones d'occupation:
"En vue de sauvegarder les intérêts du Reich allemand, le territoire français situé au nord et à l'ouest de la ligne tracée sur la carte ci-annexée, sera occupé par les troupes allemandes. Dans la mesure où les régions du territoire occupé ne se trouvent pas encore au pouvoir des troupes allemandes, leur occupation sera effectuée immédiatement après la conclusion de la présente convention".
Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui avaient été rattachés à la France en 1918 sont annexés au Reich. Pour l'occupant, les Alsaciens-Lorrains sont des Allemands (Volksdeutsche Elsass-Lothringen). A ce titre, ils n'ont pas à rester en Dordogne: le retour de ces "Allemands de race" est exigé. En même temps, le régime nazi expulse du territoire alsacien-mosellan tous ceux qui sont indésirables à ses yeux: Juifs, francophiles, Français, ménages mixtes (Français de "l'intérieur"-Alsacien), non-Allemands ...
L'article 16 de la convention d'armistice stipule:
"Le gouvernement français procèdera au rapatriement de la population dans les territoires occupés, d'accord avec les services allemands compétents".
Une procédure est mise en place: les évacués se déclarent à la mairie de leur lieu de résidence et reçoivent un certificat de rapatriement et un laissez-passer (Passierschein).
Des trains sont affêtés. L'opération concernant les Alsaciens-Lorrains débute le 5 août 1940. Une colonne militaire se présente à Périgueux et déménage les archives et les dossiers du personnel de la municipalité de Strasbourg.
De retour à Strasbourg, les évacués de septembre 1939 sont accueillis à la sortie du train par des manifestations organisées par le parti nazi avec fanfare, discours de bienvenue, banderoles, distribution de boissons...
Tous les Alsaciens-Lorrains ne rentreront pas. Certains ne le peuvent pas, beaucoup ne le veulent pas. Jusque là évacués, ils deviennent des réfugiés.
La Dordogne en général (et Douzillac en particulier) a été une véritable terre d’accueil pour des milliers d'évacués puis de réfugiés notamment Alsaciens et Lorrains. Peu d’entre eux sont restés dans la région, mais beaucoup y sont revenus après la guerre ayant noué ici de solides liens d’amitié avec les personnes qui les avaient hébérgés.
Liste des évacués et réfugiés à Douzillac.
Cette liste a été établie grâce aux documents conservés en Mairie de Douzillac.
Abréviations contenues dans le document
A.L: Alsace-Lorraine
Z.O: Zone occupée
Z.I: Zone interdite
E: Etranger(e)
X: épouse de ...
fs: fils de ....
fa: fille de ...