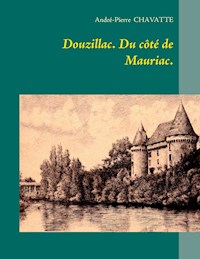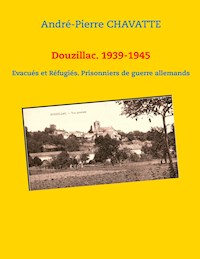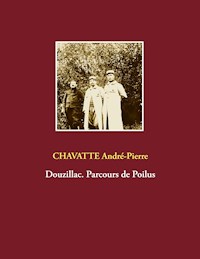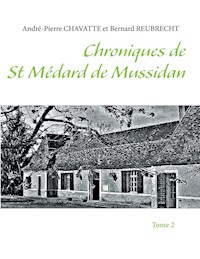Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Louis Maine. Ce nom est, pour beaucoup, inconnu. Et pourtant! Ce soldat s'est illustré dans la plupart des combats de la seconde moitié du 19ème siècle. Né à Mussidan, en Dordogne, il s'engage dans les zouaves pour deux ans. Libéré il se réengage pour combattre en Crimée où il sera fait Chevalier de la Légion d'Honneur. Il repart en Afrique puis rend ses galons de Sous-Officier pour s'engager dans la Légion Etrangère et participer à la guerre du Mexique. Caporal au combat de Camerone, le 30 avril 1863, il sera l'un des derniers survivants. Lieutenant à Bazeilles pendant la guerre contre la Prusse, fait prisonnier, il s'évadera pour rejoindre Rochefort. Promu pendant un temps Lieutenant-Colonel d'un Régiment de la Garde Mobile, il redeviendra Capitaine au 3ème Régiment d'Infanterie de Marine. Il recevra la Croix d'Officier de la Légion d'Honneur. Il finira ses jours dans le petit village de Douzillac, où il est désormais honoré chaque année, à l'occasion de la fête traditionnelle de la Légion: Camerone.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En 2009, le livre "Capitaine Philippe Louis Maine, Caporal à Camerone. Un militaire dans les conflits du 19ème siècle" est paru chez un autre éditeur (Edilivre).
Le présent ouvrage, "Louis Maine. Itinéraire d'un héros" reprend l'histoire de ce héros périgourdin trop méconnu.
L'ouvrage précédent a été augmenté de documents et agrémenté de photos.
Table des matières
Introduction
Acte de naissance de Philippe Maine
Généalogie de Philippe Louis Maine
Liste du tirage au sort des jeunes gens de la classe 1850, canton de Mussidan
Premier engagement
La guerre de Crimée
La Légion Etrangère
La Campagne du Mexique
Le Régiment Etranger au Mexique (1862-1867)
Camerone- 30 avril 1863
Guerre franco-allemande (1870-1871)
Les dernières années
Après la vie militaire
Acte de décès de Philippe Louis Maine
Journal de la Dordogne du dimanche 2 juillet 1893. Nécrologie. Le Capitaine Maine
La tombe de Philippe Maine au cimetière de Douzillac
Les cérémonies de 1965 à Douzillac et Mussidan
Le Musée de la Légion Etrangère en mairie de Douzilla La 33ème Promotion de l'Ecole Militaire Inter-Armes de Saint-Cyr- Coëtquidan. Promotion "Capitaine Maine"
Chant de la 33ème Preomotion de l'EMIA (1993-1995) dite "Capitaine Maine"
Liste des annexes
Annexe 1: Actes d'état-civil de la famille Maine
Annexe 2: Traité de Paris 30 mars 1856
Annexe 3: Les héros de Camerone- 30 avril 1863- 3ème
Compagnie du Régiment Etranger
Quelques notes biographiques
Annexe 4: Lettre du Contre-Amiral, Préfet Maritime de Rochefort au Ministre de la Marine et des Colonies
Annexe 5: 8ème Régiment de Garde Mobile Charente Inférieure. Etat de services de Mr le Lieutenant-Colonel Maine
Annexe 6: Lettre de Maine à Adolphe Thiers
Annexe 7: Lettre de Oscar Bardi de Fourtou, Ministre de l'Intérieur au Ministre de la Marine en faveur de Philippe Maine
Annexe 8: Note pour le Ministre de la Marine suite à la lettre de Oscar Bardi de Fourtou
Bibliographie
Remerciements
Introduction
Il semble que certains hommes soient prédestinés à devenir des héros.
Y a-t-il donc un gène du courage, de l’abnégation et du sacrifice ? Si ce gène existe, à coup sûr, Philippe Louis Maine en était porteur.
Philippe Louis Maine est né à Mussidan (Dordogne), le 4 septembre 1830. Il est fils de Joseph, maître bottier, âgé de 35 ans, et de Thérèse Félix. Le père est d’origine espagnole (son nom Meña a été francisé en Maine). Thérèse, elle, est bien française mais née à Madrid. (Son père y était-il caserné ?)
Le jeune enfant a reçu les prénoms de celui qui vient d’être nommé " Roi des Français " et qui, en 1831, créera la Légion Etrangère.
Son enfance semble n’avoir pas été différente de celle des enfants de son âge. Dans un article consacré à Maine, (" Un Mussidanais au Mexique "), M. Vergeade remarque qu’il " fut un écolier moyen, sans plus ", et que " les échos de la Révolution de 1848 qu’il entend alors qu’il travaille dans l’échoppe de son père en tant qu’apprenti bottier, ont enflammé l’imagination du jeune homme ".
Une autre explication de l’orientation de Maine vers la carrière militaire paraît plausible : on découvre, dans l’acte de mariage de ses parents que son grand-père maternel, Hilaire Félix était capitaine d’infanterie en retraite.
Bien que le jeune Maine ne l’ait pas connu (Hilaire Félix décède le 30 juin 1830), ses parents lui ont peut-être parlé des campagnes que son aïeul avait éventuellement faites ?1
Philippe Louis Maine deviendra donc soldat.
Philippe Louis Maine
1 Voir en annexe les photocopies d’actes d’état-civil de la famille Maine
Acte de Naissance de Philippe MAINE
Du 5 septembre 1830, 9 heures du matin, acte de naissance de Philippe Maine, enfant du sexe masculin, né le jour d’hier en la présente ville, à 8 heures du soir des mariés sieur Joseph Maine et de dame Thérèse Félix, domiciliés en cette commune.
Sur la déclaration à nous faite par ledit sieur Joseph Maine, maître bottier, âgé de 35 ans domicilié dudit Mussidan qui a présenté l’enfant.
Témoins : sieur Pierre Courcelle Labrousse, secrétaire de cette mairie âgé de 48 ans et Pierre Malard, armurier âgé de 61 ans domiciliés dans cette ville.
Constaté suivant la loi par nous, Maire de la commune de Mussidan, chef-lieu de canton, arrondissement de Ribérac, département de la Dordogne, officier de l’état-civil soussigné. Le comparant et les 2 témoins ont signé avec nous le présent acte de naissance après lecture
Généalogie de Philippe Louis Maine
Arbre généalogique réalisé par le CHGP.
Liste du tirage au sort des jeunes gens de la classe 1850, canton de Mussidan2
Numéro échu dans le tirage : 68
Nom, prénoms : Maine Philippe Louis
Profession : militaire
Commune : Mussidan
Numéro d’inscription sur le tableau de recensement rectifié : 10
« Absent, représenté par son beau-frère, " enrôlé volontaire dans les zouaves "
Né le 4 septembre 1830 à Mussidan, canton de Mussidan, département de la Dordogne, résidant à Alger, fils de feu Joseph et de Félix Thérèse, domiciliée à Mussidan.
Degré d’instruction : 1-2 (sait lire et écrire)
2 AD Dordogne 2R112
Premier engagement
Le 21 décembre 1850, Maine s’engage au 1er Régiment de Zouaves3 et rejoint Alger. Il y reste jusqu’au 6 mars 1852, date à laquelle il rejoint le 2ème Régiment de Zouaves basé à Oran4.
Depuis 1827, les troupes françaises sont présentes en Algérie. Une insulte faite au Consul de France par le Dey Hossein a été le prétexte choisi par la France pour justifier une intervention militaire en Algérie. Le 14 juin 1830, la flotte de l’amiral Duperré débarque à Sidi-Ferruch une armée de 30000 hommes.
L’occupation, tout d’abord limitée à quelques points du littoral, s’étend à tout le pays. La résistance des tribus s’organisera et durera des décennies.
Débarquement à Sidi-Ferruch
En 1852, une armée forte de 6000 hommes, commandée par les généraux Pélissier, Yussuf et Bouscaren, assiège la ville de Laghouat le 21 novembre. Le 4 décembre, la ville est prise d’assaut. L’extermination systématique de la population est ordonnée. Plus des 2/3 de la population périssent. Au 2ème Régiment de Zouaves, on compte 60 hommes hors de combat.
Maine a-t-il participé à l’expédition contre Laghouat ? Aucune mention n’y est faite dans le document reprenant ses états de service. Renvoyé par anticipation le 14 décembre, il est libéré " définitivement " le 21 décembre 1852.
Zouaves
3 Créé le 1er octobre 1830 par le général Clauzel, trois mois et demi après le débarquement de Sidi-Ferruch.
4 Le changement d’affectation de Maine est certainement dû à la réorganisation de l’Armée d’Afrique, sous l’autorité du maréchal Randon et sur instructions de Napoléon III. (Source : C. Menuge-Crépeaux, causerie " Maine ")
La guerre de Crimée
Le contexte politique :
Napoléon III ayant été proclamé Empereur des Français, a obtenu de l’Empire Ottoman le rôle de protecteur des lieux saints de Jérusalem. Ce fait est aussitôt contesté par la Russie qui adresse un ultimatum à Constantinople. Pour une fois, l’Angleterre, inquiète de la politique d’expansion de la Russie en Méditerranée, soutient la France. La Russie ayant envahi la Moldavie et la Valachie (22 juin 1853), l’Empire Ottoman lui déclare la guerre (4 octobre 1853).
L’armée turque, sous la conduite d’Omar Pasha, remporte une première victoire à Oltenitza, mais, le 20 novembre, la flotte turque est détruite à Sinope.
Le 3 janvier 1854, les flottes françaises et anglaises pénètrent dans la mer Noire pour protéger la Turquie. Le 12 mars, la France et l’Angleterre s’allient officiellement à la Turquie. Les Russes ripostent le 20 mars en attaquant la Bulgarie qui fait partie du territoire ottoman.
Le 28 mars 1854, la France et l’Angleterre déclarent la guerre à la Russie. Un corps expéditionnaire est envoyé en Crimée pour s’emparer de la base navale de Sébastopol.
Le Maréchal de Saint-Arnaud, un ancien de la Légion Etrangère, abandonne son poste de Ministre de la Guerre pour prendre le commandement de l’Armée d’Orient constituée à partir du 15 mars 1854.
Cette armée d’Orient sera constituée, à la fin de l’année 1854, de 8 divisions : 3 Régiments de Zouaves auxquels vient s’ajouter par la suite le Régiment de Zouaves de la Garde Impériale, le 1er puis le 2ème Régiment de la Légion Etrangère, le Régiment de Tirailleurs Algériens, les 4 Régiments de Chasseurs d’Afrique et des bataillons disciplinaires. Les unités de l’Armée d’Afrique (18000 hommes en 1855) seront toujours à la pointe du combat avec les Zouaves, les Légionnaires, les Tirailleurs et les Chasseurs.
Légionnaire en Crimée
Les légionnaires avaient été surnommés par les Russes les «Ventres de cuir» à cause de leur large cartouchière de ceinture
Premiers combats :
La bataille de l’Alma :
Le 14 septembre 1854, 120 bâtiments débarquent les unités alliées au Nord de Sébastopol. Les troupes marchent sur Sébastopol avec 27000 Anglais à gauche, 27000 Français au centre et 8000 Turcs à droite. Ils doivent tout d’abord franchir la rivière de l’Alma. La position est tenue par les 37000 hommes du Maréchal Menchikov. Le 20 septembre, les deux armées se font face. Alors que les Anglais subissent de lourdes pertes, les divisions françaises gagnent du terrain ; il y a là la division du Prince Napoléon à gauche, celle de Canrobert au centre et celle de Bosquet à droite. La division de Forey reste en réserve. Canrobert lance ses hommes en tirailleurs. Les Zouaves du 3ème Régiment s’emparent du plateau de l’Aklèse et ceux du 1er Régiment du pont de l’Alma. Après une contre-attaque de Menchikov, les Russes cèdent et se replient vers Sébastopol. 500 Français sont néanmoins hors de combat.
Le Général Elie Forey
Cette action restera dans les mémoires grâce au célèbre Pont de l’Alma à Paris avec la statue du Zouave qui sert d’étalon aux crues de la Seine.
Les Zouaves lors de la bataille de l’Alma (Division Bosquet)
Le siège de Sébastopol :
Le siège de Sébastopol va durer du 26 septembre 1854 au 11 septembre 1855.
Le 20 septembre 1854, une escadre Russe se saborde pour bloquer l’entrée de la rade de Sébastopol. Les unités alliées se déploient alors vers le sud. Les 3ème et 4ème divisions du Général Forey sont basées à gauche du ravin de Sarandinaki. A droite, jusqu’au plateau d’Inkerman, se trouvent les forces britanniques.
Les Russes sont solidement installés et décidés à résister malgré les forces imposantes des assiégeants (environ 100000 hommes).
Le 25 octobre, le Prince Menchikov tente une première fois de forcer le blocus des assaillants en engageant 25000 hommes appuyés par 78 pièces d’artillerie en direction de Balaklava. Leur avancée est stoppée, moyennant de lourdes pertes par les 900 hommes de la brigade de cavalerie lourde anglaise.
Le 5 novembre, nouvelle attaque contre le secteur britannique. Il faudra l’intervention de la division du Général Bosquet pour repousser les Russes qui perdent plus de 10000 hommes dans l’affaire contre 2400 aux Anglais et 880 aux Français. Une fois de plus, les Zouaves et les Tirailleurs font preuve de leur courage.
Deux autres sorties (22 février et 22 mars 1855) réussiront à repousser les lignes des assiégeants sans pour autant briser le siège.
Philippe Louis Maine se réengage le 25 avril 1854 au 4ème bataillon de chasseurs à pied. Peu de temps après, il part pour la Crimée. Comme ses compagnons, il sera confronté au redoutable hiver russe.
Chasseurs à pied
Promu caporal le 16 mars 1855, Maine participe, le 7 juin à la prise du Mamelon Vert, l’un des avant-postes de la Tour de Malakoff5 qui tombera aux mains des Français le 8 septembre. Il y sera blessé par 2 fois : le 7 juin il est atteint au dos par des éclats de pierres, le 8 septembre, devant Sébastopol, il subit des contusions à la face. (C’est lors de cette bataille de Sébastopol que le Maréchal Patrice Mac-Mahon prononcera la célèbre phrase : "J’y suis, j’y reste ! "). Maine est nommé sergent le 16 juin et sergent fourrier6 le 19 août 1855.
Le Maréchal Patrice Mac Mahon, futur Duc de Magenta
Lors de l’attaque du Mamelon Vert, Maine se comportera d’une façon si valeureuse que cela lui vaudra d’être décoré de la Légion d’Honneur le 16 avril 1856. A 25 ans, il est parmi les plus jeunes décorés de cette campagne.
Il sera aussi décoré de la médaille de Sa Majesté la Reine d’Angleterre pour la Crimée.7 (Napoléon III avait autorisé par décret du 26 avril 1856, les militaires français à porter cette médaille).
La Médaille de Crimée décernée par S.M la Reine d’Angleterre
La guerre de Crimée se termine par la signature du traité de Paris signé le 30 mars 1856.8 Le 2 avril, les 101 derniers coups de canon résonnent en Crimée, cette fois pour annoncer la paix.
95000 hommes ont perdu la vie dont 15000 au feu. Ce conflit laisse un goût amer aux combattants à cause de l’incompétence patente de certains généraux. " Le silence de Maine à son sujet laisse à penser qu’il partageait le sentiment général. "9
Cette guerre reste peu connue car peu étudiée dans les manuels d’histoire. On en tira quelques enseignements pour les conflits futurs: