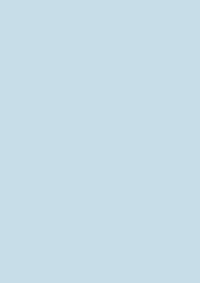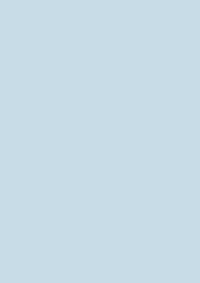Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Französisch
Vous vous demandez sans doute comment un agneau peut devenir loup. L'étude de mon cas personnel pourrait vous donner une piste de réflexion. Jusqu'à ma retraite, j'ai été un agneau, ouvert sur les autres, plein d'empathie, serviable. Tout ceci, malgré les piqûres de la vie, les trahisons de faux amis, les attaques injustifiées. J'avais cru que les blessures laissées par ces épreuves étaient guéries. Mais ce n'est pas le cas. Comme le staphylocoque doré, qui pénètre dans le corps et reste discret en attendant l'occasion de sortir, ces blessures sont restées tapies au fond de moi et se sont développées. Il a suffi de quelques piqûres pour qu'elles ressortent massivement, déclenchant la crise menant de l'agneau au loup.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les personnages et histoires contenus dans ce livre sont inventés, sauf l’épisode du début du chapitre 7, qui a vraiment eu lieu, mais dont l’héroïne restera anonyme. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ou des situations véritables ne sauraient être que fortuites.
Table des matières
Les chats retombent sur leurs pattes
Erreur ! Le signet n’est pas défini.
Un mois plus tôt : la commissaire Macinaggio.
Le courriel déclenchant
L’état-major se réunit
L’affreux Jojo passe à l’acte
Le commissariat entre en effervescence
Jojo change de braquet
Le commissariat contre-attaque
Une lueur dans l’obscurité
Retour de congés
Amour, toujours
Interrogations
Le retour de l’affreux
Jojo se distingue encore
Branle-bas au commissariat
La croisade de Jojo
L’hallali
La revue de presse
Comment l’agneau devint loup
Allegro ma non troppo
1 Les chats retombent sur leurs pattes
Son chat s’était suicidé ! Il fallait bien se rendre à l’évidence, Lolo le félin avait mis volontairement fin à sa vie. C’était donc bel et bien un suicide, ou comment appelleriez-vous un tel acte ?
Bien sûr, ce n’était pas la peine de chercher une lettre déposée sur la cheminée expliquant le pourquoi de la chose.
Pour le « comment », Jojo n’avait pas besoin de s’interroger : il en avait été le témoin privilégié. Il ouvrait sa fenêtre comme tous les matins et jetait un coup d’œil sur la terrasse du café, installée sur le square. Le second du patron, à 10 heures du matin, sifflait déjà son troisième pastis, bien tassé, et, enhardi par les effets de l’alcool, interpellait les femmes qui passaient, sans grand succès, d’ailleurs.
Jojo allait refermer la fenêtre lorsque le chat arriva, comme un TGV sortant d’un tunnel, fonçant droit devant lui. Il sauta par-dessus la rambarde, les pattes antérieures en avant, tel un plongeur. Il piqua vers le sol comme un pilote kamikaze précipitant son appareil sur un porte-avions ennemi. Jojo se demanda même, un peu plus tard, s’il ne l’avait pas entendu crier « Banzaï » !
Ratant son atterrissage, il s’était retrouvé la tête sur le trottoir, le reste du corps dans le caniveau. Il ne bougeait plus. Il avait dû se briser les cervicales.
Jojo était là comme pétrifié. Lolo, son vieux compagnon de 15 ans, gisait là, à cinq mètres au-dessous de lui, inanimé, sans vie, après s’être précipité dans la mort.
Il ne s’y était pas attendu, vraiment. D’abord, parce que jamais il n’aurait pensé qu’un chat pût se suicider. Et ensuite, parce que rien, dans le comportement de son compagnon, ne laissait supposer qu’il fût tellement désespéré.
Bien sûr, il lui avait semblé taciturne, depuis un mois environ. Il ne venait plus se frotter à lui, le matin, ne venait plus lui renifler les orteils avec délectation. Il mangeait un peu moins, semblait soucieux. Mais Jojo avait mis ce changement d’humeur sur le compte de la chaleur, dont chacun sait qu’elle émousse l’appétence.
Il fit quelques pas en arrière, regarda machinalement sur la table, à la recherche d’un indice qui lui expliquerait le geste de son compagnon. Tout ce qu’il avait laissé, c’était un souvenir dans sa caisse : il avait vidé son intestin avant de faire le grand saut.
Cela rappela à Jojo une histoire qu’il avait lue à propos d’une jeune femme qui avait voulu se jeter du premier étage de la tour Eiffel, qui s’était pomponnée pour cette occasion, et qui, au dernier moment, y avait renoncé : elle s’était brusquement souvenue qu’elle avait un petit trou dans sa culotte, et elle avait frémi d’horreur rien qu’à la pensée qu’un étranger puisse découvrir son slip troué et ainsi songer, ne serait-ce qu’une seconde, qu’elle ne prenait pas soin de sa personne. Cette pensée intolérable lui avait ainsi sauvé la vie. Lolo, lui, avait pris le temps de travailler à l’image qu’il laisserait : il avait toujours été distingué, très digne, s’était toujours consciencieusement lavé pour mettre en valeur son poil blanc aux tons mordorés de Birman fier de son apparence. Et rien, après sa mort, ne pourrait effacer cette image.
L’attention de Jojo fut attirée par un brouhaha venu de l’extérieur. Il s’approcha doucement de la rambarde : un groupe de gens s’était rassemblé autour du corps sans vie. Il se plaqua contre le mur, cherchant une ombre protectrice, écoutant ce qui se disait quelques mètres plus bas.
« Pauvre bête ! Un si beau chat !
— Il a dû être jeté d’une voiture. C’est encore les vacances, et les gens se débarrassent de leurs animaux.
— Non. Je l’ai vu tomber de la fenêtre du premier. Regardez, elle est encore ouverte. Vous voyez ?
— Alors, il devait être couché sur le rebord, et il a dû s’endormir. Mon beau-frère est tombé de sa chaise, un jour qu’il s’était endormi.
— Allons ! Les chats retombent toujours sur leurs pattes ! Surtout s’il n’est tombé que d’un premier étage.
— Pourtant, celui-là, il est tombé sur le dos. Il ne devait pas être au courant. »
Plusieurs personnes se mirent à rire, ce qui déclencha les foudres d’une grosse dame.
« Vous n’avez pas honte ? Il a l’air de ne pas aller bien du tout. Quelqu’un a appelé les pompiers ?
— Pour quoi faire ?
— Ben… Pour les premiers secours.
— C’est vrai ! Mon beau-frère les a fait venir pour aller chercher son chat, grimpé dans un arbre, et qui n’arrivait plus à redescendre.
— En tout cas, celui-là, il a réussi à descendre.
— Au moins, on pourrait appeler le SAMU !
— À quoi bon ? À mon avis, il est mort. Alors, le SAMU, il ne va pas le ressusciter, quand même ! »
Tandis que les gens devisaient, en bas, autour du cadavre de son vieux compagnon, il se dit qu’il aimerait bien récupérer son corps. « Pour en faire quoi ? », me direz-vous. Eh bien, pour lui rendre les derniers hommages. Après tout, on ne peut pas laisser partir un vieil ami sans lui témoigner l’amitié, le respect que l’on a éprouvé pour lui. Voyez un peu toutes ces vieilles canailles que l’on enterre, même les plus tordues et les moins dignes de respect, simplement parce que la mort confère une virginité à tous ceux à qui elle a fait signe.
Il pensait l’enterrer dans la nature, peut-être au pied de la Sainte-Victoire, dans le pays d’Aix. Un site cézanien, voilà qui aurait de la gueule. Il suffirait de l’allonger sur le sol, et de construire un petit monticule de terre, avec peut-être une petite plante, car Lolo adorait les herbes et fleurs en tous genres, de son vivant.
Mais il fut tiré de sa rêverie par une voix forte, soutenue par un accent de l’est à couper à la hache. Il vit de sa cachette un nouveau venu, un de ces Roms qui exploitent les poubelles marseillaises en les fouillant systématiquement et en déposant leurs trouvailles dans une poussette d’enfant.
« Le chat être mort ?
— Eh oui. Il est tombé de la fenêtre. » répondit une dame surmontée d’un chignon.
Il tenait dans la main un long crochet de métal, qui devait lui servir à farfouiller dans les poubelles en évitant de trop se salir, sans grand succès sans doute, car ses mains étaient bien crasseuses.
Il se servit de son outil pour tourner et retourner le corps du chat.
« Animal très beau. Fourrure pas abîmée. Lui être à vous ? »
Les témoins se récrièrent : eux, ils n’auraient pas laissé tomber leur chat par la fenêtre. Ils auraient fait un peu plus attention à leur compagnon.
Visiblement satisfait de la réponse, le chiffonnier s’écria : « Alors, lui être à moi. » Mais au lieu de ramasser le corps et de le mettre dans sa poussette, il fouilla dans la poche de sa veste de chasseur et en tira un rasoir coupe-choux.
Les spectateurs frémirent à la vue de la lame brillante. Le chiffonnier remarqua le malaise que suscitait son engin de mort, car pour ceux qui se rasent avec un rasoir électrique ou mécanique banal, et pour celles qui se rasent les jambes avant la belle saison, un tel instrument relevait plus du tueur multirécidiviste que du brave père de famille. Les cerveaux tournaient à cent à l’heure, se demandant ce qu’il allait bien pouvoir en faire. Certains firent même un pas en arrière. Mais l’homme avait dû être trappeur dans une autre existence, car il se baissa, prit le malheureux animal par une patte, le tourna de façon à le placer sur le dos, le ventre bien en évidence, et en moins de temps qu’il n’en faut à un percepteur pour tondre un contribuable de la classe moyenne, il coupa le bout des quatre pattes, fit avec sa lame le tour du cou du chat pour séparer la peau du corps de celle de la tête. Le sang qui coulait en abondance sur sa main ne semblait pas le gêner. Une fois ses travaux préparatoires terminés, il saisit la peau à hauteur du cou, tira un bon coup dessus et le chat fut débarrassé de sa fourrure, qui lui fut ôtée avec l’agilité d’une puéricultrice expérimentée enlevant sa grenouillère à un nourrisson.
Les spectateurs restaient cois, qui la bouche ouverte et la mâchoire pendante, qui les yeux exorbités. Certains étaient à la limite de la nausée. L’un d’eux avait vu un film de Tarantino la veille, dans lequel des soldats américains scalpaient des Allemands, avec un bruit de scratch que l’on ouvre. Le bruit de la peau tirée fit surgir dans son esprit des images de scalp, de chairs mises à nu, et il dut prendre le large pour vomir dans le caniveau. Ceci déclencha une réaction en chaîne : les bruits de vomissements, ajoutés à l’odeur aigre de suc gastrique qui venait chatouiller les narines de ces citadins ramollis par la civilisation, défiaient leur estomac, et les plus fragiles en rendirent le contenu sur place. Ceux qui avaient pu résister quelques secondes décorèrent le pied du mur de la maison.
Le concert de tuyaux terminé, le chiffonnier roula la fourrure qu’il venait de conquérir à la pointe de son rasoir et la glissa dans sa veste. Il ne voulait sans doute pas partager sa proie avec ses congénères, comme il allait sans doute devoir le faire avec le contenu de la poussette. Sur ce, il posa ses mains sur le guidon de la poussette et partit en sifflotant.
À peine eut-il tourné au coin de la rue qu’un clone de bouddha sortit de la salle du café-restaurant. Il avait dû observer la scène de l’écorchement de l’intérieur. N’ayant aucune utilisation de prévue pour la peau, il avait préféré se dispenser d’intervenir. Mais à présent que le Rom était parti, son heure à lui avait sonné. Les mains sur les hanches, un torchon sur l’épaule comme insigne de sa profession, il poussait devant lui une bedaine qui aurait pu servir d’enseigne à son établissement. Selon la classification de Zola dans le Ventre de Paris, il faisait sans aucun doute partie des gros à graisse blanche, de ceux donc qui, bons vivants, s’empiffrent, boivent et rient avec leurs semblables chaque fois que l’occasion se présente.
« On ne peut pas laisser ce pauvre chat tout nu ainsi. Je vais l’enlever de là.
— Mais que voulez-vous donc en faire ? s’enquit la dame au chignon.
— Je vais le mettre à l’abri dans mon congélateur, en attendant que nous ayons retrouvé son propriétaire. » Et il roula le corps du chat dans son torchon, l’emportant bien vite, sans attendre d’éventuelles remarques ou protestation.
Jojo, qui n’avait perdu aucun détail ni du spectacle, ni de la conversation se demanda un moment comment il pourrait bien récupérer le corps, ou ce qu’il en restait, pour l’enterrer dignement. Mais il ne se voyait pas aller réclamer la dépouille de son vieux compagnon. Il faudrait donner des explications, faire valoir ses droits, et il ne s’en sentait pas capable.
Pourtant, à bien y réfléchir, il eut l’impression désagréable que ce gargotier avait montré un intérêt bien grand pour la dépouille du félin. Il savait qu’une fois sa tête tranchée, le chat ressemblait à un vulgaire lapin, et que vu le prix de la viande, le gros bouddha faisait une bonne affaire.
Il y a longtemps que Jojo ne se faisait plus la moindre illusion sur le bon fonds des humains. Il n’ignorait pas que lorsqu’il s’agissait de défendre leurs intérêts, beaucoup n’hésitaient pas devant les moyens les plus vils. Il avait en mémoire l’histoire que l’on avait racontée à France-Info sur un restaurant chinois de Pékin. Les gens se battaient pour acheter des hamburgers particulièrement succulents qui figuraient sur sa carte, jusqu’au jour où, à la suite d’un contrôle, on avait découvert que cette viande particulière provenait des fesses de cadavres conservés dans la morgue de l’hôpital voisin, que des employés indélicats refilaient au restaurant pour arrondir leurs fins de mois. Comme quoi tout n’était pas mauvais, dans l’homme.
Il se promit donc d’aller contrôler le contenu de la carte, pour voir s’il y avait du lapin.
2 Un mois plus tôt : la commissaire Macinaggio.
Le commissariat du sixième arrondissement n’attirait pas la télévision. Pourtant, de nombreux films ou séries avaient été tournés à Marseille. Mais la plupart se contentaient de filmer la rade, avec les îles du Frioul et le château d’If en arrière-plan.
Le bâtiment lui-même n’était pas laid, avec ses quatre étages, et son entrée assez monumentale, flanquée de chaque côté de deux fenêtres défendues par des grilles en fer forgé. On ne sait si celles-ci protégeaient la police d’éventuels assaillants, ou si elles devaient empêcher des quidams en garde à vue de s’échapper.
Au-dessus de l’ouverture veillait un œil-de-bœuf sur les entrées et sorties. Et c’est au deuxième étage que se trouvait le bureau de la commissaire Macinaggio, une femme sans âge défini, dont le visage sans aménité trahissait la présence d’un ulcère à l’estomac, dû sans doute à l’accumulation de soucis divers, d’ordre professionnel.
Ses subordonnés l’appelaient avec respect et un brin d’affection « Patron ». Nul, en sa présence, ne pensait qu’il était en face d’une femme pour ne voir en elle que le chef, le meneur d’hommes. Tous se seraient fait couper en quatre pour elle, et peut-être même en huit.
Il était arrivé, par le passé, que de jeunes godelureaux, fraîchement débarqués de l’Ecole de Police, fassent des remarques désobligeantes sur ses sourcils broussailleux, voire sur les quatre poils qui ornaient son menton, mais ils avaient vite compris qu’ils étaient allés trop loin. Un croc-en-jambe par-ci, un coup de coude dans les côtes par-là, leur avaient enseigné la loi non écrite : le patron est sacré, et on ne rigole pas de lui, sous peine de représailles. Et même lorsqu’elle portait son uniforme de commissaire de la République, les jours de visite du ministre de l’Intérieur ou de l’enterrement d’un collègue malheureux, il était interdit de rire de sa façon de porter le galurin pourtant dessiné par un grand couturier, et qui évoquait, posé sur la tête de la commissaire, un morceau de beurre sur une patate chaude.
Ce jour-là, le brigadier Duchmoll entra en coup de vent dans son bureau, non sans avoir auparavant frappé à la porte. Il avait monté les deux étages quatre à quatre, et brandissait une feuille de papier qu’il posa sur le bureau de la commissaire. Il dut reprendre son souffle avant de pouvoir parler, d’une voix encore haletante par suite de l’effort fourni :
« Patron, on vient de recevoir un mail suspect. »
La commissaire fronça le sourcil, passa sa main droite sur ses quatre poils, se demandant si ce courriel avait un quelconque rapport avec les attentats de Nice ou d’ailleurs.
Elle prit donc connaissance du contenu du document. Un quidam dénonçait un copain, disant qu’il craignait qu’il ne fasse des bêtises, voire, pour reprendre les termes qu’il avait utilisés, une « énorme connerie ». Mais on ne trouvait, dans ce message, aucune information qui puisse permettre d’en identifier l’auteur, pas plus d’ailleurs que celui qui devait commettre la fameuse connerie.
La commissaire voulut savoir s’il y avait moyen de connaître l’origine du courriel, espérant qu’on trouverait, comme pour les appels téléphoniques, trace d’un numéro d’identification.
L’agent lui expliqua que chaque ordinateur avait un numéro particulier, le numéro IP, donné par le serveur du fournisseur d’accès. Un des autres agents, un geek bien connu dans le commissariat, avait déjà fait des recherches et avait réussi à trouver le fameux numéro IP, qui révélait que l’ordinateur qui avait émis le message se trouvait en Australie, à Sidney plus précisément, ce qui semblait difficile à croire, étant donné les nombreuses informations fournies qui se référaient à Marseille et collaient à l’actualité.
Le geek avait expliqué à l’agent que l’on pouvait se servir d’un VPN, un logiciel qui remplaçait le vrai numéro IP par un autre, se trouvant dans le pays que l’utilisateur avait choisi dans une liste. Il était donc quasiment impossible de retrouver l’expéditeur du message, et la seule solution était d’entamer avec lui un dialogue en espérant qu’il finirait par lâcher l’information, ou par se trahir en donnant des détails qui permettraient de l’identifier. On pouvait également envisager de lui faire peur, de l’intimider, mais celui-ci n’était sûrement pas si bête et se sentait bien à l’abri en Australie, où menaient les recherches du geek et où on ne le retrouverait jamais, puisqu’il était à Marseille. Mais on n’en avait pas la preuve.
La commissaire décida de choisir la première méthode. Ce qui lui paraissait indispensable, c’était de faire vite, car on ne pouvait pas traiter cette affaire par-dessus la jambe, d’autant plus que la connerie en question pouvait aussi bien être le suicide du copain cité, qu’un bon gros attentat dont la presse allait pouvoir faire ses choux gras, mais dont la commissaire n’avait vraiment pas besoin.
Il fallait donc trouver un policier, ou plutôt une policière, les femmes ayant un doigté, une sensibilité que ne possédaient pas les hommes, souvent bruts de décoffrage.