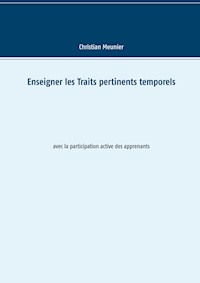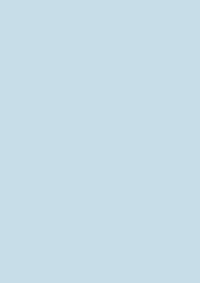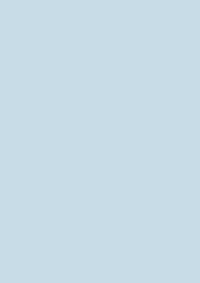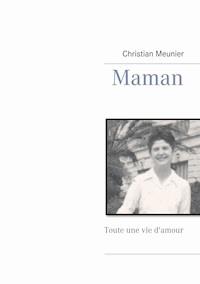Unifier l'emploi des temps par l'utilisation des traits pertinent temporels E-Book
Christian Meunier
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
L'explication des temps grammaticaux du français fournie par les grammaires souffre généralement d'un manque de cohérence. On se perd dans les temps, les modes, les aspects et les modalités. En outre, ces derniers varient souvent d'un auteur à l'autre. Lorsqu'il s'agit d'expliquer les raisons du choix d'un mode ou d'un temps, les auteurs fournissent des explications simplistes, ou au contraire, à caractère littéraire, voire ésotérique. Pour mettre de l'ordre dans ce problème, nous partons des traits pertinents temporels (TPT), qui sont tous les traits grammaticaux qui interviennent dans le choix des modes et des temps.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autres ouvrages du même auteur :
→
eGrammaire BoD 2014 ISBN : 978-2-322-08398-5
→
Grammaire participative BoD 2015 ISBN : 2015 978-2-322-08403-6
→
Petit guide de la Phonétique corrective BoD ISBN : 978-2-322-08399-2
→
Apprendre à enseigner les temps simples du passé BoD ISBN : 978-2-322-08461-6
Avec Gérard Meunier
→
OrthoFle Le guide du professeur d’orthographe Éditions du FLE- Distribué par Bookelis 2017 ISBN : 979-1-094-11308-0
Avec Jean Piètre-Cambacédes
→
La Conception du temps en français, anglais, allemand Éditions du FLE- Distribué par Bookelis 2017 ISBN : 979-1-094-11309-7
Théorie des Temps grammaticaux fondée sur les Traits pertinents temporels Éditionsdu FLE-Distribué par Bookelis 2018 ISBN : 979-1-094-11313-4
Enseigner les Traits pertinents temporels avec la participation active des apprenants Éditions du FLE- Distribué par Bookelis 2018 ISBN : 979-1-094-11315-8
Site d’accompagnement de cet ouvrage : www.theorie-des-temps.com
Sites auxiliaires :
www.la-grammaire-du-fle.com
http://www.la-conception-du-temps.com/
www.orthofle.eu
www.editions-du-fle.fr
Pour le FLE niveau débutants ou faux débutants
www.lesconet.fre
9 Table des matières
POURQUOI CETTE ETUDE ?
QUELS SONT LES TRAITS PERTINENTS TEMPORELS
REPLACER LE PROCES DANS LE TEMPS (TPT1/TPT2/TPT3/TPT4)
3.1 N
OUS ALLONS D
’
ABORD REPERER L
’
EPOQUE OU A LIEU
TPTP
ROC
: (TPT1/TPT2)
3.2 M
AIS ON PEUT AUSSI SE SERVIR DE CES TEMPS POUR DONNER UNE IMPRESSION
:
3.3 L
E ROLE DES BALISES TEMPORELLES
(TPT3)
3.3.1 La balise et le temps concordent.
3.3.2 La balise et le temps divergent.
3.3.3 La balise est équivoque.
3.3.4 Il n’y a pas de balise temporelle.
3.4 P
ROCES LIE A UN AUTRE PROCES
(TPT4)
3.4.1 A est antérieur à B
3.4.1.1 L’antériorité fortuite
3.4.1.2 L’antériorité soulignée
3.4.1.3 L’antériorité éloignée
3.4.1.4 L’antériorité par rapport à un joker : « avoir tôt fait de + infinitif »
3.4.2 B est postérieur à A.
3.4.2.1 Postériorité fortuite :
3.4.2.2 Postériorité soulignée (subordonné B postérieure à principale A)
3.4.3 A et B sont simultanés
3.4.3.1 La simultanéité fortuite
3.4.3.2 La simultanéité soulignée
3.4.3.2.1 La simultanéité soulignée de base
3.4.3.2.2 La simultanéité soulignée progressive
3.4.3.3 La simultanéité au contact
3.4.3.4 La simultanéité de remplacement (autrefois/aujourd’hui)
AUTOURS DU PROCES (TPT5/TPT6/TPT7/TPT8)
4.1 T
YPES DE PROCES
(TPT5)
4.2 D
UREE DU PROCES
(TPT8)
4.2.1 Le topogramme de la durée d’un procès
4.2.2 Les verbes bascules ou instantanés
4.2.2.1 Principe des verbes bascules
4.2.2.2 La famille des verbes bascules
4.2.2.3 Cas du verbe « vouloir »
4.2.3 Procès de faible durée
4.2.4 Accélération de l’exécution
4.2.5 Les verbes duratifs
4.2.6 Le procès sans précision de durée
4.3 N
OTIONS DE FENETRE TEMPORELLE
(TPT6)
4.3.1 Principe des fenêtres temporelles
4.3.2 La vie d’une fenêtre
4.3.3 Fenêtres et procès latents
4.3.3.1 Définitions
4.3.3.2 Ouverture
4.3.3.3 Occurrence simple ou ensemble des occurrences
4.3.4 Comment fermer une fenêtre
4.3.4.1 Fermer une fenêtre à chaud
4.3.4.2 Fermer une fenêtre à froid
4.3.4.3 La fenêtre se ferme d’elle-même.
4.3.4.4 Une fenêtre peut ne pas pouvoir se fermer
4.3.5 Comment se servir d’une fenêtre
4.3.5.1 Fenêtres et temps
4.3.5.2 Voici des exemples selon les périodes :
présent, passé ou futur
4.3.5.3 Différents cas d’emploi des temps
4.3.5.3.1 Premier cas. Les faits :
4.3.5.3.2 La fenêtre est encore ouverte au moment où je parle. (TPTLocu)
4.3.5.3.3 La fenêtre est encore ouverte au moment passé dont je parle. (TPTProc)
4.3.5.3.4 La fenêtre est fermée au moment passé dont je parle. (TPTProc)
4.4 P
ARTIE DU PROCES VISE
(TPT7)
4.4.1 Moment juste avant le début
4.4.2 Début du procès
4.4.3 Corps du procès
4.4.4 Moment juste avant la fin du procès
4.4.5 Ensemble du procès
4.4.6 Moment juste après la fin
4.5 P
RINCIPE DES FENETRES TEMPORELLES
(4.3.1)
TEMPS, PROCES, INTENTION, RESULTAT (TPT9/ TPT10/TPT11/TPT12)
5.1 D
EGRE DE PROBABILITE
(TPT9)
5.1.1 Topogramme
5.1.2 Probabilité certaine
5.1.3 Les hypothèses
5.1.3.1 Futur et incertitudes
5.1.3.2 Le futur hypothétique
5.1.3.3 L’hypothèse au conditionnel
5.1.4 Les conditions
5.1.4.1 Le potentiel probable
5.1.4.2 Le potentiel improbable mais possible
5.1.4.3 L’irréel du présent
5.1.4.4 L’irréel du passé
5.1.4.5 L’information non vérifiée
5.1.5 Subjonctif
5.1.5.1 Souhait, ordre, conseil appuyé
5.1.5.2 Dans la subordonnée
5.1.5.2.1 Postériorité
5.1.5.2.2 Doute, incertitude, gêne
5.1.5.2.3 Caractère exceptionnel, unique
5.1.5.2.4 Cas exceptionnel de la conséquence.
5.2 V
ALEUR DES TEMPS
(TPT10)
5.2.1 Tableau des emplois selon la valeur
5.2.2 Topogramme des valeurs du temps
5.2.3 Survol des quatre valeurs
5.2.3.1 La véritable valeur des temps
5.2.3.1.1 Il y a trois cas de figures de base qui mettent en jeu des temps simples.
5.2.3.1.2 L’antériorité apporte une nouvelle dimension :
5.2.3.1.3 Le conditionnel exprime l’hypothèse et la condition :
5.2.3.1.4 Le subjonctif dans la principale : souhait, ordre, conseil appuyé, malédiction
5.2.3.1.5 L’impératif sert à exprimer un ordre, un conseil appuyé ou une interdiction directe
5.2.3.1.6 Le participe
5.2.3.1.7 L’infinitif
5.2.3.2 Valeur stylistique
5.2.3.2.1 Rendre un texte plus vivant en procédant à une translation de repère
5.2.3.2.2 L’imparfait et le style
5.2.3.2.3 Le subjonctif qui complète l’impératif.
5.2.3.3 Valeur déviée
5.2.3.4 Valeur grammaticale
5.2.3.4.1 Les obligations
5.2.3.4.2 Les interdictions
5.2.3.4.3 Les obligations pas toujours respectées
5.3 C
ONTRAINTES
(TPT11)
5.4 R
ESULTATS ESCOMPTES
(TPT12)
5.4.1 Topogramme
5.4.2 Le procès présenté comme sûr
5.4.3 Le procès incertain
5.4.3.1 Si l’on emploie un temps du futuro-conditionnel, le procès sera moins certain.
5.4.3.1.1 Le futur, avenir incertain
5.4.3.1.2 Le futur hypothétique
5.4.3.1.3 Le conditionnel de l’information non vérifiée.
5.4.3.2 Le but qui dépend d’une condition (potentiel)
5.4.3.3 Le but raté
5.4.3.4 L’ordre ou le conseil appuyé
5.4.3.4.1 A l’impératif, à la première ou à la deuxième personne, :
5.4.3.4.2 Ordre transmis par une tierce personne
5.4.3.4.3 Au futur, comme dans le Décalogue :
5.4.3.4.4 A l’infinitif, généralement sur des pancartes :
5.4.4 Menaces, insultes, protestation.
5.4.5 Excuses
CONCLUSION
MATERIEL DE REFLEXION
7.1 L
ES EXEMPLES CLASSES PAR
TPT
7.2 C
HOISIR LE BON
TPT
BIBLIOGRAPHIE
1 Pourquoi cette étude ?
L’explication de l’emploi des temps grammaticaux du français fournie par les grammaires souffre généralement d’un manque de cohérence. On se perd dans les temps, les modes, les aspects et les modalités Ces derniers ne sont pas les mêmes selon les auteurs.
Lorsqu’il s’agit d’expliquer les raisons du choix d’un mode et d’un temps, on rencontre des explications simplistes, ou au contraire à caractère littéraire, voire ésotérique.
Pour mettre de l’ordre dans ce problème, nous partons des traits pertinents temporels (TPT), qui sont tous les traits grammaticaux qui interviennent dans le choix des modes et des temps.
Nous nous appuyons dans cette étude sur les ouvrages et un site :
Ouvrages de Christian Meunier
Théorie des Temps grammaticaux fondée sur les Traits pertinents temporels Éditions du FLE-Distribué par Bookelis 2018 ISBN : 979-1-094-11313-4
Enseigner les TPT avec la participation active des apprenants Éditions du FLE- Distribué par Bookelis 2018 ISBN : 979-1-094-11314-1
Site :
www.theorie-des-temps.com
Voici un exemple accompagné des TPT qui jouent un rôle dans le choix du temps et la compréhension.
Exemple
TPT
Nom
Valeur utilisée
TPT1
Les époques
période →passé
TPT2
Le repère TPTLocu
TPTProc avant TPTLocu →passé
Toute sa vie, Paul
TPT3
Les balises temporelles
balise temporelle → toute sa vie
fuma deux paquets de cigarettes par jour.
TPT6
Fenêtre temporelles
fenêtre fermée →passé simple
TPT7
Partie du procès visée
Partie utile totalité
TPT8
Durée du procès
Durée du procès : durée indéterminée
TPT9
Degré de probabilité
Degré de probabilité : certain
TPT10
Valeur des temps
Valeur : valeur de base du passé simple
Dans cet exemple, 8 TPT interviennent dans le choix du temps choisi, le passé simple. Comme on le voit, ils expriment diverses caractéristiques du ou des procès analysés.
2 Quels sont les traits pertinents temporels
Définition
Un trait pertinent temporel (TPT) est un paramètre linguistique qui peut prendre plusieurs valeurs, et qui sert, seul ou en combinaison avec d’autres, à déterminer le choix d’un temps grammatical
Les traits pertinents temporels sont au nombre de 12, que l’on peut classer en trois catégories :
Les repères temporels (TPT1-TPT4)
Qualité du procès et rapports temporels entre procès (TPT5-TPT8)
La valeur du contenu des procès (TPT9-TPT12)
Notons que les TPT ne concernent pas que les verbes. Ils s’appuient aussi sur les balises temporelles, sur les intentions et sur les connaissances extralinguistiques des interlocuteurs.
Voici le topogramme des traits pertinents temporels :
On voit sur le topogramme et dans le tableau des TPT et les valeurs qu’ils peuvent prendre.
Notons que le choix des temps dépend de nombreux éléments :
TPT
Intentions du locuteur
Connaissances linguistiques
Culture des deux locuteurs et connaissances extralinguistiques
Nous allons passer ces valeurs et ces propriétés en revue.
Il faudra considérer que le locuteur fera passer toutes ces informations en utilisant un temps plutôt qu’un autre. Mais dans le sens inverse, l’interlocuteur pourra, s’il connaît bien les TPT, déduire de leur présence ou de leur absence, décoder les informations utilisées par le locuteur.
Par exemple, dans :
Pierre n’assiste pas à la réunion. Il sera malade.
La valeur du procès « sera malade » ne correspond pas à la vraie n’est pas la vraie valeur de ce temps (cf. TPT10 :Valeur des temps). Il s’agit là d’une valeur déviée. On verra bien, en rapprochant les deux procès, que si « n’assiste pas » est employé, selon la règle de base de TPT1/TPT2 : le temps de la locution correspond au temps du procès, ce qui entraîne un présent (époque et temps), le deuxième procès, lui, possède le même repère quant à la locution, alors que le repère du procès diverge (futur simple)
C’est le TPT9 qui nous donne l’explication en définissant le degré de probabilité de la réalisation du procès : 5.1.2.1. Le futur hypothétique. Il s’agit donc là d’une hypothèse émise par le locuteur, qui suppose que Pierre est malade, sans en avoir la preuve.
Il ne nous reste plus qu’à étudier les TPT pour découvrir les informations qu’ils véhiculent.
3 Replacer le procès dans le temps (TPT1/TPT2/TPT3/TPT4)
Les temps servent avant tout à définir à quelle époque a lieu le procès dont on parle. Mais un même temps ils véhiculent aussi bien d’autres information. C’est ce que nous allons voir maintenant.
Mais les temps livrent d’autres informations que nous retrouverons au cours de notre étude sur les TPT.
La base de notre réflexion s’organise autour de deux repères :
Le moment où le locuteur produit son texte (parlé ou écrit), que nous appellerons TPTLocu. (TPT2)
Le moment où le procès a lieu, que nous appellerons TPTProc. (TPT2) Il y aura des cas où nous aurons besoin d’un autre repérage, relatif à une balise (Hier, à quatre heures, le matin, etc.) (TPT3) ou à un autre procès (Après avoir mangé, il alla se coucher).(TPT4)
3.1 Nous allons d’abord repérer l’époque où a lieu TPTProc : (TPT1/TPT2)
La première information que nous voulons avoir, c’est si le procès (TPTProc) dont on parle a déjà eu lieu avant, pendant ou après le moment où le texte est émis (TPTLocu) . De cela dépend l’époque à laquelle a lieu le procès :
Repérage
Epoque
Exemple
TPTProc a lieu avant TPTLocu
Passé
Elle dit qu’elle
a fait
ce travail toute seule.
TPTProc a lieu avant TPTLocu
Présent
Elle voit son voisin qui
tond
la pelouse.
TPTProc a lieu après TPTLocu
Futur
Elle sait que son ami
viendra
la voir plus tard.
On pourra dire que le passé composé, le présent et le futur simple sont employés selon TPT10 avec la valeur de base du temps. L’auditeur (ou le lecteur) sait, lorsqu’il trouve un passé composé, que le procès est passé. De même, lorsque c’est un présent, le procès a lieu à la période du présent. Et, lorsque c’est un futur simple, le procès a lieu à la période du futur.
3.2 Mais on peut aussi se servir de ces temps pour donner une impression :
Si l’on veut faire revivre un fait passé, on peut utiliser le présent. Selon TPT10, on dira que le présent a une valeur stylistique, celle de nous rendre témoin d’un procès.
Philippe-Auguste bat l’empereur Othon IV à Bouvines en 1214.
Le présent nous transporte par une translation virtuelle (=par la pensée) de TPTLocu de 804 ans vers le passé pour nous faire revivre comme témoins ce procès. Qu’est-ce qui nous montre qu’il y a translation ? La balise temporelle en 1214.
On peut faire la même chose avec un fait futur que l’on aimerait rendre plus vivant.
Demain, je le prends à part et je lui dis ses quatre vérités.
Ici, la balise demain nous indique qu’il y a translation virtuelle de TPTLocu vers le futur. Ainsi, le TPTLocu virtuellement translaté se retrouve avoir lieu en même temps que le procès TPTProc, dans le futur.
3.3 Le rôle des balises temporelles (TPT3)
On peut trouver plusieurs cas intéressants :
3.3.1 La balise et le temps concordent.
Règle
Lorsque la balise et le temps concordent, le repérage est clair.
Ils se sont mariés hier.
Les deux indiquent le passé
Ils partiront en voyage de noces demain.
Les deux indiquent le futur
Aujourd’hui, ils se reposent.
Les deux indiquent le présent
3.3.2 La balise et le temps divergent.
Règle
Lorsque la balise et le temps divergent, c’est la balise qui décrit la période.
3.3.3 La balise est équivoque.
Règle
Lorsque la balise est équivoque, c’est le temps qui décrit la période.
3.3.4 Il n’y a pas de balise temporelle.
Règle
Lorsqu’un procès a lieu en permanence, il n’y a pas besoin de balise.
La Terre tourne autour du Soleil.
C’est toujours vrai.
Le bois est plus léger que l’acier.
C’est toujours vrai.
Les loups mangent de la viande.
C’est toujours vrai.
3.4 Procès lié à un autre procès (TPT4)
Lorsque deux procès A et B (ou plus) sont reliés entre eux, il y a trois possibilités :
Considérons que A commence avant B.
Ce qui nous intéresse ici, c’est le rapport entre la subordonnée et sa principale.
Nous supposerons dans les cas qui suivent que c’est la subordonnée qui est antérieure, postérieure ou simultanée par rapport à la principale.
3.4.1 A est antérieur à B
A est antérieur à B lorsqu’il commence et se termine avant le début de B.
Dès que Julie a mangé, elle regarde la télévision . A est antérieur à B.
Nous distinguerons quatre sortes d’antériorité
3.4.1.1 L’antériorité fortuite
A est antérieur de façon fortuite :
Le président de la République a fait un discours. Jacques lit le journal.
Le discours du président a eu lieu avant que Jacques ne commence à lire le journal. Les deux actions n’ont rien à voir l’une avec l’autre. Ici, nous avons affaire à deux indépendantes.
3.4.1.2 L’antériorité soulignée
La subordonnée A est antérieure à la principale B. L’emploi d’une conjonction ou d’une préposition souligne cette antériorité.
Dès que Julie a mangé, elle s’installe devant la télévision.
Julie a fini de manger avant de s’installer devant la télévision. La conjonction dès que souligne cette antériorité.
3.4.1.3 L’antériorité éloignée
Lorsque un procès B s’explique par un fait A qui a eu lieu bien avant, on dira que A est une antériorité éloignée. Elle est exprimée par un plus-que-parfait.