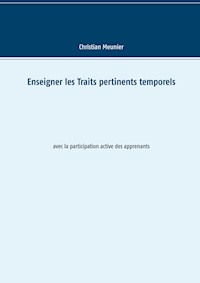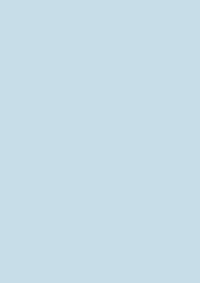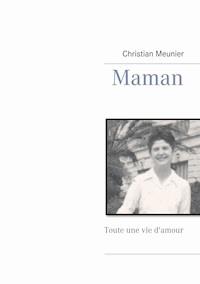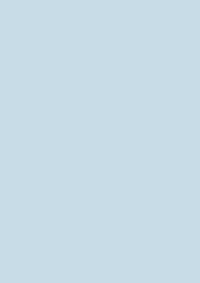
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le petit guide pratique de la phonétique corrective du FLE est un livre destiné aux enseignants de FLE. Il les soutiendra dans leur enseignement la compréhension et de l'expression orales, en leur proposant une méthode pour identifier les fautes de prononciation et améliorer la compréhension et la production orale de leurs élèves. Alors que tout le monde enseignant s'accorde sur l'importance de la grammaire, rares sont les professeurs qui ont suivi un cours de phonétique corrective. Alors que tout le monde enseignant s'accorde sur l'importance de la grammaire, rares sont les professeurs qui ont suivi, au cours de leur formation, des cours de phonétique corrective, et même de phonétique tout court. La seule méthode que certains connaissent est celle du perroquet. Alors que l'on pourrait facilement enseigner les voyelles nasales ou les semi-consonnes en faisant prendre conscience du problème, puis, en fournissant quelques règles pertinentes pour la compréhension orale et la production, l'enseignant non-phonéticien se contente de faire répéter jusqu'à plus soif le mot fautif. Si l'élève n'y arrive pas, et si l'enseignant persiste trop longtemps, la correction phonétique sera inefficace, et l'élève frustré, voire traumatisé. De même, il peut être très utile pour l'enseignant de savoir écrire les mots en écriture API, pour que l'élève garde une trace écrite du mot qu'il a appris. Cela lui permettra une fois arrivé chez lui, de pouvoir retrouver la bonne prononciation. Enfin, une bonne connaissance des règles d'emploi de l'intonation ouvrira à votre enseignement une nouvelle dimension. Une prononciation qui suit les règles de l'intonation du français apporte une amélioration sensible de la compréhension et de la production orales. L'initiation à l'intonation marquée apportera à vos apprenants plus de sûreté et d'efficacité, et leur permettra de faire passer leurs intentions en peu de mots.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
Petit Guide de la traduction systématique CMV Berlin 1986 ISBN 3-89283-001-0
Grammaire raisonnée Le Verbe CMV Berlin 1987 ISBN-3-89283-003-7
Einführung in das Programmieren eines Personal Computers : eine Einführung für Sprachdozenten und Sprachstudenten CMV Berlin 1987
eGrammaire Editions du FLE 2014 ISBN 9-10-94113-00-4
Grammaire participative Editions du FLE 2015 ISBN 9-10-94113-03-5
Petit guide pratique de la phonétique corrective Editions du FLE 2015 ISBN 9-10-94113-06-6
0rthofle Guide du professeur d’OrthographeEditions du FLE 2017 ISBN 9-10-94113-08-0
La conception du temps Editions du FLE 2017 ISBN 9-10-94113-09
Avant-propos
La langue est essentiellement orale
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le français est une langue. L’important, c’est justement que le terme de langue fasse référence à la qualité orale du français.
Quand on enseigne une langue étrangère, que l’on utilise un manuel écrit, avec des cahiers d’exercices écrits, que de plus on enseigne la grammaire, on aurait plutôt tendance à privilégier l’écrit. Pourtant, une langue passe avant tout par l’oral. Faites une petite expérience. Dites-vous, dans votre tête, consciemment : « Le français est une langue difficile. »
Quel code utilisez-vous dans votre tête ? Votre cerveau mémorise le français dans sa forme orale. D’ailleurs, au moment où j’écris ces lignes sur mon ordinateur, je les formule dans ma tête sous une forme orale. Mon cerveau commande à mes doigts d’appuyer sur des touches qui portent bien une lettre écrite, mais il formule les idées par oral, et c’est une partie inconsciente qui code l’oral en écrit.
De même, lorsque vous lirez ces lignes, votre cerveau décodera l’écrit pour le formuler en code oral, et lorsque vous raisonnerez sur le contenu, vous le ferez par oral, même si, je l’espère du moins, aucun son ne sort de votre cerveau.
Formulons cette première constatation :
Le français, comme toutes les autres langues, possède un code oral. C’est donc ce code qu’il s’agit d’apprendre.
Bien évidemment, le français possède aussi un code écrit, qui n’est qu’une méthode de codification de l’oral, et qu’il faut aussi apprendre. Mais le code de référence, c’est l’oral.
Le public visé
Ce guide est destiné aux enseignantes et enseignants de FLE, aux étudiantes futures enseignantes de FLE et à leurs homologues masculins, ainsi qu’aux formatrices et formateurs de ces étudiantes.
Notez que la plupart des lecteurs seront des lectrices, il est normal que l’on s’adresse à des femmes. Les hommes rectifieront d’eux-mêmes.
Les objectifs
L’ambition de ce petit guide est de fournir à l’enseignante les connaissances de base sur la phonétique, afin qu’elle appréhende bien le système phonique du FLE, phonèmes et intonation.
Les méthodes employées
Une fois les bases assurées, l’enseignante sera initiée aux secrets de la phonétique corrective :
Remarque
:
Étant donné que nous travaillons tous azimuts, les apprenants pouvant être de niveaux et de langue maternelle différents, les enseignants s’adressant à des publics linguistiquement homogènes ou hétérogènes, avec des méthodes différentes, il n’est pas possible de faire un cours type. Nous devrons nous limiter à mettre notre public enseignant à même de reconnaître et de corriger les fautes lui-même. Pour reprendre un proverbe chinois bien connu, nous ne lui offrirons pas le poisson, mais nous lui apprendrons à pêcher.
notre démarche
:
Nous allons procéder en plusieurs étapes :
TABLE des MATIERES
Expliquer les bases de la phonétique du FLE
1.1 Les organes participant à la parole
1.1.1 Les organes phonateurs
1.1.2 Les organes responsables de l'audition
1.2 Le système phonique du français
1.2.1 L’intonation du français
1.2.1.1 Définitions
1.2.1.2 L'intonation non-marquée
1.2.1.3 L'intonation marquée
1.2.1.4 Problèmes d'intonation
1.2.2 Les phonèmes du français
1.2.2.1 Les consonnes
1.2.2.2 Quels sont les problèmes posés par les consonnes?
1.1.2.2 Les voyelles
1.1.2.3 Les semi-voyelles
1.1.2.4 Problèmes des voyelles et semi-voyelles
Les bases de la phonétique corrective
2.1 Assurer les bases d’une bonne intonation (eGrammaire, p. 28 à 36)
2.1.1 L’intonation de la forme affirmative
2.1.2 Quelques rappels importants
2.1.3 Acquérir le rythme régulier
2.1.4 Acquérir l’endurance nécessaire
2.1.5 L’intonation de la forme interrogative
2.1.5.1 Interrogative sans mot interrogatif :
2.1.5.2 Interrogative avec mot interrogatif à la fin :
2.1.5.3 Interrogative avec mot interrogatif au début
2.1.6 L’emploi des parenthèses
2.1.6.1 La parenthèse basse :
2.1.6.2 La parenthèse haute
2.1.7 L’intonation marquée
2.1.7.1 Mise en doute
2.1.7.2 Evidence
2.1.7.3 Surprise /indignation
2.1.8 L’intonation marquée : mélanges
2.2 Assurer une bonne utilisation du système phonique français
2.2.1 Le matériau phonique
2.2.2 Rappel : Les consonnes du français
2.2.2.2 Si le voile du palais est abaissé, et que de l’air passe par le nez :
2.2.2.3 Rappel : Les voyelles du français
2.2.2.4 Rappel : Les semi-consonnes
2.2.3 Problèmes posés par le système phonique
2.2.3.1 La cause des fautes
2.2.4 Principes de la correction
2.2.4.1 Prévention,
2.2.4.2 Diagnostic
2.2.4.3 Le plan de traitement
2.2.4.4 La prise de conscience
2.2.4.5 La discrimination et la compréhension orale
2.2.4.6 La production et l’environnement
2.2.4.7 Environnement favorable et intonation défavorable
2.2.4.8 Exercices de transfert
2.2.4.9 Le service après vente
Phonétique corrective dans la pratique
3.1 Principes de base
3.1.1 Créer un environnement phonétique
3.1.2 Préparez-vous à introduire la phonétique
3.1.2.1 L’alphabet phonétique API
3.1.2.2 Préparez votre boîte à outils de la phonéticienne
3.1.2.3 Travaillez bien vos fiches de correction
3.1.3 Les fiches de correction selon les problèmes à attendre
3.1.3.1 L’intonation
3.1.3.2 Les voyelles
3.1.3.3 Les semi-consonnes
3.1.3.4 Les consonnes
3.2 Exercices d’entraînement
3.2.1 Exercices d’écriture phonétique
3.2.2 Exercices d’intonation
3.3 Solutions
3.3.1 Exercices d’écriture phonétique
3.3.2 Exercices d’intonation
3.3.3 Exercices sur les liaisons
Documents utiles
4.1 Boîte à outils
4.1.1 L’intonation
4.1.2 Le trapèze vocalique
4.1.3 Le trapèze des semi-consonnes
4.1.4 Le tableau des consonnes
4.2 Tableau de l’API appliqué au français
4.3 Tableau sur les liaisons
Conclusion
1 Expliquer les bases de la phonétique du FLE
Avant de décrire le système phonique du français, il va falloir revoir quels sont les organes qui servent à former ces sons, et que l'on appelle organes phonateurs, ainsi que ceux qui participent à l'audition et à la compréhension.
Il est utile, lorsque l’on procède à la correction des fautes, de savoir quel organe participe à l’articulation pour poser le diagnostic et trouver une méthode pour la correction.
Ensuite, il nous faudra voir quelles méthodes on emploie pour produire l’intonation adéquate, et pour former les phonèmes (consonnes, voyelles et semi-consonnes). Nous donnerons ensuite une description de ces sons, et nous montrerons quelles difficultés ils posent à des élèves non francophones.
1.1Les organes participant à la parole
Nous nous occuperons d'abord des organes articulateurs, responsables de la production de la parole, et puis, plus succinctement, des organes auditifs, responsables de la perception, la première partie de la compréhension.
1.1.1 Les organes phonateurs
Les organes participant à la phonation, outre le cerveau et le système nerveux, sont:
Vous avez peut-être quelques petits problèmes avec l'anatomie en langue française. Nous allons représenter tout cela sur un schéma. Cependant, comme les poumons, les bronches et la trachéeartère sont de simples fournisseurs d'air, et qu'ils fonctionnent de la même façon pour chacun des sons, nous nous limiterons aux organes supra-glottaux, c'est-à-dire ceux qui sont situés au-dessus des cordes vocales.
Imaginez que, d'un coup d'épée, nous coupions une personne de haut en bas: nous obtiendrions ce que l'on appelle une coupe sagittale du genre de celle-ci:
Pour faire plus savants, nous aurons besoin d'employer les adjectifs correspondant à ces organes. Voici un tableau qui vous permettra de retrouver l'adjectif correspondant aux organes ou aux parties anatomiques cités:
Organes ou parties anatomiques
adjectif correspondant (au féminin)
cordes vocales
sonore (contraire: sourde)
fosses nasales et nez
nasale
langue pointe dos
apicale (apico-) dorsale (dorso-)
lèvres
dents
alvéoles
palais dur
voile du palais
luette
pharynx
larynx
labiale
dentale
alvéolaire
palatale
vélaire
uvulaire
pharyngale
laryngale
Le voile du palais est très important. Outre le fait qu'il vibre chez certains dormeurs, provoquant alors un ronflement intempestif, il est capable de se soulever, fermant alors le passage vers le nez, ou de s'abaisser, ce qui permet alors à une partie de l'air de passer par le nez. Dans ce dernier cas, et si les cordes vocales vibrent, les fosses nasales vont également entrer en vibration, et le son sera nasal. Nous reparlerons des organes ci-dessus lorsque nous décrirons les divers phonèmes.
1.1.2 Les organes responsables de l'audition
Outre le cerveau et le système nerveux (ici, nerf auditif), l'organe responsable de l'audition est bien évidemment l'oreille (au nombre de deux, comme vous vous en doutez).L'oreille se compose de:
l’oreille externe
Située à l’extérieur
l’oreille moyenne l’oreille interne
Contenues dans un os, le rocher.
L'oreille externe
se compose du pavillon, du conduit auditif externe, et du tympan.
L'oreille moyenne
se compose de la caisse du tympan, dans laquelle se trouve la chaîne des osselets, la trompe d'Eustache, qui communique avec le rhinopharynx, et la paroi interne, qui communique avec l'oreille interne par la fenêtre ovale (où se rattache l'étrier) et la fenêtre ronde.
L'oreille interne,
qui se compose, entre autres, du labyrinthe membraneux (membrane basilaire, membrane de Reisner, canal cochléaire) et des canaux semi-circulaires, ces derniers étant responsables de l'équilibre.
Pour rester simple, disons que le son pénètre dans l'oreille par l'oreille externe. Il fait vibrer le tympan. Celui-ci ne peut vibrer que si la pression est la même à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'équilibre est rétabli par l'ouverture de la trompe d'Eustache, qui a lieu lorsque l'individu déglutit (lorsqu'il avale sa salive).
La vibration du tympan est transmise par la chaîne des osselets à l'oreille interne, par l'intermédiaire de la fenêtre ovale.
Les osselets transmettent le mieux les fréquences autour de 2000 Hz. C'est ce qui explique pourquoi c'est de 1000 à 3000 Hz que l'oreille est le plus sensible , alors qu'elle est capable de percevoir les sons de 16 à 16000 Hz, cette limite supérieure s'abaissant avec l'âge.
Le phénomène de l'audition est très complexe, et encore incomplètement connu. Notons que le décodage des vibrations en influx nerveux a lieu dans l'oreille interne. Celle-ci est sensible aux variations d'intensité (son plus ou moins fort), de fréquence (son plus ou moins aigu) et de durée (son plus ou moins long).
L'oreille ne perçoit pas de la même façon les sons venus de l'extérieur, qui lui parviennent par l'oreille externe, portés par l'air ambiant, et ceux qui sont produits à l'intérieur, qui sont transmis par le rocher.
Ainsi, le locuteur entend sa voix par l'intérieur, alors qu'il entend celle des autres par l'extérieur. C'est ce qui explique que l'on soit si étonné lorsqu'on entend pour la première fois sa propre voix, enregistrée, et qui parvient donc pour la première fois à l'oreille par la voie aérienne.
L'oreille ne sert pas qu'à écouter les autres. Lorsque le locuteur parle, ses oreilles contrôlent en permanence sa production, permettant d'ajuster la voix lorsque l'articulation sort des normes.
Cette correction a du mal à s'établir lorsque la personne chante, alors qu'elle écoute une chanson avec son baladeur. L'oreille entend à la fois la voix de son propriétaire par la voie interne, et celle de la vedette (plus la musique) par la voie externe, ce qui la désoriente et explique pourquoi son propriétaire chante particulièrement faux.
Maintenant que nous avons fait connaissance avec les organes, nous allons voir comment ils fonctionnent.
1.2 Le système phonique du français
On peut diviser le système phonique en deux domaines différents :
La mélodie, qui est créée par la variation de la vibration des cordes vocales en fréquence (aigu / grave), en intensité (accent tonique) et en vitesse (durée). Ainsi, on aura :
Dans le premier cas, la voix devient plus aiguë à la fin, ce qui fait de la phrase une interrogative. Dans le deuxième, la voix devient plus grave à la fin, ce qui fait de la phrase une affirmative.
On oublie souvent de parler de l’intonation, alors qu’elle est très importante. Elle permet l’organisation de la phrase orale, de repérer les informations connues ou nouvelles, de reconnaître les éléments qui constituent la phrase, ce qui permet une bonne compréhension de l’information donnée, et une production orale plus ordonnée, donc, plus claire.
Comme elle explique plusieurs phénomènes oraux, c’est par elle que nous commencerons. Une fois les règles de l’intonation expliquées, nous passerons à la formation et la compréhension des phonèmes (voyelles, consonnes et semi-consonnes).
1.2.1 L'intonation du français
1.2.1.1 Définitions
L'intonation est la manifestation du fondamental F0, c’est-à-dire à la vibration des cordes vocales. Le fondamental subit des variations:
en
intensité
(il est produit avec plus ou moins de force). L'intensité est responsable, du point de vue linguistique,
de l'accent tonique.
en
fréquence
(les cordes vocales vibrent plus ou moins vite). Ce phénomène détermine
la mélodie.
en
durée.
(Les syllabes sont plus ou moins longues.) Ce phénomène détermine
le rythme.
Nous allons faire un tour d'horizon rapide de l'intonation, en distinguant:
L'intonation non marquée,
dénuée de sentiments et d'intention, et qui se limite à l'affirmative et à l'interrogative.
L'intonation marquée,
où le locuteur essaie, au-delà des mots, de faire passer une
intention.
Nous nous limiterons à la mise en doute, à l'évidence et à la surprise.
1.2.1.2 L'intonation non marquée
Nous allons tout d'abord fixer les grands principes de l'intonation non marquée. Nous envisagerons ensuite trois aspects différents:
quels sont les modèles de l'intonation non marquée (on dit aussi: quels sont les patrons intonatifs de l'intonation non marquée).
quelles sont les différences entre information principale et information secondaire?
que faire lorsque la phrase est trop longue pour mes capacités respiratoires?
Voyons d’abord les caractéristiques essentielles de l'intonation:
La phrase se divise en
deux mots phoniques,
l'un contenant le
substantif sujet,
l'autre, le
verbe principal.
À l'intérieur d'un mot phonique:
toutes les syllabes non accentuées (atones) ont la même longueur, la même hauteur (niveau 2) et la même intensité. Comme toutes ces syllabes non accentuées sont identiques en hauteur, intensité et durée, on parle d'égalité syllabique.
la dernière syllabe du mot phonique est tonique (accentuée).
Si le mot phonique n'est pas en fin de phrase, elle est au niveau 3. Elle est plus longue que les syllabes atones, et elle est prononcée avec plus d'énergie.
Si le mot phonique est en fin de phrase, la dernière syllabe sera aussi plus longue et, bien sûr, sera prononcée avec plus d'énergie que les syllabes atones, et sera prononcée: au niveau 4 (question avec mot interrogatif à la fin, ou sans mot interrogatif), au niveau 1 dans les autres cas.
1.2.1.2.1Les patrons intonatifs de base:
L' affirmative.
La phrase se divise en deux mots phoniques, l'un contenant le sujet, et l'autre, le verbe.
Le mot phonique sujet se termine au niveau 3 (fin de mot, mais la phrase continue), alors que le mot phonique du verbe se termine au niveau 1 (fin de phrase).
L'interrogative:
L'interrogative sans mot interrogatif se compose aussi de deux mots phoniques, l'un contenant le sujet, et l'autre, le verbe.
Celui qui contient le sujet atteint le niveau 3, alors que celui qui contient le verbe atteint le niveau 4. Le niveau 4 est le niveau propre à l’interrogative .
Interrogative avec mot interrogatif à la fin.
Lorsqu'il y a un mot interrogatif, on le place très souvent, à l'oral, à la fin de la phrase.
Ainsi, il profite de la montée au niveau 4. Cette montée a lieu sur la dernière syllabe du dernier mot phonique, et donc, sur la dernière syllabe du mot interrogatif.
Mot interrogatif au début de la phrase.
Lorsque le mot interrogatif est placé au début de la phrase, il forme lui-même un mot phonique, dans lequel la mélodie, partant de la première syllabe au niveau 2, atteint la dernière au niveau 4. La phrase elle-même se termine au niveau 1, comme l'affirmative.
Nous venons de voir les cas de base, c'est-à-dire les cas où toutes les informations données sont de même importance. Il y a pourtant des cas où l'on est amené à reprendre des informations déjà connues, pour mieux en fournir de nouvelles.
Informations principales / informations secondaires.