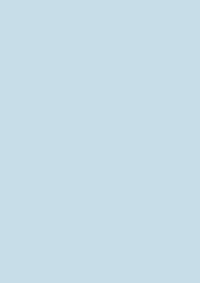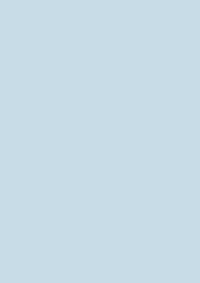Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les gens connus laissent une trace dans l'histoire. Ce n'est pas le cas des inconnus. Pourtant, la vie de Maman méritait d'être racontée. Fille d'immigrés italiens, que l'on traitait de macaronis à l'époque de sa jeunesse, elle a traversé deux guerres. Celle de 39/ 45 avant son mariage, celle d'Algérie après. Elle a traversé 78 % du siècle dernier, et 15 ans de celui-ci. Pour des lecteurs âgés, cela leur rappellera des souvenirs. Pour les plus jeunes, cela leur donnera une idée de la façon dont vivaient leurs grands-parents.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Il était 18 h 00 en ce 29 janvier 2015. Comme tous les soirs depuis trois semaines, je lui avais donné la becquée : et une cuillerée pour Papa, une cuillerée pour Gérard, une cuillerée pour Georges, une pour Marie-Françoise, une pour Nelly. Et si elle était dans de bonnes dispositions, encore une pour Yves, et une pour moi. Ce qu’il y a de bien, dans les familles nombreuses, c’est que cela fait beaucoup de cuillères, et depuis trois semaines, il m’en avait fallu une collection.
Mais ce soir-là, je n’ai pas pu dérouler ma litanie : dès la première cuillère, ce fut fini. Terminé. Plus rien ne voulait rentrer. La mangeuse ne voulait plus manger. Elle n’aspirait plus qu’à dormir, qu’au repos éternel. « Je suis tellement fatiguée. »
Et quand je l’eus embrassée, quand j’eus ouvert la porte de la chambre, éteint la lumière, et que je lui eus dit : « Dors bien, Maman. À demain. », Je sentis bien que je ne la reverrai plus vivante, et une vague de froid m’envahit.
TABLE DES MATIERES
Nice
La famille
Naissance des jumelles
Au boulot
La parfumerie de Mme Dellerba
Les temps sont durs
Retour à la maison
Paris
Petit séjour parisien
Nice
Roger entre à la banque
Le 47 avenue Cyrille Besset
La famille Pisoni
La famille Meunier
Rastatt
Papa retourne à l’armée
Nice
Retour au bercail
Alger
Saint Eugène
La villa Gabrielle
La vie courante
Il n’y a pas que l’école…
Un peu de religion
Philippe
Les « événements »
Aix-en-Provence
Le retour en France
Le Dauphin
Beisson, tout le monde descend
Vacances épiques à Nice
Jamais deux sans trois
Vacances plus tranquilles
Les oiseaux migrateurs
Éclosion des œufs
Premiers craquements
Coups durs
Une page se tourne
Le temps des maisons de retraite
Marseille
Le moment du bilan
L’installation définitive
Libérer l’appartement
La journée type à la maison de retraite
Le personnel
Le trou de la sécu
Les résidentes et leur famille
Chute et col du fémur
Le stimulateur cardiaque
Les derniers jours
L’empreinte de Maman
NICE
La famille
Maman est née dans une famille sarde. Ses parents avaient quitté la Sardaigne, sans doute pour trouver du travail en France, plus précisément à Nice.
Je n’ai pas connu mon grand-père maternel, Laurent Pisoni, qui est mort alors que je n’avais que 3 ans.
Il ne m’a laissé aucun souvenir. Seule une photo témoigne de son existence : une petite vignette format photo de carte d’identité, où il semble fort âgé, et qui ne montre que son profil droit. Tout ce que l’on m’en a dit, c’est que c’était un intellectuel puisqu’il savait lire et écrire. Né à Cagliari, orphelin très tôt, il avait été élevé sous la responsabilité de curés, ou de moines, à l’origine de son savoir. Ses compatriotes moins intellectuels venaient le voir pour qu’il leur écrive des lettres en italien. Ainsi, pour arrondir ses fins de mois difficiles, il taquinait la muse dans la langue de Dante, écrivant une demande à l’administra-tion, rassurant une famille restée au pays, ou composant un hymne à l’amour pour une Giulia qui se languissait sur le sol italien de son Luigi, parti gagner son pain à Nice.
Malheureusement, un intellectuel qui ne parle pas la langue de son pays d’accueil ne peut guère trouver de travail dans ses cordes. Il ne lui reste plus que le travail physique, celui de docker sur le port de Nice dans son cas. Mais comme ce port était de dimensions modestes, on se dit qu’il ne devait pas y avoir souvent du travail pour lui, d’autant moins qu’en tant qu’Italien, traité de « Macaroni » par les Français de souche de l’époque, il devait passer après bien d’autres dans la hiérarchie, puisque, refrain bien connu, il venait manger le pain des Français, des Niçois qui avaient eu, jusqu’en 1860, la même nationalité que lui. D’ailleurs, ne parvenant pas à se sentir Français, il a gardé ses papiers italiens jusqu’à sa mort. Même pendant la guerre, lorsque Mussolini vint occuper Nice, il resta italien, mais avec méfiance.
J’ai cru comprendre à quelques rares allusions faites dans le feu de certaines conversations, qu’il lui arrivait de boire pour oublier, les soirs où il avait touché sa paie. Et comme il aimait les animaux, il se laissait parfois, après un nombre suffisant de verres, attendrir par un chien qu’il amenait à la maison, où il devait subir les foudres de sa femme, qui avait 8 gosses sur les bras, car le grand-père n’était pas fainéant au lit. Elle se demandait comment elle allait nourrir ces huit bouches. La vue d’un berger allemand, doté de bonnes dents et d’un grand appétit, la mettait en rage et arrivait à lui faire oublier un sens de l’humour qu’elle avait, par ailleurs, plutôt développé. Le grand-père devait alors négocier, et il lui arrivait d’être convaincant.
Un jour, il rapporta deux souris dans une cage. C’en était trop pour Mémé. Tandis que son mari lisait le journal aux toilettes, seul lieu fermant à clé, elle prit son battoir à linge, sortit les souris l’une après l’autre de la cage, et les estourbit à mort d’un bon coup de battoir sur le museau, avant de les jeter dans la poubelle de la cuisine.
En effet, Mémé était très vive, et heureusement pour les siens. Elle, je l’ai bien connue : une petite femme d’à peine un mètre cinquante, chignon compris, pleine d’humour, pleine d’amour pour ses enfants et ses petits-enfants. Au travail dès cinq heures du matin pour faire le ménage et la cuisine pour sa famille, elle partait ensuite nettoyer chez les autres pour gagner la pitance de sa nichée. C’était une femme courageuse, solide, qui n’hésitait pas à donner de sa personne pour aider ses enfants, même lorsque ceux-ci furent en âge de se débrouiller seuls.
Elle avait donc quitté Sassari et sa famille avec son frère, ouvrier du bâtiment, à l’âge de 16 ans. Une jeune fille ne pouvait décemment pas vivre seule. Il lui fallait un père, un mari ou un frère. C’est à Nice qu’elle fit la connaissance de son futur époux. Celui-ci avait dû la demander en mariage au frère, représentant moral du père. La chronique familiale est muette sur la façon dont ils s’étaient connus, s’étaient plu et rapprochés. Vraisemblablement dans une réunion d’Italiens de Nice. Ma mère m’a raconté un jour qu’elle avait connu son oncle, mais n’a jamais pu m’en dire plus, si ce n’est qu’il était gentil. Mais chez Maman, tout le monde était gentil. Il est mort Dieu seul sait quand, et il est enterré Dieu seul sait où.
Selon les versions Mémé était le dix-septième ou le onzième enfant de sa famille. Son père était carabinier, et, comme on voit, un excellent tireur. Dès que ses enfants eurent l’âge de seize ans, il les envoya au travail. Mais celui-ci était une denrée rare. Certains durent donc s’expatrier, qui en France, qui en Amérique. Les enfants, une fois partis, disparaissaient de la vie de leurs parents. Jamais Mémé ne leur écrivit, sans doute parce qu’elle ne savait pas le faire. À l’époque, la plupart des gens ne possédaient pas le téléphone.
On se disait en plaisantant dans la famille qu’un des Cossu avait dû aller aux USA, où, forcément, il avait fait fortune, et qu’il allait revenir pour dépenser ses millions avec ceux de sa famille qui étaient maintenant à Nice. L’idée était intéressante, mais nous l’attendons encore. À vue de nez, il devrait avoir atteint les 120 ans. Il serait donc grand temps qu’il revienne.
Mémé en eut un jour assez de son mari qui n’apportait pas grand-chose dans l’escarcelle de la famille, à part de temps à autre un chien errant ou une bonne cuite. Un beau matin, elle prit ses enfants au nombre de 2 ou de 4, selon les versions, et partit pour Marseille. Elle trouva du travail dans une savonnerie portant le nom d’Abeille. Les enfants furent donc nourris grâce au savon de la cité phocéenne. Mais Laurent, à qui sa femme et ses enfants manquaient, finit par retrouver sa femme, et fit le voyage de Marseille. Deux enfants y naquirent, avant que la famille ne reprenne le chemin de Nice, où, bouquet final du feu d’artifice, les deux dernières virent le jour : des jumelles. Même fausses, elles venaient clore la fabrication.
Cela faisait 6 filles et deux garçons. Deux des filles, numéros 3 et 4 de la fratrie, quittèrent ce monde sans doute pour cause de maladie. La chronique familiale ne nous dit rien sur elles. Tout ce que l’on sait, c’est qu’elles se nommaient Marie et, excusez du peu, Reine.
L’appartement familial se trouvait au deuxième étage du 28 de la rue Sainte-Claire, dans le Vieux Nice, lequel à l’époque, était loin d’être aussi pimpant qu’aujourd’hui. Il se composait d’une cuisine de taille moyenne, dans laquelle trônait une cuisinière à charbon, d’une chambre à coucher enrichie d’une alcôve séparée par un rideau, et, comble du luxe, d’un WC intérieur.
Des voisins moins chanceux avaient leurs toilettes sur le balcon. Ainsi, tout le voisinage connaissait leurs habitudes intestinales. Certains témoins, par jeu, les saluaient à haute voix à l’entrée, et à la sortie. Mais ce n’était rien à côté des toilettes d’une vieille dame qui habitait au 26, dont l’entrée donnait sur l’escalier, sans palier. Cet escalier était étroit, raide, rectiligne. Les marches qui le constituaient étaient de hauteurs inégales, et plus ou moins horizontales. Lorsque sa vessie ou son intestin se manifestaient avec trop d’insistance, la pauvre femme descendait l’escalier jusqu’à la hauteur de la porte qui se trouvait dans le mur, à gauche, au-dessus d’une marche, et à droite, trois marches plus bas. La dame avait un petit escabeau avec deux pieds de longueurs différentes, qui, une fois posé le long du mur, était, ô miracle de la menuiserie, à la bonne hauteur. La pauvre femme ouvrait la porte, se tournait le postérieur vers la cuvette, baissait sa culotte et entrait à reculons et en montant. Une fois à l’intérieur, elle tirait la porte vers elle tout en se laissant tomber sur le trône. Elle était en sécurité le temps de faire sa petite ou sa grosse commission, risquait le lumbago dans ce boyau étroit en se torchant les fesses, et repartait alors vers l’avant, accrochée à la chasse d’eau qu’elle tirait par la même occasion, pour reprendre pied sur l’escabeau en faisant bien attention de ne pas le faire glisser sur le côté, ce qui aurait provoqué inexorablement sa chute en roulé-boulé dans l’escalier, façon parachutiste à l’atterrissage. Mais elle se déplaçait désormais en marche avant et voyait donc ce qu’elle faisait. Ayant conscience d’avoir une fois encore bravé la mort, elle récupérait son escabeau et remontait chez elle, les organes et la tête détendus. Cet épisode aurait pu faire un bon numéro de cirque, dans la rubrique des clowns acrobates, et lui aurait valu un roulement de tambour au moment le plus périlleux, et les applaudissements frénétiques d’un public de connaisseurs après la délivrance. Modeste, elle réalisait ce numéro dans la plus grande des discrétions, plusieurs fois par jour.
Lorsque l’on sortait de la maison, on se retrouvait dans la rue Sainte-Claire qui, à l’époque, était composée de longue, marches assez plates. C’était donc tout autant un escalier qu’une rue.
Le long des murs lépreux, sur le côté droit de la rue en montant, se trouvaient d’étranges constructions métalliques, des poubelles rectangulaires en tôle qui se pliaient, et qui étaient maintenues fermées par des sortes d’espagno-lettes, jusqu’à ce que le premier utilisateur, désireux de vider sa poubelle, vienne déplier la construction, éloignant la plaque de tôle du mur. Il jetait alors ses ordures dans cette pseudo-poubelle murale. Les liquides contenus dans sa poubelle coulaient, en bas de la construction, sur les marches et, s’il ne s’éloignait pas assez vite, lui trempaient les chaussures.
Les rats appréciaient particulièrement ce mobilier urbain pliable. Ils passaient sous la tôle, dont les côtés, fixés sur le mur, étaient, en bas, attaqués par la rouille, contraints de braver le tétanos, pour faire ripaille. Ils étaient si gros, et si farouches, que les chats du quartier, eux aussi nombreux et affamés, les évitaient soigneusement, ne tenant pas à livrer une bataille à l’issue incertaine avec ces rongeurs réputés particulièrement intelligents. Les chats n’attaquaient le contenu de la poubelle qu’une fois les rats servis et repus. Quelquefois, un chat plus fort et plus courageux que les autres arrivait à se saisir d’un de ces rongeurs par le cou et en faisait son repas. D’autres fois, c’était l’inverse. Un commando de rats faisait sa fête à un matou moins leste et moins fort que les autres. Manger ou être mangé, telle était la devise.
Les humains n’étaient pas moins intéressants. Il régnait entre les habitants un grand respect. On s’appelait « madame » ou « monsieur », et on se vouvoyait. Dans la partie haute de la rue, à main droite, se dressait un couvent de sœurs cloîtrées. Mémé leur apportait souvent de la soupe pour les pauvres, car la sœur tourière recevait les dons en nature qu’elle devait redistribuer par ailleurs. Quand on pénétrait avec Mémé dans ce couvent, on ne dépassait pas la salle d’entrée, d’où l’on ne voyait rien. En revanche, il arrivait que l’on entende des chants, des voix de femmes enterrées vivantes, dont la seule occupation était d’adorer le Créateur, et de profiter du contact avec le Tout-Puissant pour glisser un mot sur nous, pauvres pécheurs, qui menions notre vie de débauche sous la protection bienveillante et indirecte de ces saintes filles.
Même si nous n’en avions jamais discuté avec elle, j’ai toujours eu le sentiment que Mémé ne croyait pas trop en l’existence du Très Haut, et qu’elle avait une piètre opinion de son personnel au sol. Elle avait dû une fois prendre la défense d’un gamin de huit ans, qu’un curé du quartier, pédophile non encore estampillé, poursuivait de ses assiduités. Cet enfant avait frappé à sa porte et s’était placé sous sa protection. Et c’est avec son fameux battoir à linge qu’elle avait repoussé l’assaillant, en l’admonestant, dans son français appris sur le tas, et qui n’était pas estampillé par l’Alliance française : « Vous n’avez pas honte, espèce d’un gros dégueulasse, de tripoter ce petit ? » Impressionné par le battoir, et se doutant que Mémé était déterminée à s’en servir pour le ramener au sens de ses responsabilités, le curé avait préféré battre en retraite.
Mémé avait la dent dure contre le clergé, ce qui montrait bien qu’elle n’était pas portée sur la religion, même si elle pratiquait l’aumône et la compassion, mais toujours dans la discrétion. Elle n’avait rien à voir avec les dames patronnesses de Brel, qui tricotaient des pull-overs vert caca d’oie pour reconnaître leurs pauvres, vêtus aux couleurs de leur bienfaitrice, tels les jockeys portant la casaque de leur employeur. Mémé était généreuse naturellement, sans ostentation.
Il y avait autour de ces gens modestes quelques figures typiques, comme Rondinelle. Cet homme de taille moyenne portait une casquette, et traînait la jambe. La rumeur publique disait qu’il s’agissait d’un accident du travail. En effet, Rondinelle était, selon les saisons, pickpocket ou cambrioleur. Et c’était justement au cours d’un de ses cambriolages que, dans la précipitation, il avait fait une chute d’un balcon situé à un premier étage, et qu’il s’était cassé la jambe. Ce fut une mauvaise chute, entraînant des complications, si bien qu’il ne pouvait plus marcher autrement qu’en tirant la jambe restée raide, ce qui lui donnait un petit air d’ancien combattant arborant une blessure de guerre. Les habitants du vieux Nice le connaissaient et n’ignoraient rien de ses activités illégales, si bien qu’il devait aller exercer ses talents dans d’autres quartiers, où il pouvait sévir incognito aux dépends des touristes.
Il faut croire que, comme on dit en allemand, la mauvaise herbe ne crève jamais, car j’ai eu l’occasion de le voir plusieurs fois, une bonne vingtaine d’années plus tard. Il ne pratiquait plus l’art vertigineux de la cambriole, et se contentait de vider le sac des dames à hauteur de main. Il attendait que les gens s’agglutinent lors de certains événements, tels que les fêtes des fleurs, ou le fameux carnaval de Nice. Tandis que la future victime regardait passer les chars couverts de fleurs, ou de figures carnavalesques, il profitait des sacs ouverts pour les vider par le haut de tout ce qui pouvait contenir de l’argent : bourses, porte-monnaie, portefeuilles, carnets de chèques. Lorsque le sac était fermé, il utilisait un sachet à ouverture rigide et une lame de rasoir, avec laquelle il pratiquait, comme un chirurgien, une incision dans le bas du sac, et le contenu se déversait dans le sachet qu’il tenait dessous. La dame, dont l’attention était détournée par le spectacle, ne remarquait rien, et Rondinelle s’éloignait avec son butin. Il en était quitte pour jeter tout le fatras inutile qui encombrait les sacs, et mettait en sécurité l’argent et les moyens de paiement au fond de l’une des nombreuses poches intérieures de sa veste. Il fallait faire très attention car, le Carnaval de Nice attire toutes sortes de voleurs à la tire, et de quoi aurait l’air un voleur patenté de son envergure s’il se faisait dérober ce qui était devenu son bien par un quelconque voleur de pacotille ? On peut être voleur, et avoir de l’amour-propre, et le goût du travail bien fait.
Naissance des jumelles
C’est donc dans ce milieu qu’est née Maman, prénommée Joséphine et surnommée Fifi, le 10 décembre 1922, accompagnée de sa jumelle Yvonne. Ainsi après Antoine (dit Nini), Yolande, Reine et Marie (les deux disparues), Jules, Marie (à vrai dire Béatrice, mais qui avait hérité du prénom d’une des deux défuntes), arrivait le bouquet final.
Les jumelles étaient de fausses jumelles. Elles avaient bien les mêmes parents, étaient bien nées le même jour, quasiment à la même heure, mais alors que l’une était petite, fluette, nerveuse, l’autre était grande, plus ronde, et d’un calme olympien.
Les sœurs aînées chargées de donner le biberon l’avaient bien remarqué : alors que Joséphine buvait le sien régulièrement et le vidait dans un temps digne de figurer dans le livre des records, sa sœur Yvonne tétait avec nonchalance, si bien que le lait se refroidissait, alors que son niveau avait à peine baissé. Comme les préposées à la tétée avaient mieux à faire que de perdre leur temps à faire boire un bébé récalcitrant, mais qu’elles ne pouvaient pas abandonner un biberon à moitié plein, elles avaient trouvé une solution : elles donnaient le reste à Joséphine, qui terminait cette portion supplémentaire sans rechigner.
C’est là que commença une rivalité qui devait durer toute la vie de Maman, et dont elle parlait encore quelques jours avant sa mort. « Ma sœur ne m’aimait pas. Elle était jalouse de moi parce que j’étais la plus grande, alors qu’elle, elle était meilleure que moi à l’école. Alors, elle me tirait les cheveux et me battait. Ma mère disait : tu es folle de te laisser faire ! Tu es plus grande et plus forte. » Cette plainte, nous l’avons entendue presque tous les jours pendant cinq ans, quand ce n’était pas plusieurs fois par jour. On voit les dégâts causés par la jalousie, sur le moment d’abord, et qui trouvent encore un écho quatre-vingts ans plus tard. Alors que les faits qui viennent de se passer sont oubliés dans les minutes qui suivent, les souvenirs enfouis au plus profond de la mémoire reviennent régulièrement gâter la vie des gens, dans ce cas, alors même qu’Yvonne avait cessé depuis des dizaines d’années de la harceler.
Il y a très peu de photos de Maman jeune. La famille était trop pauvre pour avoir un appareil photo, et pour se payer les pellicules et surtout le développement. Par conséquent, les photos étaient liées à des événements solennels. Il y avait d’abord un cliché où les jumelles posaient en tenue de communiantes, un cierge à la main. Quoi qu’ait pu penser ma mère, on leur aurait donné le bon Dieu sans confession, même à sa sœur Yvonne.
Les deux filles ont fréquenté l’école de la rue Séguranne, dans le vieux Nice. Maman y est allée jusqu’à la fin du CM2. Et alors que l’institutrice lui avait conseillé d’obliquer vers le certificat d’études, sa famille a préféré l’envoyer travailler. Cela permettait d’arrondir le revenu familial.
Au boulot
Avec sa sœur Marie, elles ont trouvé une place Boulevard de Magnan. Tous les matins, il fallait marcher pendant quarante-quatre minutes, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il fasse beau. Et on remettait ça le soir. On devait être en trente-six.
L’usine était flexible, puisqu’elle a commencé par mettre du DDT en sachet, avant de se mettre à la fabrication de masques à gaz, la guerre menaçant.
On connaît maintenant les dangers du DDT, le nom d’artiste du Dichlorodiphényltrichloroéthane, un insecticide puissant. Les jeunes filles travaillaient sans masque, sans gants, et inhalaient joyeusement cette poudre dont les effets nocifs sont entre autres le cancer du sein, du foie, et la désorganisation endocrinienne.
Marie, elle, avait les doigts pleins de pus. Ce même syndrome apparut chez Maman aussi, qui dut même subir une opération de la main droite, faite par un des meilleurs professeurs de chirurgie de la ville. Malheureusement, c’est après l’opération que tout se gâta. En effet, au lieu de lui mettre des attelles et un bandage un peu souple, l’infirmière lui mit un bandage bien serré, qui déforma les doigts de la main droite. On pouvait imaginer la forme du pansement en observant le majeur et l’annulaire, qui avaient pris la forme d’un S, alors que la dernière phalange de l’auriculaire formait un angle droit avec le reste du doigt, qui perdait par la même occasion la fonction que suggérait son nom puisqu’il n’était plus possible de se l’introduire dans le conduit auditif, vu la largeur de la phalange.
Toute sa vie, Maman eut honte de ses doigts, mais cela se remarqua particulièrement lors de son séjour en maison de retraite, car, ne pouvant plus se couper les ongles elle-même, elle refusait pourtant de recourir aux services de l’aide-soignante qui lui proposait gentiment de les lui couper. Alors, c’est à moi qu’elle demandait ce service, car elle n’avait pas honte quand je lui servais de manucure.
Et gare à celui qui demandait à haute voix : « Mais qu’est-ce qui vous est arrivé ? ». Il avait droit alors à l’histoire complète, avec en prime le nom du chirurgien, un nom que j’ai oublié mais qui rimait sûrement avec fiasco.
Le travail était pénible, mauvais pour la santé, et mal payé. Maman se plaignit auprès du comptable :
« Vous nous avez retenu de l’argent pour les prestations sociales. Vous auriez pu les payer pour nous.
— Ah toi, Joséphine, tu es un peu trop révolutionnaire. »
Elle fut très impressionnée par cette manifestation de culot, moment unique dans sa vie, car elle a raconté cette histoire jusqu’à la fin de sa vie, toujours dans les mêmes termes.
En revanche, cela n’avait pas dû traumatiser les patrons puisqu’un jour, l’un d’eux, M. Claude Dellerba (orthographe non garantie) vint voir Joséphine et lui annonça que sa femme allait ouvrir une parfumerie, en face du lycée Masséna, en bordure du vieux Nice, mais dans un quartier acceptable, au bord d’une large place. Sa chère et tendre avait besoin d’une vendeuse qui présentât (imparfait du subjonctif car nous sommes dans la bonne société…) bien et qui eût assez de jugeote pour faire tourner la boutique quand elle s’absenterait.
Le salaire proposé était légèrement meilleur, l’environnement incomparablement plus sympathique, l’air vraisemblablement moins vicié, encore qu’à l’époque, certaines crèmes de beauté aient pu rivaliser en toxicité avec des produits chimiques. L’odeur de parfum valait mieux que celle du DDT. Et puis il y avait le contact avec les clientes, plus intéressant que la vision constante du tapis roulant qui apportait les pièces et les emportait une fois montées, vers leur destin.
Quant aux horaires, ils étaient plus humains, la parfumerie ouvrant ses portes plus tard que ne débutait le travail en usine. Et le trajet de la maison au magasin était notablement plus court, ce qui ne gâchait rien.
Dans cette famille de gens laborieux, il était impensable de faire la grasse matinée alors que tout le monde se levait tôt pour aller au boulot, mais au moins, on n’avait pas besoin de se presser.
La parfumerie de Mme Dellerba
Fifi passa ainsi de l’industrie au commerce. Quittant le dieu Vulcain, elle passait sous la protection de Mercure, dieu des commerçants et des voleurs. Certaines mauvaises langues prétendent qu’il y a peu de différences entre les deux professions, même si les méthodes diffèrent un peu.
Elle prit sa place derrière le comptoir, ne la quittant que pour conseiller les clientes dans leur choix. Mme Dellerba, en négociante avisée, avait choisi Fifi aussi pour sa peau jeune et tendue, qui ignorait tout maquillage. La jeune fille avait d’ailleurs bien compris la technique de vente. Lorsqu’une cliente ayant subi les outrages du temps la complimentait sur son teint et lui demandait quelle crème elle utilisait, l’avi-sée jeune fille amenait sa cliente au rayon où se trouvait le pot le plus cher, et la dame, qui voulait retrouver sa peau de 16 ans, achetait le produit sans sourciller. La vendeuse, elle ne croyait pas en la vertu de ces crèmes et n’en utilisait aucune.